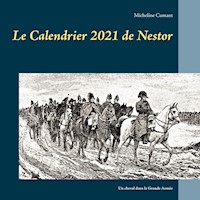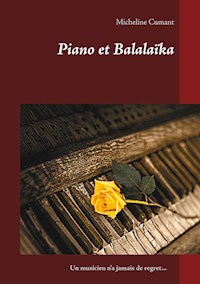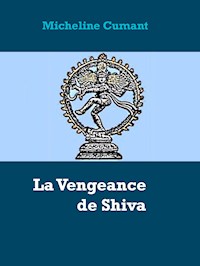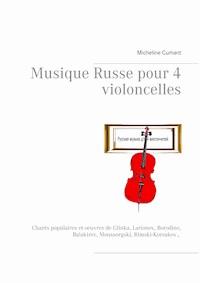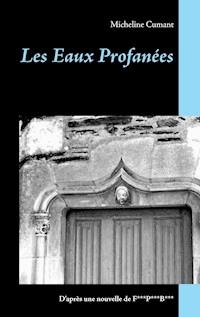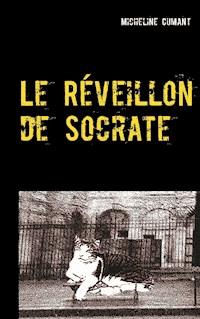
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Französisch
L'histoire est inspirée d'un fait divers réel : après la seconde guerre mondiale, on découvrit notamment dans la collection du maréchal Von Goering des faux tableaux de Vermeer, oeuvres d'un faussaire nommé Van Meegeren. Dans un petit immeuble parisien vivent des professeurs, un écrivain, un homme d'affaires, un étudiant, une retraitée, un officier de police, des commerçants et la gardienne qui connait tout le monde et voit tout. Mais, un beau jour, un crime est commis dans la maison. Et il y a Socrate, le chat de la narratrice, qui a tout entendu ... C'est évident, les chats savent toujours tout !
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 244
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
L'histoire est imaginaire, mais basée sur un événement réel : l'affaire des faux tableaux de Vermeer peints en réalité par le faussaire Han Van Meegeren, qui éclata en 1945 en Allemagne et aux Pays-Bas.
Rue Servandoni, Paris, 6éme arrondissement :
La maison du crime :
4
ème
étage :
Étudiant en droit.
Dame âgée propriétaire de plusieurs appartements.
3
ème
étage :
Ferdinand Boulard, auteur de romans policiers, et ses poissons rouges.
Moi, professeur de français, le chat Socrate, mon ami André.
2
ème
étage :
Officier de police Le Guennec, et son amie Clara.
Couple d'enseignants, leurs deux enfants, un chien, une tortue.
1
er
étage :
Pied-à-terre d'un homme d'affaires américain.
Couple de patrons de café-tabac.
Rez-de-Chaussée :
Gardienne, ses deux enfants, son chat et son canari.
Dépôt de magasin.
TABLE DES MATIÈRES
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV
XXVI
XXVII
XXVIII
XXIX
XXX
XXXI
XXXII
XXXIII
XXXIV
XXXV
XXXVI
XXXVII
XXXVIII
XXXIX
XL
XLI
XLII
I.
Il y a maintenant trois jours que je vis dans cet appartement. Les valises et les cartons ont disparu à la cave. Les livres s'entassent dans un coin, et je commence à dresser la liste des meubles qui me manquent. Dans la vieille commode que j'ai pu sauver de mes naufrages passés, mes papiers et "mon trésor": ma future thèse en la matière du vieil ouvrage avec lequel j'espère recommencer ma vie.
Car je viens de vivre quelques années pénibles, et je peux redémarrer. Mais peut-être est-ce seulement maintenant que mon histoire commence ?
Quelques années auparavant, j'avais rompu avec mes parents - de banales histoires de petites gens qui veulent voir leur fille devenue enseignante, mais restée célibataire veiller sur leurs vieux jours - et terminé ma licence et ma maîtrise de lettres en travaillant comme maître auxiliaire dans un C.E.S. En fac, lors d'une manifestation lors du vingtième anniversaire de Mai 68, j'avais rencontré Jean-Michel et nous étions partis dans sa province natale où nous avions enseigné dans le même établissement.
Les roucoulements des débuts évoluent. J'aimais le grec, le latin, je traduisais Saint Ambroise et lisais des ouvrages traitant de l'alchimie, Jean-Michel faisait du jogging, ne lisait dans les journaux que ce qui avait trait à la politique, et assistait assidûment aux réunions syndicales. Et sa famille lui ressemblait. La dernière année avait été plus que pénible: la directrice avait supprimé les classes de grec et de latin "pour cause d'effectifs insuffisants", et les avait remplacées en me collant des heures de musique, de dessin - j'avais eu le malheur de lui dire que c'étaient mes distractions favorites - et de travaux manuels, et mon bel amoureux se moquait de moi et de mes goûts passéistes devant les collègues. J'avais essayé de préparer l'agrégation par correspondance, mais Jean-Michel s'esclaffait constamment devant les sujets proposés et ne manquait pas de lâcher un commentaire méprisant à chaque fois que j'entreprenais une version latine ou grecque, me demandant "à quoi cela allait bien servir", car pour lui la littérature commençait à Victor Hugo, pour sauter très vite au vingtième siècle, avec seulement une exception pour Molière "parce qu'il se moquait des nantis". J'avais beau tenter de lui expliquer que nos ancêtres n'avaient pas l'esprit autrement tourné que nous, et que l'histoire ne faisait jamais que se répéter, il ne savait que me répondre par des arguments du genre "brûlons les livres et sortons dans la rue", oubliant que la notion de république avait été inventée bien avant la Révolution Française et encore plus avant mai 68.
Un jour, déprimée, j'étais entrée dans une église où j'avais prié des heures. Je n'étais pas extrêmement pratiquante, mais je ne pouvais vivre sans avoir de ces moments de recueillement qui me permettaient de recharger mes batteries: certains font du yoga ou de la méditation transcendantale, moi je restais dans les traditions de notre vieille Europe et je visitais les cathédrales ou j'allais me ressourcer dans un lieu de culte, de quelque confession qu'il soit. Jean-Michel m'avait vue et j'avais eu droit à une scène, avec un sermon digne du "petit père Combe"1 à la clef. Selon lui, je trahissais l'école de Jules Ferry. Encore heureux que j'aie pensé à cacher ma Bible - j'étais de confession protestante et l'avais reçue avant ma première communion, j'y tenais. Il s'était la veille moqué de moi lorsque, dans une foire aux puces, j'avais voulu acheter un ouvrage de Venance Fortunat2, car pour lui le Moyen-âge était une période obscurantiste, et il avait déclaré qu'il fallait réformer mon esprit. Je m'étais depuis longtemps rendu compte que ses connaissances littéraires n'allaient pas très loin et qu'il n'avait obtenu sa licence que grâce à mon aide, même pour des auteurs contemporains.
J'avais alors pris une chambre seule, chez des propriétaires irascibles pour qui "les profs" étaient des privilégiés, toujours en vacances, et, à la fin de l'année, demandé un poste en région parisienne.
En repartant pour ma ville natale, je savais ce qui m'attendait: je toucherai ma paye encore jusqu'en septembre, j'aurai sûrement un nouveau poste - on embauchait beaucoup d'auxiliaires, ils coûtaient moins cher - mais, comme pour tous ceux de ma catégorie, les lenteurs administratives feraient que je ne serai payée de nouveau qu'au bout de plusieurs mois. Tant pis, tout valait mieux que cet exil, cette ville que les gens n'adorent que quand ils ne font qu'y passer leurs vacances, et où plus rien ne me retenait.
1 Émile Combes (1835-1921), ancien séminariste, sénateur radical-socialiste puis président du Conseil en 1902, connu pour son action anticléricale pour l'école laïque et l'un des principaux acteurs de la séparation de l'Église et de l'État en 1905.
2 Saint Venance Fortunat (vers 530 – 609), d'origine italienne, évêque de Poitiers, poète chrétien, auteurs d'hymnes d'église restés dans la liturgie et de poèmes lyriques, ainsi que de biographies de saints.
II.
Le train avait eu du retard et j'avais raté la correspondance. Trois heures d'attente, dans une ville que j'avais décidé de visiter, et qui s'avérait sans charme. Cherchant de la lecture, au cas où les retards de trains se prolongeraient, j'étais entrée dans une vieille librairie, dont l'étalage offrait quelques policiers d'occasion : on ne lit pas que Thucydide, surtout dans les salles d'attente. N'étant pas pressée, je passais les rayons en revue.
— Je peux vous aider ?"
La voix était celle de la libraire qui devait avoir l'âge de sa boutique, et égrenait un chapelet en me regardant d'un œil endormi déambuler entre best-sellers d'il y a vingt ans, livres de cuisine et guides touristiques périmés.
On a quelquefois des inspirations. J'avais repéré quelques exemplaires des écrits de Rabelais, et, un "San Antonio" à la main, lui avais demandé si elle avait de la littérature du Moyen-âge ou de la Renaissance. La vieille femme avait alors paru rajeunir, et, tout en tripotant quelques ouvrages sans grand intérêt, s'était lancée dans une conversation à une seule voix où la décadence des mœurs actuelles et les malheurs du monde se mêlaient à ses histoires de famille. J'étais trop fatiguée pour animer la conversation qui ne m'intéressait qu'à moitié, et me contentais de l'écouter poliment, regardant machinalement les ouvrages qu'elle me désignait.
Vous connaissez le latin ?" me demanda-t-elle à un moment.
M'entendant répondre que je l'enseignais, elle me tendit un livre qu'elle me dit venir de la bibliothèque du monastère où son frère avait fini ses jours. L'ouvrage datait de la fin du siècle dernier, et semblait être une sorte de recueil d'historiettes, dans un latin tardif. Une introduction de l'auteur, assortie de commentaires prévenant le lecteur du contenu plutôt grivois de l'ouvrage qu'il ne fallait pas laisser à la portée des jeunes filles de l'époque, expliquait que ce texte venait d'un manuscrit du treizième siècle, d'auteur anonyme, dont il donnait les références à la Bibliothèque Nationale.
Sans me le formuler vraiment, je n'avais alors qu'une envie: avoir quelque chose à faire, retrouver l'ambiance de recherches où je me sentais chez moi. Je me jetai sur le livre, ma déprime pesa d'un coup moins lourd, j'eus l'impression que les dernières années avaient passée plus vite, et ma mémoire les mit immédiatement entre parenthèses. Je redevenais moi-même, il y avait quelque chose à faire avec cet ouvrage, même si bien sûr son authenticité restait à prouver. Un article? Ou même une thèse? En tout cas, je devais le prendre pour compagnon. Je me fis préciser l'adresse du monastère, demandai sa carte à la libraire, et m'offris l'ouvrage pour une somme modique, avec la "Guerre des Gaules" 3, dont Jean-Michel avait jeté l'exemplaire que je possédais, deux policiers, et quelques images pieuses que la libraire tint à m'offrir. Elle n'avait sans doute pas réalisé une aussi grosse vente depuis des mois.
3« Commentaires sur la guerre des Gaules », de Jules César (100 avant Jésus-Christ-44 av. J.C), ouvrage ayant fait souffrir de nombreux élèves en cours de latin ...
III.
J'avais ensuite voyagé debout, et débarqué à la gare pour me souvenir que je n'avais pas de logement, que l'on était au début de juillet, et que les vagues amis qui m'étaient restés risquaient d'être en vacances. Une chambre d'hôtel plutôt miteuse, mais dans mes moyens, trouvée au bout de quelques heures de pérégrinations avait été bien venue. La soirée s'était passée à déchiffrer mon acquisition, dont j'avais conclu qu'elle mériterait une thèse si les indications de l'auteur s'avéraient justes. Il faudrait que je renouvelle au plus tôt ma carte de la Bibliothèque Nationale.
Le lendemain, après avoir par précaution fait photocopier l'ouvrage, je me rendis à la Sorbonne pour me renseigner sur les inscriptions. Aïe ! Je mettais la charrue avant les bœufs : je n'avais pas encore d'adresse officielle, et l'hôtel me paraissait douteux en ce qui concernait le courrier. Et quel directeur de recherche choisir ? Ceux que j'avais connus ne travaillaient pas dans ce domaine. Mais pour cela, j'avais tout l'été. Avant tout, il me fallait une chambre, et les deux-mois-de-loyer-plus-caution demandés généralement étaient pour moi du domaine de l'utopie. Je me jurai de ne plus jamais ouvrir de compte joint: Jean-Michel l'avait vidé lorsque j'étais partie - l'argent m'indifférait assez, du moment que j'avais de quoi vivre, et je l'avais laissé gérer notre budget commun. Lui, il avait un compte-épargne personnel, et, au lieu de me conseiller d'en faire autant, il se contentait de me traiter avec commisération d' "artiste" avec des "si je n'étais pas là, ma pauvre fille..." Il ne me restait que ma dernière paye, et bien sûr mon compte n'était pas domicilié à Paris.
Quelques coups de téléphone étaient tombés sur des absents ou des gens autant dans la mouise que moi, qui me reprochaient d'avoir quitté "une aussi jolie ville au bord de la mer" pour Paris où les loyers étaient exorbitants.
Autant pour me maintenir le moral que pour prendre le frais, les vieilles pierres ont toutes les vertus, j'étais restée à arpenter les couloirs de la Sorbonne, et étais tombée sur Anne en train de s'énerver après un appariteur à cause d'une signature manquant sur un dossier.
J'avais connu Anne au lycée, et nous avions passé tous nos jours de congé unies par une commune passion pour l'astrologie, Jean-Sébastien Bach et les chats. Nous avions commencé nos études de lettres ensemble, mais Anne s'était arrêtée après la licence pour entrer dans l'Administration, et mon départ en province me l'avait fait perdre de vue. J'appris qu'elle était à présent dotée d'un mari éditeur et de deux petites filles, que son travail de fonctionnaire lui laissait l'esprit libre pour tenir la rubrique astrologique d'une revue, et qu'elle désirait entreprendre une thèse sur Nostradamus ou Paracelse. Elle poussa de hauts cris lorsque je lui racontai mes mésaventures avec Jean-Michel qu'elle qualifia de tous les noms d'oiseaux que comportait son vocabulaire, et m'offrit de m'installer chez elle. Ses enfants étaient en vacances chez la grand-mère et elle-même et son mari partiraient en août, je pourrai m'occuper de leurs deux chats.
Nous achevâmes nos biographies respectives au cours du dîner, et mon histoire de la vieille libraire les amusa beaucoup.
— Tu vois qu'il arrive toujours quelque chose qui vous remet dans la bonne direction", me dit Anne, " partir en province, toi ! Dans une ville qui a un passé historique, des archives, des recherches à faire, je ne dis pas, mais un endroit où les gens quittent leur bureau pour aller au tennis ou à la plage parce qu'il n'y a rien d'autre comme distraction, ce n'est pas pour toi. Ta vie, elle est dans les vieux grimoires. Quoi, passéiste ? Cesse de te tourmenter là-dessus, tu dis toi-même que les écrivains du Moyen-âge étaient des humains comme nous autres. Être utile à l'humanité ? Laisse ton Jean-Michel lire Marx, si encore il était secouriste ou boulanger, il pourrait dire qu'il fait quelque chose dont le résultat est palpable. D'ailleurs, est-ce qu'il t'a aidée, toi ? Il t'a seulement complexée parce que tu n'allais pas faire ton jogging avec lui pour t'entretenir les muscles. Ah, par contre, il n'a pas dû traumatiser ses élèves, quand ils faisaient des fautes de syntaxe, il devait leur dire qu'ils avaient le droit d'inventer une nouvelle forme de prosodie, pour ne pas "les brimer". J'ai raison ou pas ?"
J'en convins. Elle reprit:
— Tu as demandé ton changement ? Bon courage pour les paperasses et les files d'attente, je vais tout de suite te faire une lettre attestant que tu loges chez moi pour que tu aies une adresse officielle. As-tu contacté aussi le rectorat du privé ?
— Du privé? Non, je ne connais pas, et je suis dans le public, est-ce conciliable ?
— Tu cherches du travail, non ? En quoi est-ce que ça les regarde que tu cherches dans tous les azimuts ? Tu vas être dans un C.E.S. de banlieue, tu connais. Un poste d'auxiliaire, tu peux tomber sur le meilleur comme le pire, et tu vas encore déprimer avec des trajets qui vont te prendre tout ton temps, rappelle-toi ton année de licence, tes trois heures quotidiennes de trajet, et quand ce proviseur t'avait demandé: "Ah, vous n'avez pas de voiture ?" alors que tu pouvais tout juste payer le loyer de ta chambre de bonne, vu que tu n'avais pas tes parents derrière comme ton chéri. Et puis, qui te dit que tu auras un temps complet ? Donc, demande aussi un poste dans le privé, tu as plus de chance d'y utiliser tes études classiques et d'avoir ne serait-ce qu'un poste à temps partiel, mais moins loin. Et, éventuellement, tu pourras choisir.
— Chez les bonnes sœurs ?
— Mais tu retardes, ma pauvre, ce n'est plus du tout ça ! Ou c'est ton Jean-Michel qui t'influence encore ! Mes filles y sont, et je te jure qu'elles sont suivies, mais pas conditionnées. Et si le public te perd dans ses dossiers, et qu'on ne te propose un poste que le 1er novembre ? Tu as absolument besoin d'avoir un travail à la rentrée, rien ne t'empêche d'exercer à mi-temps dans deux établissements, dont l'un est public et l'autre privé. Deux précautions valent mieux qu'une. Je te cherche l'adresse du rectorat."
François, quant à lui, examina l'objet de ma future thèse, et me donna l'adresse des éditeurs chez qui je pouvais espérer trouver un indice.
— Mais choisis bien ton directeur de recherche. Si le manuscrit ou l'édition originale de l'ouvrage existe bien à la Bibliothèque Nationale, un chercheur peu scrupuleux aura très envie de te chiper tes travaux et de les publier sous son nom, il y en a qui ne se gênent pas."
Nous avions terminé la soirée en nous racontant des histoires de fantômes et de vieilles maisons aux planchers qui craquent, histoire de s'empêcher de dormir, et Anne avait examiné mon thème astrologique qui disait que cette année marquait un tournant dans ma vie. Je n'en doutais pas.
IV.
Juillet et août s'étaient passés sans encombre. J'avais retrouvé le manuscrit d'origine et effectué la traduction de l'ouvrage. Un collège privé m'avait proposé un poste à temps partiel, j'étais au moins assurée d'avoir un travail; quant au public, étant donné mon changement de région, il avait perdu mon adresse, et une secrétaire débordée avait refait mon dossier de demande de poste en grognant après "ces gens qui déménagent". Mon problème était de trouver une chambre, car je ne pouvais encombrer Anne et François indéfiniment une fois leurs filles revenues. Ayant plus de vingt-cinq ans, je n'avais pas droit aux chambres d'étudiants, aussi pensais-je me mettre au pair auprès d'une personne âgée, les agences demandant trop cher et exigeant des garanties, et les propriétaires regardant d'un air soupçonneux "une femme seule", et me sortant qu'un prof n'avait qu'à se faire loger par l'Administration, alors que les seuls qui y avaient droit avec quelque certitude étaient les instituteurs en milieu rural.
Entre deux journées dans les bibliothèques, j'étais allée rendre visite à mon oncle qui tenait toujours une échoppe de cordonnier à Belleville. Il était la seule personne de la famille que je voyais toujours et à qui je donnais des nouvelles, car j'avais souvent passé avec lui et ses copains turfistes les dimanches de mon enfance, sur les champs de courses où il discutait le "papier" tandis que j'allais regarder les chevaux. J'étais devenue une experte du tiercé, ce qui avait toujours beaucoup amusé Anne qui me demandait comment on disait "P.M.U." en latin. L'oncle m'avait appris que l'alcoolisme avait eu raison de mon grand-père et que mes parents, persuadés qu'avec une licence en poche, on faisait rapidement fortune, m'avaient jugée indigne et ne voulaient plus entendre parler de moi.
Il m'assura que, si je ne trouvais pas d'autre solution pour me loger, il pouvait demander à son voisin restaurateur de débarrasser pour moi un petit réduit au-dessus de son établissement où il entassait des bouteilles vides. C'était mieux que rien, je n'avais rien contre l'odeur du couscous, que le père Moktar faisait très bien. Je l'avais accompagné aux courses, risquant sur des favoris quelques francs regagnés et aussitôt dépensés en cacahuètes à Enghien ou à Saint-Cloud.
Le quinté du dernier dimanche d'août avait été astronomique. J'encadrai la photo de l'arrivée, avec la partie du ticket qui me restait. Mon oncle, qui faisait aussi partie des heureux gagnants, s'offrit une camionnette, projeta d'agrandir sa boutique, et un festin accueillit Anne et sa famille à leur retour de vacances.
Dans la semaine qui suivit, François me trouva un petit appartement, qu'un de ses clients vendait à perte pour cause de droits de succession, et il me resta un peu d'argent que, sur ses conseils, je mis sur un compte-épargne. J'étais chez moi, dans une vieille maison près du Luxembourg, et même si l'électricité et la plomberie laissaient à désirer, j 'y installai immédiatement un matelas, ma commode et mes bouquins.
Le réveil du premier jour fut un ravissement. Par la fenêtre ouverte, je voyais les vieilles pierres de la rue Servandoni, et les arbres du Luxembourg. Après mon café préparé sur un camping-gaz, je rangeai quelques affaires - ou plutôt, je les entassai par terre, n'ayant pas de meubles -, et sortis faire un tour au jardin. C'était mon quartier, j'étais en place pour redémarrer. Ou plutôt, mon histoire pouvait enfin commencer.
V.
Dans une grande ville, on ne connaît généralement pas ses voisins. Sauf dans un petit immeuble situé dans un quartier ancien, où les appartements se transmettent entre membres d'une même famille, où les gens déménagent peu, et lorsqu'on a, comme moi, une gardienne bavarde qui m'avait eue à la bonne, surtout après que j'aie aidé son gamin dans ses devoirs de vacances.
Mon voisin de palier écrivait des romans policiers sous un pseudonyme américain, ceux du dessous enseignaient à Henri IV, il y avait encore un étudiant en droit, les patrons d'un bistrot du quartier, un commissaire de police et sa copine infirmière, et au quatrième une vieille femme dont j'appris qu'elle était un peu folle. La pipelette me dit de ne pas m'en faire quand je lui appris qu'elle m'avait traitée de "pouffiasse" en me croisant dans l'escalier, après avoir insulté les livreurs qui m'avaient apporté un meuble, c'était la même chose pour tout le monde, surtout les gens jeunes, et elle se méfiait des nouvelles têtes. Elle venait de Hollande, était d'une nationalité indéfinie, et avait, paraît-il, perdu toute sa famille pendant la guerre. Elle semblait fort riche, mais savait-on jamais? Son appartement était "un vrai magasin de vieilleries", et y faire le ménage relevait du parcours du combattant, comme dans le mien, du temps de mon prédécesseur, qui était "dans les objets d'art" et voyageait beaucoup.
Je commençai mes cours, dans une banlieue proche. Le fait de préparer une thèse avait favorablement impressionné la directrice, qui, ayant pris connaissance des établissements où j'avais enseigné dans le passé, m'avait dit: "Si vous avez eu ce type de gamins à problèmes, les nôtres vont vous sembler de petits agneaux !" Si tous les gamins au collège font les mêmes bêtises, plusieurs des élèves, particulièrement intéressés et dont certains avaient des parents cultivés ou qui suivaient de près les études de leurs enfants, me posaient des questions assez pointues. J'avais plus de préoccupations dans le domaine des préparations de cours que dans celui de la discipline. Il me fallait seulement modérer ceux qui, intéressés par un point particulier, oubliaient que le cours était fait pour toute la classe, qu'il y avait un programme à respecter, et en général j'emmenais après la sortie ces éléments passionnés continuer la discussion dans le préau. Nous projetâmes une visite du musée de Cluny, du Collège de France, et organisâmes avec une collègue une sortie aux Granges de Port-Royal. J'aimais mieux cela. Dire que dans mon établissement de province, lorsqu'il m'arrivait de prolonger une explication au-delà de l'heure, on m'accusait de favoritisme, et que les jeunes - pas forcément de bonnes familles bourgeoises - qui montraient un peu plus de culture que les autres étaient priés de ne pas "ramener leur science" pour ne pas brimer leurs camarades ! Heureusement que je n'étais pas tombée sur un chef d'établissement qui s'appliquait à former des petits moutons de niveau "moyen et ordinaire"...
Les adresses d'éditeurs que m'avait communiquées François me permirent de retrouver le petit-neveu de l'auteur de mon précieux ouvrage, un Père Jésuite qui enseignait la théologie et qui m'apprit que son parent avait été un religieux, professeur de latin, décédé durant la guerre de 14-18. Je pus consulter ses autres travaux, et le théologien me trouva un directeur de recherche, un brillant latiniste aussi exalté que désintéressé, que ses étudiants dérangeaient en lui téléphonant à toute heure du jour et de la nuit.
VI.
Il est de ces petits événements qui vous bouleversent. Je me sentais en sécurité dans cet appartement, dans un immeuble pourvu d'un code et d'une concierge attentive, et il me semblait que rien ne pouvait arriver. Mais voilà. Rentrant tard dans la soirée, je vis qu'on avait essayé de forcer ma porte. Fort heureusement, j'avais fait installer une serrure de sécurité qui s'était révélée efficace et l'on n'avait pu qu'abîmer les montants.
Complètement traumatisée, je n'avais pas fermé l'œil de la nuit, et, au matin, la concierge avait sursauté: "Encore ! C'est arrivé il y a à peu près trois mois chez l'écrivain et dans le dépôt du magasin ! Pourtant il y a le code. Il va falloir le faire changer. Je vous en prie, ne donnez pas le numéro à n'importe qui, et ne le criez pas par la fenêtre au copain qui l'a oublié, comme je l'ai entendu faire au jeune du quatrième! Tiens, ça tombe bien, voilà notre policier. Monsieur le Commissaire, du travail pour vous, encore une tentative de cambriolage."
Le voisin s'enquit de la chose et me rassura : mon appartement, étant resté longtemps inoccupé, avait pu être repéré, c'était chose courante. D'ailleurs, il y avait dans l'immeuble deux autres appartements presque toujours vides : un qui servait de dépôt à une société d'édition - on l'avait mis sens dessus dessous, et emporté quelques objets de peu de valeur - et un autre qui n'était qu'un pied-à-terre pour un homme d'affaires américain. Le malandrin s'étant aperçu que la serrure avait été changée, je pouvais dormir tranquille. Il m'indiqua la marche à suivre pour porter plainte et avertir l'assurance, et approuva la concierge de vouloir faire changer le code. Cette dernière, soulagée que sa vigilance ne puisse être mise en doute, ajouta: "D'ailleurs, qui sait si ce n'est pas la vieille folle qui a fait le coup ! Mademoiselle doit avoir pour elle une tête à faire de l'espionnage ou du trafic de drogue, et le monsieur qui écrit des romans policiers, elle doit croire qu'il reçoit des truands !" Le commissaire l'adjura en riant de garder ses opinions pour elle, et sortit. Je l'imitai et vaquai aux démarches nécessaires avant d'aller donner mes cours. Pour me rassurer, j'invitai une collègue à dîner.
VII.
Quelques jours passèrent avant que les événements ne se précipitent. Un soir, j'entendis hurler la voisine avec son accent indéfinissable: "Assassins, saletés de boches!" et entendis des rires dans l'escalier. Bêtement curieuse, on est badaud ou on ne l'est pas, j'entrouvris ma porte et vis l'étudiant en droit et un de ses copains qui descendaient en rigolant. Il me rapporta qu'elle avait arraché de sa porte la carte avec son nom, et venait de l'insulter lorsqu'il était sorti.
— Vous comprenez, je suis alsacien, blond, avec un nom à consonance germanique, Kellermann, elle doit me prendre pour un officier SS. Je comprends très bien que cette pauvre femme doit traîner un passé chargé. Mais, c'est égal, on ne sait jamais, elle pourrait un jour blesser quelqu'un en lui lançant quelque chose à la tête: un jour, elle a balancé un pot de fleurs sur des gens qui passaient dans la rue en chantant, heureusement sans toucher personne. Il faudrait porter plainte, la faire enfermer." Son condisciple lui rétorqua qu'il avait eu tort de lui répondre en prenant l'accent allemand, ce n'était pas la peine d'en rajouter.
— Bah!, reprit le jeune homme, il faut bien s'amuser un peu. Et les traumatismes du passé n'expliquent pas tout, si ça se trouve, c'est elle qui en rajoute, elle est pleine de fric et doit craindre pour ses vieux bibelots. En plus, elle avait des rapports de bon voisinage avec mon grand-père, alors j'ai essayé d'être gentil avec elle lorsqu'il m'a laissé l'appartement, pas moyen, elle ne supporte pas les jeunes.
Je me rangeai du côté de son copain en l'adjurant d'éviter les méchantes blagues de potache, et nous décidâmes d'en parler au commissaire et d'écrire au gérant.
Ce dernier nous reçut, l'étudiant, le professeur dont les enfants étaient rentrés en pleurant après que la vieille leur ait crié dessus et ait menacé de tuer leur chien, en plus de les avoir insultés lui et son épouse, et moi, qu'elle ne cessait d'apostropher en des termes peu amènes, ainsi que les gens qui venaient chez moi, ayant l'habitude de venir se pencher sur la rampe de l'escalier si elle entendait quelqu'un sonner à l'étage au-dessous. Ahmed, le fils du restaurateur marocain voisin de mon oncle, qui était venu faire quelques travaux chez moi, avait eu droit à un chapelet d'injures racistes lorsqu'il lui avait simplement adressé un bonjour poli.
Le gérant se déclara fort gêné, la voisine possédant plusieurs appartements dont il avait la charge, et nous fit un discours sur les difficultés actuelles de l'immobilier. Bien sûr, nous pouvions toujours porter plainte au commissariat... mais elle avait peut-être de la famille, il fallait se renseigner, essayer de parler à ses proches, et puis, n'était-ce pas beaucoup de bruit pour peu de choses? Des personnes un peu excentriques, cela courait les rues. Et après tout, est-ce qu'il n'y avait pas quelques raisons à son attitude? Une personne âgée, nous avions peut-être fait trop de bruit, les enfants l'avaient peut-être bousculée sans s'excuser, ou le chien avait manqué de la faire tomber. Le professeur, outré, rétorqua que ses enfants étaient parfaitement bien élevés, et que son chien était un minuscule yorkshire qui avait peur de tout et ne risquait pas de se précipiter dans les jambes des gens. Quant au bruit, nous assurâmes que l'épaisseur des murs de la maison faisait que l'on n'entendait pas grand-chose, à part la plomberie, mais qu'il n'était pas dans nos habitudes de prendre des douches à trois heures du matin. Nous partîmes de mauvaise humeur. Pour la forme, une plainte fut déposée au commissariat.