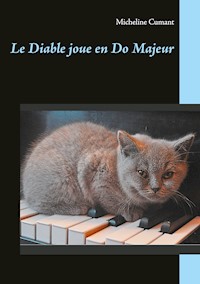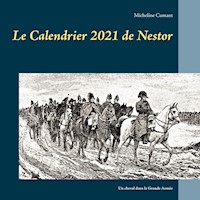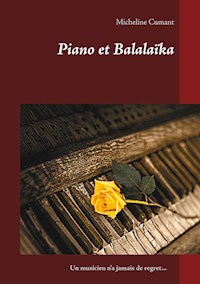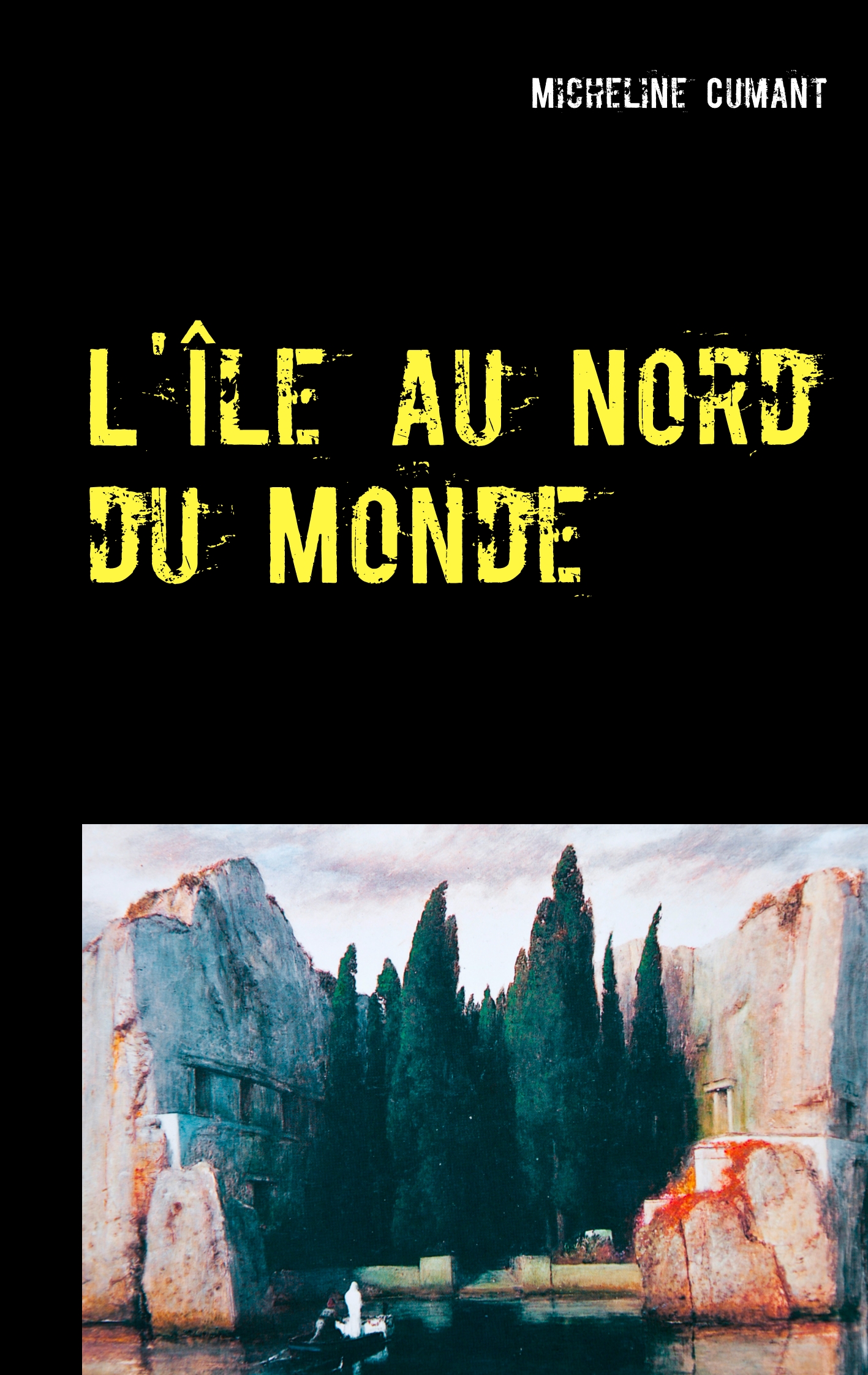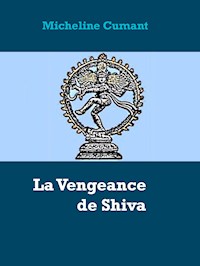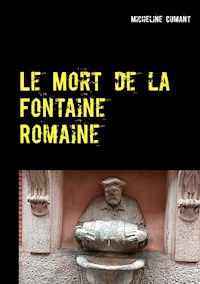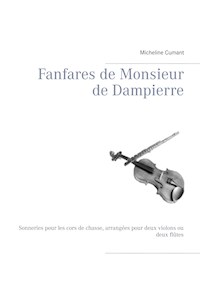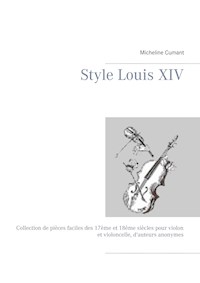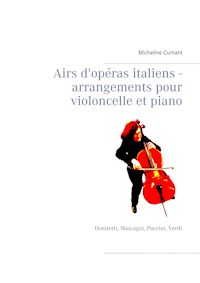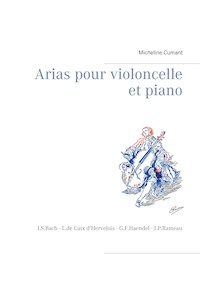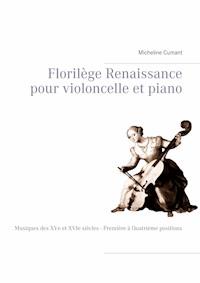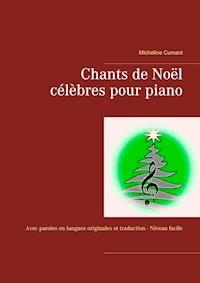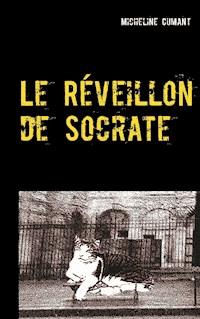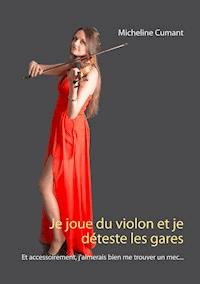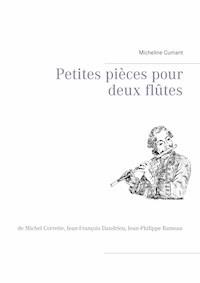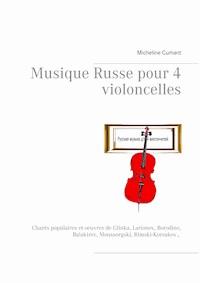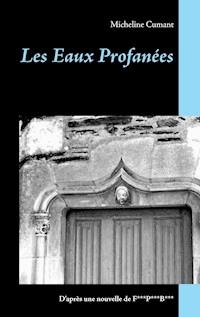Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
"Et nous, les petits, les obscurs, les sans-grades..." Ainsi débute la tirade du vieux grognard Flambeau, dans la pièce "L'Aiglon", d'Edmond Rostand. Dans la Grande Armée de Napoléon 1er, il y a les hommes, mais il y a aussi les chevaux. Eux qui pendant des siècles ont porté les hommes à la guerre, et à qui on n'a jamais rien demandé, ne sont-ils pas aussi des "obscurs et sans-grades" ? La parole est donnée au cheval Nestor, qui rejoignit l'armée impériale au lendemain d'Austerlitz, et participa à l'aventure de la Grande Armée jusqu'à Waterloo. En compagnie de son cavalier, le simple soldat Henri Fourneau, il va suivre Napoléon dans sa conquête de l'Europe, mais aussi dans la retraite de Russie et affrontera la coalition des alliés au cours de la bataille qui mettra fin au Premier Empire. "Nos chevaux, ce sont nos jambes", dit le cavalier. Loin des spéculations politiques, des stratégies militaires, des luttes de pouvoir, les soldats, pour beaucoup arrachés au monde paysan, souvent illettrés, soignent leurs chevaux qu'ils considèrent comme leurs amis, cherchent à tirer de petits profits et méditent sur les desseins des grands. Avancer, se battre, tuer... La guerre, c'est leur métier, celui du soldat et celui du cheval.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 331
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
NESTOR
L’Europe vue par Nestor
« Et nous, les petits, les obscurs, les sans-grades,
Nous qui marchions fourbus, blessés, crottés, malades,
Sans espoir de duchés ni de dotations,
Nous qui marchions toujours et jamais n’avancions… »
Edmond Rostand, « L’Aiglon »,
Acte 2 scène 8 (1900).
TABLE DES MATIÈRES
INTRODUCTION
PREMIÈRE PARTIE : Cheval dans les Chasseurs
I – Je suis engagé dans l’armée.
II – Iéna.
III – Les marais polonais
IV – Bataille de Pułtusk.
V. Fraternité d’armes.
VI. Eylau.
VII. Fin de la campagne.
DEUXIÈME PARTIE : HUSSARDS ET DRAGONS – Les campagnes d’Autriche et d’Espagne (1809)
I. Premiers combats.
II. Les idées noires de Bouquet.
III. L’Aube de Wagram.
IV. Une Nouvelle Guerre.
V. La guérilla.
VI. Un duel au bivouac.
VII. Une guerre d’embuscades.
VIII. Trafics et traîtrises.
IX. Une poule insolente.
X. Retour en France.
TROISIÈME PARTIE : LES CUIRASSIERS — La Campagne de Russie (1812)
I. Vers de nouveaux horizons.
II. Prendre une décision.
III. En route vers la Grande Armée.
IV. Le passage du Niémen.
V. Le Dniepr.
VI. De Smolensk à la Moskova.
VII. La bataille de la Moskova.
VIII - Moscou
IX. Avant la retraite.
QUATRIÈME PARTIE : La débâcle
I. La retraite.
II. Adieu, mes amis.
III. La bataille de Krasnoï et la Bérézina.
IV. Sur la route de Wilna.
CINQUIÈME PARTIE : Vers la paix.
I. Réformé !
II. Retour au pays.
III. La fin du voyage.
IV. Retour au régiment.
SIXIÈME PARTIE : La fin de l’épopée
I. Les deux amis
II. La campagne de France.
III. L’abdication de Napoléon.
IV. Les revenants
V. La fin des espérances.
VI. Le colonel et l’intendant militaire.
VII. Les Demi-Soldes.
VIII. Le retour de l’Aigle.
IX. Prêts pour l’affrontement suprême.
X. Waterloo.
ÉPILOGUE
INTRODUCTION
La ville de Clamecy rayonnait en ce mois d’avril 1848, et tous les habitants s’activaient en préparant une grande fête. Ils allaient célébrer le retour de la République, en plantant un arbre de la liberté, comme en 1793. Le curé avait accepté de bénir l’arbre, de la même façon que sous la première République.
Le roi Louis-Philippe avait abdiqué sous la pression populaire et avait pris la fuite vers l’Angleterre. La République venait d’être proclamée.
La ferme de la famille Caron avait revêtu ses habits de fête, sa façade et la salle à manger étaient décorées de guirlandes. Le fils Caron avait pour l’occasion fait venir son frère jumeau, maréchal-ferrant à Nevers, afin que toute la famille soit réunie. La grand-mère s’occupait des petits, et le père Caron rêvait en contemplant une miniature qu’il n’avait jamais voulu déplacer du mur, elle représentait un portrait de l’Empereur Napoléon à la tête de son armée. C’était une peinture naïve, un peu maladroite, mais le vieux fermier l’avait un jour achetée à la foire et depuis n’était jamais sorti de chez lui sans la regarder, comme pour saluer celui qui avait été son général et son Empereur. Car il avait été un soldat de la Grande Armée.
Ses petits-enfants le pressaient toujours de questions. Celui qui était représenté sur le tableau, Napoléon, l’Empereur, il l’avait vraiment vu ? En vrai ? Et puis, pourquoi y avait-il une petite tresse de crins de cheval fixée sous le tableau ?
La grand-mère Adrienne prit la parole :
– Maintenant que les rois sont partis, tu peux leur raconter l’histoire. Celle d’Henri et de Nestor. Celle que j’ai plus devinée qu’entendue, tu ne m’as pas tout dit.
Le grand-père soupira.
– Je ne sais pas tout. Mais si le cheval Nestor était là, il nous en raconterait ! Lui qui a suivi Napoléon entre Iéna et Waterloo.
– Il est mort à la bataille ? demanda un des petits.
– Il est mort au champ d’honneur, dans la plaine de Waterloo. Avec son cavalier…
– Henri Fourneau, acheva la grand-mère. Mais raconte donc… Mieux : les enfants, imaginons que le cheval nous conte son aventure… »
PREMIÈRE PARTIE : Cheval dans les Chasseurs
I – Je suis engagé dans l’armée.
Je suis né en 1802 dans une ferme près de Saint-Flour, dans le département du Cantal, d’une jument d’origine anglo-normande et d’un étalon d’Auvergne. Mon éleveur me destinait à la carriole du notaire ou au fils du juge, qui était un fin cavalier, appréciant les beaux chevaux — car j’étais, à presque quatre ans, un assez puissant modèle, de très grande taille pour un cheval d’Auvergne1, d’un beau noir zain2. Mais le destin en décida autrement : six officiers de cavalerie — hussards, chasseurs, cuirassiers — vinrent en tournée d’achats. L’armée avait besoin de beaucoup de chevaux : « un cheval pour sept hommes » disait le règlement. Certains officiers recherchaient des chevaux lourds, pour le trait, ils étaient moins nombreux dans notre région. Un autre règlement disait que les chevaux qui avaient entre cinq et neuf ans devaient être recensés, dans le cas où le besoin de réquisition se ferait sentir.
Avec deux de mes camarades — un rouan 3 et une alezane4 —, nous fûmes menés, tenus en main, au pas et au trot. Les officiers nous déclarèrent « bons pour le service », notre éleveur fut payé, et on nous emmena à Aurillac, où nous rejoignîmes une cinquantaine d’autres chevaux. La route commença.
Il fallait d’abord nous affecter en fonction de nos aptitudes. Pour cela, nous partîmes par petites étapes jusqu’à Clermont-Ferrand. Là, on nous sépara en trois groupes : les plus grands furent destinés aux cuirassiers, les moyens aux dragons, et les plus petits aux hussards et aux chasseurs. Je me trouvais bien avec les amis de la ferme qui étaient enrôlés avec moi, et je me permis de gambader, de sautiller, je restais un poulain joueur, tout comme mes amis que cette réunion amusait beaucoup. Et bientôt, ce fut un beau chahut dans la troupe, ce qui ne fut pas du goût des militaires chargés de nous garder. Un sous-officier qui avait assisté à la débandade, décréta que tous trois, bien que grands et forts pour des chevaux de quatre ou cinq ans, nous n’étions pas assez disciplinés pour nous verser dans le corps des cuirassiers, et l’on nous affecta à la cavalerie légère. Ce qui nous indifférait assez. Mais cette indiscipline fit que ceux des officiers qui cherchaient des montures nous dédaignèrent : en effet, eux étaient tenus d’avoir au moins deux chevaux, qu’ils achetaient eux-mêmes, et ils ne voulaient pas avoir à perdre du temps en calmant les ardeurs d'animaux qu’ils disaient rétifs. Nous serions des montures de simples soldats, à moins que nos cavaliers ne montent en grade.
Avant de nous affecter à un régiment ou à un autre, il fallait nous baptiser et nous inscrire sur les registres. Les chevaux des cuirassiers reçurent des noms mythologiques : Jupiter, Neptune, Vénus… un soldat revint vers nous en disant que nous avions de la chance, nous n’allions pas devoir porter des noms tels que Mathusalem, Nabuchodonosor ou Salomon, qu’avaient reçu les chevaux d’un autre groupe de la part d’un gradé lettré. Pour nous, cela se passa plus simplement. On nous fit aligner par dix, un officier nous examina, puis il désigna chacun en le baptisant, tandis qu’un adjudant les inscrivait, avec un numéro qu’il appelait « matricule », en ajoutant les caractéristiques de chacun, robes, marques diverses... Je fus baptisé « Nestor », et quant à mes deux camarades, le rouan devint « Ardent » et la jument alezane « Musette ». Et, par chance, nous restâmes ensemble. Il est vrai que nous avions entendu un soldat dire que les chevaux qui se montraient trop difficiles étaient revendus. Par crainte d’être ainsi séparés, nous décidâmes de nous tenir tranquilles.
Et c’est ainsi que nous fûmes incorporés au deuxième régiment de chasseurs, cantonné à La Haye, en Hollande. On nous attacha par groupe de six, deux soldats s’occupaient de chaque groupe. Nous entendions dire « Doucement au début ! Il faut les habituer, d’abord des petites étapes ; et ne les poussez pas ! » Quatre lieues, puis cinq, puis six… les soldats qui nous montaient se contentèrent de nous faire avancer droit, calmement. Dès que l’un de nous semblait fatigué, ou bronchait, son cavalier changeait de monture. Nos cavaliers étaient de vieux soldats, à longues moustaches, et leurs cheveux étaient nattés sur la nuque. Tout en restant au pas, petit à petit, ils tendaient les rênes, pressaient leurs jambes contre nos flancs, nous apprenions notre métier, il fallait que nous réagissions aux gestes de nos cavaliers sans nous braquer, et bientôt nous fumes capables de marcher au pas, au petit trot, à tourner, à rester immobiles, sans nous énerver ni nous fatiguer. Pendant ce temps, les étapes s’allongeaient, six, huit, dix lieues… En arrivant à La Haye, nous étions fins prêts à devenir de bons chevaux de régiment et tenions la cadence : une heure au pas, une dizaine de minutes d’arrêt, pour nous permettre de nous soulager, les cavaliers vérifiaient le harnachement, le sanglage, puis nous repartions au pas une petite heure. Suivaient deux heures de trot, on repassait au pas, on reprenait le trot. Quand il y avait une montée un peu raide, le cavalier mettait pied à terre.
Il faisait très beau, et nous étions le 15 août 1806, jour de l’anniversaire de l’Empereur. Tout le régiment avait revêtu les tenues de gala, et présentait les armes à la famille royale. Le lendemain, ordre fut donné de nous remettre en marche avec le reste de la troupe, nous partions pour Cologne.
Le 1er septembre, nous arrivâmes au cantonnement. Nous étions très curieux de savoir ce qui allait se passer. Pour ma part, je fus déçu : tous les matins, on nous emmenait sur des pistes, dans des prairies aménagées en carrières de dressage, ou dans des champs labourés. Nous apprenions à changer d’allure, à placer notre tête, en gardant le contact avec le mors, et nous ne cessions de faire des voltes, des demi-voltes, des changements d’allure, et à passer de l’immobilité au galop de charge en un clin d’œil. Tous les jours, le travail était le même, nous changions quelquefois de cavalier. On nous ramenait ensuite à l’écurie, où nous étions soigneusement pansés et où nous avions droit à de généreuses portions d’avoine. Les maréchaux-ferrants passaient souvent pour vérifier nos pieds, et les cavaliers étaient tenus de posséder quatre fers de rechange et des clous dans leurs fontes. De plus, des hommes qui avaient reçu une formation spéciale, et que l’on appelait « vétérinaires », étaient passés nous voir, pour vérifier qu’aucun de nous n’avait de maladie qui eût pu se transmettre au reste de la cavalerie, et ils morigénaient les soldats qui négligeaient leur harnachement, laissant leur monture blesser au dos ou à la sangle.
Peu après, nos cavaliers arrivèrent en armes, et nous montèrent en brandissant leurs sabres ou en tirant des coups de pistolet ou de mousqueton. Nous étions entraînés à trotter ou galoper en ligne, quatre par quatre. Quand on disait « Chargez ! » nous partions au trot, puis au petit galop, et il fallait partir au galop de charge lorsque l’on entendait une sonnerie de trompette. Je trouvai cet exercice plutôt amusant, cela me distrayait, car l’endroit était une plaine, toute plate, un peu boueuse, où l’herbe n’était guère appétissante. D’ailleurs, nous étions bien nourris, nous n’avions pas maigri et même nous étions plus musclés qu’en arrivant, disaient les officiers. Je m’habituais, et même je ne faisais plus attention aux bruits, aux cris que poussaient les cavaliers. Certains de mes confrères bronchaient, partaient en ruades à la sonnerie de trompette, l’on entendait l’officier instructeur crier : « Restez groupés ! », il fallait apprendre à charger en ligne. Sur ce plan, je suivais les instructions, cela nous amusait de galoper ensemble, bien que nous ayons comme tous les chevaux envie de faire la course, nos cavaliers nous retenaient.
Après la charge, nous rentrions au petit trot afin de nous rafraîchir et de reprendre notre souffle. Je tenais bien la cadence, mais, rentrant à l’écurie, je n’avais plus qu’une envie : manger et dormir. Or, il arrivait que le picotin tardât, si le soldat Bouquet qui s’occupait de moi, et qui était blasé après plus de vingt ans de service, avait bu plus que de raison. C’était un brave homme, gentil avec moi, mais son amour de l’eau-de-vie passait avant sa conscience professionnelle, et il arrivait qu’un officier le morigène et qu’il soit consigné les dimanches. Du coup, il ne pouvait plus sortir s’acheter à boire, et cela le rendait hargneux, il me pansait à la va-vite et allait ensuite ronfler sur une botte de paille. Il redevenait aimable lorsqu’un soldat rentrait et lui apportait une bouteille qu’il se hâtait de déboucher, avant de boire « à ma santé ». Je ne comprenais pas comment le fait que le père Bouquet boive pouvait être bon pour ma santé…
Au bout d’un mois, nous étions prêts à être attribués à un escadron. Nous allions partir en guerre. En même temps, les jeunes soldats avaient terminé leur instruction, on les avait fait travailler sur de vieux chevaux, car, comme je l’avais entendu dire un jour au colonel : « À jeune cheval, vieux cavalier, à jeune cavalier, vieux cheval ». J’appris que, depuis quelques années, les cavaliers étaient meilleurs qu’auparavant, car ils avaient reçu une formation dans une école nationale d’équitation, et leur expérience leur permettait de former des recrues, d’en faire de bons cavaliers qui savaient utiliser leurs montures au mieux, et sachant aussi bien se tenir correctement en selle, se rendre compte de l’état de son cheval, et le soigner à l’écurie. À présent, on allait nous attribuer à ces jeunes soldats, tandis que les anciens reprendraient leurs montures ordinaires.
Mais mon brigadier, Rambert, s’empara de Musette, et l’adjudant tint à garder Ardent, qu’il avait beaucoup aimé à dresser. À leur exemple, Bouquet offrit de m’échanger contre sa jument, Lutèce, qui avait les membres fatigués. Mais, le jour des attributions, il était comme souvent ivre mort, et un conscrit récemment arrivé, Henri Fourneau, devint mon cavalier.
Fourneau était un brave garçon, de belle prestance déjà, quoique très jeune. Sa haute taille et les capacités qu’il avait montrées pendant son instruction firent qu’on me présenta à lui :
« Tiens, voilà Nestor, il est grand, il a de l’énergie, comme toi, lui avait dit le sous-officier. Et il avait ajouté : en plus, vous êtes “pays”, tu connais Saint-Flour ? »
Sûr, avait-il répondu, il était d’Andelat, un village près du château du Sailhant. Les recruteurs l’avaient pris là, à la ferme de son père, qui après la Révolution s’était attribué un bout du terrain du château, ce qui arrivait à le faire vivre chichement. Fils unique, seul soutien de ses vieux parents, Henri était parti sans enthousiasme, mais la vie du camp, plus animée que celle d’un village, les uniformes chamarrés, les nouveaux amis et la compagnie des chevaux qu’il aimait, les sonneries de trompettes, les bruits de manœuvres, tout cela lui redonna sa gaieté naturelle et il mit beaucoup d’entrain à s’occuper de moi, à faire briller mes harnachements et aussi à soigner sa tenue à laquelle il ne manquait jamais un bouton.
Mais, si appliqué et adroit qu’il fût, le pauvre garçon ne savait pas lire. Sinon, peut-être aurais-je fini cheval d’officier… Et pourtant, parmi nos chefs, il y en avait, des hâbleurs, des opportunistes, d’autres qui avaient su saisir la chance au moment où elle passait, ils avaient été promus, et leur avancement avait été rapide. Mais les honneurs vont rarement trouver le mérite silencieux, et Henri était en plus un garçon modeste, qui n’avait pas pour habitude de faire du zèle.
1 Le cheval de la race auvergnate est en principe petit (environ 1,50 m au garot), pèse environ 500 kg et est connu pour sa rusticité. Nestor ayant une mère d’origine anglo-normande, sans doute un croisement de cob normand et de pur-sang, se trouve donc être plus grand (1,60 m/1,65 m). Mais il a hérité de la robe noire ou bai-brun des chevaux auvergnats.
2 Un cheval « zain » est de robe unie, fauve ou noire, mais sans aucun poil blanc.
3 Un cheval « rouan » est de couleur de poils mélangée de roux, de noir et de blanc.
4 Un cheval « alezan » est de robe rousse, fauve, ou marron, avec la crinière et la queue également fauves.
II – Iéna
Un matin, une rumeur courut dans le cantonnement. Les trompettes sonnèrent le boute-charge, puis le boute-selle. Les gradés distribuèrent de la poudre, de l’avoine, du pain, des pierres à fusil et des balles à nos cavaliers. J’entendis Bouquet parler à Fourneau :
– Ça va barder, mon petit, nous partons en Prusse ! Paraît que l’Empereur vient de déclarer la guerre ! »
À ces mots, je m’ébrouai joyeusement, pendant que Fourneau répondait en riant au vieux briscard :
– Eh bien, l’Ancien, on les verra venir les « Têtes Carrées"5 !
– Ils ne sont pas terribles, va, fiston ! Pas comme le Nestor, ils ne casseront pas le mors de bride ! » En réalité, je n’avais pas cassé le mors, j’avais mordu la boucle de cuir qui le tenait, et elle s’était détachée. Bouquet avait voulu aider Henri, en mettant ma bride. Mais, ce jour-là, il avait quelque peu forcé sur une eau-de-vie locale particulièrement traître, et de plus il commençait à ne plus voir bien clair. Aussi n’avait-il pas ajusté la boucle comme il le fallait.
Et ce jour-là, nous partîmes vers l’Allemagne. Le 20 septembre, nous traversions le Rhin, le 10 octobre, nous passions la Saale à Saalfeld. C’est là que j’entendis les premiers coups de fusil tirés pour de bon. Je compris le pourquoi des pétarades, des cris, auxquels on nous avait accoutumés à Cologne. Au soir du même jour, nous apprîmes que les Français venaient de battre un régiment prussien, et que le maréchal des logis Guindet, du Dixième Hussards, avait tué le prince héritier Louis de Prusse d’un coup de sabre. Le moral du régiment était au beau fixe, et, le lendemain, nous nous mîmes en marche. Les étapes comptèrent quinze à dix-huit lieues, quasiment le double d’un coup. Une trentaine de chevaux et quarante-huit chasseurs durent abandonner en route.
Ardent, Musette, et moi, nous tenions bon, solides que nous étions, mais Lutèce avait les boulets enflés, et lorsqu’arrivait le soir, elle boitait bas. Bouquet la soignait, l’encourageait, demandait conseil au vétérinaire, et la brave jument parvenait courageusement à finir les étapes.
Nous fûmes cantonnés à Géra, en Saxe, dans un champ d’herbe grasse, près d’une ferme en ruine. Les soldats profitaient des moments de liberté pour déterrer des pommes de terre dans le champ voisin. Le matin du 14, le brigadier Rambert, entendant les crépitements de la fusillade dans le lointain, dit à mon chasseur :
– Tu entends, conscrit ? On déchire la toile6, par là-bas ! »
De temps en temps, un sourd grondement se faisait entendre : les hommes dirent que c’était le canon. Les choses devenaient sérieuses.
Nous reprîmes la route, qui fut difficile, les jeunes soldats ne pouvaient s’empêcher d’être impressionnés : les chemins étaient jonchés de cadavres, hommes ou chevaux, grenadiers, chasseurs ou hussards, et de morceaux de charrettes, de caisses éventrées. Il fallait dégager la route, pousser les cadavres dans les fossés, et de temps en temps certains râlaient encore. Des chevaux, les membres brisés, hennissaient en tentant de se relever. Cette fois, c’était la guerre, la fête des morts !
Le général Lasalle, commandant la brigade, vint nous placer en ligne de bataille, et, tout à coup, un boulet, qui ricocha sur un rocher, vint décapiter notre colonel et frappa en pleine poitrine l’adjudant qui était juste derrière. Son cheval, Ardent, eut une telle peur que, d’un bond, il fit volte-face et se coula entre nous. Au même instant, une balle foudroyait Lutèce en pleine tête. D’un bond, Bouquet sauta à terre, attrapa Ardent et l’enfourcha. Il n’eut pas le temps de dire adieu à sa vieille et fidèle jument, car, tout à coup, nous reçûmes l’ordre de charger.
Une petite côte, un chemin, un tournant, un boulet faucha le premier rang, neuf chasseurs tombèrent, les chevaux, emportés par leur élan, et rejoints par notre groupe, continuèrent, sauf deux jeunes chevaux qui trébuchèrent et, se relevant, prirent la fuite vers l’arrière.
Ce fut ma première bataille. Elle s’était passée au village d’Iéna.
Il n’y eut pendant un moment plus personne en face de nous, nous nous regroupâmes, attendant les ordres. Pendant ce temps, les régiments d’infanterie se battaient comme des enragés et mettaient l’ennemi en fuite. Les cuirassiers, commandés par le beau Murat, grand-duc de Berg, chamarré selon son habitude comme un suisse de cathédrale, mais qui savait faire manœuvrer les unités de cavalerie comme un seul homme, transformèrent cette fuite en déroute. Le Septième Chasseurs, qui avait chargé avant nous, avait perdu la moitié de son effectif, en hommes et en chevaux. Mais les Prussiens avaient complètement cédé le terrain, et ceux de leur armée qui ne gisaient pas dans la plaine avaient disparu.
Le soir, nous bivouaquions à Weimar, et Henri, quand il fut seul avec moi, me bouchonna avec ardeur, et je vis que d’un coup ses yeux se remplissaient de larmes. Il cacha sa tête dans ma crinière et m’embrassa en me disant des mots sans suite. Il avait tremblé à la mort du colonel, s’était senti glacé en voyant tomber ses camarades, mais il avait crispé sa main sur la poignée de son sabre, prêt à s’en servir si on nous avait donné l’ordre de charger, il avait continué à me pousser en avant. Nous avions fait notre métier, lui et moi.
Pendant que l’Empereur, qui avait lui-même commandé la bataille, triomphait à Iéna, à côté, à Auerstaedt, le maréchal Davout venait de remporter une brillante victoire.
Il n’était pas aimé dans l’armée, le maréchal Davout, car nulle carrière militaire n’offrait, plus que la sienne, l’image d’une plus parfaite incohérence. Ce chef, inflexible dans l’application des règlements, pointilleux à l’extrême, avait été, lors des premiers grondements de la Révolution, le lieutenant le plus indiscipliné de la cavalerie royale. Son nom de naissance était D’Avout, et il fut comme la plus grande partie de sa famille destiné aux métiers des armes. Élève au collège militaire d’Auxerre, il avait atteint le grade de sous-lieutenant quand il fut gagné par les idées révolutionnaires et abandonna la particule, pour constituer un club politique. Il avait pris barre sur les autres sous-officiers, et même sur les officiers de ce régiment, leur avait monté la tête, tant et si bien qu’un jour, refusant le service, tout ce beau monde s’était barricadé dans la cantine, avait chassé le colonel et proclamé l’abolition de tous les règlements disciplinaires. Il avait fallu que ceux de la troupe qui étaient restés dehors, par respect de ces règlements, par peur des sanctions, ou tout simplement parce qu’ils étaient occupés ailleurs, soient sommés par un officier d’armer les fusils et de tirer dans les portes, de pénétrer par force dans la salle pour en chasser les mutins. Ironie du sort, les meneurs furent renvoyés dans leurs foyers, alors que les simples soldats furent emprisonnés quelques jours.
Le lieutenant Davout, lui, fit quelques semaines de prison, puis fut libéré contre sa démission de l’armée. Mais, ne réussissant pas à s’employer dans la vie civile, il se fit incorporer comme simple soldat dans un régiment levé par l’Assemblée Constituante dans le département de l’Yonne, où il gravit bien vite les échelons de la hiérarchie militaire, jusqu’à devenir général durant la Terreur. Napoléon Bonaparte arrivant, il le suivit dans la campagne d’Égypte et devint maréchal. Il avait en outre épousé la sœur du maréchal Leclerc, qui était le beau-frère de l’Empereur. « Il a pensé à tout », disaient de lui les officiers qui n’aimaient pas les opportunistes, ou tout simplement étaient jaloux. N’empêche qu’il avait fort bien mené la bataille d’Auerstaedt, mettant en fuite les troupes du général Blücher.
Présentement, nos soldats fêtaient la victoire de l’Empereur à Iéna, à laquelle ils avaient participé, certains avaient même vu l’Empereur donnant des ordres de mouvements de troupes et de pièces d’artillerie.
Pendant que les soldats faisaient ripaille, je me sustentais de bonne avoine et reniflais avec bonheur la paille fraîche, n’ayant cure des petits trafics qui se faisaient à l’intérieur et autour du camp. Il faut bien penser que la guerre est l’école de tous les crimes, et que ceux qui ne l’ont pas vécue, ou ne l’ont pas connue par un proche, ne peuvent la juger. Si j’avais traversé toute cette glorieuse épopée en me contentant de faire mon devoir de soldat, ma vie eût été plus intéressante aux brancards du cabriolet de mon éleveur, ou même devant la charrue. Il faut parler des petits marchandages, sans lesquels la vie des soldats eût été déprimante, des trafics de bons de vivres, des tractations avec les paysans, les juifs et les usuriers des pays que nous traversions. Car les soldats, après les batailles, ne restaient pas inactifs devant les morts dont ils faisaient les poches, et les leurs étaient abondamment garnies de thalers et groschen. Je vis mon Henri hésiter au début, scrupuleux, puis, voyant que cela ne servirait à rien de se distinguer en faisant la fine bouche, en faire autant. Ainsi, il acheta à un paysan quelques bonnes mesures d’avoine pour moi, en plus de quelques bouteilles pour lui et ses camarades. Quand il me sellait, je sentais que les fontes de la selle étaient sérieusement alourdies, et les pièces tintaient joyeusement au rythme du trot. Toutes les ressources locales étaient mises à contribution.
« La loi de la guerre ! » Dit Bouquet à Fourneau, qui s’en étonnait et avait parfois un mouvement de gêne. « Dis donc, les envahisseurs, c’est nous, non ? Eh bien, on se sert ! Et on se sert chez ceux qui en ont, on n’a pas touché à des pauvres paysans, non ? Seulement aux riches, et aux morts. Les morts n’ont plus besoin d’or ! » Il ne fallait effectivement pas se montrer trop délicat ou respectueux.
Quant à moi, je n’étais pas une grosse brute, j’étais un soldat loyal, un bon cheval de troupe, donc un instrument, je grappillais de l’avoine quand il y en avait, mais aussi de la gloire ou des horions quand il en passait. Moi, simple cheval de soldat, quand les batailles se calmaient, quand nous nous arrêtions pour bivouaquer, je ne pensais qu’à mon picotin, pas au résultat des combats ni aux savantes stratégies militaires dont discutaient les officiers. Bien sûr, il y avait des morts, mais c’était cela, la guerre. Bon, je m’inquiétais pour Henri, quand il semblait fatigué ou souffrait, il s’occupait bien de moi, nous étions un duo bien soudé.
Nous passâmes à Berlin, une ville banale, où les habitants nous regardèrent avec une indifférence toute philosophique, puis à Posen, et enfin on nous fit cantonner deux semaines dans un petit village proche de Varsovie.
5 « Têtes carrées » : expression québécoise datant de la colonisation du Canada. Les français installés ont surnommé ainsi les anglais car ils construisaient des maisons à toit carré. L’expression est utilisée par Henri, car, à l’époque, l’ennemi numéro un des français était surtout l’anglais.
6 « Déchirer de la toile » signifie, en langage militaire de l’époque, tirer des coups de fusil, en salve et en désordre, le bruit ressemblant à celui d’une déchirure.
III – Les marais polonais
Nous étions en décembre, et nous couchions dans la neige, lorsque nous ne nous battions pas contre les Russes qui, paraît-il, étaient devenus nos ennemis. Je n’y comprenais rien : j’avais entendu parler des Prussiens, nous les avions déjà rencontrés. Il y avait les Anglais, il paraît qu’ils sont les meilleurs ennemis des Français. Les Autrichiens, bon, ils sont à côté de l’Allemagne. Mais les Russes ? Quand Henri soulevait le problème, Bouquet, ou l’adjudant Rambert, rétorquait : « On te demande de te battre, pas de comprendre la politique ».
Le 6 décembre, nous traversâmes la Vistule et le 24, les mamelouks de l’Empereur chargèrent des uhlans qui, les prenant pour des Turcs à cause de leur costume, s’enfuirent épouvantés.
Après plusieurs petites escarmouches, nous cantonnâmes une quinzaine de jours dans les marais polonais, où une singulière aventure nous arriva.
Ces marais, au bord desquels nous avions installé nos tentes et nos bivouacs, servaient de barrières entre nous et les Russes qui, dix fois supérieurs en nombre, n’osaient cependant pas nous attaquer. Il faut dire que tous, cuirassiers, dragons, chasseurs et hussards français, nous usions de stratagèmes bizarres pour leur donner, par la multiplicité de nos feux de nuit, l’illusion de la masse. Tous les soirs, à la chute du jour, les cavaliers nous sellaient à l’improviste, puis, en un temps de galop, nous allions à une lieue ou deux, un peu à l’écart. Tout le long des marais, ils allumaient alors des feux de bivouac volants.
Mais, comme ces marais qui nous séparaient étaient impraticables, chaque armée se croyait complètement à l’abri et négligeait la pose des grand-gardes7.
Pour pouvoir passer d’une rive à l’autre, les habitants avaient construit une sorte de pont : deux gros sapins étaient placés sur deux rangs parallèles, des planches étant clouées en travers, fixées à de solides madriers reposant sur ces traverses, ceci formant quelque chose qui ressemblait à des pilotis. Sur cette construction improvisée, où les habitants du pays n’osaient pas se risquer, le général de division eut l’idée folle de nous faire passer, de nuit : nous étions quatre mille chevaux, tenus en main par nos cavaliers. Son intention était de prendre l’ennemi par la surprise.
Miracle ! Il paraît que cela arrive… Tout le monde put passer. J’entendis des officiers dire : « impossible n’est pas français ». Ah, bon ? Ce devait être vrai. Les planches bougeaient, oscillaient, le pont était étroit, nous glissions, nous butions, certains d’entre nous bronchaient, frappaient les planches… Mais, au bout de presque huit heures d’inquiétude, nous étions tous passés. Nos cavaliers montèrent en selle, et tout le monde fonça vers le camp des Russes… qui avaient pris la fuite. Toute la troupe s’arrêta, les soldats se demandaient ce que nous faisions, et Henri dit à mi-voix à son voisin : « S’ils s’étaient doutés, ils n’avaient qu’à nous attendre à la sortie du pont, puisque nous passions en file indienne, ils auraient pu nous massacrer comme ils voulaient ! » Le camarade répondit « Eh ! En tout, il faut un peu de chance ! Surtout pour rester vivant ! » Et le brigadier Rambert avait ajouté : « Les soldats doivent être courageux, les chevaux obéissants, les chefs intelligents… et avec tout ça, c’est vrai, il faut de la chance ! Beaucoup de chance ! »
7 Grand-gardes : corps de cavalerie placé en avancée afin de prévenir une attaque surprise.
IV – Bataille de Pułtusk
On ne s’attarda pas dans les marais de la Pologne, et pendant environ deux semaines, il y eut quelques escarmouches, nous partions en patrouilles en petits groupes, ou carrément en escadrons, et à chaque fois nous mettions en fuite quelques Russes.
Henri Fourneau, mon jeune cavalier, était très audacieux, et, comme nos deux caractères s’accordaient à merveille, nous foncions avec joie lors des charges, lui le sabre en avant, hurlant, moi en ronflant comme un soufflet de forge. La bataille nous galvanisant, nous étions de plus en plus décidés à en découdre avec tout ce qui s’opposerait à notre avancée — vers quoi, au fait ? Nous n’en savions rien et cela n’avait pas d’importance, nous devions mettre l’ennemi en fuite. Mais aussi, nous apprenions que le courage consiste à envisager tous les dangers, sans n’en mépriser aucun, et de faire toujours comme si notre général nous regardait. C’étaient les ordres qui comptaient.
Depuis quelques jours, les routes devenaient des chemins de plus en plus boueux, de plus en plus impraticables. Nous enfoncions dans des marécages jusqu’aux jarrets, et l’artillerie peinait : comment tirer des canons dans un sol détrempé ? Le temps avait été assez doux, il n’y avait pas eu de gel, ce qui eût raffermi la terre. Il pleuvait de temps en temps, et ces ondées rendaient encore pires ces routes qui n’en méritaient plus le nom.
De plus, nombre d’entre nous arrivaient au cantonnement le ventre creux, avec seulement un peu d’herbe mouillée comme subsistance, car souvent le fourrage faisait défaut, ou les cavaliers n’avaient pas trouvé de moyens pour s’en procurer. En ce qui me concernait, mon ami Fourneau était toujours parvenu à m’assurer une ration d’avoine et du foin. Comment s’y prenait-il ? Mystère ! Sans doute son bon sens et sa débrouillardise de paysan auvergnat lui permettaient-ils de traiter avec les locaux. En tout cas, il me fournissait de quoi me sustenter et sortait pour lui et ses camarades une bouteille. Bouquet, lui, s’endormait ivre et ronflait jusqu’au lever. Beaucoup d’hommes étaient malades, les rations étaient gâtées, et même le général Lannes souffrait de fièvres. Malgré tout cela, nous avancions.
Le 24 décembre, nous arrivâmes devant Golymin, et nous nous dirigeâmes vers Pułtusk, après avoir traversé un bois avec d’infinies précautions, car les Russes auraient pu aisément nous y canarder s’ils nous avaient attendus. Mais ils avaient sans doute d’autres plans en tête : bientôt, les cuirassiers de leur garde et leurs dragons se rangèrent dans la plaine, à gauche du bois. Ils étaient environ dix mille cavaliers, devant trente mille fantassins et quarante pièces d’artillerie, entendîmes-nous dire.
Soudain, une formidable canonnade retentit. Notre brigade fut balayée de biais, comme si un coup de vent l’avait fauchée. Nous vîmes tomber des files entières d’hommes et de chevaux. Notre nouveau colonel n’eut pas le temps de nous faire reformer en bataille, car le général ordonnait un mouvement de retraite.
Dans la brigade voisine, celle du général Lasalle, un fait inouï se produisit. Comme un des régiments de hussards qui la composaient s’était laissé transpercer par le canon et déborder par une charge des Russes, le général, pour punir ses hommes, les fit ranger en bataille devant l’artillerie ennemie et les y laissa immobiles. Devant eux, impassible, il fumait la pipe.
Pendant ce temps, notre infanterie contournait le bois, mettait l’ennemi en déroute, bloquait ses pièces d’artillerie et nous préparait ainsi le terrain pour une chasse aux fuyards. Notre régiment était fortement décimé, mais ni mon zèle ni celui de mon brave Fourneau n’avaient fléchi devant cette hécatombe. On nous regroupa, un ordre fusa, et, comme dans les escarmouches, où mes jambes et mon courage avaient pu s’exercer, je chargeai avec ardeur. Au premier fossé, je vis tomber presque sous mes sabots le voisin de Fourneau, Camus, un jeune Auvergnat, dont le cheval, un vieux rouan, venait d’être éventré par un boulet perdu. J’étais lancé à une telle vitesse que je ne pus l’éviter, et mes sabots frappèrent le malheureux en plein visage. Lorsque nous eûmes l’ordre de nous replier, je le cherchai des yeux. Misère ! Son visage n’était plus reconnaissable, et c’était moi, son compatriote, qui l’avait tué ! Heureusement, Fourneau ne s’en rendit pas compte, il en aurait pleuré pendant plusieurs jours et peut-être cela eût-il ralenti son ardeur.
Nous étions, Henri et moi, sains et sauf. Ce fut de justesse : un boulet passa par-dessus mon encolure et frappa un jeune officier, que son père, commandant aux cuirassiers, était venu embrasser avant la charge.
Telle fut la bataille de Pułtusk. Le général Lannes, quoique malade, tremblant de fièvre, avait toujours dirigé les opérations. Plusieurs régiments russes avaient été anéantis.
Une semaine après la bataille, nous retrouvions dans les bois des centaines de leurs blessés qui vivaient encore, mangeant leurs rations ou celles de leurs camarades morts, ou même cueillant de l’herbe et la mâchant avec application. Des signes de maladies diverses s’ajoutaient aux souffrances causées par leurs blessures. Nous passions, il fallait continuer.
V. Fraternité d’armes
Le lendemain soir, après vingt heures de marche, coupé par quelques minutes de repos et un combat du matin — nous avions anéanti un escadron de Russes — mon petit groupe, commandé par l’ex-brigadier Rambert, nommé depuis peu maréchal des logis, était en patrouille d’avant-garde.
Pendant que la moitié de notre peloton se dispersait en postes d’observation, l’autre moitié, celle dont nous faisions partie, Fourneau avec moi, Bouquet avec Ardent et le maréchal des logis avec Musette, essaya de se reposer. Manger, il n’y fallait pas songer : nos bissacs étaient vides, et le cantonnement n’était qu’une plaine caillouteuse et enneigée. Derrière nous, les cadavres s’entassaient sur la neige rougie et, plus avant, l’arrière-garde ennemie, chassée par nos patrouilles, ravageait tout sur son passage, jusqu’au moindre brin d’herbe.
À court d’idées, Bouquet tortillait sa longue moustache et jurait en silence. De temps à autre, il flattait les flancs d’Ardent qui tremblait de froid. Quant à moi, je commençais à crier famine, et mes jarrets fléchissaient sous le poids du harnachement.
– Si je n’étais pas crevé comme je suis, marmonna Bouquet, je sais bien où j’en trouverais, de la viande fraîche et de l’avoine !
– Et où donc ? demanda Fourneau, qui soufflait dans ses doigts engourdis et s’efforçait de masser mes jarrets tuméfiés.
– C’est une affaire d’une lieue et demie, à pieds, en arrière. Autant pour le retour, ça fait trois. En une heure ou deux, malgré cette bise, ça fouette le sang tout de même, un homme reposé pourrait faire le trajet.
– Malheureusement, intervint Paulin, un vieux soldat à la moustache aussi longue que celle de Bouquet, nous sommes tous éreintés, et nos chevaux ne nous soutiennent que par la force de l’habitude !
– Les pauvres bidets ! Nous sommes bons pour passer tout de suite dans l’infanterie, si nous n’arrivons pas à les nourrir, ajouta Rambert.
– Nos chevaux sont nos jambes, déclara Fourneau. Quand nous ne les aurons plus, que deviendrons-nous ? Nous ne sommes pas entraînés au combat à pied ! Et c’est notre devoir que de soigner nos chevaux ! Dis-moi, Bouquet, où se trouve ce bon coin, et j’y cours !
– C’est là-bas, vers la droite, la ferme abandonnée où nous avons estourbi quelques Russes ce matin ! »
Et, ce disant, le vieux chasseur lui désigna la maison où, effectivement, nous avions, à trente, enfoncé un escadron de cent vingt dragons russes.
– Si mon devoir ne me retenait pas ici, je vous accompagnerais, dit Rambert, très occupé par la visite des chevaux malades ou blessés.
– T’en fais pas. Et occupe-toi de nos gars, dit Bouquet. Et, passant mes rênes, ainsi que celles d’Ardent, à Paulin, il ajouta :
– Prenons toujours nos pistolets, on ne sait pas ce qui peut arriver. Et ne fonçons pas tête baissée, car qui court trop vite reste en rade ! »
Les deux soldats se mirent en route, escaladant des cadavres de Russes tombés en paquets ; quelques-uns râlaient encore, ou murmuraient d’une voix mourante : « À boire ! À boire ! »
Soudain, un coup de feu retentit sur la route. Du cantonnement, nous vîmes la flamme du canon. J’eus peur pour Henri, mon cœur se serra et je hennis doucement. Mais nos deux amis étaient prudents. Bouquet avait aussitôt poussé Henri dans le fossé, disant :
– À terre, vite, petit, et ouvrons l’œil, le russe est tout près !
– Une idée, Bouquet, répondit mon chasseur au vieux soldat, si nous nous enveloppions dans le manteau d’un de ces pauvres diables de Russes ?
– Bonne précaution, en plus il fait frisquet et, là-bas, des prunes de gros calibres pourraient nous attendre ! »
Se coulant le long des fossés, rampant à quatre pattes, se dissimulant derrière les arbres, les buissons et les monceaux de cadavres, les deux hommes, que les manteaux des ennemis avaient fait prendre pour de simples maraudeurs, réussissaient, après une heure passée moitié à marcher, moitié à ramper, à pénétrer dans la ferme où, le matin, nous avions fait une si sanglante besogne.
Hélas ! Tout comme les nôtres, les bissacs des chevaux russes étaient vides.
– Ne te désespère pas, fiston, les renards sont malins, et pourtant on les prend ! Fit Bouquet qui, pour dissimuler sa profonde déception, inspectait une écurie déserte.
– Regarde ! Un coffre ! s’écria Fourneau.
– Et m…, il y a un cadenas ! Et quelque chose me dit qu’il y a de l’avoine là-dedans ! grommela le vieux chasseur en hochant la tête.
– Attends un peu, tu vas voir ! »