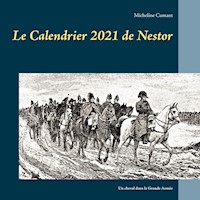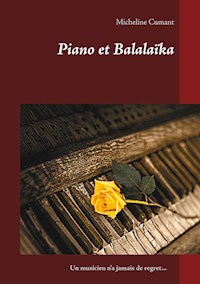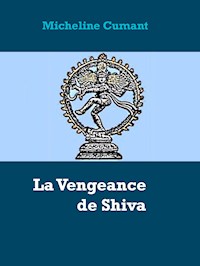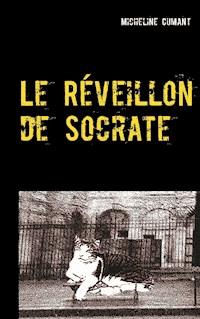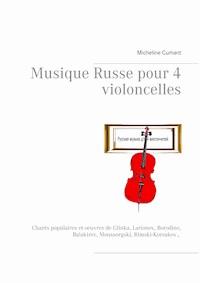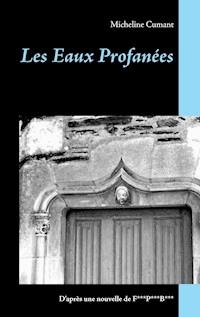Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Französisch
Le Superintendent Quint-William Rockwell, de Scotland Yard, comptait bien passer un séjour agréable à Rome avec son amie Alicia, violoniste. Rendant visite à son homologue italien le Commissario Capo Guido Panella, il se retrouve invité à collaborer à une enquête lorsqu'un cadavre fait son apparition... puis un autre... Il a aussitôt l'impression que les événements et les personnages rencontrés sortent à la fois d'une comédie de Goldoni et d'une pièce de Shakespeare: d'un scientifique surdoué suisse, austère, à un Italien exubérant et touche-à-tout, de la parfaite secrétaire anglaise à un couple de commerçants chinois, sans oublier deux jeunes Anglais champions aux jeux vidéo. Le policier anglais, fin musicien, démonte les ressorts de l'affaire comme s'il analysait une fugue de Bach, mais en met en lumière les aspects psychologiques avec la maestria d'un opéra de Verdi ou Rossini...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 501
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Plan de Rome, quartier centre
TABLE DES MATIÈRES
PROLOGUE
Giuseppe Verdi: Ouverture de "La Force du Destin"
I.
II.
III.
IV.
Première Partie
Giuseppe Verdi: Don Carlos: Air de Philippe II et Rigoletto: Air du Duc de Mantoue: "Comme la plume au vent".
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
Deuxième Partie
Giuseppe Verdi : La Traviata : "Brindisi" et Macbeth : Air de Lady Macbeth "La Luce Langue".
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
Troisième Partie
Giuseppe Verdi : Otello: "Credo" de Iago et Giacomo Puccini: Tosca: "Vissi d'Arte".
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
Quatrième Partie
Ruggiero Leoncavallo: Air de Paillasse et Wolfgang Amadeus Mozart: Don Juan: Air du Commandeur.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
ÉPILOGUE
Gioacchino Rossini: Le Barbier de Séville: Air de Figaro.
I.
II.
III.
PROLOGUE
Giuseppe Verdi,
Ouverture de « La Force du Destin »
I.
L’homme venait de monter dans l’avion, il se frayait avec difficulté un passage entre les voyageurs qui le bloquaient avec leurs sacs à dos, leurs valises, qui gesticulaient en quittant leurs vêtements imprégnés de l’odeur de la pluie londonienne.
« J’espère qu’il fera beau à Rome, au moins… » Se dit Morris Townsend en s’asseyant enfin, son sac de voyage sur les genoux. Il parvint à ôter son imperméable qu’il plia du mieux qu’il put, mais renonça à se lever pour mettre le tout dans le porte-bagages, son voisin de siège était assez corpulent, et dans l’allée se bousculaient encore quelques personnes qui essayaient d’entasser leurs affaires tandis que les hôtesses s’échinaient à faire fermer les casiers.
Enfin, l’avion roulait sur la piste. Il s’adossa, ayant bouclé sa ceinture, s’efforçant de se calmer, de reprendre son souffle. Tout allait bien, il avait réussi à embarquer, au prix d’une course effrénée dans Londres, dans les transports, dans l’aéroport, où il s’était un peu perdu. Tout allait bien… façon de parler, il ne connaissait pas la personne qu’il devait rencontrer, il ne savait pas où il devait aller, on ne lui avait fourni que des informations succinctes. Le dossier se trouvait dans son sac, avec sa trousse de toilette et son linge de rechange. Mais il n’avait pas eu le temps de dire au revoir à Madame Laurens, la responsable du service comptabilité, le collègue se chargeait de la prévenir, pourvu qu’il n’oublie pas. Quand il était descendu, elle ne se trouvait pas dans son bureau, elle était chez le directeur, et lui, le savait-il ? Sûrement, c’était le directeur.
Deux jours auparavant, on lui avait demandé s’il pouvait faire un petit voyage pour l’entreprise. Rien de très important, mais il s’agissait de documents anciens que l’on ne pouvait pas copier pour les envoyer par mail, ni par la poste, ils avaient de la valeur, on ne pouvait courir le risque qu’ils s’égarent ou soient ouverts par la mauvaise personne. Il avait accepté, puisque tout serait payé, le trajet, l’hôtel, et il serait rémunéré en heures supplémentaires pour ce service.
Et voilà, ce matin même, il était arrivé le premier dans le bureau du service comptable, l’ingénieur avait appelé « Monsieur Townsend » et lui avait dit de prendre ses affaires. Il était descendu au laboratoire où il avait reçu le dossier, avec une enveloppe contenant un billet d’avion aller et retour et une feuille où l’on avait noté l’adresse de l’hôtel, ainsi que différents numéros de téléphone. Il s’était inquiété, sa chef, savait-elle qu’il partait ? Bien sûr, on l’avertirait que c’était aujourd’hui. Mais il n’avait pas pu terminer son bilan, et le directeur, était-il prévenu lui aussi ? Et la responsable du personnel ? On l’avait assuré qu’il n’avait pas à se faire du souci, il devait se dépêcher s’il était obligé de repasser à son domicile, il était sorti par la porte de derrière et avait couru vers le métro. Chez lui, il avait perdu du temps, il ne voulait pas oublier quoi que ce soit. Il avait une petite valise, mais la poignée ne tenait pas bien, il avait choisi le sac de voyage, fermé sa porte, l’avait rouverte pour être sûr que rien n’était allumé dans la cuisine… À peine dans l’escalier, il avait fait demi-tour pour vérifier que cette maudite porte était bien verrouillée, et dans la rue il s’était aperçu qu’il ne savait pas où était la station de l’autobus qu’il devait prendre. Il avait demandé à quelqu’un, était revenu sur ses pas, avait finalement trouvé le car qui menait à l’aéroport, mais la circulation était dense, il était arrivé juste à temps.
Il se décida à ouvrir le sac pour regarder le contenu du dossier. La pluie avait un peu traversé, taché le dessus. Il défit l’élastique qui le maintenait, non, rien n’était mouillé. Il essaya de lire le titre, le début de ce qui ressemblait à un rapport scientifique, ou à une comptabilité particulière, mais sa tête était vide, les mots et les chiffres n’évoquaient rien pour lui. Comme dirait un informaticien : « Brain not found1»… Il dut refermer le dossier, on apportait des boissons, son voisin tendait le bras pour prendre un soda. Il faillit refuser, puis se décida à demander un café, il avait besoin de quelque chose de réconfortant. Il remit les documents dans le sac, descendit la tablette et dégusta lentement son café.
Son voisin le poussa légèrement en se levant pour aller aux toilettes, et il s’aperçut qu’il s’était endormi. Tant mieux, se dit-il. Mais il avait la bouche pâteuse, il manqua perdre ses lunettes et son imperméable était tombé de ses genoux. L’autre revint, il se leva à son tour. Dans la glace au-dessus du lavabo, il vit son visage livide, bouffi, il avait un regard vide, des cernes… Tant pis, je ne vais pas à un rendez-vous galant, il, ou elle, peu importe, me prendra comme je suis. Plutôt, il prendra le dossier… Il fouilla dans sa poche et eut un moment de panique : l’enveloppe où étaient les adresses et les numéros de téléphone n’y était pas. Il se souvint qu’il l’avait remise dans son imperméable après avoir présenté son billet, et revint aussi vite que possible à son siège où il examina le contenu de ses poches. Ouf, tout y était. Oui, c’était bien écrit là, un numéro de portable, il s’appelle Pietro Rosso, et il y en a un autre, « en cas d’urgence ». Et une adresse d’hôtel. Bon, j’ai tout.
L’avion amorçait son virage avant de descendre sur l’aéroport de Fiumicino. Atterrissage… Ouf, sauvé, se dit-il. Il se souvint qu’il avait toujours eu peur en avion. Bizarre, cette fois-ci cela ne m’a rien fait, je devais être trop fatigué, j’ai même dormi. À moins que cette peur ne m’ait quitté.
La sortie, il se retrouva dans le hall, se fit bousculer par des gens qui poussaient des chariots de bagages, il cherchait un téléphone… mais non, j’ai mon portable, il fonctionne ici, suis-je bête ! Il prit l’appareil et jura : il était déchargé. Bon, cherchons une cabine, est-ce que ça existe toujours ? Ah, mais, il me faut des euros ! Le bureau de change… il se renseigna, ouf, c’est tout près, il changea ses livres sterling, on lui indiqua un endroit où il pouvait charger son téléphone, il faillit renverser tout le contenu de son sac pour trouver le chargeur, mais finalement l’appareil daigna reprendre vie. Il composa le numéro.
Un homme lui répondit en italien, et, l’entendant bafouiller qu’il ne comprenait pas, passa à l’anglais. Monsieur Rosso, c’est moi, vous êtes… vous avez l’adresse de l’hôtel ? Allez-y, on vous recontactera. Où est-ce ? Pas loin de la gare de Roma Termini, vous prenez le train à l’aéroport. Une fois arrivé, vous traversez la place, c’est l’hôtel Chiagi, tout près de l’entrée des Thermes de Dioclétien.
Le train… ah, oui, je dois rejoindre Rome, bon sang, je suis complètement perdu, ou je deviens idiot, c’est vrai que les voyages ne me réussissent pas… Où vais-je ? Il devait acheter un plan, il se dirigea vers la librairie. Bon, maintenant, la gare ? Le panneau, c’est par là. Il tourna un moment, demanda son chemin, il avait totalement perdu le sens de l’orientation. Enfin, il arriva à la gare, prit un billet pour « Roma Termini », quel quai ? Ce doit être celui-là, c’est écrit sur le train. Il monta, s’installa et attendit, le wagon se remplissait petit à petit, et il finit par démarrer. Espérons que l’hôtel n’est pas trop loin, et que le type va m’appeler assez vite, que je sois débarrassé de tout ça… Alors, premièrement, je dois trouver l’hôtel, deuxièmement charger mon téléphone, qu’est-ce que je suis bête d’avoir oublié hier ! Enfin, avec toutes ces histoires… Je ne suis pas fait pour ce métier, on m’avait engagé comme comptable, et voilà qu’on me demande des choses bizarres. Mais c’est bien payé, je voyage en avion, ouais, bon, la galère, le monde entier voulait prendre le même avion que moi ! En plus, je tombe sur un gros qui me pousse, me pique l’accoudoir, pas confortable tout ça. Mais ce dossier, qu’est-ce qu’il a de particulier ? Laissons, ce n’est pas mon affaire, je me contente de faire mon boulot.
À son grand soulagement, il trouva tout de suite l’hôtel après avoir traversé la place, oui, nous avons une réservation pour vous, Monsieur Townsend. C’était joli, confortable, la réceptionniste était sympathique, et elle s’exprimait correctement en anglais. Il expliqua qu’on allait l’appeler, d’accord, on le guida vers la chambre, très claire, douillette. En temps ordinaire, il aurait jugé l’aménagement et l’harmonie de couleurs dans les tons rose pâle un peu chichiteux, avec les tableaux romantiques et les coussins à falbalas. Mais son état de fatigue fit qu’il se sentit rassuré dans cette bonbonnière, il n’avait qu’à attendre. Il accrocha son imperméable, brancha son téléphone portable et se risqua à regarder dehors, il avait une jolie vue sur des ruines romaines. Même s’il n’y connaissait rien, il se dit que c’était beau, un léger dépaysement, l’impression d’être vraiment en vacances... Cela le changeait, lui qui avait horreur de quitter Londres et son petit confort personnel et ne conservait que de mauvais souvenirs de congés scolaires en famille dans des stations balnéaires surpeuplées ou de déplacements professionnels dans des villes industrielles. Il referma la fenêtre, il ne devait peut-être pas trop se montrer, il avait vu des films de James Bond, un tireur embusqué en face… Bon, ne nous prenons pas pour l’espion vedette ! Je ne suis que le porteur de valises… et puis, est-ce que je fais quelque chose d’illégal ? Apporter des dossiers, c’est un peu bizarre à notre époque, tout peut s’envoyer par mail… Il y a peut-être des papiers qu’on ne peut pas scanner, ah, mais c’est vrai, il me l’a dit, il y a une pellicule photo là-dedans, une archive qui doit dater, une histoire de brevets, sans doute. En ce cas, cela doit concerner un médicament qui n’était pas fabriqué en Italie, ce doit être pour une demande de mise sur le marché, rien d’interdit. S’ils me font confiance… mais est-ce qu’il va appeler ?
Le téléphone sonna, enfin ! C’était celui qu’il avait contacté. On lui donna rendez-vous : Via Volturno, au coin de la Via Gaeta, c’est tout près de votre hôtel. Vous prenez le dossier, vous sortez, à gauche, au premier croisement vous verrez une boutique de souvenirs, entrez, regardez les rayons, vous mettez l’objet en évidence. On vous demandera si vous travaillez pour Monsieur Rosso, vous direz oui, vous le donnerez. Ne soyez pas étonné, je suis trop occupé pour venir maintenant, notre bureau est en banlieue, assez loin, ce ne serait pas pratique pour vous… Et la personne qui tient la boutique a toute notre confiance. On vous recontactera plus tard, vous devrez peut-être aller ailleurs pour toucher vos honoraires pour le déplacement, et éventuellement vous aurez un autre document ou un paquet à rapporter.
Il repéra l’endroit sur le plan puis se reposa une petite heure. Au moment de partir, il s’aperçut qu’il s’était mis à pleuvoir. À Rome, il pleut ! Quelle guigne… Bon, je suis obligé de prendre mon sac de voyage, le dossier serait mouillé. Il mit son imperméable, ferma le sac et sortit. Il trouva tout de suite la boutique, au coin de la rue, avec ses cartes postales et sa bimbeloterie en matière synthétique fabriquée en Chine ou on ne savait où exposées sur des présentoirs, protégés de la pluie par un plastique transparent. Il entra, fit mine de chercher un quelconque objet, repérant ce qui semblait le moins ringard, des reproductions de tableaux, de belles photos, entre deux casques romains en papier mâché et des maillots du Football Club de Rome.
Il n’y avait personne au comptoir, mais on entendait des bruits de voix provenant de l’arrière-boutique, une femme parlait très fort, dans une langue inconnue du visiteur, apparemment il y avait une grosse dispute par là. Qu’est-ce qu’ils ont, les gens, à crier comme ça ! Un homme s’efforçait de calmer son interlocutrice, qui peu à peu baissait le ton. Ces Italiens, on dit qu’ils sont agités, voilà la preuve. Mais est-ce que c’est de l’italien ? Ça n’en a pas l’air… Les voix se firent plus normales, puis s’arrêtèrent. Bon, va-t-on s’occuper de moi ? Il sortit le document de son sac, espérant qu’on allait comprendre pourquoi il était là.
Un jeune Asiatique qui semblait être le vendeur le vit, s’approcha, désigna le dossier qu’il tenait bien en évidence et lui demanda en anglais s’il venait pour « Monsieur Rosso ». Oui, c’est bien moi, voilà. Il tendit l’objet, l’autre le fourra de suite sous le comptoir et, comme deux touristes entraient dans la boutique pour se mettre à l’abri, lui montra une boîte contenant des gravures. Histoire de se justifier, il fouilla un instant dedans, acheta deux cartes postales, l’homme lui rendit la monnaie, lui dit : « en principe, vous pourrez y aller demain matin, mais on doit vous appeler pour confirmer le rendez-vous » et lui donna son ticket, en même temps qu’un papier où était notée une adresse, il les prit et sortit. La pluie redoublait, il courut jusqu’à l’hôtel, rassuré, il avait rempli sa mission.
Rentré dans sa chambre, il se rendit compte qu’il avait faim. Zut, je dois attendre l’appel… bon, il n’est pas très tard. Avec cette pluie, je n’ai pas regardé s’il n’y avait pas une sandwicherie à côté… Ah, mais, voyons dans le frigo, et ce petit meuble... Ouf, il contenait de quoi faire du thé, du café, des boissons fraîches et des biscuits. Il se servit et se sentit mieux, mais garda l’œil fixé sur le téléphone, comme s’il reprochait à l’appareil de ne pas sonner. Ne nous impatientons pas, j’ai remis le dossier, je dois aller à cette adresse, pourquoi faire, au fait ? Sans doute va-t-on me payer. À moins qu’ils ne me demandent de reprendre un autre paquet. Ah, non, ça suffit ! Si cela se trouve, ils vont m’expédier à Pékin ou à Oulan-Bator — il savait à peine où cette ville de Mongolie se situait, mais cela lui semblait le bout du monde, un endroit perdu, froid et hostile. Au moins, à Rome, il y a des choses à voir. Il repéra l’autre adresse sur le plan et feuilleta les guides touristiques de la chambre, oui, il pouvait visiter quelque chose, ou se promener, si la pluie voulait bien s’arrêter.
Ah, et aussi, il avait envie d’envoyer une carte à Madame Laurens, il tenait à être poli, et puis cette personne l’avait bien aidé, en plus elle travaillait sérieusement, ne bavardait pas, et elle ne lui posait jamais de questions indiscrètes. Avec elle, il était rassuré. Un matin, il était arrivé en retard à cause d’un accident de la circulation qui avait obligé son autobus à attendre. Elle avait coupé court à ses explications, en lui montrant le travail à faire, personne ne lui avait dit quoi que ce soit. Si l’on trouvait une erreur — cela n’était arrivé que deux ou trois fois — elle le faisait remarquer, sur un ton neutre, il en convenait bien volontiers, effectuait les corrections nécessaires, et il ne se passait rien de plus. Non, c’était quelqu’un de bien, pourvu que je puisse rester dans cette boîte, et dans son service ! C’était pour cela qu’il avait accepté ce voyage, après tout, Rome, c’est une belle ville, et ce n’est pas le bout du monde !
1 « Cerveau non trouvé ».
II.
Après plusieurs demandes d’autorisation, mots de passe et décryptages divers, le dossier de l’ordinateur finit par s’ouvrir, et Peter examina les fichiers, tout en récapitulant ce qui lui restait à faire. La commande était finalisée, le client avait gobé son boniment, un produit miracle, introuvable dans le pays et avait réglé, il n’y avait plus qu’à effectuer l’envoi. La publicité… c’est ça, je dois changer le code pour la remplacer… attention, utilisons l’autre compte Twitter, l’adresse IP n’est pas la même... Tiens, le concurrent a posté quelque chose sur LinkedIn, je vais brouiller sa pub… et je mets la nôtre… Ça y est. Bon, maintenant, appelons notre type pour l’histoire du dossier. Est-ce qu’il va répondre, aujourd’hui ?
Il composa un numéro, on répondit, et il discuta un moment, expliquant, décrivant, promettant… Apparemment, son interlocuteur se faisait tirer l’oreille. Mais on parla argent, et l’argument porta, affaire conclue. Je sais, je vous oblige à aller chercher l’envoi, mais vous n’étiez pas là, j’étais bien forcé de lui donner l’autre adresse. Oui, ne vous en faites pas, vous y allez, et lui, il passera demain, on lui a donné vos coordonnées, vous lui remettez… comme d’habitude. Non, pas d’inquiétude, il ne fera pas de difficultés, c’est la première fois qu’il effectue ce travail, on verra si on peut l’employer de nouveau. Et je préfère que ce soit vous qui le payiez, ce sera plus discret que dans la boutique, cela doit rester entre nous. Vous vous occupez du reste ? Je sais que je peux vous faire confiance, vous me contactez quand ce sera fait ? D’accord, merci beaucoup !
Il fallait toujours passer de la pommade à l’individu à qui on demandait un service un peu spécial : il était le seul à pouvoir le faire, il était le meilleur, on lui faisait une confiance totale, on le payerait rubis sur l’ongle… Surtout ça, lui, il marche au pognon, c’est plus simple.
Quelques instants plus tard, le jeune homme s’activait sur le clavier de l’ordinateur lorsque son portable sonna. Il consulta l’écran qui donnait l’origine de l’appel, un code composé de chiffres et de lettres. Ah, oui. Il ne répondit pas, remit le téléphone dans sa poche et se leva. Il entrouvrit la porte de son bureau et regarda dans le couloir. Ne voyant personne, il referma, tourna le verrou, alla se rasseoir et appela son correspondant. Après un « allo » laconique, il écouta, on lui expliquait quelque chose, il acquiesçait, disait « c’est fait », conclut par : « d’accord, tout est prêt », salua et raccrocha.
Rangeant son téléphone dans sa poche, il arbora un sourire satisfait. Tout se mettait en place, l’affaire allait être résolue, et dans ce cas, la concurrence pouvait toujours essayer de s’aligner !
Bon, puisque tout est réglé, je peux retourner à ma compétition… je suis en retard d’un niveau, il me faut rattraper ça… Pas question que je perde mon titre !
Peter ouvrit un site, composa son code et pénétra dans l’univers d’un jeu vidéo en ligne, dont les arcanes étaient incompréhensibles pour la plupart des internautes dotés d’un cerveau normal. Il examina les scores… il était encore en tête, mais attention, l’écart diminuait… Je dois m’y remettre à fond.
À présent, le monde n’existait plus pour lui, la planète pouvait bien changer d’orbite et l’équateur se positionner à la place des pôles, tant que le net fonctionnait, y avait-il encore une vie sur terre ? Hormis les tourelles, l’abîme hurlant, la brèche de cristal, et son champion vaillant et indestructible, il n’existait plus rien.
III.
Rome était toujours la même, immuable et vivante, grouillante de vie et méditative à la fois, il retrouvait des sensations anciennes, cette présence constante d’une histoire millénaire. Peu de choses avaient changé dans le centre, les monuments avaient été nettoyés, et il y avait encore plus de touristes, de vendeurs de souvenirs de pacotille, qui gâchaient un peu les lieux, mais ne déparaient pas l’ambiance qui vous étourdissait toujours autant. Il se décida à quitter la place du Panthéon, se dirigeant vers la Piazza de la Minerva, il trouvait sympathique l’éléphant qui supportait l’obélisque. Ayant en pensée salué l’animal de pierre, il regarda sa montre et marcha lentement vers la Via del Corso.
Le Superintendent Quint-William Rockwell, de Scotland Yard, appréciait cette parenthèse qu’il était en train d’ouvrir dans son existence peuplée de délits, de crimes, de personnages douteux, de secrets de familles sordides, de malfaiteurs dotés d’appuis financiers ou politiques puissants, de vedettes qui s’attendaient à ce que tout le monde leur manifeste des égards, y compris la police. Cette parenthèse, qu’il hésitait encore à appeler vacances, il la devait à son amie Alicia, la musicienne, sa « bonne copine » de toujours. Elle l’avait rencontré à Londres alors qu’il venait de travailler sur une enquête délicate durant laquelle il avait dû ménager plusieurs personnalités politiques et qu’il avait dû transmettre aux services compétents, ceux-ci devant la poursuivre à l’étranger. Il avait résolu toute l’affaire, mais n’avait plus le pouvoir d’arrêter lui-même les coupables, raison d’État… Alicia l’avait trouvé énervé, épuisé, vidé. Elle avait estimé qu’il lui fallait se déconnecter pendant un temps de son milieu professionnel, n’y avait-il pas une possibilité ? Car elle disposait de quelques jours de liberté, n’ayant pas de concert ni de tournée dans l’immédiat, son violon pouvait bien se reposer lui aussi.
Quint-William avait connu Alicia au conservatoire, alors qu’après la mort de sa mère il essayait de reprendre goût à la vie en se plongeant dans la musique. Son seul confident avait jusqu’alors été son piano, sa sœur, Ann, était encore très jeune et leur père s’occupait davantage d’elle. Mais il poussait son héritier à retourner à la faculté de droit, souhaitant qu’il prenne sa place dans son cabinet d’avoué.
Alicia, elle, émergeait tout juste d’une histoire de cœur embrouillée qui avait failli lui faire arrêter la musique, et Quint-William s’était trouvé là, cherchant à sortir la tête de l’eau, sentant bien que l’étude du piano en solitaire ne pouvait qu’élever le mur qu’il s’était bâti autour de lui. Chacun d’eux se raccrochait à l’autre, comme si cette mise en commun de leur tristesse leur permettait d’apercevoir une lueur d’espoir. Leur professeur leur avait suggéré de travailler la sonate de César Franck, avec laquelle ils avaient obtenu une récompense qui avait propulsé Alicia dans le milieu professionnel. Depuis, elle était devenue premier violon dans un orchestre et donnait parfois des concerts dans une formation de chambre.
Quint-William Rockwell avait essayé de reprendre le droit, mais rester enfermé en suivant une ligne fixée par les codes ne convenait pas à sa nature qui le poussait à l’action. Il s’était d’abord engagé dans l’armée, mais avait été par hasard témoin d’une affaire de meurtre, menée de main de maître par un officier de police chevronné, et s’était fait un ami en la personne du juge, un vieil Irlandais rusé, tout cela l’avait convaincu d’entrer ensuite dans la police. Cette décision avait beaucoup étonné son entourage, son digne père s’était déclaré déçu, et seule Alicia, qui avait tout de même été surprise, lui avait dit qu’il devait aller vers sa destinée sans se préoccuper de ceux qui voulaient choisir à sa place. Elle avait ajouté qu’après tout, ils étaient tous les deux amateurs de romans policiers, simplement elle n’avait pas envie de le voir fumer la pipe comme un certain commissaire Maigret… C’était Quint-William qui lui avait fait découvrir les ouvrages de Simenon.
Pendant un temps, ils s’étaient un peu perdus de vue, chacun construisait sa vie, et avait essayé d’avoir une relation suivie. Mais leurs professions respectives et la façon qu’ils avaient l’un et l’autre de s’y plonger tout entier faisaient qu’aucun d’eux ne pouvait ni ne souhaitait s’attacher. Il ne pouvait y avoir que quelques compagnes ou compagnons de passage dont aucun d’eux ne parlait. Et, un jour, Rockwell, sortant d’un séjour à l’hôpital durant lequel il avait appris le retour définitif d’Evelyn en Australie, avait assisté à un concert. Alicia était là, au premier violon. Sans réfléchir, il l’avait attendue à la porte de derrière, celle réservée aux employés et aux artistes. Elle n’avait pas eu l’air surprise, comme certaine qu’ils étaient faits pour se rencontrer, se retrouver, se perdre et se retrouver encore. Ce jour-là, ils n’avaient échangé qu’un bref bonsoir, avec quelques commentaires sur les œuvres du programme, mais c’était comme s’ils continuaient une conversation entamée quelques heures auparavant, ils ne s’étaient en fait jamais quittés. Et depuis, ils étaient toujours restés en contact, sans qu’aucun nuage de jalousie ou de manque vienne obscurcir leur univers. Leur petit secret, leur amour commun, c’était la sonate de Franck qu’ils n’oubliaient jamais de jouer lorsqu’ils se trouvaient ensemble, ou avec des amis mélomanes.
Dans la police, Rockwell avait découvert un monde qu’il ne s’imaginait qu’à moitié, fait de règles, de procédures — sur ce plan ses connaissances en droit l’avaient aidé — mais aussi d’états d’esprit différents, d’antagonismes, de bassesses, de sordide, de grandeur parfois, et de courage, en bref de tout ce qui fait le genre humain. Il s’était passionné pour la criminologie, la psychologie, et ses qualités de recherche et de jugement lui avaient permis de gravir très vite les échelons jusqu’à ce poste de Superintendent à Scotland Yard qu’il occupait à présent. Mais il y avait en plus la politique, les intérêts nationaux et locaux, les privilèges des uns et des autres… l’enquête qu’il terminait comprenait tous ces aspects, et le fait de devoir la transmettre à un service spécialisé, alors qu’il avait la solution en main, lui avait déplu. Aussi la proposition d’Alicia était-elle tombée à pic. Il pensait passer quelques jours avec elle dans sa maison du Wiltshire, près des alignements d’Avebury, mais un mail d’un ami en avait décidé autrement.
Le Commissario Capo Guido Panella était venu quelques années auparavant à Londres, pour un séminaire de criminologues organisé par Scotland Yard. Le Superintendent Rockwell y avait participé, et le policier italien s’était intéressé de près à ses méthodes, avait beaucoup discuté avec lui, et était en plus passionné de musique classique, ce qui prolongeait agréablement les conversations sur des sujets purement professionnels. Si Guido Panella avait les défauts d’un homme du Sud, un excès d’enthousiasme, d’impatience, une tendance à précipiter les choses, il s’efforçait de corriger ces défauts et avait une capacité d’analyse très rapide des situations. Depuis, il était resté en contact avec l’homme de Scotland Yard, était revenu à Londres et n’hésitait pas à lui demander conseil lors d’affaires un peu compliquées. À plusieurs reprises, il l’avait invité à Rome, mais jusqu’à présent Rockwell n’avait jamais pu se libérer. Cette fois, le mail de Panella était arrivé au bon moment. Quint-William avait demandé à Alicia si elle était déjà venue à Rome, celle-ci avait sauté de joie : elle y avait donné un concert, mais n’avait fait qu’un aller-retour, sans avoir la possibilité de voir grand-chose. Elle s’était composé un planning des lieux à visiter, avec ou sans son ami qui certainement allait passer une partie de son temps avec son homologue italien. Et comme lui connaissait un peu la ville pour y avoir séjourné quelques jours des années auparavant, chacun allait suivre son itinéraire personnel.
IV.
Thomas Hersten reposa le téléphone avec un soupir agacé. Un problème au laboratoire ! Il y avait eu une panne, un court-circuit… On avait perdu un dossier important, puis on l’avait retrouvé dans un autre bureau, et aucun employé ne se souvenait l’avoir déplacé. Il devait aller voir s’il ne manquait pas des papiers, encore que là-dessus il ne s’inquiétât pas trop, il possédait sur son ordinateur les doubles de tous les rapports d’expériences. Mais qui sait si un concurrent n’avait pas trouvé un moyen de se procurer une formule ? Même s’il connaissait tous ses employés, il ne pouvait jurer de leur parfaite honnêteté. Il fit prévenir l’ingénieur en chef qu’il allait venir pour examiner ces rapports sur un plan technique, et se rendre compte des dégâts.
Après avoir raccroché, il se leva pour prendre un gros classeur qu’il feuilleta, chercha un instant dans son ordinateur, coucha quelques signes par écrit sur un papier, et sortit son téléphone portable. Il secoua la tête, le reposa, et attrapa le fixe du bureau. Il composa un numéro, il sonna dans le vide, il en fit un second, un troisième... Cette fois, quelqu’un répondit, et il entama une conversation en allemand. Apparemment, on était parti chercher la personne qu’il voulait joindre. Finalement, il put lui parler, jeta un coup d’œil sur ses notes et la discussion s’engageait lorsqu’un signal retentit pour indiquer un autre appel. Il regarda de qui cela émanait, le mit en attente et reprit son interlocuteur. Il s’agissait d’un brevet, Hersten disait qu’il était d’accord, qu’il allait le faire parvenir, il fallait convenir du prix, mais la transaction devait se faire discrètement… La conversation s’acheva, il voulut récupérer l’autre personne, mais on avait raccroché. Il consulta sa montre et entreprit de sauvegarder ses travaux, avant de ranger les dossiers dans ses tiroirs.
Il avait la main sur la poignée de la porte lorsque son portable sonna. C’était Fux, enfin ! C’est toi qui m’as appelé ? Oui, je t’ai dit de le faire sur le portable, c’est plus discret. Alors, tu as donc reçu le mail ? Tout va bien, tes équipes peuvent le faire ? Tout est en règle, lui assura son homologue italien, tu peux me faire parvenir le microfilm de l’ancienne formule ? J’ai été retenu par un incident, mais je m’en charge, cela ne te concerne pas, c’est mon autre société, du coup j’ai été débordé. Non, mais je t’explique tout, je ne veux pas te cacher des détails.
Ce que lui raconta l’italien lui importait peu, c’était à l’autre de régler les petits problèmes matériels et humains. Quand il put reprendre la parole, son ton se fit cérémonieux : tu es le directeur, après tout, Fux, tu dois arranger tout cela au mieux. Écoute, mon cher ami, je suis suisse, je dirige un laboratoire à Londres, je dois rendre des comptes au bureau de Berne, l’Italie c’est toi en ce qui concerne la main-d’œuvre et la fabrication, et quant à ta société d’import-export de souvenirs d’Italie made in China, j’ai juste quelques parts dedans, je ne m’occupe pas de son fonctionnement. Et ne me raconte pas des histoires de syndicats ou d’inspecteurs du travail, je t’ai vu à l’œuvre pour les endormir. Verstanden ?2
Quand il s’énervait, Hersten ne pouvait s’empêcher de jurer en allemand, et il savait que son collègue comprenait. Ce Fux était intarissable, il fallait toujours lui raccrocher le téléphone au nez. Dire qu’il était le fils d’un ancien officier des gardes suisses du Vatican et d’une Italienne calabraise… il avait tout pris de sa mère ! Mais il ne pouvait se passer de cet homme qui était un excellent manager, parlant plusieurs langues, constamment au courant de tout ce qui concernait le monde des affaires, et qui savait faire travailler les autres. De plus, Hersten le connaissait depuis très longtemps, l’avait bien souvent vu à l’œuvre et se rendait compte que si l’on pouvait vouer ce personnage aux flammes de l’enfer dix fois par jour, il était impossible de lui en vouloir, il vous démontait tout de suite, n’opposant aux reproches qu’un visage rigolard, comme s’il confondait travail et amusement. En fait, il ne se fatiguait jamais beaucoup, c’était du moins l’impression qu’il donnait, mais son débit verbal et son argumentation étaient tels que le plus enragé des délégués syndicaux ne pouvait qu’acquiescer à ses propos avant de se précipiter sur une aspirine. Bon, espérons que tout est en ordre à Rome, que je puisse régler cette histoire de brevet ici.
Ayant raccroché, Hersten se rua vers l’escalier pour descendre au laboratoire où se trouvait l’ingénieur, Robert White. Celui-ci lui montra une lampe dont l’ampoule avait grillé, une prise électrique qui ne tenait plus dans le mur, et expliqua qu’il y avait eu une fuite d’eau, qu’il avait fallu déplacer tout le matériel et les rapports en catastrophe, afin que rien ne soit détérioré. C’était sans doute la raison du problème, le dossier avait été mis avec d’autres, en lieu sûr et au sec. Mais il n’y manque rien, je viens de vérifier. Il y a juste quelques pages qui ne sont pas dans l’ordre, je vais me charger de ça, ne vous inquiétez pas. Apparemment, tout allait bien, le nommé White, lui, n’avait pas du tout l’air inquiet, les travaux les plus importants n’avaient pas été interrompus. Le microfilm ancien que vous m’avez demandé ? Oui, je viens seulement de le retrouver, il faut que je fasse la copie, ce n’est pas long, je vous l’apporterai. Certainement, cet après-midi, sans faute, Monsieur.
Le Suisse respira, tout en pestant après le service de maintenance qui n’avait pas fait son travail. Une fuite d’eau, dans un laboratoire où l’on faisait des recherches de pointe ! Encore heureux que les appareils n’aient rien eu, qu’il n’y ait pas eu un court-circuit, cela aurait pu provoquer une explosion. L’ingénieur restait impassible, s’était rassis, surveillant d’un œil l’écran de son ordinateur, et fit signe de patienter à un collaborateur qui avait besoin de lui. Hersten paraissait agacé par l’apparente indifférence du technicien, mais après tout, ce n’était pas un endroit où l’on pouvait se permettre d’avoir des états d’âme. White l’assura que l’on allait tout réparer de suite. « Aber schnell ! » dit très fort Hersten, qui ajouta en anglais : « Vite, aujourd’hui, pas dans huit jours ! » sur un ton qui n’admettait pas de réplique. Puis il se tourna vers les autres employés et leur intima de se remettre immédiatement au travail, en tapant du poing sur la table. Avec un juron, il sortit de la pièce et remonta l’escalier. Les membres de l’équipe furent surpris : ce genre d’énervement n’était pas coutumier chez leur patron, qui d’ordinaire n’élevait jamais la voix, avec lui, il suffisait d’un regard contenant une lueur de reproche pour que la personne concernée se sente en faute. Deux manipulateurs plus âgés se considérèrent en écarquillant les yeux, puis se tournèrent vers Robert White qui haussa les épaules. Apparemment, il n’y avait rien à signaler.
Remontant dans son bureau, Thomas Hersten décida d’aller jusqu’à la comptabilité, il avait quelques factures à vérifier. Il frappa, pas de réponse, il entra, personne. Une femme sortit de la pièce voisine et lui dit que l’un des employés était en congé, mais qu’elle s’était chargée de ses dossiers. Son chef retint une parole de reproche, elle soutint son regard et lui expliqua que Monsieur… comment, déjà ? Enfin, le comptable, reviendrait après-demain, elle avait fait tous les bilans de la veille et vérifié ceux de ses collaborateurs. Mais j’aurai un peu de retard, évidemment. Je crois que vous pouvez me faire confiance, ajouta-t-elle d’un ton sec.
Hersten la regarda d’un air agacé, il ne pouvait se faire aux manières de cette femme autoritaire même avec ses supérieurs. Mais bon, elle connaissait son travail. Et puis, le type qui est absent, il avait sans doute des jours à prendre, c’est le travail de la directrice des ressources humaines, qui aurait dû prévenir.
— Très bien, Madame Laurens, mais appelez-moi si quelque chose ne va pas ou si vous n’avez pas le temps de finir. Monsieur Fux va m’envoyer par mail des pièces comptables de Rome, des choses importantes, ce sera pour vous, nous verrons ensemble s’il y a un problème. »
Il remercia poliment la responsable qui regagna son bureau. Réfléchissant, il se dit qu’il n’aimait pas beaucoup cette femme, mais il lui était attaché, professionnellement parlant. Également, elle avait quelque chose de rassurant, il n’arrivait pas à définir cette sensation, un côté… pas vraiment maternel, mais protecteur, il était le chef et elle l’employée, une cadre, tout de même, mais il n’avait pas l’impression d’un rapport hiérarchique, il ne se mêlait pas de son travail et elle ne faisait pas le sien, ils étaient complémentaires, elle était aussi scrupuleuse que lui, on ne badine pas avec les factures, les coûts de production ou les fiches de paye. Quel âge avait-elle, au fait ? La cinquantaine, à peu près, il ne savait pas si elle avait de la famille, oui, son fils… ah, si, une fois elle m’a parlé de sa sœur qui était hospitalisée, à part ça… Il y avait en lui une part d’agacement, il lui semblait qu’il dépendait d’elle. Non, il se reposait sur elle, en fait. Il aurait dû en être satisfait, mais sans doute avait-il besoin de faire sentir son autorité, et avec elle il n’y était jamais parvenu. Il aurait dû dès le début la considérer comme une collaboratrice, une associée, au lieu de faire semblant de respecter la hiérarchie. Chacun fait son travail, on n’a pas à chercher qui a barre sur l’autre.
Plus tard, dans l’ascenseur, il se souvint… tiens, ce comptable, c’était madame Laurens elle-même qui me l’avait trouvé, elle devait le connaître… Ah, mais, peut-être pas, elle s’était chargée de contacter une agence d’intérim, on avait dû lui envoyer cette personne. Oh, elle sait ce qu’elle fait, elle a dû le choisir sans se laisser influencer, traîner un boulet n’est pas son genre. Bon, je crois qu’il faut que je me dépêche pour le microfilm, mais White m’a promis de le faire aujourd’hui. Résumons… J’ai pu joindre le laboratoire allemand, l’incident du laboratoire va être résolu très vite, Fux m’a appelé. Tout va bien, je n’ai pas bien compris ce qu’il m’a raconté au sujet d’un petit problème, des colis endommagés, il avait reçu des Tours Eiffel « souvenir de Paris » au lieu du Colisée de Rome… Laissons, il en rajoute toujours, il a fallu absolument qu’il me précise qu’il pleuvait à Rome ! En quoi cela peut-il m’intéresser ?
Première Partie
Giuseppe Verdi,
Don Carlos, Air de Philippe II
&
Rigoletto, Air du Duc de Mantoue
« Comme la Plume au Vent »
I.
L’homme avait fait le tour de la Piazza Venezia, il commençait à monter les marches menant au Capitole et s’arrêta, essoufflé. Ses jambes tremblaient, il avait couru, n’avait pas voulu prendre d’autobus, d’ailleurs il n’avait pas de tickets, ne savait pas comment on faisait pour en acheter… Il se reprocha de ne pas s’être renseigné auprès de la patronne de l’hôtel, la seule personne qui avait été aimable avec lui. Tout à l’heure, complètement perdu, il avait demandé son chemin, un vendeur de souvenirs à la sauvette avait baragouiné quelque chose, heureusement en indiquant de la main la bonne direction, mais avait cherché à lui refiler une perche à selfies, il avait eu du mal à s’en défaire, il traînait son sac, tout tournait dans sa tête. Il s’appuya sur une rampe, des gens le bousculèrent, il redescendit et traversa l’avenue pour s’asseoir sur un banc. Allait-il rentrer à l’hôtel ? Il vérifia son portefeuille, il avait bien son billet de retour, son argent, mais il avait laissé des choses dans sa chambre… récupérer son pyjama et son linge de rechange lui parut soudain très important, il ne devait pas abandonner quoi que ce soit lui ayant appartenu, la police, ils ont les moyens d’analyser, d’en retrouver les possesseurs… et puis c’était ses affaires, son linge, on ne voyage pas sans slips ou chaussettes de rechange, il avait horreur de dormir sans pyjama, et il ne voulait pas avoir à racheter savon, rasoir et brosse à dents… Ces pensées qu’en d’autres circonstances il aurait jugées dérisoires l’obsédaient, il essayait de remettre son cerveau en ordre, il devait retourner à l’hôtel, peut-être lui avait-on envoyé un message. Et puis, on lui avait promis de le payer, il n’avait pas fait ce maudit voyage pour rien… Levant la tête, il embrassa du regard le panorama, se fit la réflexion que le blanc du monument à Victor-Emmanuel contrastait avec la couleur ocre des vestiges, ah oui ce n’est pas de la même époque, c’est vrai, je dis des bêtises. Il baissa les yeux et remarqua une tache sur sa manche de veste. Le tissu foncé empêchait d’en voir la teinte exacte. Il passa le doigt, il lui sembla que… c’est un peu rouge, mon Dieu, il faut que je nettoie, est-ce que ça va partir ? Je dois rentrer à l’hôtel, mais par où ? Il sortit son plan, parvint à repérer la Piazza Venezia. Oui, alors… il faut traverser, aller de l’autre côté, et c’est près de la gare, ça doit bien être indiqué…
Il se leva, ses jambes ne tremblaient plus, il lui fallait marcher doucement, il commençait à être fatigué. Bon, le mieux est d’appeler ce « Monsieur Rosso ». Il vérifia son portable, oui, il était chargé. Quelle heure est-il ? D’accord, faisons-le maintenant, le temps d’arriver à l’hôtel, si je me perds, je risque de ne trouver personne… Ah, non, c’est un numéro de portable, je pourrai au moins laisser un message. Mais autant le faire de suite, si on me dit d’aller quelque part... La sonnerie se déclencha, mais rien… un répondeur… il bafouilla, il fallait le rappeler tout de suite, c’était grave… Il se sentit abandonné, comme un aventurier au milieu du désert, qui meurt de soif… enfin, non, qui a froid, pas possible, c’est ça, l’Italie ? Il se rassit, réfléchit un instant, et reprit son portable. Ah, mais, on m’a donné un numéro « en cas de problème », il doit y avoir quelqu’un. Il respira un grand coup pour se calmer, et prépara son discours, il devait rester vague en ce qui concernait ce qu’il avait vu, mais il fallait qu’on le contacte.
Il tomba encore une fois sur un répondeur, une voix masculine s’exprima en italien, puis en anglais, on ne pouvait lui parler, on le priait de laisser un message. L’homme se rendit compte que l’on ne savait peut-être pas son nom, il le donna et ajouta « j’ai remis les documents pour Monsieur Rosso, au magasin de la Via Volturno, les a-t-on bien transmis à ce Monsieur ? On m’a dit d’aller à une autre adresse pour être payé, là il y a eu un problème, j’aimerais savoir ce que je dois faire. Appelez-moi, s’il vous plaît ».
Il se mit en marche, se demandant s’il avait bien fait. Mais ils devaient bien avoir son numéro de portable, de toute façon. Ah, mais oui, on l’avait contacté, mais non, c’était à celui de l’hôtel… Il faut que je parle à quelqu’un… essayons de joindre Madame Laurens.
Sa supérieure était la personne qu’il fallait, elle savait toujours tout. Oui, elle doit encore être au bureau.
Madame Laurens lui répondit, le rassura en disant que la chef du personnel l’avait prévenue, certes le jour même, mais elle avait dû rectifier des erreurs dans les tableaux de service. Elle lui demanda s’il allait bien, où il était. À Rome ? Quelle chance, il fait beau ? Profitez-en, vous êtes passé voir la Basilique Saint-Pierre ? Non, alors ne la manquez pas. Tiens, au fait, vous pouvez rencontrer Monsieur Fux, le correspondant de Monsieur Hersten à Rome, il est très aimable, un peu trop bavard, mais il vous recevra, et peut-être voudra-t-il vous recommander un lieu à visiter, ou un bon restaurant. Je vous donne l’adresse… Le téléphone aussi, je n’ai que le numéro du standard, mais dites que vous appelez de ma part. Je vous laisse, j’ai du travail. Bon séjour !
L’homme resta coi, Madame Laurens ne savait rien de son voyage ? Mais on lui avait remis des documents, au labo, en lui disant qu’il s’agissait non seulement de rapports d’expériences, mais également de pièces comptables, d’originaux très importants, comment n’était-elle pas au courant ? Elle croit que j’ai pris des jours de congé, alors ? Et est-ce que j’appelle ce Monsieur Fux, je ne le connais pas, si cela se trouve, il ne sait rien de ces papiers, et qui est ce « Monsieur Rosso » ? Ah, mais, peut-être y avait-il quelqu’un dans son bureau, elle ne pouvait pas me parler, c’est une mission « top secret » dont je suis chargé là, elle ne voulait pas qu’on l’entende… Est-ce qu’elle était fâchée que je l’appelle ? Elle a toujours le même ton de voix, non, elle n’avait pas l’air d’être dérangée par mon coup de téléphone… Il faut que je retourne voir le magasin de la Via Volturno... Et puis que je refasse le numéro d’urgence, peut-être pourra-t-on me répondre…
Il avait traversé la place, pris une rue qui montait, tourné à droite, et puis à gauche, ça monte, c’est vrai, Rome est bâtie sur sept collines, j’ai appris ça au collège, mais c’est fatigant, ça monte toujours… Via Nazionale, oui, j’ai vu ça sur le plan, tiens, il y a des autobus, mais je n’ai pas de tickets, je ne sais pas comment ça fonctionne ici, marchons. Tout au bout, une grande avenue menait à la gare, ouf, je ne suis plus bien loin.
Arrivé à sa chambre, il s’écroula sur le lit, ayant à peine pris le temps de jeter son imperméable sur une chaise et d’enlever sa veste. Non, il ne pouvait dormir, il lui fallait trouver une solution. Il voulait son argent, on le lui avait promis, ce qui s’est passé, ce n’est pas ma faute, j’ai fait ce qu’on m’a demandé, on me doit quelque chose. Même si ce n’est pas déclaré, même si c’est irrégulier, un travail, ça se paye. Dès le début, il avait flairé une affaire louche, mais là, en plus… oh, qu’est-ce que j’entends ?
Morris Townsend était glacé de terreur, dehors résonnaient des sirènes de police, du bruit montait par la fenêtre ouverte. Rasant le mur, il s’approcha, jeta un œil… ah, non, c’était une ambulance, et des policiers la précédaient. Quelle heure est-il à présent ? Appelons, est-ce que ça ne va pas énerver la personne ? Tout de même, c’est grave, et j’aimerais savoir pourquoi on me laisse comme ça en plan…
De guerre lasse, il composa le numéro « urgent », et, cette fois, on lui répondit. Il se présenta comme « ayant remis les documents pour Monsieur Rosso », plus tard on l’avait appelé, il s’était rendu à l’endroit indiqué… et il y avait eu un problème. Quel problème ? Un mort. Mais non, il ne savait pas qui c’était. Il était parti ? N’avait vu personne ? Si ? Bon, mais je n’ai pas le temps de m’occuper de vous, vous avez votre billet de retour ? L’Anglais protesta, on lui avait promis de l’argent, on n’allait pas le laisser s’en aller comme ça. L’autre maugréa, lui demanda s’il connaissait la Via del Corso. Une grande avenue qui part de la Piazza Venezia, vous la remontez, la deuxième petite rue à gauche, il y a une fontaine avec un personnage, sur le mur de la Banco Di Roma. Je vous y retrouverai, soyez patient, à partir de six heures, et si je ne suis pas là aujourd’hui à neuf heures, revenez demain. Pour que je vous reconnaisse, mettez une pochette rouge à votre veste. Oh, écoutez, achetez ça n’importe où, un bout de chiffon rouge, débrouillez-vous. Et attendez. Pardon ? S’il y a du danger ? Comment voulez-vous que je le sache ? Soyez au rendez-vous, c’est tout.
II.
Guido Panella était comme d’habitude débordé. Soucieux du détail comme il était, il ne pouvait rien laisser au hasard et voulait toujours tout contrôler. Sa nature aimable faisait qu’il passait son temps à s’excuser auprès de ses collègues et subordonnés, cherchant la petite bête dans les rapports, examinant toutes les investigations. On le voyait partout en train de gesticuler, de s’agiter, de fouiller, la responsable des archives avait un instant d’angoisse à chaque fois qu’il débarquait dans son antre, se doutant qu’il allait lui faire retourner des cartons datant d’on ne savait quand pour trouver une simple feuille de papier qui d’après lui avait une importance capitale aujourd’hui, là, tout de suite. Mais on respectait ses exigences, on se disait que ses stages à Scotland Yard l’avaient rendu méticuleux, et ses rapports de fin d’enquête ne laissaient rien au hasard.
Il avait prévenu tous ses collègues qu’il attendait un grand détective anglais, le Superintendent Quint-William Rockwell, de Scotland Yard, qui avait été son maître de stage, et les policiers italiens se précipitèrent tous à la porte lorsqu’un homme entra et demanda en anglais à rencontrer le Commissario Capo Guido Panella. Ce dernier arriva et présenta l’officier anglais à toute la brigade, puis emmena son ami à son bureau.
— Ah, Dottore ! — User de ce titre plutôt que d’un grade était pour lui plus respectueux — vous venez au début d’une nouvelle affaire. Bon, rien de très bizarre, un petit receleur qui a été trouvé assassiné. Vous plairait-il de nous accompagner ? On m’a prévenu à l’instant, l’équipe technique doit déjà être sur place, je dois y aller pour tout vérifier.
Rockwell ne pouvait refuser, d’ailleurs les manières du Commissario l’amusaient et cela allait lui permettre de visiter quelque peu la ville, de voir exister les gens, il ne pouvait admirer un monument ou un panorama sans se représenter comment on y vivait, les personnes qui l’avaient bâtie ou habitée. À la vue des ruines romaines, il imaginait tout un peuple évoluer, gérer, légiférer, les pierres n’étaient là que par et pour les hommes. Il suivit son homologue et monta dans sa voiture, le chauffeur le salua avec un large sourire, tout juste si les policiers italiens ne s’étaient pas disputés pour conduire le grand maître ès enquêtes anglais.
L’endroit n’était pas loin, près d’une voie de chemin de fer, une entrée de garage donnant sur une cour où s’ouvrait un hangar plein d’emballages vides entassés, de meubles, de palettes de marchandises de toutes les tailles. C’était un grossiste en souvenirs, lui expliqua-t-on, d’ailleurs certains cartons portaient des inscriptions en chinois, d’autres dans des langues inconnues du Superintendent. Le porche était barré, les équipes techniques étaient au travail. Panella devint calme tout à coup et avança prudemment dans le local quand on lui fit signe, Rockwell restant à l’extérieur et examinant les lieux.
Il trouva qu’il y avait un contraste évident entre ce bâtiment quelconque aux murs écaillés, un hangar où s’entassaient paquets éventrés, poubelles, outils, mobilier cassé, bimbeloterie sans valeur, et les deux immeubles qui entouraient la cour, anciens, de la belle couleur ocre de tout le quartier central de Rome, avec des fenêtres surmontées de linteaux et de tympans sculptés de style baroque, des balcons ouvragés fleuris. Il y avait là comme une verrue, comme un virus attaquant un corps parfait. Le policier qui avait conduit la voiture lui fit signe, il entra. Il se retrouva dans son élément professionnel, et s’il n’y avait pas eu les uniformes des Italiens, il aurait pu se croire en Angleterre à mener une enquête ordinaire. Panella discutait avec une femme qu’il lui présenta comme le médecin légiste. Elle n’avait rien de plus à constater qu’un décès par arme à feu, l’homme avait été abattu d’une balle dans la tête, mais le visage était resté à peu près intact, ce qui avait permis à l’employé qui avait découvert le cadavre de le reconnaître. Cet employé, un jeune à l’accent napolitain, s’était précipité aux toilettes pour vomir quand il avait vu la scène, puis avait aussitôt appelé la police en ne touchant à rien. Il s’était planté devant la porte du hangar, son gros souci avait été d’empêcher le chat du voisin d’entrer.
La victime était un homme d’une cinquantaine d’années, nommé Manzoni, connu comme un petit receleur et qui ne conservait son commerce que parce qu’il pouvait renseigner de temps en temps la police sur des affaires de concurrents, ou de drogue, chose qu’il détestait, il préférait se cantonner dans les pillages de déménagements ou de successions, les faux certificats d’authenticité, les transactions douteuses. Il avait un appartement qui communiquait avec le magasin, et un escalier extérieur menait à un débarras et à une chambre où il logeait son employé. Celui-ci s’était levé comme d’habitude, avait vaguement entendu du bruit, mais cela pouvait être les voisins, ils avaient des enfants très jeunes et assez remuants, il était descendu et s’était presque cogné dans un type qui sortait précipitamment. Comment était-il ? En imperméable, mouillé, il pleuvait un peu à ce moment-là, mais il n’avait pas vu son visage. Il avait appelé son patron, et avait trouvé le corps au fond du magasin, ça lui avait causé un choc. Bien sûr, il se doutait que les affaires qui se traitaient ici n’étaient pas toujours légales, mais enfin, les touristes, on leur fait passer une statuette fabriquée par votre copain de l’école de sculpture pour une pièce ancienne, on leur raconte que ce vase est récent, mais d’un style assez rare, et comme ça on leur fait payer plus cher. Oui, il y a des gens qui viennent apporter des objets, des paquets, quelquefois Monsieur Manzoni m’envoie faire une livraison, ou acheter des cigarettes, et il y a quelqu’un qui entre par l’appartement. Il me dit tout le temps que les clients, ça ne me regarde pas, c’est lui qui fixe les prix et s’occupe des factures... Il parlait toujours de son patron au présent, n’ayant pas encore réalisé.
Le policier qui avait fait office de chauffeur s’exprimait bien en anglais, aussi expliqua-t-il à Rockwell tout ce qui s’était passé, et ce qu’avait raconté l’employé. Ce dernier s’inquiétait, il ne savait pas s’il pouvait rentrer chez lui, on le calma, sa chambre avait une entrée indépendante, mais on fermait le magasin et l’appartement, et on le priait de ne pas quitter Rome. Il assura qu’il était à la disposition de la police, mais il ne connaissait rien aux documents, à la comptabilité, comme il l’avait dit, Monsieur Manzoni faisait tout lui-même. Lui, il rangeait, allait chercher, livrait, et il passait le balai. On le laissa prendre son scooter, un vieux modèle Vespa — c’était à lui, il se l’était payé, il avait les papiers, insista-t-il — et il précisa que la remorque était à son patron. Il gara l’engin dans le fond de la cour, le recouvrit d’une bâche, et sortit pour aller au café à côté.
Rockwell regarda un court instant le corps, c’était un petit bonhomme maigrichon mal vêtu, il avait été abattu d’une seule balle, et gisait dans une mare de sang, rien d’original. Panella interrogeait les gens de la police scientifique, s’excusant presque à chaque phrase, à son habitude, mais ne gênant pas leurs mouvements. Il sortit avec son ami anglais.
— Un crime dès votre arrivée, on va croire que vous attirez… oh, pardon !
Rockwell se mit à rire, mais non, il n’était pas superstitieux, ni susceptible. Il regarda la cour, l’allée, et demanda si l’employé avait remarqué quelle direction avait prise l’homme qui s’était enfui. Il avait traversé la rue, mais ensuite il ne l’avait plus vu, il ne lui avait pas couru après, il avait pensé à un voleur qui aurait entendu du bruit… Ce devait être ça, peut-être son patron l’avait-il surpris et l’autre l’avait-il abattu ?
Les deux policiers se regardèrent d’un air incrédule, un voleur ne tire pas sur sa victime. Il peut l’assommer — le receleur n’était pas bien costaud — ou lui donner un coup de couteau, mais se balader armé pour cambrioler un dépôt de magasin… En plus, on n’avait pas entendu le coup de feu, ou il n’y en avait eu qu’un seul, les gars sont en train de chercher s’il y a des impacts de balles. La détonation pouvait avoir été prise pour une pétarade de pot d’échappement, ou un bruit quelconque, à moins que l’on ne se soit servi d’une arme munie d’un silencieux. Non, l’assassin est venu pour tuer, ou pour menacer puis tuer ce Manzoni. Mais à quelle heure est-il mort ? Depuis quelques heures, assurait le légiste. Alors, le type qui est sorti est-il le coupable, un complice, ou un simple client qui a paniqué en voyant le corps ? Il faut le retrouver. Là, pas facile. Mes hommes sont partis interroger les voisins, et on va examiner les papiers de « cet honnête commerçant ». Je ne vous le propose pas, c’est fastidieux et en italien, mon collègue et moi allons rester dans le bureau, je laisse un agent devant le magasin pour empêcher les gens d’entrer. Je vous contacte, en tout cas, vous et votre amie venez chez moi après-demain soir, je vous préparerai un vrai dîner romain, les recettes de ma nonna,3vous m’en direz des nouvelles !
III.
Et encore un coup de téléphone ! Peggy Laurens ne décolérait pas : aujourd’hui, tout le monde avait décidé de la mettre en retard dans ses bilans ! Elle avait raccroché au nez de sa sœur, incendié la chef du personnel qui s’enquérait de ses dates de vacances. C’était bien le moment ! Alors qu’elle ne l’avait prévenue qu’à la dernière minute du congé de son collaborateur… Elle houspilla deux employés qui lambinaient trop à son gré, et parvint non sans effort à garder son calme quand Monsieur Hersten lui demanda si elle avait terminé. Non, elle avait reçu les renseignements trop tard, elle resterait pour les finir, mais il ne fallait pas qu’on la dérange. Et voilà qu’on m’appelle encore ! C’était le comptable, qui s’excusait, mais était toujours à Rome, un problème, il reprendrait l’avion demain, ou après-demain, il était désolé… Madame Laurens le coupa en lui disant que ce n’était pas le moment, mais bon, vous avez des jours à prendre, tâchez seulement de me prévenir quand vous rentrerez.
Justement, elle était sur les bilans qu’il avait dressés. Cet homme était compétent, mais il agaçait tout le monde à s’excuser pour tout et n’importe quoi. Comment avait-elle pu choisir ce mollusque, elle qui n’aimait travailler qu’avec des gens précis et sans état d’âme ? Ah, oui, c’était l’agence d’intérim, et on l’avait recommandé… qui, elle ne se souvenait plus, mais il avait, paraît-il, toutes les qualifications requises pour le poste. Il l’avait remerciée dix, quinze fois, il avait apporté un bouquet de fleurs à la chef du personnel, il était apparemment aux abois, il avait quémandé une avance de salaire… Bon, il travaillait correctement, rien à dire.
Tiens… il manque quelque chose, là… une facture ? Elle retourna le dossier et recompta les feuilles une à une. Oh, cela, ce n’est pas normal.
Elle prit le téléphone et appela Thomas Hersten, lui demandant de venir voir. Le directeur se fit un peu prier, mais arriva tout de même. Devant l’évidente erreur, il eut une expression bizarre, réfléchit une seconde, puis claqua des doigts et expliqua :
— Ce sont les documents de Fux qui manquent, je ne les ai pas encore reçus, il a eu des problèmes. Vous rectifierez plus tard, pour l’instant vous n’avez qu’à mettre… il lui indiqua une somme approximative, avec un libellé vague. Puis il sortit.
Peggy était très surprise. Hersten, lui, toujours si pointilleux, qui épluchait la moindre facture, le voilà qui aujourd’hui lui fait inscrire un chiffre inexact, dans la rubrique « fournitures ». Et ce n’est pas une petite somme…
Un moment plus tard, elle tomba sur des documents dont elle n’avait pas souvenance : billets d’avion, indemnités de déplacement, mais d’où cela sort-il ? Elle rappela Hersten.
Le Suisse resta calme, mais la fixa avec un air excédé :
— Vous vous contentez de pointer et de faire vos bilans, vous n’avez pas à chercher si un déplacement ou une facture de restaurant sont justifiés, tout de même ! Quand je vous donne une note libellée « fournitures », vous l’enregistrez telle quelle, c’est mon affaire, peu importe s’il s’agit de choses destinées au bureau ou au laboratoire, c’est tout !