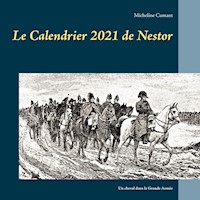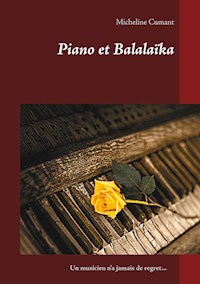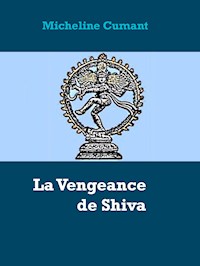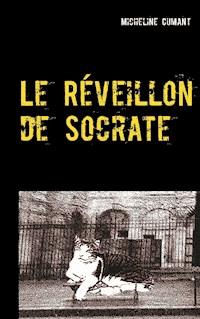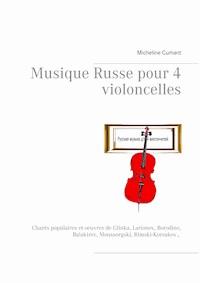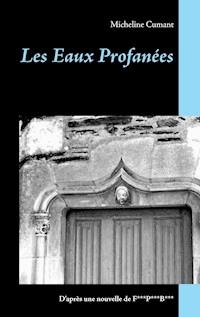Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Sonia a quinze ans, l'âge où l'on se découvre, mais où l'on se croit unique, et où l'on se culpabilise de ne pouvoir changer la courbe du destin. Au moment où des sentiments s'éveillent en elle, elle voit que sa soeur aînée, brillante étudiante qui a toujours été pour elle un soutien, un modèle, sombre dans une déchéance dont elle ne comprend pas tout de suite la cause. Elle s'en veut, elle en veut à son père, en même temps qu'elle vit une évolution de sentiments tendres pour une amie plus jeune. Dans une campagne pourtant paisible, où le cours de la vie est rythmé par la pluie et le vol des oiseaux qu'elle a appris à aimer et à considérer comme des présages, elle se sent impuissante et se reproche sa lâcheté. Seule, Sonia est seule à pouvoir affronter ce que vit sa soeur, ne faisant confiance à personne et ne sachant pas à qui ou à quoi attribuer la responsabilité de ce malheur.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 123
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
À la mémoire de
Pascal Besnier
Qui imagina le sujet de ce livre.
TABLE
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
I.
Il y avait encore de la lumière quand j’atteignis la maison. Dans le salon, mon père fumait en écoutant la radio. Du Mozart, ou du Haydn. Il devait m’attendre. Quand j’entrai, il m’examina.
— Alors, tu es encore partie ? »
Il avait dit ça comme si j’étais sa femme plutôt que sa fille. Il écrasa un mégot dans le cendrier qui débordait.
— J’avais besoin d’être seule, expliquai-je.
— Toute la journée ? Je sais que tu n’es pas allée au lycée. Et il est tard, ce soir. »
Il regarda la chaîne hi-fi, dont le métal et le plastique luisant reflétaient les ampoules.
— Tu t’es amusée, au moins ? »
Son ton était las, pas même cinglant. Il me regardait.
— Je voulais réfléchir, dis-je.
— Et ta sœur, et moi, dans tout ça ? » Fit-il en allumant une énième cigarette. La radio diffusait maintenant un allegro charmant, précieux. Je commençais à me sentir mal à l’aise. D’une certaine façon, j’aurais préféré être accueillie par une bonne paire de gifles. C’eût été logique. Plus que ces yeux tristes.
— Tu ne penses donc qu’à toi ? »
Je ne répondis rien. Je sentais que j’allais m’ennuyer, à écouter un sermon qui n’en finirait pas. Une gifle, ou une grosse engueulade, cela aurait passé très vite et ce serait fini maintenant.
— Je devrais te punir », dit-il du ton de ceux qui savent qu’ils ne feront pas ce qu’ils disent. À l’étage, j’entendis marcher. Élisabeth, ma sœur aînée. Il y eut un bruit de chasse d’eau.
— Bon, excuse-moi, fis-je, incapable de pouvoir dire autre chose.
— C’est tout ? »
Il se leva, demeura immobile près du fauteuil. Je sentis qu’il commençait à en avoir assez de cette conversation qui ne rimait pas à grand-chose. Il ne m’avait même pas demandé pourquoi j’avais fui. Il arrêta la radio, vint vers moi.
— Sais-tu que tu peux aussi te confier à moi, de temps à autre ?
— Je sais … Mais je préférais garder mes emmerdements par-devers moi.
— Regarde-moi », dit-il.
J’obéis. Ses yeux pâles étaient presque transparents. Je l’entendais respirer lentement, comme s’il cherchait à se contrôler. Mais ce ne devait pas être ça. Plutôt l’inspiration puis l’expiration d’une douleur qu’il absorbait mécaniquement, métronomiquement, plutôt, comme si elle revenait goulée d’air par goulée d’air, à un rythme constant. J’aurais voulu avoir un geste d’affection, n’importe lequel, un sourire, une caresse. J’avais l’impression que le corps de mon père s’usait à force de se heurter à mon refus d’extérioriser les sentiments que j’éprouvais envers lui. Il se rapprocha de moi, à me toucher. L’odeur du tabac l’imprégnait.
— Je te souhaite de pouvoir toujours régler tes problèmes en fuguant. »
Je fus décontenancée par son ton doux et mélancolique. Comme s’il sortait d’un songe.
— Moi aussi, murmurai-je.
— Maintenant, Sonia, va te coucher. »
Je ne cherchai pas à demander mon reste. Chaque marche de l’escalier me parut résonner dans toute la maison, bien que je m’appliquasse à rendre légers mes pas. Je n’avais pas envie de tomber sur ma sœur.
Je n’allumai pas la lumière en entrant dans ma chambre. Un peu de lune filtrait de dessous les volets. Je m’assis sur mon lit. Je repassais dans ma tête la scène que je venais de vivre. J’étais un peu inquiète de l’apathie de mon père. Il faisait frais, et j’avais l’impression d’attendre quelque chose. La maison était devenue totalement silencieuse. Je l’aimais ainsi, comme si elle était plus vaste et plus ancienne la nuit que le jour.
Mon père l’avait achetée après la mort de Maman, quand il avait décidé de déménager et de s’installer à la campagne. C’était un ancien presbytère Restauration, bâti en pierres de taille, avec une petite tourelle plus ancienne et un beau jardin cerné de murs. Une petite rivière passait non loin et allait se jeter dans la Loire toute proche. Les cloches de l’église du hameau rythmaient encore les existences. Et j’avais découvert que j’aimais les oiseaux, dont les chants, les cris et les bruissements accompagnaient nos journées, ils allaient et venaient des maisons aux champs proches comme pour nous dire de sortir, ou au contraire de rester à l’abri pour éviter la pluie. J’avais appris à distinguer les corbeaux, les merles, les rouges-gorges, les busards, les fauvettes et la nuit les hiboux. En ville, tous les oiseaux sont des moineaux ou des pigeons, plus quelques corbeaux. La gent ailée me tenait compagnie quand je partais dans la campagne. En fait, je n’aimais pas beaucoup les gens… Les oiseaux, eux, ne vous contredisent pas.
Mes parents s’étaient rencontrés juste après leurs études universitaires. Elle, traductrice d’anglais, lui, avocat, devenu depuis responsable du service juridique d’une compagnie d’assurances. Pourtant, des deux, il était le plus artiste. Quand nous étions nées, ils n’étaient plus tous jeunes. Ils avaient dû un peu bourlinguer avant de nous avoir, il y avait des photos d’eux en Inde, au Népal, en Afrique, en France sur des sites de fouilles archéologiques. Ensembles ou séparément, avec d’autres personnes que nous ne connaissions pas, ma sœur et moi. Il y avait surtout une photo discrète, dans un coin, entre une vue d’un paysage népalais et une grande carte postale représentant Manhattan, une petite photo qui devait avoir été prise en France, dans le Sud, sur laquelle on voyait ma mère habillée d’une de ces robes indiennes que portaient les hippies dans les années 1970, elle avait de multiples tresses et des fleurs dans ses cheveux longs. Mon père arborait une barbe et des cheveux longs, on ne le reconnaissait pas. Apparemment, ils avaient pas mal vécu. Ils n’en parlaient jamais, peut-être par pudeur. Ou parce qu’ils estimaient que cela ne nous regardait pas …
Ma mère avait été mince et jolie. Je ne l’aimais guère, son charme dont les gens parlaient n’agissait pas sur ses enfants. Elle devait surtout être maladroite, et je devais le ressentir. Sans doute avait-elle « finalement » fait des enfants pour faire comme tout le monde, à la limite – si elle avait été de ces « baba-cools » - pour être en communion avec la nature. Oui, bon, pour faire fonctionner ses ovaires. Mais bon, elle avait accouché dans une clinique correcte, pas sous la tente ou dans la nature pour faire comme les indiennes, elle n’était pas inconsciente. Après, tant qu’il s’était agi de jouer à la poupée, cela n’avait pas dû la gêner. Mais elle ne savait pas ni diriger, ni dresser, ni éduquer, ni faire obéir – ce n’était sans doute pas dans ses idées – elle ne parvenait pas à simplement être à l’écoute d’un être humain. Le courant ne passait pas. Ma sœur et moi, nous n’étions pas des révoltées, ni même des chahuteuses, mais simplement nous ne tenions pas compte d’elle, de ses avis, nous nous arrangions toutes les deux. En fait, notre seule marque de respect était de « ne pas déranger ». À son enterrement, il avait fallu que je me force pour prendre l’air constipé de circonstance. Mon père était différent. Plus sûr, plus fiable, je crois. Même si je ne faisais que commencer à le connaître. En fait, je n’apprenais à le connaître que depuis la mort de sa femme. Avant, il était seulement présent, mais n’avait jamais une opinion à donner. Il nous laissait nous arranger, ne donnant un conseil que de loin en loin.
Cet événement l’avait rendu un rien désabusé. Peut-être aussi y avait-il d’autres raisons. J’imaginais qu’il devait craindre pour son avenir, son travail, ses deux filles. Il devait aussi parfois se sentir seul avec nous. Seul pour tout assumer. Peut-être encore se disait-il qu’il ne menait pas la vie d’un homme de son âge.
En songeant à tout cela, j’avais fini par me déshabiller et me coucher. Dans le lit, j’allongeai mes bras le long de mon corps. Les draps étaient rassurants. Tous comme les peluches que je mettais sur le couvre-lit. Il y avait trois mois, pour mes quinze ans, je m’étais obligée à les faire émigrer du traversin au pied du lit. Une façon anodine de tourner le dos à l’enfance. Je m’endormis très vite, en serrant les poings.
II.
À partir de cette soirée du début du printemps, les choses se mirent à changer autour de moi. Pas d’un seul coup, mais par petites touches, pour autant que je pouvais m’en rendre compte. Ce fut à l’image de ces inondations, de ces éboulements, qui obligent parfois les gendarmes à barrer certaines routes : lent et sournois, la nuit de préférence. Comme si l’ombre était favorable à la montée des eaux, aux glissements de terrain, aux éruptions volcaniques, aux séismes, aux changements de la vie.
Mon père changea peu à peu ses habitudes. On le vit moins. Il rentrait plus tard, était parfois obligé de s’absenter une journée, voire deux, une tante venait s’occuper de nous. Il avait beaucoup de travail, oui, mais je crois aussi que celui-ci lui tenait d’un coup plus à cœur, comme s’il voulait oublier quelque chose. Quand on a quinze ans, on trouve trop compliqué d’aller chercher ce qui se cache dans le cœur de ses parents, et puis on s’en moque, on a déjà trop de mal à se trouver soi-même. Je n’essayais pas de comprendre mon père. Je me préservais, d’une certaine manière, il y avait des barrières que je n’avais pas envie de franchir trop tôt. Le monde adulte, je n’avais pas encore envie de le jauger. Même si je savais que j’allais promptement y vivre. Ma sœur, pas exemple, qui y était installée, paraissait mal le supporter. Depuis quelque temps, je la trouvais nerveuse, irritable, ou alors aux prises avec un grand trouble qui la mettait au bord des larmes, à tel point qu’elle courait parfois se cacher dans sa chambre. La pression des études lors d’une première année de médecine n’expliquait pas tout. J’avais la curieuse impression qu’elle s’était engagée dans un tournant sans fin, un virage qui se refermerait sur lui-même. Elle se modifiait. Quelquefois, elle avait de curieuses réactions.
Le lendemain de ma « fugue », je me rendis en classe comme si rien ne s’était passé. J’avais entendu mon père partir de très bon matin, et j’étais descendue prendre mon petit déjeuner en tête à tête avec Élisabeth.
— Ne recommence pas tes conneries d’hier de sitôt », m’avait-elle dit en guise de préambule. Mais, plus tard, avant que je ne parte prendre le car, elle m’avait retenue sur le perron, en me disant de ne jamais trop m’en faire. Elle me souriait, en disant cela. Elle ajouta qu’on pouvait toujours faire face. Sur le moment, je ne compris pas, j’étais pressée d’aller à la station de bus au centre du village.
Une dizaine de jours plus tard, un autre matin, alors que je cherchais mes livres de classe dans le fouillis de mon armoire, elle vint me trouver. C’était inhabituel qu’elle n’attendît pas, pour me parler sérieusement, le moment du petit déjeuner.
— Si je viens te chercher ce soir au lycée, ça t’ira ?
— Tu parles ! »
Elle s’était approchée de la fenêtre et regardait la pluie.
— Mais pourquoi ? Demandai-je.
— Oh, parce que j’ai envie de te parler seule à seule.
— Ah. »
Elle haussa frileusement les épaules. L’humidité était presque palpable.
— Puis, avec cette flotte, tu seras plus vite rentrée.
— Et tes cours ?
— Ils se terminent à quatre heures aujourd’hui. Décidément, je n’aime pas la pluie, fit-elle en se détournant de la fenêtre. On dirait qu’elle pourrait nous engloutir, tu ne trouves pas ? La grande crue finale.
— Tu as dû voir l’Arche de Noé en rêve ».
Sous sa robe de chambre, elle était nue. Je voyais nettement sa peau encore plus pâle que la mienne.
— Et si tu te couvrais, suggérai-je. Sinon, tu vas te taper un rhume de fesses »
Elle ne répondait pas et tourna les talons.
En fin d’après-midi, elle m’emmena dans un bar. Le serveur la connaissait et il y avait une télévision muette dans l’angle d’un mur. J’eus un peu honte de mon sac d’écolière que je planquai sous ma chaise..
— Tu viens souvent ici ?
— Parfois. Avec des copains. »
Jolie comme elle l’était, je savais qu’elle flirtait. Et plus, normal, à son âge, cela ne me gênait pas. Même si elle me serinait que j’étais « en retard pour mon âge ». Mais, cette fois, cela me fit mal de savoir qu’elle m’avait emmenée au même endroit où elle devait s’amuser « avec des copains ».
Elle commanda une bière, moi un thé.
— Ce que tu peux être bourgeoise ! Fit-elle, une lueur au fond de ses yeux bleus.
— Tu m’invites pour me dire ça ?
— Tu sais, je vais sûrement entrer en seconde année. Le concours a bien marché. »
J’eux une bouffée de chaleur. J’étais heureuse. Il me semblait que sa réussite estudiantine rejaillirait plus tard sur moi. Quelqu’un se leva en faisant grincer une chaise. Élisabeth était subitement devenue loquace, elle évoquait l’avenir, me décrivait le cursus des études de médecine avec tous ces sigles inconnus des non-initiés, propos qui venant de quelqu’un d’autre m’auraient fait bâiller. Mais c’était Élisabeth, ces instants étaient les siens, n’étaient pas comme les autres. Elle disait tout ce qui lui passait par la tête, sautant du coq à l’âne, des sciences médicales au club d’équitation qu’elle fréquentait, de la politique au temps qu’il faisait. Cependant, je doutais qu’elle m’eût invitée uniquement pour me faire part de sa réussite. Je me demandais si elle n’était pas en train de vouloir oublier les réalités du moment.
Elle commanda une autre bière.
— Tu aimes ça ?
Elle tourna et retourna son verre. La mousse monta, se referma sur elle-même. La télévision était à présent allumée, il y avait un vague chanteur avec une guitare noire.
— Parfois.
— C’est vraiment bon ? L’alcool, je veux dire. »
Ma question parut la ramener sur terre.
— Des fois. Mais la bière, ce n’est pas vraiment de l’alcool. »
Elle avait dit ça curieusement, avec une intonation mélancolique qui ne convenait pas à la banalité des propos. Je l’observai. Sa belle humeur s’était envolée. Son visage régulier s’ombrait sans raison apparente. J’eus un vague soupçon, informulé, informulable.