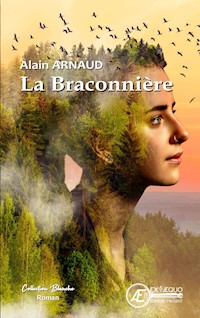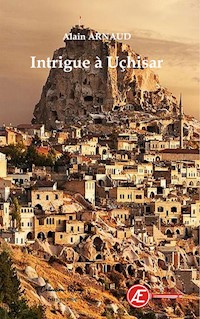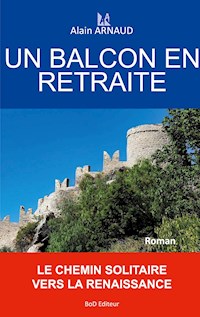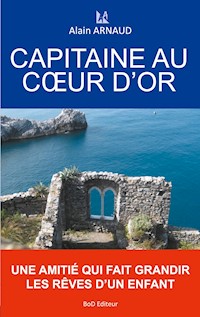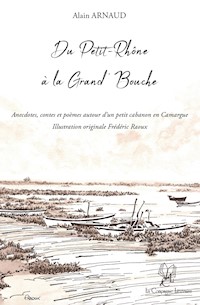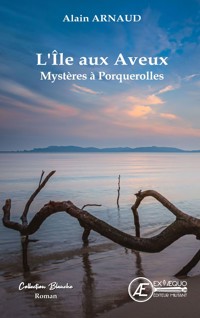
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ex Aequo
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Après une vie tumultueuse de séducteur au Québec, Angel Caseneuve s’installe sur l’île de Porquerolles, en quête de sérénité. Il va être confronté à la disparition inexpliquée du loca-taire précédent de la maison qu’il loue. Quel peut être le lien de ce journaliste d’investigation avec d’anciennes affaires politiques et certains décès non élucidés ?
Le nouveau résident fait lui-même l’objet de suspicion et de mystérieuses agressions.
Il va héberger, l’espace d’un été, une jeune élève infirmière dont la présence va mettre à l’épreuve sa conception particulière des relations affectives.
Venu sur l’île pour remettre de l’ordre dans sa vie, Angel va être ballotté entre épreuves, révélations et découvertes.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Alain Arnaud vit à Hyères-Les-Palmiers, dans le Var. Après diverses activités professionnelles de cadre et de diplomate à l’étranger, il se consacre depuis 2018 à sa passion pour la littérature.
"L’Île aux aveux" est son neuvième roman.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 280
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alain Arnaud
L’Île aux Aveux
Mystères à Porquerolles
Roman
ISBN : 979-10-388-1028-0
Collection : Blanche
ISSN : 2416-4259
Dépôt légal : juin 2025
© couverture Ex Æquo
© 2025 Tous droits de reproduction, d’adaptation et de traduction intégrale ou partielle, réservés pour tous pays.
Toute modification interdite.
« La vérité c’est comme la lumière, aveugle. »
Albert Camus
« Toute révélation d’un secret est la faute
de celui qui l’a confié. »
Georges Simenon
1
Deux malles, c’est tout ce qu’il me reste de visible, accroché au bât de ma vie. Le reste est enfoui en moi, en attendant que ne transpirent des sanglots de vérité, des victoires sur moi-même, des remords peut-être.
C’est aussi là que le bât blesse.
Lorsque mes malles touchent le sol sur le quai de Porquerolles avec un léger craquement, je comprends que je jette l’ancre dans un lieu inconnu, loin du Québec. Très loin de la grande ville de Montréal où j’avais trouvé refuge jeune homme et qui a aspiré cinquante-huit ans de ma vie dans sa bouillonnante termitière humaine, au croisement des cultures du monde.
Me voilà de nouveau devant le vide d’un avenir incertain. J’ai choisi d’en planter la graine sur une île que je ne connais pas. À portée raisonnable de mes terres natales occitanes que j’avais quittées sans réfléchir, poursuivi par une menace de mort.
Je reviens sur le tard vivre au pays, encore éloigné du village de mon enfance : Montréal dans l’Aude, planté sur une colline à vingt kilomètres de Carcassonne. Après avoir navigué inconsciemment d’un Montréal à l’autre — étrange destinée ! —, me voilà exposé au soleil éblouissant de la Méditerranée, convaincu que la pleine lumière réduira mes zones d’ombre et mes facettes obscures.
Je souris en regardant les porteurs soulever les lourdes malles et l’ombre minuscule qu’elles déplacent jusqu’à disparaître une fois posées sur la plateforme du véhicule.
Oui, le plus gros de mon passé, c’est moi, Angel Caseneuve, qui le transporte. Il me pèse aussi. Je veux croire qu’il trouvera le repos et l’absolution en ce lieu, dans l’anonymat de la foule en été et l’oubli en hiver, lorsque l’île s’éteint, se referme sur elle-même. Je me glisserai dans sa population enracinée et resserrée, qui survit à petit feu, avec l’espoir qu’elle me tolérera.
Une fois franchi le port, déjà actif en avril, je découvre le village. Son artère principale, la rue de la Ferme, est une longue fissure entre les commerces. Un rempart d’eucalyptus clôture la grande place voisine.
La place d’Armes est déserte, pareille à un miroir sans tain brûlé de soleil. Au fond, ivre de lumière, se dresse l’église coiffée d’un clocher, son torse rosé et son allure mexicaine. J’aurai tout loisir de découvrir plus tard ses battements de chœur et les ruelles qui l’irriguent.
Le triporteur vire à gauche après la place, en montée dans le chemin Sainte-Agathe. Je serre dans ma poche la clé de la résidence louée par l’intermédiaire d’une connaissance à Montréal.
L’offre avait claqué dans ma tête comme si l’on fracturait un verrou pour une évasion inattendue. L’envie soudaine de me libérer d’un passé pesant et séduit par le nom enchanteur des îles d’Or de la Côte d’Azur. J’ai choisi la plus grande, assez grande pour y creuser un discret sillon où abriter les rides de mes vieux jours.
Je m’éloigne de l’aventure outre-Atlantique pour une villégiature, un repos, un besoin de vie assagie.
J’avais saisi au vol l’opportunité : un Marseillais disposait d’une maison sur l’île. Le locataire était parti depuis quelques mois sans payer les derniers loyers ni laisser d’adresse. Le propriétaire recherchait quelqu’un qui prendrait soin de sa maison peu entretenue, à l’aspect vieillot, et l’accepterait en l’état, sans réclamer de travaux. J’avais compris qu’elle n’était pas adaptée au tourisme. L’appât avait aussitôt ferré mon attention.
Je suis parti sur un coup de tête, tout comme lorsque j’avais quitté la commune rurale de l’Aude enroulée autour de son église, pour la grande ville homonyme au Canada. Une séduisante métropole aux Amériques qui allie passé et modernité, sur une île robuste chaque jour battue par les flots impétueux du fleuve Saint-Laurent et leur course aveugle vers l’océan Atlantique.
Montréal était ma réalité ! Un refuge prestigieux que j’échange contre la promesse d’une île paradisiaque, bercée par la Méditerranée et ses vagues langoureuses. Un berceau pour mon vieil âge. Et peut-être, en filigrane, le rêve d’une renaissance !
Le temps du basculement est venu, car j’ai définitivement perdu l’ardeur aveugle de l’aventure et de ma jeunesse téméraire. Certes, j’avais été curieux et friand d’expériences, instable dans mes relations affectives, coureur de jupons autant que d’opportunités, souvent inconscient des risques. Désormais, j’aspire au calme, à enterrer les douleurs du passé et à me concentrer sur celles d’un corps vieillissant.
Les lendemains me diront si j’ai eu raison.
2
Au bord de l’étroite route en pente, à l’adresse indiquée siège une maison blanche d’un étage, une construction en dur des plus banales. Un rideau hirsute de pins et de bruyères mêlés d’aloès en protège l’accès, ouvrant un étroit passage vers un escalier. Trois marches de face suivies de neuf autres latérales hissent le visiteur jusqu’au balcon de l’étage où court une rampe métallique sur un muret.
Je découvre ma nouvelle demeure sans prétention. Plus haut, la route longe d’autres habitations. Elle se rétrécit en se hissant jusqu’au fort Sainte-Agathe qui veille sur le port et le village. Une végétation méditerranéenne dense protège les joyaux qui ornent la colline.
À l’étage, la porte donne sur une grande salle sombre. Un séjour-salon aux odeurs aigres de renfermé. Les deux porteurs hument l’air, froncent les sourcils et ouvrent des yeux ahuris. Ils déposent les malles sur le sol et repartent à la hâte, des frissons sur leurs bras musclés comme s’ils venaient de visiter une maison hantée !
J’ouvre les volets en bois déjà entravés de fines toiles d’araignée, puis les deux fenêtres de la salle. La lumière s’engouffre, envahit jusqu’aux recoins de la cuisine adjacente. Elle découvre un nouveau lieu à conquérir, traverse la pièce en gonflant ses joues. Je fais de même pour la chambre attenante et la salle de bains. Quant au cellier aveugle, il ne sera atteint que par les ricochets du soleil dans le couloir.
Le propriétaire m’avait informé de la présence, au rez-de-chaussée, d’un garage et d’un studio attenant, accessibles depuis la ruelle.
J’ai la sensation étrange de violer l’intimité d’une maison inconnue où je me serais introduit à la dérobée. En effet, le locataire est parti dans la précipitation, sans laisser d’adresse et en abandonnant jusqu’à ses affaires personnelles. Des livres sur les étagères, des portraits accrochés. Intrigué, j’ouvre un placard de la chambre. Quelle surprise d’y trouver deux vestes et trois pantalons suspendus, des chemises oubliées, et encore d’autres effets ! Une situation inattendue. Est-ce que l’occupant des lieux ne va pas revenir à l’improviste et me demander ce que je fais chez lui ?
Dans la salle, un cadre mural présente la photo d’un homme de taille moyenne arborant de fines moustaches. La chevelure légèrement grisonnante, le regard vif et une longue cicatrice dans le cou. Il tient dans les mains un journal de la région et me regarde comme s’il m’inspectait. Sa présence insistante me fait détourner les yeux.
J’en veux au propriétaire de m’avoir si peu informé sur son bien locatif. Sans doute par négligence. Peut-être tenait-il à faire occuper la place au plus vite et à ne pas s’embarrasser de détails. Je comprends mieux sa remarque jointe à l’envoi des clés : « Vous prendrez les lieux en l’état. Le niveau modéré du loyer ne me permet pas d’entreprendre des travaux dans la maison. » Il aurait au moins pu retirer les affaires du partant.
Sur le bureau en bois de pin disposé dans un angle, l’éphéméride est restée à la page du samedi 4 novembre 2023, jour de la Saint-Charles. Un carnet vierge abandonné à côté, ainsi que deux stylos à bille. De vieux journaux entassés en vrac dans un tiroir : Le Monde, Var-Matin, Libération… Dans un autre, je puise un paquet entamé de cartes de visite au nom de Léon Burgaud, journaliste d’investigation, 39 rue Doudeauville, 75018 à Paris. Je me dis aussitôt que je devrais lui écrire, lui demander de venir récupérer ce qui lui appartient. Non ! Plutôt oser l’appeler et gagner du temps.
Je compose sur mon téléphone portable le numéro de la carte de visite. Que vais-je lui dire ? Monsieur Burgaud, cher Léon, j’ai pris votre place ?
J’écoute le signal électrique creuser la brume parisienne, se contorsionner, grésiller un moment à la recherche du correspondant. Puis une voix neutre me martèle une réponse automatique : « Ce numéro n’est plus attribué. Veuillez consulter… »
Je raccroche, soulagé. Je m’immisce dans l’intimité d’un individu que je ne connais pas, qui ne me connaît pas. Je fouille ses tiroirs, ses placards. J’agis comme un intrus et je suis malgré tout dans mes droits.
Pour m’en convaincre, je reprends le trousseau de clés et descends les marches, jusqu’au garage. J’ouvre la porte en bois aux grincements lugubres sur ses gonds. Dans la caverne sombre, des vieilleries sont entreposées sur les étagères, des outils suspendus au-dessus d’un établi. Une brouette en appui contre le mur de gauche, les bras levés. Puis un brusque froissement d’ailes me surprend : deux chauves-souris s’enfuient. Elles avaient profité d’un mince passage dans le haut de la porte en bois pour occuper l’antre abandonné ; un refuge plongé dans la nuit permanente et l’oubli.
Sur le flanc droit, une porte fermée à clé donne accès à un appartement bien ordonné, un modèle réduit de celui à l’étage. Une partie salon et un lit double derrière une alcôve. Un minuscule coin cuisine et la salle de bains. Tout est propre et en ordre. Aucune affaire ne trahit de présence. Le placard est vide. Pas de doute : le locataire disparu vivait à l’étage.
J’ouvre l’unique fenêtre du studio, sur l’arrière de la maison. Les plantes sauvages bondissent dans l’espace libre, à l’assaut d’un nouveau territoire.
L’appartement ressemble à un abri cosy, à une cachette adossée au garage, à une grotte creusée dans la végétation. La peinture des murs est d’un jaune délavé, d’une couleur encore dans l’œuf, signe d’un lieu qui ne demande qu’à éclore.
Après ma rapide reconnaissance et l’assurance qu’aucune présence humaine ne subsiste, je récupère deux sacs en toile de jute dans le garage. J’y entasse les vêtements et les chaussures du locataire fantôme. Ensuite seulement, je m’attelle au déballage des malles, une manière de m’approprier la maison et de me rassurer.
L’aération à l’étage, aidée par une légère brise, a nettoyé l’espace qu’il me reste à domestiquer. Je referme les portes, pousse les fenêtres. Rassuré, je respire de larges bouffées d’air.
Entre ces murs défraîchis, je vais poser l’une après l’autre les briques de mes jours nouveaux et bâtir le décor de lendemains apaisés. Pendant ce temps, le soleil descend lentement vers l’Ouest, bien au-delà de l’île sur laquelle je me sens en sécurité. Une terre paisible entourée des douves naturelles de la Méditerranée.
Dans un placard de la cuisine, quelques bouteilles d’alcool entamées me tendent les bras. Est-ce un cadeau de bienvenue ? Sans hésiter, je me sers un verre de Casanis, l’apéritif anisé de Marseille.
Assis dans un fauteuil, je regarde l’étroite cheminée où dorment depuis longtemps deux bûches presque consumées, leur nez dans les cendres froides. Elles ont tricoté en silence les soirées de l’occupant précédent dont elles gardent sans doute les empreintes. Les reflets de sa silhouette dans les flammes sont depuis longtemps partis en fumée.
Je trinque avec moi-même, puis me ressers, ne serait-ce que pour me convaincre que je suis désormais chez moi.
3
Au petit matin, ma fenêtre s’ouvre sur un ciel sans échardes ni cicatrices, sous un toit sans frontières tapissé d’un bleu lumineux. Les grands pins du voisinage font craquer leurs articulations sous le jacassement amusé des pies. Les bruyères étirent leurs branches en fleurs vers le soleil. C’est mon premier jour dans un havre nouveau et l’accueil est étincelant de fraîcheur.
Que vais-je faire de ce jour de chance, de cette abondante nouveauté à brasser, à embrasser ? Devant moi se dresse un nouvel univers à conquérir.
À la fois ébloui et désemparé, un bol de café à la main, je m’approche du bureau. L’éphéméride est toujours bloquée au samedi 4 novembre 2023. Son mystère m’interpelle. Ma main droite frémit. Le café tangue. Les vagues étroites d’une marée noire imaginaire s’agitent, balancent en surface comme si elles tentaient de rompre les amarres du présent.
Je me raccroche à mon passé, à son cortège de souvenirs pareil à une longue traîne. À cette date, j’occupais un appartement trois-pièces à Montréal, entre le centre des affaires et le Vieux-Montréal, naufragé en pleine agglomération. Je songeais vaguement à revenir dans mon pays gaulois, sans plans précis. Une sorte d’intuition me hantait. Le temps était venu de partir. Mes attaches se défaisaient dans la grande ville. Plus d’amie intime. Mes rares relations se distendaient et des nuages sombres planaient encore.
L’âge et la lassitude m’éloignaient peu à peu de la gent féminine qui avait rempli mes jours et mes pulsions, et m’avait donné tant de plaisir. Tant de rencontres disparues, car je n’avais fait que papillonner, détourner des cœurs, picorer au hasard comme les poules, avec légèreté et inconscience. Encore que les volatiles laissent derrière eux de délicieuses pépites ovoïdes et font éclore des poussins. Quant à moi, il ne restera rien de mon passage. Je me sens désormais isolé et à l’étroit dans la métropole, au carrefour des migrations et des caprices du ciel.
Mais voilà, je n’ai plus personne au berceau familial de Montréal dans l’Aude, si loin du fleuve réel de ma vie. J’avais enterré mon père vingt ans plus tôt. Ma mère nous avait abandonnés pour toujours alors que j’avais huit ans. Elle était partie avec un Italien, travailleur saisonnier dans les vignobles. On avait perdu sa trace du côté de l’Italie.
Je ressentais pourtant un besoin vital de changement : m’éloigner de la grande ville et laisser décanter mes actes. Respirer le grand air moins pollué, loin de la foule en liesse.
Certes, le fleuve Saint-Laurent faisait de son mieux. Il nettoyait la grande île de ses scories et entretenait une termitière où pullulaient résidents, touristes, Français et étrangers en mal d’aventure, et bien d’autres égarés. Je commençais à m’y ennuyer, avec la crainte d’être rattrapé par mes erreurs passées, par l’ire de rivaux et de maris trompés.
Le temps est venu de me reconstruire : oublier le passé, me raisonner, domestiquer mon impatience et redorer le bouquet d’années devant moi.
Dans l’immédiat, le réfrigérateur et les placards de la cuisine sont vides. Un appel à consolider ma présence et ma santé physique. Et l’occasion de découvrir le village qui m’accueille sans lui demander son avis, sur une île inconnue qui sera mon cadre de vie et mon parc naturel.
Dans la rue principale, on ne prête guère attention à ma présence nouvelle. À l’exception d’une femme qui semble étonnée de croiser un homme grand, de belle allure, aux yeux bleus et au teint clair. À coup sûr un étranger venu d’un pays nordique, doit-elle se dire ! La dame n’est plus très jeune. Elle a pourtant conservé une réserve de charmes et l’œil quêteur. Je ne m’attarde pas. Je feins de ne rien remarquer.
Avant le port, la rue de la Douane est saturée de vélos, en rangs serrés devant les magasins de location. À l’évidence, le moyen privilégié pour visiter l’île. Les voitures sont interdites, à l’exception des indispensables pour le commerce, les fermes, les vignobles et les secours.
Libérés de leurs nuisances, les rues, chemins et sentiers appartiennent autant aux promeneurs qu’aux tourments des vents et aux rodéos de la poussière.
Le port semble niché dans une gueule de baleine. Il ne filtre ni krill ni sardines, mais, en ce mois d’avril, la maigre portion de passagers déversée sur les quais par la navette maritime. Après seulement dix minutes de traversée depuis l’embarcadère de la Tour fondue, à Giens. Un aspect rassurant auquel chacun s’accroche : savoir le continent si proche en cas d’urgence, et bien à l’écart à la fois.
Au cœur du village, je marque un arrêt devant ce qui s’impose comme un carrefour de paix et de recueillement : la place d’Armes luisante au soleil. Son arène vide. Il paraît que le feu qui tombe du ciel en plein été chasse les imprudents. Les boulistes viennent s’y frotter le soir, lorsque la lumière décline.
Tout autour, les préparatifs se remarquent déjà à l’agitation sur les terrasses. Bars, restaurants, hôtels et commerces se préparent au débordement de visiteurs.
La veille au soir, j’avais pris le temps de feuilleter un livre oublié sur une étagère : « À la découverte de Porquerolles — Île d’Hyères… et d’Aujourd’hui ».
Au dix-neuvième siècle, elle fut un centre de convalescence pour les soldats revenus des guerres coloniales. « De la conquête de l’Algérie à celle du Tonkin, de la prise du Dahomey aux sanglantes batailles de Crimée, les soldats vinrent se remettre ou mourir dans l’île. »
La place d’Armes servit de champ d’exercices à la garnison. La chapelle militaire, construite pour l’île-hospice, fut promue plus tard église. Elle côtoie un espace autrefois irrigué par le sang des blessés et une nappe rouge invisible gît pour toujours sous l’épaisse croûte du sol.
Alentour, épicerie et marchands de primeurs exposent leurs étals. Je remplis mon panier de bon cœur.
Le commerçant m’interpelle, l’accent chantant et le sourire enjôleur : « Est-ce que vous êtes en vacances chez nous ? Peut-être sur un bateau ? »
Je décline la vérité : « Je suis arrivé hier. J’habite désormais sur l’île. »
— Alors, bienvenu parmi nous. Et où est-ce que vous habitez ?
— Tout près, sur le chemin Sainte-Agathe.
— Ah bon ! Vous avez trouvé un logement par là ? dit-il, le regard curieux et insistant.
— J’ai repris la maison blanche, la première en montant.
— Ah !
L’homme a un réflexe de recul. Il baisse la tête, le visage froissé, suivi d’un silence.
— Bon, finit-il par reprendre. Tenez, votre ticket de caisse.
Il me semble que sa main tremble un peu.
Je range mes courses, salue le commerçant, les deux clientes derrière moi. Je m’éloigne, songeur.
Dans la rue, allégé un tant soit peu du fardeau de mes souvenirs, je me confronte à mon nouveau voisinage et aux questions inévitables. Mon expérience outre-Atlantique me servira de béquille ou de prétexte.
Sur le chemin qui me hisse jusqu’à mon refuge bordé de verdure, tout à coup s’enfoncent dans le sous-bois deux faisans et leurs couleurs enflammées.
De quoi ranimer la confiance en mes voisins !
4
À l’étage, je retiens au dernier moment mon geste : j’allais frapper à la porte. J’ouvre avec appréhension. Personne à l’intérieur. Sauf, peut-être, dans le garage, la compagnie des chauves-souris sous leur cape noire qui donnent à la maison blanche son air d’hospitalité de l’ombre. Non, mes affaires personnelles et mes empreintes n’ont pas encore marqué mon nouveau territoire au point de me sentir chez moi.
Les courses rangées, je me sers une bière avant de m’affaler dans le canapé, les yeux clos. Cette première sortie dans l’air vif du matin m’a épuisé. Déjà, quelques personnes ont repéré ma présence. Les villageois devront s’habituer à me voir, à me distinguer peu à peu des touristes.
Mon allure nonchalante et la mine souriante, affable, ne devraient pas choquer. Je répondrai autant que possible à leur curiosité sans cacher mes origines occitanes. Ni mon très long séjour dans la métropole portuaire du Saint-Laurent, au pied des rapides de Lachine. J’étais dans la plus grande ville francophone du continent américain qui suscite l’envie. Ils pourraient alors se demander ce que je viens faire dans leur modeste village, bien qu’il devienne, à leurs yeux, le centre du monde l’été.
En baissant les paupières, je revois défiler la date du samedi 4 novembre 2023, celle qui a libéré les lieux que j’occupe d’une manière impromptue. J’étais encore dans l’insouciance de Montréal et de son atmosphère unique, un mélange d’Europe et des Amériques. Pourtant, je manquais d’horizon et de souffle nouveau à refaire toujours les mêmes circuits, du quartier international à la vieille ville, des théâtres au Quartier latin et son université UQAM du Québec. Autant de lieux, de bars et de restaurants balisés de souvenirs. De rencontres féminines déplacées ailleurs par la vie. D’amis disparus, emportés par l’âge ou la maladie.
Je ne regrette pas mon départ. Je n’en pouvais plus de vivre ainsi, de piétiner les ombres du passé en attendant mon tour. Je prolongeais mes heures dans les galeries boréales, à contempler les sculptures inuites, la transparence et la luminosité de la stéatite, de la serpentine, la courbure travaillée des os de baleine ou de caribou. Je me répétais, à déjeuner sur le pouce dans un buffet du quartier chinois ou à flâner sur le Vieux-Port.
Je me rappelais alors l’éclosion non préméditée de mon aventure québécoise. J’avais vingt et un ans, un corps épanoui et le désir de le partager. J’étais ouvert aux conquêtes les plus osées. Mais voilà, rapidement je fus menacé du pire par un mari furieux, un boulanger de Carcassonne. Je visitais son épouse la nuit, lorsqu’il était à son fournil. Une Espagnole au corps ferme et désirable. Elle avait le croustillant du pain, la peau brune raffinée. Le sourire festif, racoleur. Je ne pouvais rien lui refuser. Elle m’avait tendu discrètement un double de clé de la porte arrière.
Une expérience troublante et dangereuse. Une exception dont je garde le souvenir vague de nos ébats explosifs, de sa jouissance volcanique. Hélas ! Le mari s’est douté de quelque chose. Il a fouillé la petite poubelle où sa femme jetait ses cotons de démaquillage. Il a trouvé au fond des préservatifs garnis d’une sève jeune, encore bouillonnante.
L’homme l’a brutalisée et lui a fait avouer sa trahison, puis le nom de son amant. Il m’a menacé de mort.
Un ami d’enfance m’offrait l’hospitalité loin de chez moi, au Canada, à Montréal. Sans hésiter, j’ai fui le danger, me jurant d’être plus prudent, à l’avenir, avec les femmes mariées.
Inconsciemment, l’attraction et la complicité des corps prêts au partage l’ont toujours emporté sur le statut conjugal. Un défaut incorrigible. J’étais comme un agrume, un fruit des quatre saisons à l’écorce épaisse et au cœur pulpeux que je partageais avec générosité. D’autres complications naîtront de cet état de fait. Mais un travers plus aisé à dissimuler dans la mégapole québécoise.
Je m’efforce de semer peu à peu ce passé sans gloire d’aventurier, d’adepte de la communion des corps. J’explore mon île salvatrice, les ruelles du voisinage, le passage étroit et tranquille de la traverse Roussy. Je longe les portails en bois, les cascades de bougainvillées sur les façades. Sous mon regard ébahi foisonne un monde silencieux, tandis que le soleil détruit les ombres sur mon passage.
Lorsque je me hisse plus haut sur mon chemin, je bute contre le fort Sainte-Agathe de François 1er, bardé de hauts murs de pierre, d’une épaisse carapace endormie.
L’édifice domine le port et le feuillage de tuiles en terre cuite patinées d’ocre et de brun des maisons alentour. Du haut de sa tour, on embrasse l’immense croissant de terre de l’île. Sur sept kilomètres d’envergure se dessinent clairement les vignobles, d’autres forts éloignés, les chemins engloutis par les bois, jusqu’aux vastes plages et le phare, au sud, dont la vigie illumine la nuit. À l’image de la société, chacun tient son rôle.
Étrange perspective ! En fermant les yeux, j’imagine que la lune blafarde projette sur la mer le spectre mouvant de Porquerolles et sa forme de chauve-souris géante qui hante la Côte d’Azur. Le mammifère regagne ensuite sa place aux premières lueurs de l’aube. Et le morceau de terre détaché de la Provence jette l’ancre, reprend sa vie normale. Puis le cœur du village palpite de nouveau. Les bateaux vont et viennent dans la main tendue du port comme dans une ruche.
C’est là que ma vie va s’incruster, creuser sa place et faire battre son ombre minuscule forgée par les rayons aiguisés du soleil.
5
Chaque jour nouveau est un miracle ouvert sous les éclats éparpillés du soleil, parmi la végétation accueillante aux feuillages vert doré. Au bas des escaliers, un tapis d’aiguilles de pin m’accueille pendant que les oiseaux éclaboussent de leur liberté les frondaisons.
Quel étonnement de n’avoir plus les grands murs de la ville devant les yeux ni le bourdonnement des moteurs dans les oreilles ! Habiter une île quasiment sans pollution réjouit les poumons et remplit les yeux d’excitation.
Les commerçants de la place s’habituent à mon manège paisible et à mon air contemplatif. La nouveauté qui m’entoure est, dès le matin, une réjouissance.
En revenant d’un pas flâneur dans la rue de la Ferme, une femme, devant moi, avance les bras chargés d’un pack de bouteilles d’eau et d’un lourd panier. Je la rejoins et lui propose mon aide.
— Ce n’est pas de refus, dit-elle en se retournant, le souffle court. Je ne vais pas très loin.
Je reconnais la dame brune, longiligne, au profil agréable. L’allure élégante, elle est vêtue d’un chandail rouge et d’un pantalon de toile moulant. Je me souviens de son air curieux, le premier jour où je rôdais autour de la place. Son regard m’avait épinglé et observé un moment.
Les bras soulagés, elle expire de plaisir, ravie de ma galanterie. Elle me montre la voie, souriante. Elle pointe les villas qui bordent la maison du parc national et le jardin botanique.
Est-elle en vacances ou en résidence sur l’île ? Alors que je progresse avec ses lourds paquets, la réponse vient naturellement.
— J’habite la maison bordeaux devant nous, depuis déjà cinq ans. C’est un héritage de mes parents.
Alors que je dépose ses courses sur son pas-de-porte, elle s’agite.
— Vous n’allez pas partir comme ça, voyons ! Je vous offre un verre. Un café, un thé ou une boisson fraîche. Vous l’avez bien mérité.
— Je n’ai pas fait grand-chose. Quelques centaines de mètres seulement pour vous soulager.
— Mais c’est déjà beaucoup. Allons, entrez ! Suivez-moi.
Je reprends les paquets et les dépose dans la cuisine. La maison est moderne, confortable, sans comparaison avec la mienne d’un autre âge. Pourtant, je préfère de beaucoup ma vue sur la verdure à sa ruelle sombre. La maîtresse des lieux me conduit au salon, jusqu’à un fauteuil près d’un lampadaire qu’elle allume, peut-être pour mieux me voir. La pièce est luxueusement meublée, accueillante.
— Qu’est-ce que je peux vous servir qui vous ferait plaisir ?
— Un café noir suffira.
Son sourire élargi en dit long sur la satisfaction de m’avoir attiré jusque dans son repaire. Elle semble aussi précéder mes interrogations silencieuses.
— Je vis seule et je n’ai pas souvent de visite. À vrai dire, je ne pensais pas passer ma retraite ici, après une vie active de comptable dans une petite entreprise de Gap, dans les Hautes-Alpes. Le village manque cruellement de divertissement. Avec le temps, je m’y habitue par force. Je me résigne, peut-être comme les autres habitants. Et l’arrivée des touristes est plus une gêne qu’un enchantement, sauf pour les commerçants.
Elle prépare le café, des biscuits secs, puis prend place en face de moi. Quel contraste entre ma masure défraîchie et cette resplendissante villa, sans doute trop grande pour une personne seule !
— Je m’appelle Réjane. Et vous ?
— Angel.
— Vous pouvez m’appeler par mon prénom et je ferai de même, si cela ne vous dérange pas. Nous serons amenés à nous revoir souvent dans le village, autour de la place d’Armes. Elle paraît déserte et immense au premier abord, mais tous les îliens s’y rencontrent et parfois s’entendent.
Réjane prend un air malicieux. Lorsqu’elle m’avait observé avec insistance près de la place, était-ce par simple curiosité ou pour une autre raison ? Je n’ose pas le lui demander, mais sa familiarité avec un inconnu m’intrigue. Elle est plus jeune que moi et son physique bien conservé ne manque pas d’attrait.
— Je vous ai déjà aperçu dans les rues, dit-elle comme si elle devinait mes pensées. Est-ce que vous êtes parmi nous pour quelque temps ?
Sur mes gardes derrière ma tasse de café, je m’attends à un interrogatoire. Après tout, mis à part les échanges banals et courtois avec les commerçants, j’ai peu l’occasion de discuter avec les autochtones. Je ne connais de l’île que le contenu historique d’un petit livre.
— Oui, je viens de m’installer. Je ne sais pas encore pour combien de temps.
— Je m’en doutais. Vous n’êtes pas de la région.
Réjane semble soulagée. Son regard brille. Espère-t-elle me convaincre de rester longtemps ?
— J’arrive de Montréal. J’ai vécu l’essentiel de ma vie au Québec, mais je suis Français, originaire du Sud-Ouest.
— Est-ce le hasard ou une raison précise qui vous a conduit jusqu’à nous ?
Elle repose sa tasse de thé fumante et m’observe, impatiente d’en savoir plus.
— Je dirai plutôt le hasard. Enfin ! Une opportunité.
— Eh bien ! Vous m’en direz tant. Pour ma part, j’avais le choix entre vendre, louer ou habiter la résidence de mes parents sur l’île. Le côté affectif l’a emporté.
— À chacun ses motivations.
J’ai terminé ma tasse de café, avec le sentiment qu’il me sera malaisé de quitter aussitôt le fauteuil chaud de mon hôtesse.
— Racontez-moi. Vous avez dû avoir une vie trépidante au Canada, le pays de nos cousins et des coureurs des bois. Quelle était votre occupation ?
— Oh ! J’ai fait plusieurs métiers très ordinaires : couvreur à la belle saison, je veux dire réparateur de toitures, puis bûcheron, mais aussi serveur dans les bars et les restaurants. Rien de particulièrement exceptionnel, vous savez.
Je ne lui parle pas d’autres expériences telles que videur de boîte de nuit ou un temps gigolo, profitant de mon succès auprès des femmes.
Elle ferme un moment les yeux, peut-être pour m’imaginer dans ces emplois inattendus. Puis elle efface mon passé de deux battements de cils pour reprendre de plus belle, davantage intéressée par le présent.
— Et où habitez-vous désormais ?
— Sur le chemin Sainte-Agathe.
— Dans l’une des maisons attenantes plus haut, sans doute ?
— Non, dans la maison blanche isolée, à gauche en montant.
— Dans la maison du disparu ?
— Je ne connais pas celui qui m’a précédé. Il serait parti sans laisser d’adresse…
Elle sourit.
— On peut le voir comme ça. Il a disparu un matin sur sa barque, sans bagages. Il faut dire qu’il avait l’habitude de sortir en mer, parfois pour se baigner ou pour pêcher, toujours seul. Il y avait du vent d’ouest ce jour-là, paraît-il. C’était en novembre dernier, si je me rappelle bien. On ne l’a jamais revu.
— Est-ce qu’il aurait eu un accident en mer ?
— Personne ne sait. Les recherches n’ont rien donné. Il n’avait rien emporté avec lui.
Sans le confesser à Réjane, je comprends mieux pourquoi j’ai retrouvé autant d’affaires personnelles du disparu.
— C’était un journaliste, semble-t-il.
— À vrai dire, il était très discret. Il fréquentait peu les gens d’ici. Parfois, il recevait une courte visite de l’extérieur, une ou deux personnes de passage. Certains disent qu’il écrivait des livres…
La bouche entrouverte, après quelques instants, elle reprend :
— Deux jours après sa disparition, la maison a été cambriolée, les placards et son bureau fouillés, son ordinateur dérobé. On ne connaît pas la valeur sentimentale ou professionnelle de ce qui a été volé. La gendarmerie est restée muette sur l’enquête.
Des passants discutent à voix haute dans la ruelle voisine. Leurs échos nous parviennent par la fenêtre ouverte et distraient notre attention. J’en profite pour me lever.
— Vous m’excuserez, mais je dois vous quitter. Merci pour le café. Il était très bon.
— J’espère que nous aurons d’autres occasions de nous voir et de partager un verre ou un repas. Merci encore de m’avoir rendu service. Une femme seule a besoin de soutien.
Malgré son air désolé de me laisser partir, je referme la porte, contrarié par ce que j’ai appris : la disparition mystérieuse de mon prédécesseur et un cambriolage inexpliqué. Mais aussi soulagé d’être parvenu à m’évader du logis de Réjane, une femme-ventouse qui n’aspirait qu’à me retenir.
Un vol de goélands passe au-dessus des toits en piaillant. Que se disent-ils ? Ils s’éloignent vers la mer et la liberté, tandis que je retourne à mon gîte avec des pensées embrouillées.
6
Avant que la nuit ne vienne clore les volets sur l’horizon, je contemple depuis le port l’immense perle d’or qui roule sur l’Ouest, écrasant les collines sur son passage.
Le coucher du soleil répète son tour de magie.
Au-delà de la presqu’île de Giens et de son museau au ras de l’eau, la vie semble s’arrêter lorsque la nuit affale ses voiles. Dans les marais salants et les étangs de la côte, les flamants roses cessent leur danse. La journée éblouissante se referme sur le silence et les lucioles de la cité.
Bien qu’un mince filet d’air froisse encore les draps de la Méditerranée, c’est déjà l’amorce d’une paix nocturne.