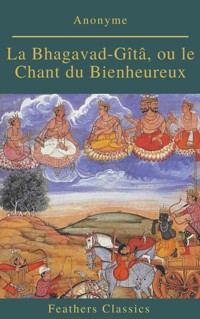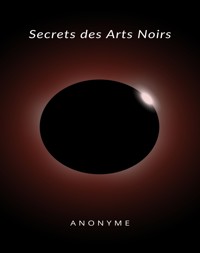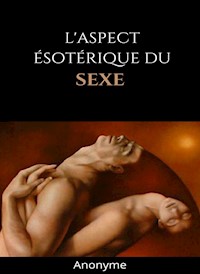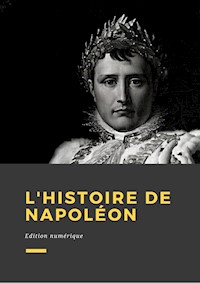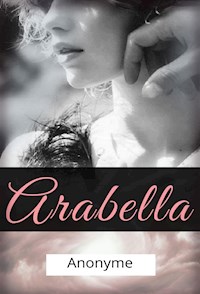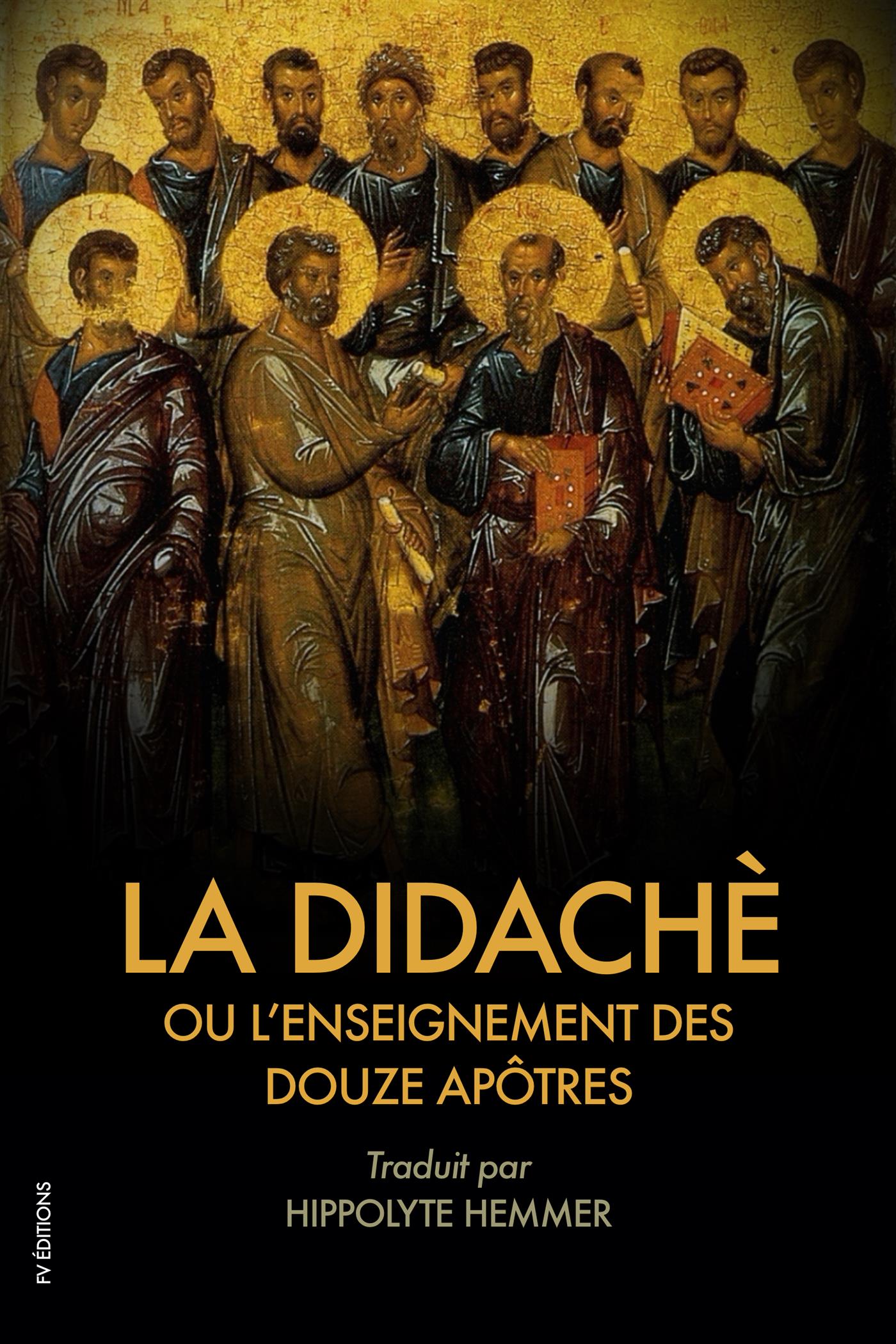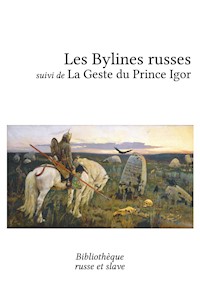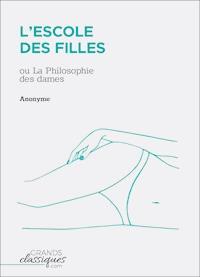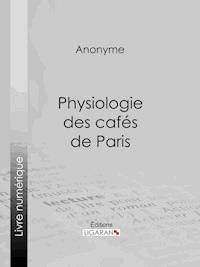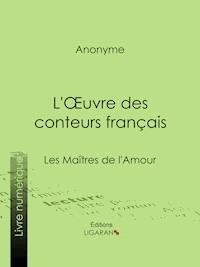
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
"""L'Oeuvre des conteurs français"" est un recueil fascinant qui nous plonge au cœur de la tradition orale française. À travers ces pages, nous découvrons un univers riche en histoires, en légendes et en contes, transmis de génération en génération par des conteurs anonymes.
Ce livre nous offre un voyage à travers le temps et l'espace, nous transportant des terres mystérieuses de Bretagne aux ruelles animées de Paris. Chaque récit est unique et captivant, nous emportant dans des mondes fantastiques où se mêlent magie, créatures mythiques et héros légendaires.
Les conteurs français ont le don de captiver leur auditoire avec leur talent narratif exceptionnel. Leurs récits sont empreints de sagesse, de poésie et de profondeur, nous invitant à réfléchir sur des thèmes universels tels que l'amour, la mort, la justice et la quête de soi.
Ce recueil est une véritable mine d'or pour les amateurs de littérature et de folklore. Il nous permet de redécouvrir des contes célèbres tels que ""La Belle et la Bête"", ""Le Petit Chaperon Rouge"" ou encore ""Cendrillon"", mais également de plonger dans des récits moins connus, mais tout aussi captivants.
""L'Oeuvre des conteurs français"" est un hommage à ces artistes anonymes qui ont su préserver et transmettre notre patrimoine culturel à travers leurs récits envoûtants. C'est un livre qui nous transporte dans un monde imaginaire, où la magie et la réalité se confondent, et où les mots ont le pouvoir de nous émerveiller et de nous faire rêver.
Que vous soyez passionné de littérature, amateur de contes ou simplement curieux de découvrir l'héritage culturel français, ce recueil est un incontournable. Plongez dans ces pages et laissez-vous emporter par la magie des mots et la richesse de l'imagination des conteurs français.
Extrait : ""Plusieurs excellents personnages, qui ont eu parfaite connaissance des choses du monde, ont écrit que naturellement
les dames sont plus adonnées à l'amour que les hommes, parce que c'est leur propre, en ce qu'elles n'ont pas l'esprit occupé à tant d'affaires pressantes qu'eux, et qu'elles sont d'une habitude plus délicate et plus molle et, par conséquent, plus aisées à glisser dans les délices..."""
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 341
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
LES HEURES PERDUES DE R.D.M., CAVALIER FRANÇAISLES CONTES AUX HEURES PERDUES DU SIEUR D’OUVILLE
Les heures perdues du Cavalier français sont comme un appendice des Dames galantes de Brantôme ; mais un appendice tellement adéquat, – s’il nous est permis d’employer ce mot sans grâce – qu’on se prend à se demander si le Cavalier français ne serait pas le sire de Bourdeilles, abbé de Brantôme, lui-même.
Alcide Bonneau, en présentant ce Recueil, au fidèle public d’Isidore Liseux, en 1881, rappelait que Brantôme, désespérant de tout dire des dames qui font l’amour et leurs maris cocus, se déclarait disposé à laisser sa plume au Diable ou à quelque bon compagnon, qui la reprendrait. Ne serait-ce pas là pur subterfuge ? Et Brantôme lui-même ne préparait-il pas ses lecteurs à l’apparition ultérieure d’un Recueil écrit de la même plume, avec le même humour, sur les mêmes sujets ?
Aucun fait nouveau ne nous autorise à émettre une pareille hypothèse, à tenter même d’attribuer à Brantôme Les Heures perdues du mystérieux R.D.M. Mais, vraiment, le mystère a été si bien épaissi autour de ces trois initiales et de leur œuvre, toutes les traces qui auraient pu nous permettre de nous guider pour les identifier ont été si à dessein effacées ; la physionomie de l’écrivain, celle même des personnages, a été si habilement estompée, que les voiles paraissent à jamais impossibles à déchirer.
Dans cette incertitude précise, c’est seulement le désir d’une solution facile, logique cependant, qui nous a conduit à penser que le seigneur de Bourdeilles avait pu se dissimuler derrière le Cavalier français R.D.M. Pourquoi se serait-il ainsi dissimulé, alors qu’il est plus imprécis dans ce Recueil que dans celui des Dames galantes, alors que, par suite, il risquait moins de froisser de délicates susceptibilités ? C’est chercher la difficulté que se poser une pareille question, car l’art d’un écrivain comme Brantôme est aussi insondable que le cœur d’une femme légère. Toutefois, rien ne semble s’opposer à l’hypothèse de notre attribution.
Manifestement, ainsi que l’a établi Alcide Bonneau, les Nouvelles de R.D.M. ont été écrites dans les dernières années du XVIe siècle, certaines peut-être postérieurement à 1610. Or, Brantôme a vécu jusqu’en 1614, immobilisé sans doute depuis l’âge de 50 ans, mais en possession de toutes ses facultés jusqu’à ses derniers jours.
Le langage de l’écrivain est celui d’un soldat, même et surtout dans les sujets graveleux : ses métaphores gaillardes sont empruntées à l’art militaire. « Ici, c’est un cavalier qui fait tant de rondes par nuit ; là, un autre qui se dépite de n’avoir pas son pistolet chargé. L’amour est toute une stratégie : engager l’escarmouche, mettre l’épée à la main, reconnaître la forteresse faire les approches, dresser les machines, pointer les pièces, envoyer des volées de canon, franchir la contrescarpe, combler le fossé, passer le retranchement, allumer la mèche, bouler le feu à la mine, se loger dans la place », voilà ses figures coutumières, relevées par Alcide Bonneau. Or, Brantôme ne dédaigna guère de prendre la rapière, qu’il tira dans tous les camps, et non sans entrain.
Le Cavalier français R.D.M. est certainement un gentilhomme, et le digne contemporain, le digne camarade du seigneur de Bourdeilles, lui qui reproche aux nobles « d’apparier leurs filles en des familles plus basses, voire plus viles, étant certain qu’il y ait du bien : n’important pas même que les races soient tarées, pourvu que la tare soit couverte avec force pistoles ».
Il devait aussi vivre près de la Cour, car toutes les dames, tous les Princes, dont il conte les aventures galantes, en étaient. Peut-être même le mystérieux R.D.M. était-il attaché, comme Brantôme, à Marguerite de Navarre, première femme de Henri IV.« Je connais, dit-il, une Princesse qui a toujours été tenue pour le plus bel esprit de son temps, la plus libérale qui ait régné devant elle, car tout son soin a été et est encore d’employer tous ses biens à donner à ceux qui sympathisent le plus à son humeur… L’amour, le plus souvent, se plaisait fort à sa compagnie ». Cela convient très bien à Marguerite. Dans cette hypothèse, le souvenir qu’un peu plus loin un de ses gentilshommes rappelle à la Princesse : « Ce que la fortune et le malheur vous avaient fait perdre par la mort d’une personne que vous aimiez… » se rapporterait à La Môle ; enfin, la suite du conte (la Princesse fait coucher avec sa dame d’honneur ce gentilhomme, qui n’y pensait pas précisément) est tout à fait dans l’humeur de la Reine Margot. Les fureteurs, qui ont exploré tous les coins et recoins des Mémoires du temps, nous diront peut-être aussi le nom de cette dame de la Cour, dont les galanteries étaient célèbres sous Charles IX, qui avait quatre filles, aussi faciles que jolies, et dont la maison était une Académie amoureuse où allaient le Roi, les Princes et les plus grands seigneurs. Cette Dame possédait un château en Touraine, et en faisait, dans la belle saison, le rendez-vous « des plus galants et des mieux frisés de la Cour » ; notre Cavalier en était assurément et connaissait la maison par le menu, car il a consacré deux de ses Nouvelles (la IVe, Le Pucelage recousu, et la Ve, La Bonne Mère) à cette dame et à ses filles, « trois desquelles, dit-il, furent mariées en des meilleures maisons du royaume, dans lesquelles elles n’entrèrent pas si neuves, qu’elles ne fussent capables d’enseigner leurs maris en ce qui dépendait de l’art qu’elles avaient appris sous l’aile de leur mère ». C’est peut-être encore la même dont la fille aînée, « en un canton de la Touraine », se fait donner l’Enseignement complet (nouvelle X).
Toutes ces analogies ne composent pas, hélas ! une certitude ; mais du moins, permettent-elles d’apparenter notre Recueil, et de façon glorieuse, à laquelle sans doute aucun lecteur, après vérification, ne contredira.
Cependant les Heures perdues sont restées dans l’ombre, alors que les Dames galantes – leurs parents riches – ont conquis le monde. Habent sua fata libelli.
Publiées pour la première fois en 1616, peut-être même en 1615, les Heures perdues de R.D.M., cavalier français, ont eu au dix-septième siècle, un certain nombre de rééditions :
1620, chez Claude Larjot, in-12 ;
1629, chez Jean Berthelin, Rouen, petit in-12 ;
1662, chez Jean Dehoury ou Étienne Maucroy, in-12.
Les premières éditions contiennent vingt-sept nouvelles ; celle de 1662 en présente vingt-neuf, dont deux sont considérées comme absolument apocryphes et forgées sans doute par un libraire peu scrupuleux, désireux d’augmenter l’intérêt de l’ouvrage : car, pour certains, l’importance d’un livre se mesure au poids. C’est de cette édition que Charles Nodier, qui la possédait, a écrit :
Joli exemplaire, d’un recueil de nouvelles, dont quelques-unes sont écrites et contées d’une manière fort agréable. Je m’étonne que ce volume, qui n’est pas très rare, ait échappé aux recherches de nos faiseurs de feuilletons, qui ne seraient ni fâchés, je pense, ni embarrassés d’y trouver la matière de quelque bon roman qu’ils parviendraient sans peine, je m’en rapporte à eux, à délayer en une trentaine, peut-être même en une quarantaine de chapitres. Je prends, en conséquence, la liberté de leur recommander ce joli recueil.
L’ouvrage eut certainement du succès : le nombre des éditions publiées en quelque cinquante ans le proclame irréfutablement. Une autre preuve de ce succès, nous la trouvons dans le titre d’au moins deux autres recueils, inspiré par celui de R.D.M. : d’abord Les Heures perdues et divertissantes du chevalier de Rior (Amsterdam, 1716, in-12), qui ont pour auteur un certain Gayot de Pitaval ; ensuite l’œuvre de d’Ouville, publiée sous le titre : Contes aux heures perdues du sieur d’Ouville, ou le Recueil de tous les bons mots, réparties, équivoques, brocards, simplicités, naïvetés, gasconnades, et autres contes facétieux non encore imprimés.
Ce Recueil, dont nous publions les parties les plus intéressantes, parut pour la première fois en 1643, peut-être même en 1641. On n’est pas très fixé sur ce point, comme on l’est peu sur la vie et la carrière de l’auteur.
Antoine Le Metel, sieur d’Ouville, est né à Caen, sans doute dans les dernières années du seizième siècle, et mort vers 1657 : les Archives normandes elles-mêmes ne nous donnent aucun renseignement sur son compte. Ce que nous savons de plus précis, c’est qu’il est le frère de François Le Metel, plus connu sous le nom d’abbé de Boisrobert, un des beaux esprits les plus renommés de la première moitié du dix-septième siècle, très goûté du cardinal de Richelieu pour sa verve, sa facilité d’improvisation, et peut-être trop goûté par ailleurs, de façon moins orthodoxe, puisqu’il fut surnommé « le bourgmestre de Sodome », surnom dont le plaisantait amicalement son indulgente et belle amie Ninon de Lenclos, sa divine, comme il se plaisait à l’appeler.
Notre d’Ouville fut ingénieur, paraît-il, et le titre ne suffit guère à l’identifier ; il semble surtout avoir été peu ingénieux à se tirer d’affaire dans la vie ; car bien qu’il consacrât à la littérature les nombreux loisirs de sa carrière technique (ou peut-être parce qu’il les consacra), il se trouva toujours dans une situation précaire et dut plus d’une fois avoir recours aux libéralités de son frère, lequel faisait appel en sa faveur à la générosité intermittente du cardinal rouge.
Dramaturge, d’Ouville a commis une douzaine de pièces de théâtre, jouées et publiées de 1638 à 1650, et aimablement accueillies.
Conteur, il prit des modèles rassurants, le Moyen de parvenir, certains recueils anonymes de contes ingénieux, comme Le facétieux Réveil matin des esprits mélancoliques, et aussi les grasses et divertissantes Facéties de Pogge. Les lecteurs pourront se rendre compte qu’il a tiré un bon parti de ses lectures.
Il a bien témoigné, de-ci de-là, de son peu de scrupule à l’égard de ses modèles : ainsi il a reproduit exactement, sans rien changer, même au titre, la septième nouvelle du Recueil de R.D.M., De la raison pertinente qu’une belle dame donna de la cause du cocuage ; mais ses successeurs en ont usé à peu près de même avec lui et ses devanciers.
Nos aïeux aimaient beaucoup le conte, genre éminemment français, voire gaulois. Aussi le Recueil du sieur d’Ouville a-t-il eu de nombreuses réimpressions : en 1661, 1664, 1669, 1692, 1703, 1732. Mais encore des compilateurs indélicats ont cueilli ses anecdotes, les ont parfois légèrement défigurées, soit en délayant la matière, soit en la resserrant ; puis ils les ont publiées sous des titres différents et alléchants : Divertissements curieux, 1650 ; – Récréations françaises, 1658 ; – Nouveaux contes à rire, 1678, 1692, 1702, etc.
Enfin, dès 1680, parut à Rouen, l’Élite des Contes du sieur d’Ouville, réimprimée à La Haye en 1703 et à Paris (Lemerre, 2 vol. in-8) en 1883, avec préface de Ristelhueber. Cette dernière édition n’est pas une copie intégrale des précédentes : un choix nouveau a guidé l’éditeur.
De même avons-nous cru devoir procéder, pour notre réimpression, à un tirage plus conforme au caractère de notre collection.
B.V.
À la belle que j’aime mieux que mon cœur et que mes yeux
Madame,
Je n’estime point d’heures plus perdues que celles qu’on laisse passer sans rien faire. C’est pourquoi, encore que ce messager porte ce titre sur le front, n’estimez pourtant pas que, lui ayant commandé voir le jour sous l’aveu de votre beau nom, je les aie inutilement écoutées, le mettant au monde. La cause seule qui me la fait qualifier de la sorte est que je tiens tout le temps auquel je ne jouis point des douceurs de votre présence pour perdu. Et celui même que j’ai employé à faire vivre ce livret, si ce n’est que vous y rencontriez quelque gaillardise qui vous fasse rire. Car, cela arrivant, je croirai non seulement les heures, mais les jours heureux que j’ai donnés à cet ouvrage ; et si le contentement que vous prendrez en y voyant les gentilles aventures de quelques amants radoucit votre courage à m’en faire goûter de semblables, j’estimerai ces heures si agréables qu’au lieu de les nommer perdues, je les appellerai chères et bien-aimées, puisque la libre possession de vos bonnes grâces est la chose la plus aimable que reconnaisse en ce monde,
Madame,
Votre très humble serviteur,
R.D.M.
Comment, sans y penser, un galant homme acquit les bonnes grâces d’une belle dame, et de la ruse qu’elle trouva pour faire battre la mesure à son mari, cependant qu’elle tenait sa partie avec son ami.
Plusieurs excellents personnages, qui ont eu parfaite connaissance des choses du monde, ont écrit que naturellement les dames sont plus adonnées à l’amour que les hommes, parce que c’est leur propre, en ce qu’elles n’ont pas l’esprit occupé à tant d’affaires pressantes qu’eux, et qu’elles sont d’une habitude plus délicate et plus molle et, par conséquent, plus aisées à glisser dans les délices, de telle sorte que si la plupart n’étaient retenues de honte et d’autres considérations qui les empêchent, il n’y a nul doute qu’elles feraient souvent l’office de suppliantes, encore qu’il s’en voit bien, lesquelles, si elles ne prient, au moins, elles consentent promptement aux supplications et aux désirs de ceux qui leur requièrent quelque courtoisie.
Et pour preuve de mon dire, c’est qu’il y a quelque temps qu’un gentil cavalier de Bourgogne, se promenant à cheval par les rues de Paris, fut arrêté par la rencontre d’un de ses amis et, discourant avec lui, par hasard, il lève les yeux et aperçut, à une fenêtre, une extrêmement belle dame, femme d’un homme de robe longue, les beaux yeux de laquelle pénétrèrent si avant dans son estomac qu’ils le forcèrent à proférer à son ami ces paroles : « Ah ! monsieur, quelle beauté est-ce que je viens d’apercevoir ? Sans doute les divinités que les poètes nous ont tant chantées par leurs fables ne peuvent approcher de celle-ci qui m’a, à cette première rencontre, tellement surpris et animé mon courage à souhaiter la possession de ses bonnes grâces que je voudrais avoir donné cent pistoles et que quelque bon démon m’eût, à cette heure, conduit auprès d’elle et disposé son humeur à recevoir de moi les douceurs qui se ressentent parmi les agréables larcins de l’amour. » Ces paroles, proférées avec une action qui ne témoignait, point une passion feinte, furent entendues de cette belle et goûtées de telle sorte qu’elle ne vit pas plus tôt la séparation de ces deux amis qu’elle envoya incontinent après lui une servante instruite de ce qu’elle lui devait dire de sa part, qui fut si diligente à l’exécution des commandements de sa maîtresse que ce cavalier n’était pas au bout de la rue que cette gentille Dariolette l’aborda avec ces paroles : « Monsieur, vous êtes à cette heure arrêté tout devant la fenêtre d’une belle dame en faveur de laquelle vous avez proféré des paroles si à son avantage qu’elle s’en ressent votre obligée, et avez conclu votre discours par un souhait que vous avez fait de la possession de ses bonnes grâces avec une action qui lui a été si agréable qu’à la même heure elle m’a fait partir pour vous dire qu’il ne tiendra pas à elle que vous ne soyez content, et si vous désirez exécuter votre parole de point en point et vous trouver ce soir, sur les huit heures, en son logis, et je vous fera ressentir l’effet de ce que je vous dis avec tant de contentement que vous mettrez ce jour au nombre de ceux qui vous ont été heureux. »
Le cavalier, entendant cette ambassade, tant s’en faut qu’il s’étonnât de cette harangue, qu’au contraire il rendit mille grâces à la messagère et lui promit merveilles, avec assurance qu’il ne manquerait à l’heure donnée, qui n’est plus tôt arrivée qu’il s’en va trouver cette belle courtisane, résolu de bien employer son argent, et lui dit en l’abordant : « Je me suis tellement trouvé surpris, madame, et de la rencontre du trait de vos beaux yeux, qui m’ont fait entrer en admiration et naître des désirs d’entrer en possession de chose si belle, et de la pitié que vous avez eue de la passion que mon action vous a témoignée en la preuve que vous m’en rendez par la douceur de votre message, que non seulement les cent pistoles que j’ai proférées ne sont dignes de récompenser un tel bien, mais tous les trésors du roi de la Chine et de tous les monarques de l’univers ; vous ne laisserez pas pourtant de les recevoir pour échantillon de ce que je désire faire lorsque l’occasion m’obligera à l’avantage. » Finissant ces mots par un baiser qui peu à peu le conduisait dans le parterre d’amour, leur dessein se trouve troublé et retardé par la survenue du mari de cette mignonne qui ne peut donner autre remède plus prompt à cet accident inopiné, sinon de faire cacher cet amoureux trompé dans la garde-robe de sa chambre, le consolant de promesses et d’assurances que la nuit ne se passerait point qu’elle n’en allât couler une partie avec lui. Lui, voyant que où la nécessité est il n’y a ni réplique, ni remède, il se résolut d’attendre la fortune à jouer, se promettant qu’elle ne l’avait point conduit jusque-là pour le laisser en si beau chemin.
La plus grande appréhension toutefois était que ce ne fût une partie dressée exprès pour lui faire évanouir ses pistoles, mais le temps l’éclaircit de ce doute et lui fit voir que cette désireuse de la friandise, étant couchée avec son mari, seuls dans leur chambre (comme la plupart ont accoutumé de faire et principalement les belles qui ne veulent pas qu’on entende leurs mignardises et les petites folies qu’elles font avec leurs époux), elle n’y séjourna pas deux heures qu’elle se mit à se plaindre de telle sorte que son pauvre mari, étonné de la promptitude de ce mal, lui en demanda la cause. Elle, feignant toujours de plus en plus des ressentiments de douleur, lui dit que c’était une colique qui la venait de surprendre qui l’obligeait de se lever, mais la peur qu’elle avait des esprits l’en avait empêchée. Lui, fâché de cet accident, se veut jeter en place pour allumer une bougie, sans qu’elle s’oppose à ce dessein, lui disant : « Il n’est pas besoin que vous preniez cette peine, pourvu seulement que je vous entende faire bruit contre quelque chose afin que je connaisse que vous ne dormez : cela m’assurera assez et irai bien seule, espérant qu’à mon retour je serai soulagée du mal qui me presse. » Pour la contenter, il lui promet de ne pas bouger et de se faire entendre à elle ; il prend le pot de chambre et se met à jouer des doigts contre d’une assez agréable mesure, laquelle étant approuvée de cette malade, elle va trouver son médecin dans la garde-robe, auquel elle dit : « Eh bien ! mon cœur, ne suis-je pas religieuse en l’exécution de mes promesses ? Tout mon déplaisir est que je vous ai fait attendre en ce mauvais lieu plus que je ne pensais, mais celui qui en est la cause en recevra la punition ; car, tandis que nous danserons l’agréable branle que le vulgaire nomme la danse du loup, j’ai fait en sorte qu’il nous en marquera les cadences sur un instrument assez propre pour cela. » Lui, qui avait ouï l’artifice dont elle avait usé et qui en voyait si heureusement réussir l’effet, ne s’amusa point aux discours, songeant, puisqu’il payait le violon, que c’était bien raison qu’il sonnât en vain. Il en trouva donc la mesure si douce et les temps de celle qui conduisait si justes qu’il recommença le même branle par trois fois et eût continué davantage si l’haleine ne lui eût manqué, tant il avait pris de plaisir à cette nouvelle façon de bal et à la gentillesse de cette belle danseuse, laquelle s’en retourna, toute émue de l’exercice, imposer silence à ce nouveau joueur de matassins, qui demeura très content de l’allègement qu’elle lui témoigna avoir ressenti par le succès de son voyage.
Ils se rendormirent tous deux jusqu’au matin fort tard, et durant leur sommeil notre prisonnier, avec des pieds de laine, s’en va trouver celle qui l’avait introduit, laquelle, après avoir bien ri de l’invention de sa maîtresse et du bon succès de cette entreprise, le mit dehors, où de là il s’en va se remettre au lit dans son logis ; puis, l’heure de se lever venue, il se porte sur le temps du dîner en la maison d’un de ses amis, où il était prié, avec fort bonne compagnie qui s’y rencontra.
Entre la poire et le fromage, chacun se met à conter quelque gaillardise que notre danseur écoutait attentivement ; mais voyant que personne de ces gentils discoureurs n’avait passé un plus agréable passage que lui, il leur dit : « Je vois bien qu’aucun de cette troupe ne peut entrer en comparaison avec moi, pour avoir été inopinément favorisé de la fortune par une rencontre plus plaisante. » Puis, se voyant pressé de tous d’en faire rire la compagnie, il leur fit entendre de mot à mot l’aventure que je vous viens de faire voir, sans y rien oublier. Mais par hasard le mari de sa favorite était à table avec les autres, et des convives du festin, lequel il ne connaissait, pour n’avoir jamais été dans sa maison, que le soir qu’il y dansa le ballet au son du pot de chambre ; qui, entendant la naïveté de ces paroles, considéra que c’était lui qui avait donné le tambour tandis qu’on attaquait la forteresse de sa femme, se ressouvenant de la feinte maladie et du moyen qu’elle avait trouvé pour l’empêcher de se lever, lui faisant battre la mesure tandis qu’elle tenait le dessous de la musique. Toutefois, comme prudent qu’il était, il jugea à propos de n’en faire semblant pour l’heure, jusqu’à ce qu’il eût consulté et trouvé le meilleur moyen pour mettre quelque ordre au désordre qu’il voyait dans sa maison. Ce qu’ayant fait et n’en trouvant de plus à propos que de se familiariser avec celui qu’il croyait son lieutenant, il ne manquait tous les jours à se trouver au logis d’un prince où ce cavalier faisait sa demeure, et là il l’entretenait si ordinairement avec tant de compliments et d’offres d’assistance qu’il lut promettait en toutes ses affaires, que cela l’obligea de telle sorte qu’il ne croyait pas l’être davantage à personne du monde.
La pratique de cet entretien ayant duré quelque temps entre eux, M. le juge pensa être à propos de donner air à la mine, et que pour y parvenir il était nécessaire de convier à dîner son rival : ce qu’il fait avec la courtoisie ordinaire en ces actions-là, qui est accepté de lui avec la même civilité. Les jour et heure venus, il ne manque pas de se porter à l’assignation, et entrant dans la salle, la première chose qu’il rencontra devant lui fut celle sur le clavier de laquelle il avait si doucement joué, tandis que son mari marquait la cadence sur le pot de chambre, qui le fît entrer en étonnement, connaissant que c’était la femme de son hôte, auquel il avait fait si naïvement le conte de cette aventure, que les moins clairvoyants en telles affaires eussent aperçu l’altération que lui avait causée cette surprise, qui ne fut pas seule en lui, car la crainte lui fit compagnie tant qu’il fut là, pensant que cet homme ne l’avait point fait venir à autre intention que pour lui faire déplaisir, qui le mit en telle alarme qu’il ne voulut manger tout le long du repas, de peur de goûter quelque morceau qui l’envoyât danser un autre branle que celui de la garde-robe ; et quelque prière que lui fit le maître du logis, il s’excusait toujours, qui lui confirma encore la créance qu’il avait en la vérité de l’histoire.
Les tables levées, il tardait beaucoup à ces amoureux refroidis qu’il ne fût hors de la peur, que quelque comédien habillé en Rodomont ne le vînt faire descendre aux enfers avec lui pour vengeance de la comédie qu’il avait jouée sur le théâtre de cette belle, et se forme une affaire pour prétexte de prendre congé : à quoi se préparant, le maître de la maison le supplie d’avoir un peu de patience et appelant sa femme il lui dit qu’elle allât quérir une boîte qu’il lui montre, dans laquelle elle mettait ses pierreries et son argent, ce qu’ayant fait promptement, il parla de la sorte : « – Monsieur, la pratique que j’ai faite de votre humeur depuis que j’ai la faveur d’être connu de vous m’a tellement rendu vôtre que peu de choses, quelque difficiles qu’elles fussent, se passeraient devant moi où je croirais vous pouvoir rendre quelque service, que je ne les entreprisse plus librement que vous ne le désiriez et ne demanderais autre salaire de ma peine que vos bonnes grâces ; car ce n’est pas le propre d’un courage généreux de tirer récompense de son labeur, et encore moins de prendre quelque chose de celui qui travaille, au lieu de lui donner. Je dis ceci pour ce qu’étant né avec de l’honneur et du courage, j’ai cru devoir prendre alliance en pareil lieu, qui m’avait fait choisir une femme issue de parents si généreux que je croyais qu’elle ne forlignerait point. Mais, à ce que je vois, elle n’a point suivi la piste de sa libéralité ; car ayant eu dessein de vous appeler auprès d’elle pour vous faire cultiver et arroser une terre dont le jardinier n’était point assez soigneux à sa fantaisie, au lieu de vous bien payer vos journées, elle a pris cent pistoles pour vous faire ouverture de sa porte, chose du tout injuste : car si quelqu’un devait tirer quelque émolument de son travail, ce devait être moi, qui vivais en peine pour la crainte que j’avais du mal de cette mignonne, qui perdais mon repos durant le temps de l’accès de sa feinte douleur et qui encore sonnais du tambour, tandis qu’elle jouait de la flûte. Mais comme je vous ai dit, les braves courages ne demandent jamais le payement de leur labeur, ce qui fait que je vous tiens quitte pour ce qui me regarde, et par conséquent je n’entends pas que celle qui a eu sa part du plaisir, et non de l’incommodité, participe au gain. Tellement, madame, dit-il, adressant la parole à sa femme, que je veux que tout à cette heure vous rendiez à monsieur les cent pistoles que vous avez touchées pour le prix de la privauté que vous lui avez donnée, et de plus que vous fassiez état de sortir de ma maison et alliez chercher autre que moi pour vous servir de trompette lorsque vous voudrez courir la bague. Vous assurant que c’est tout le mal que je vous procurerai et que je ne vous empêcherai point de jouer à toutes sortes de jeux, pourvu que je ne tienne point la chandelle, et de danser toutes danses, pourvu que je ne sois point le violon. Et quant à vous, monsieur, ne croyez point que cela refroidisse l’affection que je vous ai promise, car je sais trop bien connaître les dames de cette étoffe pour en faire comparaison avec les chevaliers de votre mérite. Vivez donc content et assuré que je ne changerai point pour cela le vœu que j’ai fait de vous honorer et servir aux occasions où vous aurez besoin de mon assistance. »
Ces paroles finies, cet amant étonné se retire si troublé de ce qu’il avait vu et entendu qu’il ne se rassura qu’il ne fût en son logis : où étant et ayant pensé en ces divers accidents, il tourna le tout en risée, concluant qu’il était le plus fin des trois d’avoir bien passé son temps, avoir fait un bon repas, acquis un bon ami et retiré son argent.
La gentille ruse que trouva un homme d’esprit pour détourner l’intention que sa femme avait de lui faire porter le panache.
Beaucoup, aujourd’hui, s’affligent quand ils connaissent que leurs femmes se réjouissent un peu plus que de coutume et que leurs yeux se radoucissent pour quelque sujet dont la fréquentation ordinaire les peut émouvoir à l’amour, sans considérer que leur honneur ne dépend pas de là et que les plus sages ne s’alambiquent point la fantaisie pour si peu de chose, indigne d’occuper un esprit solide et arrêté. Car il est tellement impossible de retenir le cours de cette maladie en une femme lorsqu’elle y a pris racine et que le dessein de s’y laisser aller est résolu en elle, que plutôt détournerait-on celui des plus grands fleuves de l’univers, que d’empêcher cette opinion quand elle est formée dans leur imagination : si bien que le meilleur est de laisser faire la nature, vu la difficulté qu’il y a de la forcer, en ce que, si on le voulait entreprendre, ce serait entrer en un tel gouffre de travaux, de misères, de déplaisirs et de hasards, que la vie serait ennuyeuse à celui qui s’en trouverait réduit à ce terme. Quelques-uns ont voulu nommer cette maladie cocuage, les autres cornardise. Pour le premier, il y a quelque apparence, en ce que c’est aucunement imiter le cocu que d’aller pondre au nid d’autrui. Mais pour les cornes, je n’en ai jamais vu qui en eussent, bien qu’il y a un homme des principaux d’un présidial de ce royaume qui témoigna par ses paroles, il y quelque temps, qu’il avait quelque opinion qu’un homme ne pouvait avoir ce mal sans qu’il en apparût quelque chose à sa tête, soit qu’il en parlât ou par bouffonnerie ou tout de bon. Mais je crois plutôt que c’était pour se donner du bon temps et se rire de lui-même, en se réconfortant d’avoir son semblable, que par foi qu’il ajoutât à la sortie de cette perruque cornue.
Ayant donc M. le juge épousé une des plus belles femmes de la ville où il demeurait, il arriva qu’au bout de quelques jours elle fut avisée d’un cavalier du pays qui avait quelque autorité dans la province, duquel elle ne rejeta point tant les regards qu’elle ne lui en rendit au double, pour lui témoigner n’avoir point désagréable la suite du dessein qu’elle voyait former dans son courage. Lui, jugeant que s’embarquant promptement en faisant voile vers cette belle qu’il ne ferait point naufrage en ce voyage et qu’il arriverait au port de salut pourvu que ses voiles, ses cordages et son mât fussent bien tendus, autrement il y pourrait avoir du péril, il poursuit cette navigation si heureusement et par un temps si calme qu’étant près de rentrer dans le havre, le mari, qui autrefois avait fait pareil voyage sur les vaisseaux d’autrui et mouillé l’ancre dans le port de ses voisins sans leur demander congé, connut incontinent que ce nouveau pèlerin voulait venir faire recalfeutrer son vaisseau et faire un ravitaillement par surprise sur ses terres, qui le fît entrer en considération, comme prudent qu’il était, des moyens qu’il pourrait trouver pour empêcher que la pointe du navire de ce gentil pilote ne vînt choquer le sien, de sorte qu’étant de bois plus délicat, il n’entrât plus de la moitié dedans, et pensa si profondément à l’invention de détourner cet orage qu’il entra en quelque soupçon que ce pouvait être cette maladie de cornardise qui voulait commencer à le surprendre. Mais n’en étant pas bien assuré et ne sachant comment contenter son esprit de cette certitude, il s’avisa qu’un de ses voisins de la même ville et des plus apparents avait dès longtemps fait épreuve de la même infirmité qu’il présageait lui devoir advenir, lequel le pourrait bien relever du doute où il était. Qui fit que, le mandant soudain avec un bon nombre de ses parents et de ceux de sa femme, tant pour se réjouir avec eux que pour le soulager s’il y avait moyen, ils ne manquèrent de le gratifier de leurs visites, se portant tous en sa maison, où, le trouvant au lit et cette belle amoureuse auprès de lui, contrefaisant la triste, chacun se mit à plaindre cet accident, et même son ami qu’il avait mandé, qui lui dit : « Eh bien, monsieur, que veut dire que vous, qui avez toujours triomphé des adversités, défié la mort et bravé la fortune, êtes retenu au lit pour un petit mal de tête ? Non, non, n’appréhendez point, car ce sont les maux qui tirent le moins à conséquence dans ce pays que ceux-là, en ce que les Français ne redoutent nullement les blessures de la tête : j’en parle comme savant, car il se trouve peu d’hommes aujourd’hui qui aient eu plus de douleurs en cette partie que moi, et de toutes sortes, qui ne m’ont point encore, comme vous voyez, conduit au tombeau. C’est pourquoi prenez courage et vous réjouissez en l’assurance que je vous donne. »
Le patient, qui voyait ce vénérable au point où il le demandait, lui repart : « Vous pouvez croire, mon cher ami, que je n’ai pas supplié toute cette bonne compagnie de mes proches et de mes amis prendre la peine de me venir trouver, sinon pour essayer de rencontrer parmi quelqu’un d’eux du soulagement à ma peine, ni vous particulièrement, duquel je ne suis en doute de l’usage que vous avez de longue main au mal qui, comme je crois, veut m’affliger ; occasion que je vous supplie de tout mon cœur ne me dénier point ni votre secours, ni votre bon avis, pour ce que le peu de connaissance que j’ai en ces misérables douleurs me donne plus de peine que si j’étais bien certain de ce que c’est. » L’autre, l’ayant assuré ne lui manquer en nulle sorte, se tut pour attendre ce qu’il désirait de lui, comme firent tous les autres, ce qui obligea le malade à parler en cette sorte : « – Le manque de pratique que j’ai, messieurs, aux maladies qui surprennent les hommes par la tête, et même en une qu’on m’a dit les attaquer par ce lieu-là, est le sujet que je vous ai envoyé tous supplier de m’honorer de votre présence, et même monsieur que voilà, dit-il à cet ami, pour m’obliger me relever de mon ignorance, me répondant à une question que je prétends lui faire, comme au plus expert en la connaissance de ce mal, à ce que lui-même m’a confirmé par ses paroles. – Parlez promptement, lui repart-il, et vous réjouissez, puisque votre guérison ne consiste qu’en ma réponse. – Puis donc que vous avez agréable radoucir mon martyre par une connaissance parfaite de sa cause, je vous conjure, par notre ancienne amitié, de me dire en quel endroit la tête vous faisait le plus de mal lorsque les cornes commencèrent à vous sortir, et si, quand elles furent sorties et crûes en leur perfection, comme elles sont à cette heure, vous sentiez encore des douleurs ; car, pour vous parler franchement, je suis en doute que le mal de tête que je souffre ne soit causé de ce fâcheux bois, qui a quelque dessein, comme j’estime, de poindre sur mon front. Mais ayant appris de vous, comme expérimenté, l’endroit où la tête fait le plus de mal à cette origine, je verrai si c’est véritablement cette maladie ou quelque autre, et si, par votre réponse, vous me faites apercevoir que ce soit celle-là sans doute, je supplierai tous ces messieurs mes parents, ceux de ma femme, et elle aussi, qu’elle donne ordre qu’à son occasion je ne sois point affligé de cette incommodité. Si aussi c’est une autre migraine, les remèdes ordinaires en médecine suffiront à cela, avec une petite exhalation que nous ferons, ma chère moitié et moi, des humeurs qui nous portent ces mauvaises vapeurs au cerveau. » Il n’eut plus tôt terminé ces mots qu’ils demeurèrent tous étonnés de cette harangue, et plus que les autres cet ami et sa femme, laquelle se voyant si doucement pincée sans rire et en si bonne compagnie, cela lui fit changer la résolution qu’elle avait prise de rendre son mari de la livrée d’Actéon, ayant reconnu son jugement si bon d’avoir découvert par ses premières actions le but de son intention, laquelle, si elle n’a été conduite jusqu’à son dernier période, ne m’en accusez pas, je vous en supplie, mesdames, car n’étant point ennemi de nature, je vous assure qu’il n’a pas tenu à moi.
Qu’il est bien vrai que l’heure du berger se rencontre quelquefois parmi les dames ; et comme, manque de hardiesse, un cavalier laissa perdre une occasion, laquelle il ne put jamais recouvrer.
Je ne doute pas que quantité de dames qui ont pratiqué le monde et goûté la douceur qu’il y a d’être aimée de quelque galant homme, n’aient quelquefois ressenti ce que c’est que ces vieilles matrones du temps jadis ont nommé dans le livre des Quenouilles « l’heure du charretier », et nous, pour parler plus doucement, « l’heure du berger » ; mais peut-être celles qui en ont eu quelque sentiment n’ont pas jugé la cause d’où provenait cette émotion, laquelle, charitablement, je leur veux enseigner afin qu’elles remédient aux accidents qui en surviennent. La première vient de l’objet de la chose aimée, qui émeut la puissance et porte la nature au désir d’exercer ses fonctions ; et ce désir attirant de tous les endroits du corps les humeurs les plus propres à obliger les parties séparées à se joindre, il n’y a nul doute que l’imagination venant à se figurer l’extrême contentement qui arrive en l’instant de cette conjonction fait que le cerveau contribue du sien en cette action et laisse glisser cet esprit vivificatif qui met le feu aux étoupes ; de telle sorte que si, à l’instant que cela surprend les belles, les cavaliers qui les servent avaient le don de prophétie, il est certain qu’ils arriveraient bien plus tôt au but de leurs espérances plus affectionnées, que le plus souvent ils manquent par faute de cette connaissance, à leur grand mécontentement et des pauvrettes qui, cependant, endurent mille maux. Car les parties animées ne recevant l’aliment que leur espérance et leur souhait leur promettait, à cause de l’ignorance ou de la trop grande discrétion – que les dames nomment sotterie – de celui de qui elles l’attendaient, il est tout vrai que les humeurs étant émues et ne venant à prendre leur cours ordinaire, portent par leur regorgement des vapeurs si nuisibles à l’estomac et au cerveau que le plus souvent elles causent des accidents si sinistres que les exemples qui s’en voient tous les jours me servent de preuve plus que suffisante : occasion que les pauvres amants sont bannis des bonnes grâces de leurs maîtresses, à tort et sans cause. Car, puisqu’elles ont des ressentiments si fâcheux, auxquels elles pourraient trouver remède en donnant connaissance plus claire à leurs serviteurs, il ne les faut pas plaindre si elles endurent du mal.