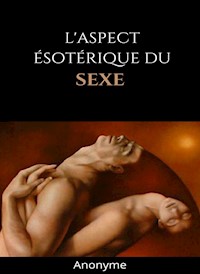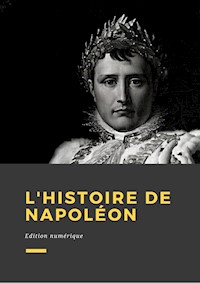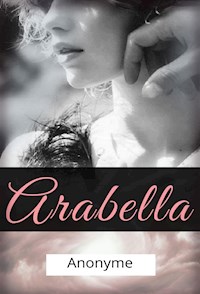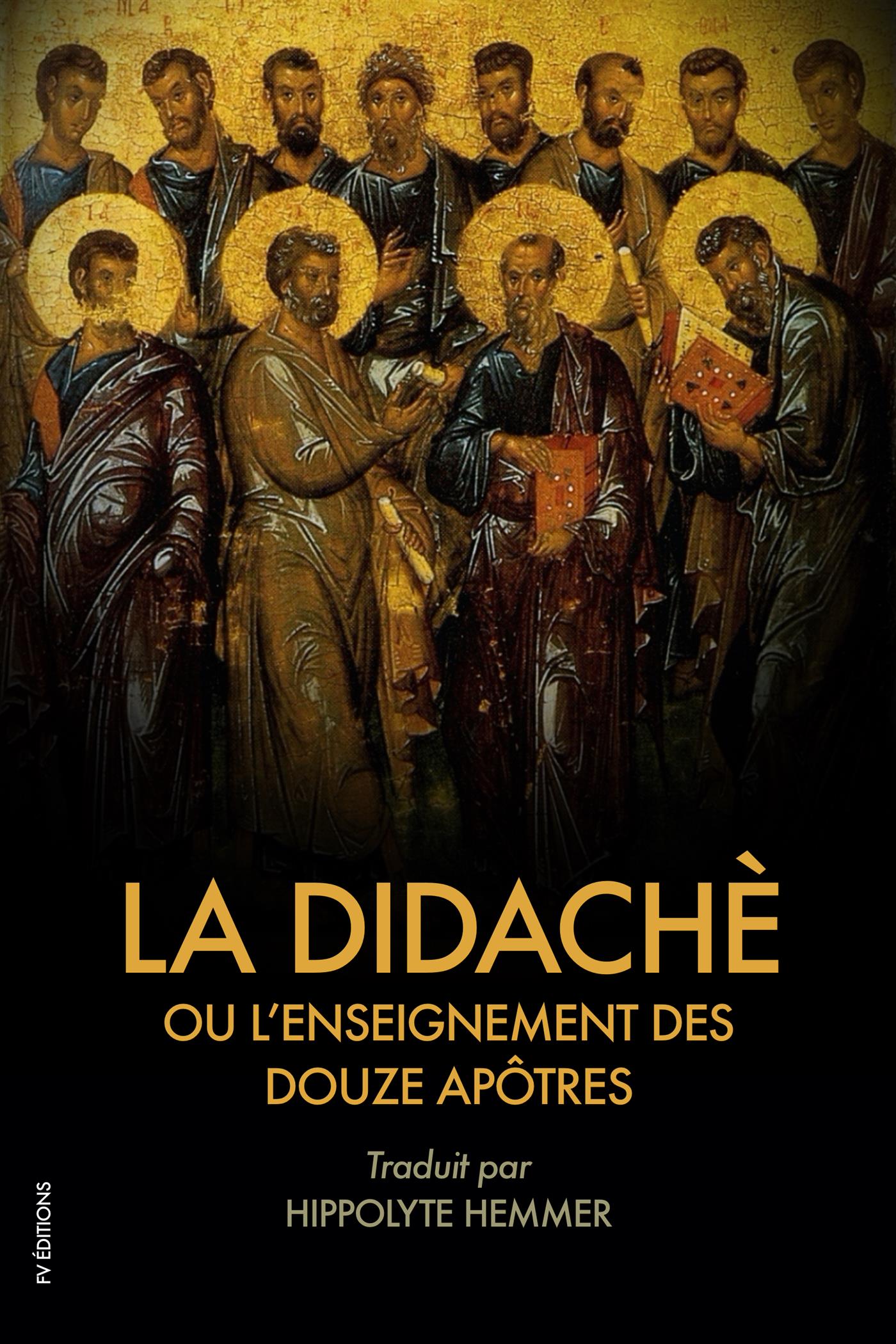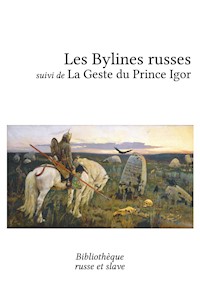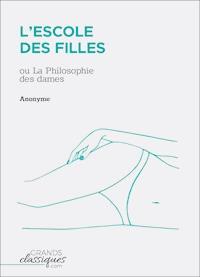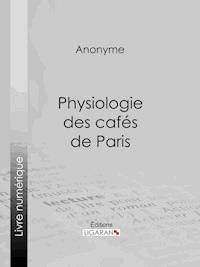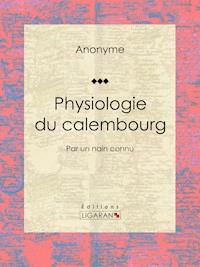Extrait : "Le printemps était arrivé et fouettait le sang' d'un lièvre qui, bien que peu vaillant, se donnait des airs gaillards. Il alla dans un bois et s'avisa de faire visite à une renarde. Celle-ci, au moment où il s'approchait de son terrier, se trouvait sur le poêle, et ses enfants étaient près de la fenêtre. Apercevant le lièvre, elle leur dit : « Allons, mes enfants, si le louche vient me demander, répondez que je ne suis pas chez moi."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de qualité de grands livres de la littérature classique mais également des livres rares en partenariat avec la BNF. Beaucoup de soins sont apportés à ces versions ebook pour éviter les fautes que l'on trouve trop souvent dans des versions numériques de ces textes.
LIGARAN propose des grands classiques dans les domaines suivants :
• Livres rares
• Livres libertins
• Livres d'Histoire
• Poésies
• Première guerre mondiale
• Jeunesse
• Policier
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 317
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La littérature russe n’offre point, au premier abord, de productions vraiment comparables à celles que nous recueillons dans la littérature des différents pays sous le titre expressif « Les Maîtres de l’Amour ». Et pourtant le peuple russe, d’après la croyance générale, cache, sous une façade froide, impénétrable, une âme passionnée, ardente à l’amour comme à la guerre. Serait-ce donc qu’une censure rigoriste a, de tout temps, poursuivi de son inflexible tyrannie jusqu’à l’expression des désirs, des élans voluptueux ? Vraisemblablement oui. D’aucuns pensent bien, comme le marquis de Custine dans son livre sur La Russie en 1839, que la délicatesse innée, la distinction native du peuple russe tout entier l’éloignent des sujets où la chair – notre vile chair – a trop de part et réclame trop énergiquement ses droits. Mais voici des pages qui semblent bien infirmer cette assertion. Le marquis de Custine, d’ailleurs, ne dut pas les connaître.
Certes, elles n’émanent pas des grands noms de la littérature russe ; elles sont même anonymes, et pour cause. Ce sont des récits populaires, dans toute la force du terme, nous pourrions presque dire populaciers, s’il ne s’y mêlait quelque symbole. Le cynisme s’y étale, la scatologie même y a sa place ; car le peuple se plaît à des gestes et à des récits malodorants, surtout le peuple livré à ses instincts, sans le contrepoids de l’instruction et de l’éducation, le paysan tout spécialement, tel le Jésus de Zola.
Mais encore ne peut-on nier qu’il y ait dans cette littérature populaire un sens profond, ardent, de la volupté. Ici les animaux les plus vulgaires, comme les plus nobles, recherchent, par ruse ou par force, la satisfaction d’instincts charnels communs à tous les êtres vivants ; là des femmes effrontément, ou plutôt naturellement friandes de priapes aux fortes proportions, renoncent aux plus opulents partis pour pouvoir s’attacher aux heureux possesseurs de si remarquables appendices. Plus loin, c’est un anneau magique qui communique à son détenteur des qualités herculéennes dans l’œuvre d’amour. L’inceste même y est chose commune, constatée sans étonnement. (« Et dès lors le pope vécut maritalement avec sa fille comme avec sa femme », conte 46). Et les roueries des femmes, leur incontinence, leur dévergondage fournissent des tableaux, des récits que ne désavoueraient les conteurs d’aucun pays, d’aucune époque.
Ce n’est pas, en effet, une des constatations les moins curieuses que l’on peut faire à la lecture de ces pages : on y retrouve des analogies, voire même des similitudes frappantes avec les contes gaulois de nos trouvères, ou même de Rabelais et de La Fontaine, que déjà avaient imités les plus délicats de nos conteurs au XVIIIe siècle ; et c’est aussi naturellement avec les productions des conteurs libertins de l’Italie que les rapprochements sont fréquents.
Que la source de toutes ces productions soit commune – hypothèse la plus probable – ou bien qu’il y ait eu imitation directe, c’est une question discutée et difficilement soluble aujourd’hui. Mais il n’en subsiste pas moins une œuvre très curieuse, établissant nettement que l’imagination populaire russe ne se désintéressait d’aucun des gestes, d’aucune des formes de l’amour. Et ce que le peuple a su exprimer, sous une forme trop cynique sans doute, en des récits mystiques ou satiriques, peut-être des écrivains de même race, plus raffinés, l’ont-ils exprimé plus délicatement en des fictions que la pudeur officielle d’une critique intransigeante les a obligés de garder rigoureusement cachées. Espérons-en la révélation prochaine.
En 1883 paraissait à Heilbronn, sous le titre Kruptadia, le premier volume d’un « Recueil de documents pour servir à l’étude des traditions populaires » (Henninger frères, éditeurs. Et ce premier volume s’ouvrait par la publication de CONTES SECRETS TRADUITS DU RUSSE, avec cette indication mystérieuse d’origine : « Valaam, par l’art typographique de la confrérie monacale. Année de la diablerie des ténèbres. – Imprimé uniquement pour les archéologues et les bibliophiles, à un petit nombre d’exemplaires, dont dix sur papier de couleur, grand format. »
Quelques années plus tard, en 1891, l’érudit chercheur Isidore Liseux présentait à son fidèle public de lettrés une traduction nouvelle des CONTES SECRETS RUSSES (Éditionunique à 220 exemplaires numérotés. Prix : 60 francs) ; et il écrivait dans son avertissement :
« L’original du présent recueil, tiré à quelques exemplaires seulement, « pour les archéologues et les bibliophiles », a été imprimé clandestinement, comme l’auteur lui-même nous l’apprend dans sa préface. L’avertissement, du reste, était inutile, car il suffit de jeter les yeux sur la couverture du livre pour être fixé sur le caractère interlope de cette publication. L’exemplaire dont nous nous sommes servi pour notre travail appartient à la Bibliothèque nationale de Paris. C’est un petit in-80 de 200 pages, intitulé : Rousskiia zavetniia skaski (Contes secrets russes). Point de nom d’auteur, naturellement. »
Nous ne pouvons songer à mettre en doute l’indication donnée par Isidore Liseux, dont la conscience professionnelle est au-dessus de tout soupçon. Mais nous devons avouer que nous avons en vain recherché à la Bibliothèque nationale l’original dont parle l’éditeur. C’est là un petit problème dont nous proposons la solution à la perspicacité des bibliophiles.
Nous avons suivi de plus près la traduction Liseux, qui nous a paru de meilleure tenue littéraire ; et nous avons cru devoir indiquer, en quelques notes, un certain nombre de contes français et étrangers présentant de grandes analogies avec les contes russes.
B.V.
« Honny soit qui mal y pense. »
L’édition de nos contes secrets, dans la forme et l’ordre sous lesquels nous les présentons aux amateurs de la nationalité russe, est une apparition à peu près unique en son genre. Il pourra bien se faire que précisément pour cela notre édition donne lieu à des reproches et à des exclamations de tout genre, non seulement contre l’éditeur téméraire, mais aussi contre la nation qui a produit de pareils contes, contes où la fantaisie populaire, sans la moindre contrainte d’expression, a déroulé, dans d’éclatants tableaux, toute la force et toute la richesse de son humour. Mettant de côté tous les reproches qui ne s’adresseraient qu’à nous personnellement, nous devons déclarer que toute exclamation contre l’esprit national serait non seulement une injustice, mais encore l’indice de cette ignorance complète qui, le plus souvent, à dire vrai, constitue un des traits les plus indélébiles de la pruderie criailleuse.
Nos contes secrets sont, comme nous l’avons dit, une apparition unique en son genre, parce qu’il n’existe pas à notre connaissance une autre édition dans laquelle le vrai langage populaire jaillisse avec une aussi grande abondance, étincelant de tous les côtés brillants et ingénieux de l’homme du peuple.
Les littératures des autres nations offrent beaucoup de contes secrets du même genre, et depuis bien longtemps déjà nous ont précédés dans cette voie. Non peut-être sous forme de contes, mais sous forme de chansons, de dialogues, de nouvelles, de farces, de soties, de moralités, de dictons, etc. ; les autres nations possèdent une énorme quantité de productions, dans lesquelles l’esprit populaire, également sans aucune contrainte d’expressions et de tableaux, signale avec humour, stigmatise par la satire et les livre hardiment à la risée différents côtés de la vie. Qui donc a jamais douté que les contes joyeux de Boccace ne soient tirés de la vie populaire, que les innombrables nouvelles et facéties françaises des XVe, XVIe et XVIIe siècles ne proviennent de la même source que les productions satiriques des Espagnols, les Spottlieder et les Schmähschriften des Allemands, que cette masse de pasquinades, de feuilles volantes diverses dans toutes les langues, apparaissant au sujet de tous les incidents possibles de la vie privée et publique, ne soient des productions du peuple ? Dans la littérature russe, il est vrai, jusqu’à ce jour, il existe toute une catégorie d’expressions populaires qui n’ont pas été imprimées, qui ne sont pas destinées à l’impression. Dans les littératures des autres nations, de pareilles barrières n’existent plus depuis longtemps pour le langage du peuple. Sans remonter à l’antiquité classique, est-ce que les Ragionamenti de P. Aretino, les Capitoli de Franc. Berni, de Giov. della Casa, de Molza, la Rettorica delle putane, de Pallavicini, l’Alcibiade fanciullo a scola et les productions des autres écrivains italiens ; est-ce que le livre de Meursius : Elegantiœ latini sermonis ; est-ce que toute la série, dans la littérature française, des célèbres Joyeusetez, facéties et folastres imaginations, le fameux Recueil de pièces choisies par les soins du Cosmopolite ; est-ce que tout ce déluge de Flugschriften, qui au dire de Schade, « damals wie eine Fluth übers Land führen », ne montrent pas clairement qu’on ne regardait point comme nécessaire de couvrir le mot imprimé de la gaze d’une pruderie effarouchée et de la feuille de vigne d’un écrit passé à la censure ? Est-il besoin de rappeler encore les productions macaroniques, jouissant d’une si haute estime depuis le magnifique Laurent de Médicis jusqu’aux Médicis de notre époque ? Est-il besoin de remarquer, en finissant, qu’elles ne sont pas réservées aux seuls bibliophiles, ces sections entières dont les sujets sont décrits dans des bibliographies spéciales, telles que la Bibliotheca scatologica (Scatopolis, 5850), sections connues dans le monde des livres sous le nom de : Singularités, Curiosa, Erotica, ouvrages sur l’amour, sur la galanterie, etc.
Et le reproche de cynisme grossier fait à la nation russe équivaudrait au même reproche fait à toutes les nations, c’est-à-dire se réduirait à zéro. Le contenu érotique des contes secrets russes ne témoigne ni pour, ni contre la moralité de la nation russe : il met tout simplement en relief un côté de la vie qui, plus que tout autre, excite l’humour, la satire et l’ironie. Nos contes sont livrés sous une forme sans art, tels qu’ils sont sortis des lèvres du peuple, et sont écrits avec les mots des conteurs. C’est ce qui constitue leur caractère propre : rien n’a été ajouté. Nous ne nous étendrons pas sur cette particularité que, dans les différentes zones de la vaste Russie, le même conte se présente sous des formes différentes. Ces variations sont nombreuses, et pour le plus grand nombre, sans aucun doute, elles passent de bouche en bouche, sans avoir été jusqu’à ce jour ni recueillies, ni transcrites par les collectionneurs. Celles que nous donnons sont tirées du nombre des plus remarquables ou des plus caractéristiques à un point de vue quelconque.
Nous regardons aussi comme superflu d’expliquer l’ordre dans lequel paraissent nos contes. Nous ferons seulement remarquer à ce propos que ceux dont les acteurs sont des animaux font voir, on ne peut mieux, toute la sagacité et toute la vigueur d’observation de notre homme du peuple. Loin des villes, travaillant dans le champ, dans la forêt, sur le fleuve, il comprend partout avec profondeur la nature, sa bien-aimée ; il observe avec précision et apprend à connaître dans le menu détail la vie qui l’entoure. Les côtés pris sur le vif de cette vie muette, mais éloquente pour lui, se peignent d’eux-mêmes dans son imagination, et voilà un conte tout prêt, plein de vie et d’éclatant humour. La section des contes sur ceux que le peuple appelle la race étalonnière, et dont nous n’avons donné pour le moment qu’une petite partie, éclaire vivement et les relations de notre moujik avec ses pasteurs spirituels et la véritable manière de comprendre ces derniers.
Curieux sous beaucoup de rapports, nos contes secrets russes sont particulièrement remarquables sous le rapport suivant : au savant grave, à l’investigateur profond de la nationalité russe, ils fournissent un vaste champ de comparaison, relativement au contenu de quelques-uns d’entre eux, avec les récits de contenu presque identique des écrivains étrangers, avec les produits des autres nations. Par quel chemin ont pénétré dans les coins reculés de la Russie les Contes de Boccace, les Satires et les Farces françaises du XVIesiècle ? Comment la nouvelle occidentale a-t-elle ressuscité dans le conte russe, quel est le côté commun à l’une et à l’autre, où sont et de quelle part viennent les traces de l’influence, de quelle nature sont les doutes et les conclusions dérivant de l’évidence d’une pareille identité, etc., etc. ?
Abandonnant la solution de toutes ces questions et de beaucoup d’autres à nos savants patentés, nous espérons que nos lecteurs trouveront une bonne parole pour les travaux des honorables collecteurs de ces contes. Nous, de notre côté, en éditant cette rare collection, dans le but de la soustraire à l’anéantissement, nous resterons en dehors, nous osons le penser, et de la louange et du blâme.
Ainsi, sans prendre hypocritement un extérieur scientifique, notre livre apparaît comme le simple recueil occidental de ce côté de l’humour du peuple russe, qui jusqu’à ce jour n’avait pas trouvé place sous la presse. Devant les conditions sauvages de la censure russe et sa fausse appréciation de la moralité et de la morale, notre livre s’est imprimé sans bruit, dans une retraite éloignée des agitations du monde, là où n’a pas encore pénétré la main sacrilège de quelque censeur que ce soit. À ce propos, nous ne pouvons nous empêcher d’exprimer un de nos désirs intimes : que d’autres coins paisibles de notre patrie suivent l’exemple de notre couvent. Que là se développe, à l’abri de toute censure, le noble art de la typographie, que des mains de la confrérie laborieuse sortent et viennent se réunir sous des presses secrètes tous mots libres, tous récits intimes, à quelque côté de la vie russe qu’ils se rattachent.
Nous ajouterons, en finissant, que nous nous proposons de publier ultérieurement les Proverbes secrets russes et la suite des Contes secrets russes. Les matériaux sont entre nos mains ; il ne nous reste plus qu’à les mettre en ordre. En les publiant, nous espérons rendre service et à l’étude de l’esprit national russe en général, et, en particulier, à nos confrères, aux amateurs véritables et experts de la verve russe intime, franche, imagée, et du brillant humour populaire.
Le printemps était arrivé et fouettait le sang d’un lièvre qui, bien que peu vaillant, se donnait des airs gaillards. Il alla dans un bois et s’avisa de faire visite à une renarde. Celle-ci, au moment où il s’approchait de son terrier, se trouvait sur le poêle, et ses enfants étaient près de la fenêtre. Apercevant le lièvre, elle leur dit : « Allons, mes enfants, si le louche vient me demander, répondez que je ne suis pas chez moi. Voyez-vous, c’est le diable qui l’amène ! Il y a longtemps que j’en veux à ce drôle ; à présent peut-être je le pincerai de façon ou d’autre. » Là-dessus, la renarde se cache. Le lièvre arrive et frappe à la porte. « Qui est là ? demandent les renardeaux. – C’est moi, dit le visiteur ; bonjour, chers petits ! Votre mère est-elle à la maison ? – Elle n’y est pas ! – C’est dommage ! Moi qui venais pour la besogner… et elle n’est pas chez elle ! » reprit le lièvre ; sur ce, il s’élança dans le bois.
La renarde avait tout entendu : « Ah ! fils de chienne, diable louche, vociféra-t-elle, attends un peu, effronté, je te ferai payer cher ton impudence ! » Elle descendit du poêle et se mit aux aguets derrière la porte, pensant que le lièvre ferait peut-être une nouvelle apparition. En effet, il ne tarda pas à revenir. « Bonjour, petits ; votre mère est-elle chez elle ? demande-t-il aux renardeaux. – Elle n’y est pas ! – Tant pis, reprend le lièvre ; je l’aurais régalée à ma façon ! » Soudain la renarde surgit devant lui : « Bonjour, mon cher ! » Le lièvre détale au plus vite, il court à perdre haleine, semant des crottes sur son chemin. La renarde le poursuit. « Non, diable louche, tu ne m’échapperas pas ! » Voilà qu’elle va l’atteindre ! Le lièvre fait un bond et saute au travers de deux bouleaux très rapprochés l’un de l’autre. La renarde veut l’imiter, mais elle reste prise entre les deux arbres, il ne lui est plus possible ni d’avancer ni de reculer, vainement elle s’épuise en efforts pour reconquérir sa liberté. Le louche regarde derrière lui, il voit ses affaires en bon train, revient vivement sur ses pas et prend son plaisir avec la renarde. « Voilà notre genre à nous autres, voilà notre manière, » répète-t-il. Après avoir bien besogné, il se remet précipitamment en route.
Non loin de là se trouvait une fosse à charbon : un paysan y avait fait du feu. Le lièvre court se vautrer dans la poussière noire, ce qui lui donne l’air d’un vrai moine. Ensuite il va rejoindre la route et se tient coi, l’oreille basse. Sur ces entrefaites, la renarde, qui avait enfin réussi à se dégager, s’était mise à la recherche du lièvre ; en l’apercevant, elle le prit pour un religieux : « Bonjour, saint père, dit-elle n’as-tu pas vu quelque part un lièvre louche ? – Lequel ! celui qui t’a f…ue tantôt ? » La renarde rougit de honte et retourna chez elle à la hâte. « Ah ! le coquin, se disait-elle, il a déjà répandu la chose dans tous les monastères ! » Quelque rusée que fût la renarde, le lièvre lui dama le pion !
Dans la cour d’un paysan se trouvait toute une bande de moineaux ; l’un d’eux commença à se vanter devant ses camarades : « La jument grise, dit-il, est amoureuse de moi ; elle m’adresse de fréquentes œillades ; voulez-vous que je la baise devant toute notre honorable réunion ? – Voyons un peu ! » répondirent ses camarades. Le moineau vole vers la jument et lui dit : « Bonjour, chère petite jument. – Bonjour, chanteur ! qu’est-ce que tu me veux ? – Voici : je voudrais te demander… – C’est très bien, reprit la jument ; chez nous, à la campagne, quand un garçon commence à en tenir pour une jeune fille, c’est l’usage qu’il lui fasse des cadeaux, qu’il lui achète des noix et du pain d’épice. Mais toi, qu’est-ce que tu me donneras ? – Dis seulement ce que tu veux. – Eh bien ! va me chercher, grain par grain, un tchetvérik d’avoine ; et alors nous ferons l’amour. »
Le moineau se mit à l’œuvre ; après de longs efforts il réussit enfin à charrier tout un tchetvérik d’avoine. Ensuite il accourut à tire d’aile auprès de la jument : « Allons, ma chère, l’avoine est prête ! » En prononçant ces mots, le moineau ne se sentait pas d’impatience. « Bien, répondit la jument ; il est inutile de remettre l’affaire ; je ne puis pas rester honnête toute ma vie, et l’amour d’un gaillard comme toi n’a rien de déshonorant ! Apporte l’avoine et appelle tes camarades : je ne rougirai pas de t’appartenir ! Pose-toi sur ma queue, tout près de mon cul, et attends que je lève la queue. »
La jument se mit à manger l’avoine, le moineau se plaça sur la queue, les camarades regardant ce qui va se passer ; la jument dévora, dévora, puis leva la queue et le moineau s’introduisit brusquement dans son derrière. La jument le serra avec sa queue et il se trouva horriblement mal. Cependant, après avoir mangé, elle se mit à péter ; le moineau sortit précipitamment du lieu où il était et se mit à dire avec jactance à ses compagnons : « Voilà comme nous sommes, nous autres ! la jument n’a pas pu y tenir : vous avez entendu comme elle a pété. »
Une paysanne labourait dans un champ ; un ours la vit et se dit : « Penser que pas une fois je n’ai engagé la lutte avec les femmes ! Sont-elles ou non plus fortes que les hommes ? J’ai déjà démoli assez de paysans, et je n’ai pas encore eu l’occasion d’avoir affaire aux femmes. » Il s’approche donc de la paysanne et lui dit : « Laisse-moi lutter avec toi ! – Et si tu me déchires quelque chose, Michel Ivanovitch ? – Eh bien ! en ce cas, je t’apporterai une ruche de miel. – Soit, luttons ! » L’ours saisit la femme dans ses pattes et la jette sur le sol. Elle lève ses jambes en l’air, les écarte et lui dit : « Qu’est-ce que tu as fait ? Comment maintenant me montrerai-je à la maison ? Que dirai-je à mon mari ? » L’ours regarde, il aperçoit une grande fente. Voilà son œuvre ! Il ne sait que faire. Soudain un lièvre passe en courant. « Attends un peu, lui crie l’ours, attends, viens ici ! » Le lièvre obéit. L’ours prenant la femme par les lèvres du c.n, les allonge en tirant dessus et ordonne au lièvre de les tenir un moment pendant que lui-même ira en toute hâte chercher des tilles au bois. Il en rapporte un faisceau si gros qu’il peut à peine le traîner. Il veut recoudre la fente faite à la femme. Il jette les tilles par terre ; la femme a peur, elle pète, ce qui fait faire au lièvre un bond de deux archines. « Eh bien ! Michel Ivanovitch, ça craque partout ! – À présent elle se lézarde de tous les côtés ! » dit l’ours, et il s’enfuit aussi vite que possible.
Un paysan possédait une truie qui venait d’avoir douze petits ; il l’enferma dans une étable dont les murs étaient faits de broussailles entrelacées. Le lendemain, le paysan vint voir les jeunes cochons, il les compta et s’aperçut qu’il en manquait un. Le surlendemain il constata encore la disparition d’un marcassin. Qui les vole ? Le vieillard alla passer la nuit dans l’étable où il se mit en observation. Du bois arriva précipitamment un loup qui, s’étant rendu droit à l’étable, tourna le dos à la porte, introduisit sa queue dans une ouverture et commença à la frotter contre le sol de l’étable. Attirés par le bruit les petits cochons quittèrent leur mère et s’approchèrent de la porte pour flairer la queue du loup. Aussitôt celui-ci fit volte-face, fourra sa gueule dans le trou d’où il venait de retirer sa queue, et, saisissant un des jeunes cochons, l’emporta dans le bois.
Le soir suivant, le paysan revint à l’étable et s’assit tout près de la porte. Quand l’obscurité fut devenue épaisse, le loup accourut de nouveau et se livra au même manège que précédemment ; mais, dès qu’il eut introduit sa queue dans l’étable, le paysan la saisit des deux mains et, se tenant solidement appuyé contre la porte, se mit à crier de toutes ses forces : « Tu ! Tu ! Tu ! » Le loup fit des efforts désespérés pour se dégager, il se démena avec violence, tant qu’à la fin sa queue se détacha. L’animal s’enfuit, mais il perdait beaucoup de sang ; après avoir fait vingt pas, il cessa de courir, s’affaissa sur le sol et expira. Le paysan l’écorcha et vendit sa peau.
Le paysan ne savait comment faire pour échapper à ses ennemis. Tout à coup, une idée lui vient : il saisit sa femme dans ses bras et la jette par terre ; elle crie ; « Tais-toi ! » lui dit son mari qui, sans désemparer, la dépouille de sa robe et de sa chemise ; ensuite il lui lève les jambes en l’air aussi haut qu’il peut. L’ours voit que le paysan moleste une femme. « Non, renard, dit-il, toi et le taon vous aurez beau dire, pour rien au monde je ne m’approcherai de ce paysan. – Pourquoi ? – Mais regardez donc, voyez un peu comme il maltraite cette personne. » Alors le renard regarda et dit : « Tu as raison : le fait est qu’il brise les jambes à quelqu’un ! » À son tour, le taon regarda : « Ce n’est pas cela du tout, dit-il ensuite ; il introduit une paille dans le cul de quelqu’un ! » Chacun comprenait que mal leur en prendrait de s’attaquer à l’homme, mais le taon avait mieux deviné qu’aucun autre. L’ours et le renard s’enfuirent dans le bois, et le paysan resta sain et sauf.
Un paysan avait chassé de chez lui un chat libidineux, qui s’était retiré dans un bois. Là habitait une renarde très polissonne : tout le temps elle folâtrait avec les loups et les ours. Elle rencontra le chat ; ils causèrent de ceci et de cela. « Kotoféi Ivanovitch, dit la renarde, tu es garçon, et moi je ne suis pas mariée ! prends-moi pour toi ! » Le chat consentit. Ils firent ensemble un joyeux repas, après quoi ils en vinrent à l’amoureux déduit. Le chat monta sur la renarde et la caressa moins qu’il ne la déchira avec ses griffes. Cependant il ne cessait de crier : « Encore, encore, encore ! » – « Quel être, se dit la renarde, pour lui ce n’est jamais assez ! »
Un pou rencontre une puce : « Où vas-tu ? – Je vais passer la nuit dans le c.n d’une femme. – Eh bien ! moi, je vais entrer dans le cul d’une femme. » Ils se séparèrent. Le lendemain, ils se rencontrèrent de nouveau. « Eh bien ! comment as-tu dormi ? demanda le pou. – Ne m’en parle pas ! j’ai eu si peur ! Une espèce de chauve est venu vers moi et a commencé à me donner la chasse, je sautais çà et là, mais il ne cessait de me poursuivre ; ensuite il a craché sur moi et s’est retiré. – Eh bien ! ma commère, il y en a deux qui cognaient à l’endroit, où je me trouvais, je me suis caché, ils ont continué à cogner et à la fin sont partis. »
Une paysanne prit un pic et le mit en cage. Quand son mari revint à la maison, elle lui apprit la capture qu’elle avait faite. « Où est maintenant ce pic ? Tu ne l’as pas laissé s’envoler ? demanda-t-il. – Je l’ai mis en cage, répondit la femme. – Très bien ! Je vais lui faire son affaire ! Je vais le dévorer tout vif. » Il ouvrit la cage, mais comme il allait donner un coup de dents au pic, celui-ci vola dans la bouche de l’homme, dont il parcourut tout le corps jusqu’au cul, puis, passant sa tête par cet endroit, il se mit à crier : « Je suis vivant ! Je suis vivant ! » Il disparut ensuite, mais pour se montrer de nouveau peu après et répéter la même parole. Il ne laissa pas de repos au paysan qui, se trouvant fort incommodé, dit à sa ménagère : « Prends une bûche, je vais me mettre à quatre pattes ; dès lors que le pic se montrera, assène-lui un bon coup sur la tête. » Il se mit à quatre pattes, sa femme prit une bûche qu’elle brandit sitôt que le pic passa sa tête ; mais le coup, au lieu d’atteindre l’oiseau, meurtrit le derrière du paysan. Que faire ? Le malheureux ne pouvait se débarrasser du pic, qui continuait à passer la tête hors de son cul et à crier : « Je suis vivant ! Je suis vivant ! » « Prends une faux bien aiguisée », ordonna le moujik à sa femme ; « je vais encore me mettre à quatre pattes, et dès que le pic passera sa tête, tu la lui couperas. » La femme prit la faux et son mari se mit à quatre pattes. L’oiseau n’eut pas plus tôt passé sa tête, que la paysanne entreprit de la lui trancher ; mais l’arme, mal dirigée, blessa seulement le cul du moujik. L’oiseau s’envola, le paysan perdit tout son sang et mourut.
Une dispute surgit un jour entre le c.n et le cul, et Dieu sait quel tapage ils firent ! Le c.n dit au cul : « Tu ferais mieux de te taire, vaurien ! Tu sais que je reçois chaque nuit un excellent visiteur, et pendant ce temps-là tu ne fais que répandre une odeur infecte. – Ah ! misérable c.n ! répliqua le cul. Quand on te f. . t, les crachats coulent sur moi, et je me tairais ! » Tout cela est arrivé jadis, dans le temps où on ne connaissait pas encore l’usage des couteaux et où l’on coupait la viande avec le v.t.
Il y avait une fois deux époux. Un jour que la femme servait le dîner à son mari, celui-ci commença à la frapper en disant : « Lave le cul, lave le cul ! » Elle se mit à laver son cul, elle le frotta avec du sable, l’essuya avec une natte au point de faire venir le sang. Mais dès qu’elle entreprend de servir le dîner, son mari recommence à la battre et à répéter : « Lave le cul, lave le cul ! » La femme se plaint à sa tante. « Je n’y comprends rien, ma tante, dit-elle ; quand je mets le couvert, mon mari me bat toujours et me crie : « Lave le cul ! lave le cul ! » Pourtant il me semble que je lave assez bien mon cul, je le frotte même jusqu’au sang ! – Eh ! que tu es sotte, ce n’est pas ton cul qu’il faut laver, c’est celui de la tasse. » Dès que l’épouse se fût mise à laver le cul de la tasse, son mari cessa de la battre.
Un chien est assis sur une meule qui flotte à la surface de l’eau ; il a la tête basse, la queue serrée entre les fesses, il pousse de petits cris et lèche sa patte. « Tu as passé devant la maison de l’évêque ? – Oui ; il y a des chevaux sellés, des hommes à cheval, on joue de la trompette, le diable sait ce qu’on célèbre ? C’est, dit-on, le mariage de l’évêque avec une jument isabelle… – Et as-tu vu l’ours de Rostoff ? – Oui. – Comment est-il ? – Gris. – Est-ce ça un ours ? – Va te faire foutre ! Ne dis pas de sottises, c’est un loup. – Veux-tu te taire ! Chez nous le loup court dans le bois et agite ses oreilles. – C’est un lièvre. – M…. pour toi ! ».
Un paysan avait un fils qui était fort bête. Le jeune homme eut envie de coucher avec une femme ; il se mit à importuner son père : « Marie-moi, papa ! – Attends un peu, mon fils, lui dit le père, il est encore trop tôt pour te marier : ton v.t ne va pas encore jusqu’au cul ; quand il l’aura atteint, alors je te marierai. » Voilà le fils qui prend son v.t dans ses mains et le tire le plus fort qu’il peut, ensuite il regarde et constate la justesse de l’observation faite par son père. « En effet, dit-il, il est trop tôt pour que je me marie, mon v.t n’est pas encore assez grand, il ne va pas jusqu’à mon cul ! Il faut attendre un an ou deux. » Le temps se passe, l’imbécile ne s’occupe qu’à allonger son v.t ; voilà qu’il est parvenu à ses fins ; son v.t non seulement arrive jusqu’au cul, mais le dépasse ! « À présent, dit le jeune homme, je puis me marier sans déshonneur, j’ai de quoi satisfaire ma femme, et elle n’aura pas besoin d’aller avec d’autres ! » Quel jugement attendre d’un imbécile ? pense à part soi le père, et il répond au jeune homme : « Eh bien, mon fils, puisque ton v.t a tellement grandi qu’il atteint ton cul, tu n’as que faire de te marier ; reste garçon, continue à demeurer ici et f. . s-toi avec ton v.t… » Ainsi finit l’histoire.
Une jeune paysanne alla un jour herser dans le clos de ses parents. Elle travaillait depuis longtemps lorsqu’on l’appela à la maison pour manger des beignets. Elle quitta le clos en y laissant le cheval et la herse. « Puisque je vais revenir, ils peuvent bien rester là », pensa-t-elle. Mais le voisin avait un fils qui était un imbécile. Depuis longtemps ce garçon avait des vues sur la jeune fille et il ne savait comment arriver à ses fins. Ayant aperçu le cheval et la herse, il franchit la haie, détela l’animal et l’emmena dans son clos ; la herse, il la laissa à sa place, mais il prit les limons, les fit passer à travers la haie et remit le cheval au brancard. Grande fut la surprise de la paysanne quand elle revint dans son clos : « Qu’est-ce que cela veut dire ? Le cheval est d’un côté et la herse de l’autre ? » Elle commença à allonger des coups de fouet à sa rosse : « Quel diable t’a emmené ? Tu as su sortir du clos, tu sauras bien y rentrer ; allons, allons, arrive ! » Le jeune homme l’écoutait en riant. « Si tu veux, je t’aiderai, dit-il, seulement permets-moi… – Soit », répondit la rusée jeune fille. Elle avait remarqué par terre une vieille tête de brochet qui traînait là avec la bouche béante ; elle la ramassa, et la fourra dans sa manche. « Je n’irai pas près de toi, dit-elle au jeune homme, ne viens pas non plus ici, il ne faut pas qu’on nous voie ; passe-moi plutôt ton affaire à travers la haie et je la mettrai où tu sais. » Le gars s’empressa de faire ce qu’on lui disait ; la jeune fille prit la tête de brochet et, après en avoir écarté les mâchoires, y introduisit l’objet qui y était présenté. Sentant une douleur cruelle, le jeune homme retira au plus vite son membre ensanglanté et se sauva chez lui, où il s’assit dans un coin. « Ah ! peste soit d’elle ! se dit-il, son c.n mord d’une façon terrible ! Pourvu seulement que ma blessure se cicatrise ! Désormais je ne rechercherai plus les faveurs d’aucune fille. »
Voilà qu’au bout d’un certain temps les parents de ce gars s’avisèrent de le marier ; ils le fiancèrent à la fille du voisin et le mariage eut lieu. Un jour, deux jours, trois jours se passent, puis une semaine, deux semaines, trois semaines : le jeune homme n’osait pas toucher à sa femme. Sur ces entrefaites, les époux durent aller voir la mère de la mariée ; ils se mirent en route. Pendant le voyage, la jeune femme dit à son mari : « Écoule, cher Danikoula, pourquoi, m’ayant épousée, n’as-tu pas de relations avec moi ? Si tu ne peux pas, quel besoin avais-tu de faire le malheur de ma vie ? – Non, répondit Danilo, à présent tu ne m’y repinceras plus ! Ton c.n mord. Il m’en a cuit dans le temps, et ce n’est pas sans peine que j’ai été guéri. – Tu plaisantes, reprit-elle, alors je t’ai fait une farce, mais maintenant n’aie pas peur ! Allons, essaie un peu ici, dans le traîneau, toi-même tu trouveras ça bon. » Excité par ces paroles, le jeune homme retroussa la robe de sa femme : « Attends, Varioukha, dit-il, laisse-moi d’abord te lier les jambes ; comme cela, s’il commence à mordre, je pourrai me sauver. » Là-dessus, il détacha les guides et les noua autour des cuisses nues de Varioukha. C’était un mâle vigoureux que ce mari ; il assaillit sa femme avec tant de violence qu’elle jeta les hauts cris. Le cheval était jeune, il prit peur et partit à grand galop ; Danilo roula à terre et Varioukha, emportée à toute vitesse, arriva, les cuisses toujours nues, dans la cour de sa mère. Celle-ci, qui regardait par la fenêtre, reconnut l’équipage de son gendre. « Sans doute, se dit-elle, il apporte du bœuf pour la fête. » Elle alla au-devant de lui et se trouva en présence de sa fille. « Ah ! ma mère, cria la jeune femme, délie-moi vite, que personne ne me voie en cet état. » Quand elle l’eut déliée, la vieille se mit à la questionner : « Et ton mari, où est-il ? – Le cheval l’a jeté en bas du traîneau. »
Entrées dans l’izba, les deux femmes aperçurent par la fenêtre Danilka, qui arrivait. Des enfants jouaient aux osselets dans la cour ; il s’approcha d’eux, puis s’arrêta et regarda autour de lui. La maîtresse de la maison dit à sa fille aînée d’aller le chercher. La jeune fille se rendit auprès de son beau-frère. « Bonjour, Danilo Ivanitch ! commença-t-elle. – Bonjour. – Viens à la maison, on n’attend plus que toi. – Varvara est chez vous ? – Oui. – Est-ce qu’elle ne saigne plus ? » La jeune fille lança un jet de salive et s’éloigna. La vieille envoya alors sa bru au-devant du visiteur. « Viens, Danilouchka, fit celle-ci, il y a longtemps que le sang a cessé de couler. » Elle le conduisit à la maison, où il fut reçu par sa belle-mère, qui lui dit : « Sois le bienvenu, mon cher gendre ! – Varvara est chez vous ? demanda-t-il. – Oui. – Est-ce qu’elle saigne encore ? – Il y a longtemps que c’est fini. » À ces mots, Danilo sortit son membre de son pantalon et le montra à sa belle-mère en disant : « Voyez-vous, matouchka