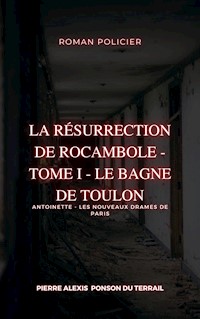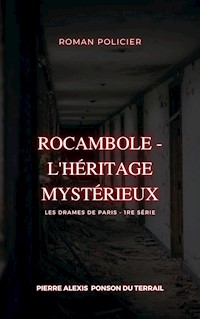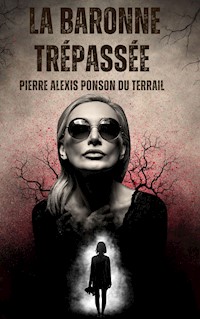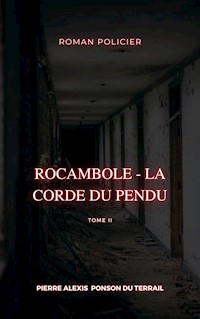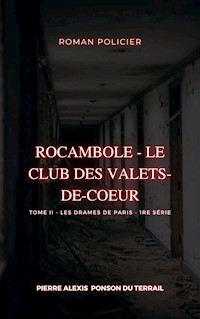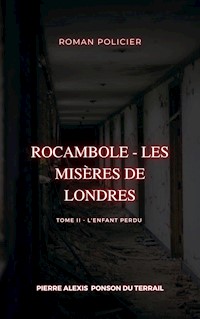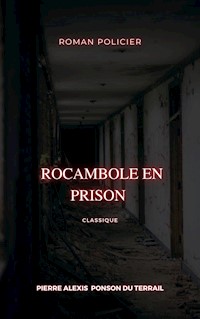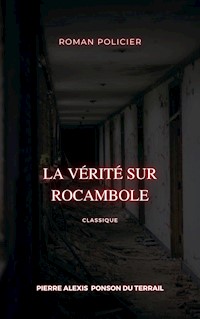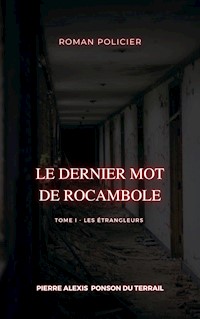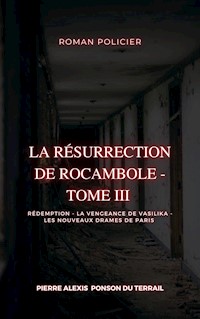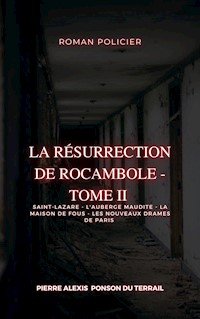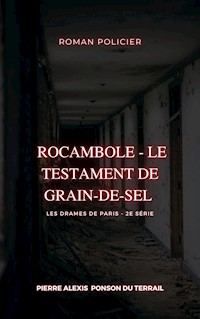2,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
- Le tilbury de monsieur Anatole est prêt ! dit le valet d'écurie en se montrant au seuil du petit salon, tortillant avec gaucherie son bonnet rayé dans ses doigts. - Eh bien, répondit M. Anatole, mets la couverture à mon cheval pour qu'il ne s'enrhume pas. Je perds trop d'argent pour m'en aller comme ça. Ceci se passait un samedi soir, jour de marché, à l'hôtel du Léopard, à Auxerre, dans un petit salon situé à gauche dans la cour, et dans lequel une demi-douzaine de jeunes gens buvaient du punch et jouaient au lansquenet. Les choses se passaient ainsi à peu près tous les samedis. Quelques jeunes gens des châteaux voisins se rencontraient à l'hôtel du Léopard.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 322
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
L'orgue de Barbarie
Pages de titreIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIIIXIVXVXVIXVIIXVIIIXIXXXXXIXXIIXXIIIXXIVXXVXXVIXXVIIXXVIIIXXIXXXXXXXIXXXIIXXXIIIXXXIVXXXVXXXVIXXXVIIXXXVIIIXXXIXXLXLIXLIIXLIIIXLIVXLVXLVIXLVIIXLVIIIXLIXLLILIILIIILIVLVLVILVIILVIIILIXLXLXILXIILXIIILXIVPage de copyrightL’orgue de Barbarie
_________
Ponson du Terrail
I
– Le tilbury de monsieur Anatole est prêt ! dit le valet d’écurie en se montrant au seuil du petit salon, tortillant avec gaucherie son bonnet rayé dans ses doigts.
– Eh bien, répondit M. Anatole, mets la couverture à mon cheval pour qu’il ne s’enrhume pas. Je perds trop d’argent pour m’en aller comme ça.
Ceci se passait un samedi soir, jour de marché, à l’hôtel du Léopard, à Auxerre, dans un petit salon situé à gauche dans la cour, et dans lequel une demi-douzaine de jeunes gens buvaient du punch et jouaient au lansquenet.
Les choses se passaient ainsi à peu près tous les samedis. Quelques jeunes gens des châteaux voisins se rencontraient à l’hôtel du Léopard.
Les uns étaient venus pour leurs affaires, les autres pour tuer le temps ; ils avaient déjeuné ensemble et chacun, avant de quitter l’hôtel pour monter en ville, avait recommandé qu’on lui tînt son cheval prêt pour quatre ou cinq heures de l’après-midi.
Puis les premiers rentrés à l’hôtel avaient demandé du punch, ensuite des cartes, et il était souvent minuit que les chevaux, attelés depuis cinq heures, attendaient encore ces messieurs qui cartonnaient avec fureur.
Cela était arrivé ainsi ce soir-là.
– Messieurs, s’était écrié un grand jeune homme aux cheveux noirs, au teint pâle, fort beau garçon, mais d’une beauté étrange, et comme empreinte d’un sceau de méchanceté, messieurs, je crois que je perdrais ce soir la terre de la Bertaudière tout entière, si elle était à moi déjà.
– Comme si tout ce qui est à ton oncle ne devait pas te revenir ! dit un autre jeune homme qui gagnait et avait le gain de belle humeur.
– Parbleu ! reprit M. Anatole, car c’était ainsi qu’on appelait le grand jeune homme au teint pâle, je voudrais voir que ce vieux grigou me refusât quelque chose !...
– Jeune homme, dit une voix grave, dans un coin du petit salon, vous êtes peu respectueux pour le commandant de Perne..., votre oncle...
Les joueurs tournèrent la tête et aperçurent alors un homme d’environ cinquante ans, sec, maigre, portant une moustache grise, boutonné jusqu’au menton, coiffé d’une casquette ronde, chaussé de grandes bottes à l’écuyère et tenant à la main un fouet de chasse.
– Tiens, c’est vous, Armand, fît le baron de V., par où diable êtes-vous entré ?
– Par la porte, mes amis, mais sur la pointe du pied, attendu que vous paraissiez jouer un de ces petits jeux d’enfer qu’il ne faut pas interrompre.
– Peuh ! dit le baron, je gagne vingt-cinq louis.
– Moi j’en perds cinquante, dit M. Anatole.
– Raison de plus pour vous en aller, jeune homme, dit le chasseur. Votre oncle est au lit depuis longtemps, et vous avez un bout de chemin d’ici à la Bertaudière.
– Je me moque de mon oncle, répliqua le jeune homme au teint pâle, mais je ne veux pas m’entêter. Tenez, c’est à moi la banque, je fais mes derniers dix louis, et je n’en veux plus.
M. Anatole prit les cartes et perdit du premier coup. Alors il donna un violent coup de poing sur la table, se leva et dit :
– Cette fois, j’en ai assez ; et il faudra que le vieux ouvre ses tiroirs demain. Bonsoir, tout le monde.
– Bonsoir, Anatole, dit le baron de V... Chassez-vous demain à Frettoye ?
– Non, je vais à Vermenton où j’ai affaire.
Et le jeune homme sortit en saluant. Et deux secondes après, on entendit le bruit de son tilbury qui roulait sous la porte cochère et gagnait le quai d’Yonne.
– Quel singulier garçon ! dit alors le baron de V...
– Quel type ! fit un autre joueur.
– Quel vilain type ! dit un troisième.
– Il est certain, reprit un quatrième personnage, que notre ami Anatole n’est ni un bon camarade, ni un bon garçon.
– Je dirais même, reprit le baron, qu’il est méchant. On ne l’aime guère dans le pays où il est.
– Oui, mais on y adore le commandant, répondit l’homme au fouet de chasse à qui on avait donné le nom d’Armand.
– Son oncle le commandant ?
– Son oncle ou son père, on ne sait pas.
Ces derniers mots firent tressaillir les personnes qui entouraient la table de jeu.
– Il est certain, messieurs, reprit le baron de V..., que l’état civil de M. Anatole de Perne n’a jamais été bien établi. Est-il le neveu du commandant ?
– Certainement, dit une voix.
– Non, dit une autre.
– Est-il son fils ?
– Baron, dit le chasseur, quel âge avez-vous ?
– Trente et un ans, pour vous servir, mon noble ami monsieur Armand de Bertaud, et je suis encore le doyen de tous ces messieurs, la vraie fine fleur de la société de Rallie-Morvan, répondit le baron en riant.
– J’en ai cinquante-cinq, moi, mes enfants, répondit M. Armand de Bertaud, et je sais une foule de choses que vous ne savez pas, que vous ne pouvez pas savoir.
– Ah ! ah !
– Je me rappelle, comme si c’était hier, le retour du commandant de Perne dans notre bonne ville d’Auxerre. Ce fut un événement.
Je me rappelle encore les commentaires qui accueillirent, six mois après, l’apparition de l’enfant qui devait être un jour ce joli vaurien qui sort d’ici.
– Ma parole d’honneur, s’écria le baron, nous sommes pourtant en province.
– Sans doute.
– En province, on doit tout savoir, et chacun est passé au crible de la belle manière.
– Généralement.
– Il est donc bien étrange qu’on ne sache pas dans tout le département la véritable situation d’Anatole.
– C’est qu’en effet, répondit M. Armand de Bertaud, s’il y a une histoire mystérieuse au monde, c’est bien celle-là.
– Eh bien, dites-nous ce que vous en savez.
– Oh ! volontiers, répondit M. de Bertaud.
Les joueurs abandonnèrent leur partie et se prirent à écouter.
II
M. Armand de Bertaud était un homme de cinquante à cinquante-cinq ans, nous l’avons dit, et un des types les plus corrects du gentilhomme de province.
Il avait servi, obtenu le grade de capitaine et la croix, était revenu en Bourgogne et s’était fait agriculteur et chasseur.
Les veneurs de la contrée le tenaient en haute estime ; son petit manoir d’Arcy-sur-Cure, à demi perdu dans un massif de chênes, au flanc d’un coteau, passait pour le toit le plus hospitalier des environs. C’était un homme doux, affable, que les paysans et les vignerons aimaient et respectaient, et duquel on disait : Il est vraiment singulier que M. de Bertaud ne se soit pas marié ; il eût fait un mari modèle.
Resté jeune de cœur et d’esprit autant que de corps, car il était robuste, en dépit de son apparence un peu chétive, Armand de Bertaud se plaisait dans l’intimité de cette jeunesse un peu fougueuse à qui le vin de Bourgogne a servi de lait nourricier.
Par contre, tous les jeunes gens que nous venons de voir à l’hôtel du Léopard avaient-ils pour lui une respectueuse amitié.
Il était donc tout naturel qu’on eût cessé de jouer et que tout le monde se fût pressé autour de lui pour écouter son récit.
– Mes enfants, dit le vieux gentilhomme, vous me permettrez de prendre les choses d’un peu loin et de vous donner quelques petits renseignements sur la famille du commandant.
La maison de Perne n’est pas bourguignonne. Le père du commandant et du baron de Perne, son frère, était un cadet de province qui s’en vint, au commencement du premier Empire, épouser, à Coulanges-sur-Yonne, une riche héritière, une fille de la branche aînée de ma famille à moi, Mlle de Bertaud, ce qui vous explique comment la terre de la Bertaudière, à qui nous avons donné notre nom, appartient au commandant.
En 1830, celui que nous appelons le commandant était capitaine dans un régiment de hussards.
Peut-être eût-il donné sa démission si son régiment n’eût pas été en Afrique en présence de l’ennemi.
Après la prise d’Alger, et quand son régiment rentra en France, il quitta le service, mais pas assez tôt pour ne pas voir au Moniteur, en débarquant à Toulon, sa double nomination de chef d’escadron et d’officier de la Légion d’honneur.
Son père venait de mourir laissant une fortune considérable partagée entre ses deux fils, mais par inégales portions, suivant la vieille tradition du droit d’aînesse qui avait beaucoup de mauvais, sans doute, qui était même souverainement opposée aux principes de l’équité, mais qui permettait de conserver de génération en génération la fortune d’une maison.
Le commandant n’accepta pas tout d’abord le testament paternel.
Il offrit à son frère un partage en égales parts, mais le frère refusa.
Il n’y avait pas huit jours que le commandant de Perne, rentré dans la vie civile, avait fait son apparition dans l’Auxerrois, qu’il était déjà le point de mire de toutes les maisons où il y avait des filles à marier.
Il avait trente mille livres de rentes, on lui en donnait cinquante, comme toujours ; il était tout jeune, vingt-sept ans à peine, beau garçon et brillant cavalier.
En un mois on lui offrit dix héritières qu’il refusa, disant qu’il avait bien le temps d’affronter cette grande épreuve.
Il s’installa à la Bertaudière qu’il restaura de fond en comble, remonta son chenil et son écurie, donna des fêtes et se montra pendant six mois le plus gai et le meilleur compagnon qu’on pût voir.
Néanmoins la province n’était pas contente.
Les pères de famille fronçaient le sourcil, les douairières murmuraient, les jeunes filles soupiraient.
On aurait voulu que le commandant se mariât.
La médisance fit alors son tout petit bonhomme de chemin.
On remarqua que le commandant venait à Auxerre trois ou quatre fois par semaine, le soir et non le matin, et qu’il n’en repartait que bien avant dans la nuit.
Cette remarque faite, on en fît une autre.
Il y avait alors à Auxerre un vieux receveur général en retraite qui avait une jeune et jolie femme. Ils habitaient à la porte des Glainies, hors de la ville, un bel hôtel entouré d’un immense jardin. Un soir, quelques écervelés, en sortant du cercle, rencontrèrent un homme qui sortait par la porte des Glainies en rasant les murs et le nez dans son manteau.
– Hé ! fit l’un, c’est le commandant.
– Farceur ! dit un autre, que faites-vous donc là, hein ?
– Je fume mon cigare, répondit le commandant visiblement contrarié.
– Et vous allez chez Mme de C...
– Vous êtes fou, dit le commandant.
– Mais non !...
– Mais si !
Le commandant se fâcha ; une provocation s’ensuivit, et, le lendemain, le jeune homme qui avait prononcé le premier le nom de la femme du receveur général reçut un galant coup d’épée dans le bras.
Mme de C..., comme bien vous pensez, s’en trouva un peu plus compromise, et les bonnes langues de la province allèrent leur train.
Mais un beau jour ce fut bien pis.
Le commandant cessa tout à coup de venir à Auxerre, et ne sortit plus de son manoir.
D’abord on crut à une rupture avec Mme de C...
Puis à travers les grilles du parc, on aperçut avec stupeur une bonne grosse Cauchoise qui promenait par la main un enfant de deux ou trois ans.
Le commandant était devenu père, et on ne lui connaissait pas de femme.
On jeta les hauts cris. Les plus forcenés pénétrèrent chez lui et demandèrent le mot de l’énigme.
– C’est mon neveu, dit le commandant.
– Mais votre frère n’est pas marié.
– Soit.
– Donc il n’a pas d’enfant.
– C’est mon neveu à la mode bretonne, dit-il, l’enfant d’une cousine qui vient de mourir en Provence.
Le frère cadet du commandant jura qu’il n’avait jamais entendu parler de cette cousine.
Le commandant demeura impénétrable.
Un moment on avait pu croire à une délivrance clandestine de Mme de C...
Mais Mme de C. était mondaine ; elle n’avait pas manqué un seul bal durant deux hivers ; et puis, d’ailleurs, il y avait sept ou huit mois à peine que le commandant était dans le pays.
Alors, en opposition à la version du commandant, il s’en établit une autre.
On demeura convaincu que cet enfant qu’on appelait Anatole était un péché de jeunesse et de garnison du beau commandant.
– Péché est bien le mot, dit alors un des auditeurs, tandis que M. de Bertaud allumait un cigare, car jamais vaurien pareil n’a vécu sous la calotte des cieux.
– Attendez donc, mes enfants, dit M. de Bertaud, je n’ai pas fini.
– Continuez, Armand, nous vous écoutons, dit le baron.
Et le cercle se resserra autour du narrateur.
III
À partir de ce jour-là, continua M. Armand de Bertaud, la vie du commandant fut pour ainsi dire murée.
On ne le vit plus nulle part.
Il donna sa démission de membre de Rallie-Bourgogne et de Rallie-Morvan, et six années s’écoulèrent sans qu’il eût franchi le seuil de la Bertaudière.
Vous voyez d’ici le vieux manoir, hein ?
Il est sur la rive gauche de la Cure, en face de Cravant et de Vermenton.
Un bois de châtaigniers l’entoure ; de grands murs, bordés de peupliers, clôturent le parc.
Du haut des étages supérieurs ou des tourelles, on découvre une vue admirable.
Le lieu, comme vous voyez, était merveilleusement choisi pour servir de Thébaïde à un homme qui semblait avoir rompu avec le monde entier.
On s’était beaucoup occupé de lui d’abord ; on finit par l’oublier.
Son frère, le baron de Perne, s’était marié dans l’intervalle.
Le commandant avait signé au contrat, assisté à la bénédiction nuptiale, et s’était retiré aussitôt après sans vouloir prendre part au repas de noces.
Les deux frères étaient en froid déjà. Le baron se fâcha tout à fait.
Il y a près de vingt ans que les deux frères ne se sont vus.
– Cependant, interrompit M. de V... ils sont voisins.
– Très proches voisins même, reprit M. de Bertaud ; il n’y a pas une lieue par la traverse de la Bertaudière à Pré-Gilbert. Les deux châteaux sont adossés à la même colline, l’un au nord, l’autre au midi.
Dans ma jeunesse, j’étais lié avec Charles de Perne, le baron, et nous sommes allés bien des fois de l’un à l’autre en remontant à travers le parc jusqu’au sommet du coteau.
Mais je reprends mon récit.
Le commandant vécut donc dix ou douze ans à la Bertaudière sans en sortir, et on avait fini par ne plus songer à lui, quand un matin on vit une chaise de poste sortir du vieux manoir, gagner la grand-route et se diriger bruyamment vers Auxerre.
C’étaient le commandant et l’enfant mystérieux qu’il avait élevé qui partaient pour Paris. Une semaine après, le commandant revint et reprit sa vie de solitude.
Il avait mis le jeune Anatole à Sainte-Barbe.
Chaque année, aux vacances, l’enfant revenait, et chaque année, quand arrivait le mois de novembre et que le barbiste repartait pour Paris, on entendait dans tout le pays comme un murmure de satisfaction.
Les instincts méchants du drôle s’étaient développés de bonne heure.
Tantôt, quand il chassait, il tirait sur les poules d’un paysan, tantôt il fourrageait une vigne non vendangée.
On venait se plaindre à la Bertaudière ; le commandant soupirait et payait sans mot dire.
Depuis qu’il a terminé ses études et qu’il mène à la Bertaudière l’existence d’un gentilhomme campagnard, Anatole ne s’est point modifié.
C’est toujours le vaurien sans foi ni loi, méchant pour le plaisir de l’être, et que les paysans d’alentour écharperont bien certainement le lendemain de la mort de ce pauvre commandant, que j’ai entrevu l’autre jour et qui a l’air d’un cadavre ambulant.
– Mais, dit un des auditeurs de M. de Bertaud, il faut convenir que la province est bien naïve pour douter de la paternité du commandant en présence de cette faiblesse déplorable qu’il montre pour Anatole.
– Il lui laissera toute sa fortune, dit un autre.
– Et il déshéritera ses neveux, ajouta M. de Bertaud. Seulement, je vais vous dire une chose bizarre et que le hasard seul m’a révélée.
– Voyons.
– Le commandant n’aime pas Anatole.
– Par exemple !
– Il est même des heures où il le traite violemment.
– Mais c’est impossible ce que vous dites là. Alors il le craint.
– Je ne le crois pas. Que voulez-vous, dit M. de Bertaud en terminant, tout est mystère dans cette affaire. Je vous ai dit ce que j’en savais.
– Alors c’est tout ?
– Oui.
– Vous ne savez plus rien ?
– Plus rien absolument.
– Eh bien, moi, dit alors le baron de V..., je suis plus avancé que vous, Armand.
– Vous ?
– Moi.
– Que savez-vous donc de plus ?
– Je suis devenu le confident de maître Anatole.
– Comment cela ?
– Maître Anatole a des projets qu’il caresse dans l’ombre, et il lorgne, à travers l’épaisseur de la colline qui sépare les deux châteaux, Mlle Josèphe de Perne.
À ces paroles M. de Bertaud fit un soubresaut sur son siège.
– Vous êtes fou, baron, dit-il.
– Nullement, mon ami.
– Josèphe est un ange de vertu et de beauté, et c’est un autre mari que maître Anatole qu’il lui faut.
– Je suis entièrement de l’avis de M. de Bertaud, dit un autre des auditeurs, et je puis même vous fournir un petit renseignement.
– Ah ! fit Armand.
– Il est question d’un mariage pour Mlle de Perne.
– Avec qui ?
– Avec notre bon et excellent ami Jean de Mauroy.
– À la bonne heure ! fit M. de Bertaud.
– Et je crois qu’ils s’adorent déjà.
– Jean est un cavalier accompli.
– Ils feront le plus joli couple du monde.
– Je puis même vous dire qu’ils sont déjà fiancés.
– Tout cela ne prouve rien, dit froidement le baron de V...
– Plaît-il ?
– Je vous jure qu’Anatole a fait le serment d’épouser sa cousine, et qu’il y arrivera.
– Eh bien, moi, dit en se levant M. de Bertaud, je vous jure que je suis trop l’ami du père pour laisser accomplir le malheur de la fille.
Et sur ce serment, M. de Bertaud rajusta son manteau et ajouta :
– Excusez-moi, mes jeunes amis, mais je chasse demain au Puisaye, et j’ai dix bonnes lieues à faire pour arriver au rendez-vous.
Il serra toutes les mains et rejoignit son cheval qu’un palefrenier promenait tout sellé dans la cour.
Et mettant le pied à l’étrier, le vieux gentilhomme murmura :
– Quand je devrais le tuer, je saurai bien empêcher ce drôle de jamais épouser ma belle et vertueuse Josèphe !
IV
Suivons maintenant M. Anatole, qui venait de monter en tilbury pour s’en retourner à la Bertaudière.
L’Yonne, qui est un des plus beaux départements de France, est un peu le pays du sans-façon.
Il y a de grosses fortunes qui ne font pas grand bruit et ne se refusent rien, cependant, de ce qui fait le confort de la vie.
C’est la terre du bon vin, des bons repas, des joyeux rires et des braves cœurs.
C’est aussi le pays des gens d’esprit, du paysan moqueur, du chasseur possédé du feu sacré et du braconnier incorrigible.
Bien vivre est la devise de chacun ; mais vivre à sa guise, sans faire d’embarras, sans se créer des ennuis. Tel gentilhomme qui a table ouverte dans sa gentilhommière, a coupé les arbres de son parc pour planter un clos de vigne ; et, s’il a vingt-cinq briquets au chenil, qui chassent le lièvre aussi bien que le chevreuil, il en est encore au petit cheval du Morvan et se contente, pour livrée, d’un galon à la casquette de cuir de son domestique.
La plupart des gentilshommes fermiers, pour nous servir de l’expression anglaise, vont à la ville sans bruit ni trompettes.
Quelquefois un méchant gamin de douze ans est assis dos à dos avec son maître sur son dog-cart haut sur roues.
Le plus souvent, le gentilhomme est tout seul dans un tilbury attelé d’un bon cheval un peu lourd, mais qui a un train soutenu et fait ses quatre lieues à l’heure.
Il arrive à Auxerre, descend au Léopard qui est le premier et le plus confortable hôtel de la ville, confie son modeste équipage au garçon d’écurie et va passer sa journée à ses affaires.
Le soir, comme nous l’avons vu, il revient, ordonne d’atteler, boit un grog en attendant, s’attarde à un whist ou à un lansquenet dans le petit salon, et finit par ne s’en aller qu’à minuit ou une heure du matin.
Les femmes du beau pays de Bourgogne sont faites à ce manège et ne s’en préoccupent guère.
Elles dînent toutes seules le samedi, couchent leurs enfants et s’endorment elles-mêmes sans préoccupation aucune.
Les routes sont sûres, du reste. L’histoire du courrier de Vermenton qui fut assassiné entre Vincelles et Cravant est devenue une légende, car il y a bien quinze ans de cela, et depuis ce temps la vigne a été malade et s’est guérie trois fois.
Cependant, on glisse une paire de pistolets dans le tablier du tilbury roulé au garde-crotte ; ou bien on emporte son fusil de chasse dans le canon gauche duquel on a mis une balle ; mais, ni pistolets ni fusil n’ont jamais servi.
M. Anatole était donc parti tout seul.
On était en octobre, le temps était frais, le ciel clair, et une belle lune versait ses rayons d’argent sur le paysage.
La route qui menait à la Bertaudière était l’ancienne route impériale de Paris à Lyon par la Bourgogne.
Elle passe l’Yonne à Auxerre, remonte la rive droite de la rivière jusqu’à Champs, en décrivant une courbe, repasse l’eau à ce dernier village et file alors tout droit jusqu’à Vincelles, une jolie bourgade qui n’a qu’une rue.
À gauche, les coteaux d’Irancy et de Saint-Bris et la plaine de Vincelottes ; à droite, les coteaux opulents de Coulanges-la-Vineuse, au-dessus desquels s’étendent de grands bois giboyeux.
Puis tout là-bas, devant soi, les tours ruinées et l’enceinte à demi détruite de ce village à mi-côte qu’on appelait jadis Cravant-le-Fort, et sous les murs duquel, au moyen âge, le connétable de Chastellux écrasa les Anglais.
La route est unie comme un lac ; elle est ferrée de cailloux de rivière et résonne comme un tambour.
M. Anatole avait laissé éteindre les lanternes qui brûlaient depuis huit heures du soir, et la jument, une de ces petites charbonnières morvandelles qui vont un train d’enfer, avait dévoré en quarante minutes les trois lieues et demie qui séparent Auxerre de Vincelles, lorsque le jeune homme s’arrêta tout à coup.
La bourgade était silencieuse et il y avait longtemps que minuit était sonné.
Cependant un peu de lumière passait sous une porte, et au-dessus de cette porte, devant laquelle le tilbury s’était arrêté, se balançait la traditionnelle branche de houx que les gens altérés contemplaient avec amour.
– Hé ! Forestier ? cria M. Anatole.
Aussitôt la porte s’ouvrit et un homme à moitié endormi se montra sur le seuil.
– Ah ! c’est vous, monsieur le comte, dit-il.
– Parbleu ! oui, c’est moi.
– Excusez-moi, je me suis endormi. Quelle heure peut-il bien être ?
– Une heure du matin.
– Après ça c’est bien possible, dit le paysan ; ma chandelle, qui était neuve, est quasiment tout usée.
– As-tu vu le Héron, ce soir ?
– Oui, monsieur, il est venu ; il est même resté longtemps ici.
– Jusqu’à quelle heure ?
– Dix heures environ. Mais il s’en est allé.
– Il ne t’a rien dit pour moi ?
– Si fait ; il prétend qu’il y a un joli coup de fusil à faire dans les prés de Bazarne, et il y sera demain matin.
– L’imbécile ! fit M. Anatole avec humeur, comme s’il n’aurait pas pu m’attendre ! Bonsoir, Forestier...
– Bonsoir, monsieur Anatole... Vous ne voulez pas boire un coup, par hasard ?
– Merci ; je n’ai pas soif.
– Ma nouvelle cuvée est pourtant fameuse !
– Non, non, merci... pas ce soir... un autre jour.
– Comme vous voudrez...
M. Anatole donna un coup de langue et sa jument repartit.
À trois cents mètres environ des dernières maisons de Vincelles, le chemin se bifurque.
La voie impériale est croisée, en cet endroit, par la route départementale de Mailly-la-Ville et Chastel-Censoir.
Sur la droite s’élève un petit bois de chênes et de hêtres.
Au moment où M. Anatole atteignait cette bifurcation, un être bizarre se dressa tout à coup devant lui.
– Tiens ! c’est le Héron, dit le jeune homme.
Le Héron était un être humain ; mais, la lune aidant, il avait une apparence fantastique, et ses jambes étaient si longues qu’on eût dit celles d’un échassier, tandis que son buste était si court qu’on aurait pu croire qu’il était fendu jusqu’au menton.
Et celui à qui sa conformation bizarre avait valu le sobriquet de Héron, allongea ses jambes démesurées et vint à la rencontre de M. Anatole, qui paraissait très pressé de le voir et de causer avec lui.
V
Quel était donc ce bizarre personnage ?
C’est ce que nous allons vous dire en quelques mots.
Au physique, cet homme ressemblait donc à un échassier : longues jambes, long cou, tête pointue et nez recourbé, et, séparant les jambes du cou, un buste court et gibbeux rappelant fort bien le corps du héron.
Le Héron avait les cheveux d’un blond incertain, les yeux bleus, le visage assez doux, bien que certains signes accusassent un caractère bien trempé et une volonté énergique ; il avait de grandes dents jaunes et des lèvres minces, mais son sourire n’était ni disgracieux ni dépourvu d’une certaine finesse.
La couleur même de ses cheveux, qu’il portait un peu longs, et de sa barbe, qui était rare, laissait son âge indécis.
Avait-il trente-cinq ans ou bien cinquante ?
Il était presque impossible de trancher la question.
Le Héron n’était pas du pays et on ne savait guère d’où il venait.
À Cravant, à Vermenton, à Pré-Gilbert, on l’avait toujours vu.
Du temps de M. de Perne, le père, – il y avait beau jour, par conséquent, – le Héron était déjà dans la maison. Il était un peu palefrenier, un peu garde-chasse, un peu courrier.
C’est-à-dire, pour justifier ce dernier emploi, qu’on lui donnait des lettres à porter et qu’en ouvrant ses grandes jambes comme un compas il allait plus vite qu’un cheval au trot.
Quand le vieux marquis de Perne était mort, le Héron n’avait pas tout à fait quitté le service de la maison, mais il avait changé de position.
Au lieu de rester soit à la Bertaudière, soit au château de Pré-Gilbert, de servir par conséquent soit le commandant qui revenait du service, soit son père, il avait voulu servir les deux, et voici comme :
Bien que le marquis eût fait un testament par lequel il avantageait son fils aîné le commandant, certains biens étaient restés indivis entre les deux frères.
C’étaient des bois qui couvraient une superficie de plusieurs centaines d’hectares, de l’autre côté de la route de Mailly-la-Ville.
Le Héron s’en était nommé garde général de sa propre autorité, et les deux frères, qui n’étaient pas encore brouillés, l’avaient laissé faire.
Il y avait donc, à l’époque où commence notre récit, quelque chose comme vingt-quatre ou vingt-cinq ans que le Héron habitait une maisonnette en plein bois, taillait et rognait à son idée, vendait des coupes, en aménageait d’autres et avait pleins pouvoirs.
Il était devenu peu à peu l’unique trait d’union qui restât encore entre les deux frères, brouillés depuis si longtemps.
Le Héron était grand chasseur ; il était même braconnier.
Qu’on nous permette d’expliquer ce dernier mot.
Braconnier, pour le vulgaire, signifie un homme qui chasse, sans permis de port d’armes, sur la terre d’autrui, prend le gibier de son voisin de toutes les manières et en tire profit.
Mais il y a des gens qui ont un permis de chasse et des terres et qui n’en sont pas moins braconniers ; car ce mot veut dire aussi un homme qui a déclaré au gibier une guerre sournoise et pleine de ruse, alors que ce même gibier lui appartient ; qui ne dédaigne ni la chanterelle au temps où la perdrix est folle d’amour, ni l’affût, ni le filet, ni le collet de cuivre ; qui engage avec le gibier une lutte de tous les instants, répondant par la ruse à la ruse, et faisant une étude constante des mœurs et des habitudes de son ennemi.
À ce dernier point de vue, le Héron était fameux à six lieues à la ronde.
Grande ou petite chasse, il était malin entre tous.
Tel gentilhomme qui chassait à courre ne dédaignait nullement ses conseils ; tel jouvenceau à qui on mettait un fusil dans la main pour la première fois, s’en allait demander au Héron sa protection et ses lumières.
Il vendait bien un peu de gibier ; mais il en donnait beaucoup et fournissait en toute saison la table des deux châteaux.
Il était également bien vu à Saint-Gilbert et à la Bertaudière.
Mlle Josèphe de Perne, que M. de Bertaud appelait un ange et avec qui nous ferons bientôt connaissance, aimait fort le Héron.
M. Anatole, ce vaurien qui n’aimait personne et faisait la vie si dure au pauvre commandant, ne pouvait plus se passer de lui.
Cet homme, doux et naïf en apparence, poursuivait cependant un but ténébreux, un but que personne n’avait même soupçonné, et, comme on va le voir, ce n’était pas pour préparer quelque vulgaire expédition de chasse qu’il avait attendu si longtemps ce soir-là M. Anatole au cabaret de Vincelles, et qu’il l’attendait encore à une heure du matin, couché dans le fossé de la route.
Le Héron, en reconnaissant au clair de lune le tilbury de M. Anatole, s’était donc dressé tout à coup, et mettant ses longues jambes en mouvement, il était venu à la rencontre du jeune homme.
– Eh bien ! fit celui-ci qui arrêta net sa jument, y a-t-il du nouveau depuis ce matin ?
– S’il n’y en avait pas, répondit le Héron, je ne serais pas venu. Vous savez bien que c’était convenu entre nous.
Et le Héron, qui avait son fusil sur le dos, monta lestement dans le tilbury à côté de M. Anatole, ajoutant :
– Vous n’avez pas besoin de presser la grise, nous avons à causer un brin.
– Parle, dit le jeune homme.
– M. de Mauroy est venu à Pré-Gilbert aujourd’hui, reprit l’homme aux longues jambes, tandis que M. Anatole mettait sa jument au pas.
– Ah ! fit ce dernier avec colère.
– Il s’est longtemps promené avec le baron dans le parc.
– Josèphe était-elle avec eux ?
– Non, mais j’aurais autant aimé qu’elle y fût.
– Pourquoi ?
– Parce qu’ils ont parlé d’affaires tout le temps.
M. Anatole serra le manche de son fouet avec fureur.
Le Héron poursuivit :
– J’étais couché dans une cépée, à deux pas d’un tronc d’arbre sur lequel ils se sont assis, causant comme des gens qui se croient bien seuls.
– Après ?
– Ils ont parlé du contrat.
– Mais, tonnerre ! exclama M. Anatole, c’est donc décidé, ce mariage ?
– Jusqu’à présent, dit le Héron ; mais je suis là, moi, et je m’arrangerai bien de manière qu’il ne se fera pas.
Un sourire glissa sur les lèvres minces du garde-chasse.
– J’ai dépisté bien d’autres gibiers dans ma vie, fit-il.
– As-tu donc une bonne idée ?
– Peut-être.
Et le Héron eut un air mystérieux, et M. Anatole se prit à le regarder et à l’écouter avec une sorte d’avidité.
VI
Cependant, comme le Héron ne se pressait pas de parler, M. Anatole lui dit :
– Je parie que je devine.
– Hein ? fit l’homme aux longues jambes.
– Tu vas te camper, un de ces soirs, au coin du bois du Fay, et tu attendras qu’il passe.
– Qui ça ?
– Mauroy, parbleu !
– Et puis ?
– Et puis tu le prendras pour un lièvre.
Dame ! la nuit, on se trompe.
Le Héron eut un geste de dénégation énergique.
– Oh ! pas de ça, monsieur Anatole, fit-il.
– Plaît-il ?
– Je veux bien être avec vous, continua le Héron ; mais je ne veux pas commettre un crime.
– Imbécile !
– J’ai un autre moyen, allez...
– Voyons-le, ton moyen.
– M. de Mauroy est un gentil garçon, poursuivit le Héron ; on ne peut pas dire autrement, et on l’aime dans le pays, bien qu’il ne soit pas bien riche.
– Il n’a pas le sou, dit M. Anatole avec dédain.
– Mais c’est un noble du vieux temps, continua le Héron, bon au pauvre monde, le cœur sur la main et pas fier...
– Après ?
– Il a quasiment trente ans aujourd’hui, et il en avait dix-huit que Mlle Josèphe était une petite fille. Vous pensez bien qu’alors il ne songeait guère qu’il l’aimerait un jour et penserait à en faire sa femme.
– Héron, mon ami, dit M. Anatole avec impatience, est-ce que tu vas jaser longtemps comme ça pour ne rien dire ?
– Vous êtes un peu pressé, monsieur Anatole, répondit le Héron avec flegme, faut pourtant que je m’explique...
– Eh bien ! va, mais dépêche-toi.
– Je vous disais donc que lorsque M. de Mauroy avait vingt ans, Mlle Josèphe n’en avait guère que six ou sept.
– Après ?
– M. de Mauroy vivait seul avec son père, dans leur château.
– Tu veux dire leur bicoque ?
– Pour une bicoque, je ne dis pas non, fit l’homme aux longues jambes ; mais c’est tout de même un château, et il y a beau jour que l’Yonne, en passant, voit ses quatre tours se mirer dans l’eau.
Je vous disais donc que M. de Mauroy et son père vivaient seuls.
Le papa avait fait la guerre au temps de Napoléon, il était vieux, et quand ses rhumatismes le prenaient, il était cloué pour des mois entiers dans son fauteuil.
M. Jean allait à la chasse tout le jour, et il ne faisait pas plus attention à une fille qu’à un pigeon de colombier.
Mais il y avait une fillette qui s’occupait de lui, tout au contraire.
– Ah ! ah !
– C’était la fille à Jacques Dubarle, le meunier de Sezy, un beau brin de fille, du reste, qu’on appelait la Toinon.
M. Jean passait souvent par le moulin ; la Toinon lui faisait bonne mine. Quelquefois il buvait un coup avec le meunier, et la Toinon jasait comme une pie.
Quand on a vingt ans, on n’a pas grand-défense, et M. Jean était innocent.
La Toinon mena bien sa barque ; elle la mena si bien qu’un matin le père Dubarle s’en vint chez le vieux M. de Mauroy et lui dit :
– Votre fils a compromis ma fille. Faudrait voir à réparer tout cela.
M. de Mauroy demanda quarante-huit heures pour réfléchir, et il se renseigna. Ce n’était pas difficile.
Quand le meunier revint, M. de Mauroy lui donna six mille francs, et le bonhomme se tint pour satisfait.
La Toinon quitta le pays et s’en alla à Paris, les uns dirent pour cacher sa faute, les autres pour se mettre en service.
– Et elle n’est plus revenue ?
– Non, mais elle reviendra.
Ici le Héron cligna de l’œil.
– Elle a un enfant, dit-on, et M. de Mauroy pourrait bien en être innocent. C’est une gaillarde qui n’a pas froid aux yeux, allez ! et qui fera ce que nous voudrons.
– Comment cela ?
– Le père Dubarle est mort, mais le moulin est toujours à la Toinon ; elle l’avait loué. Le bail est à terme, la Toinon va revenir pour chercher un locataire, et alors, pour peu qu’on lui monte la tête, et je m’en charge, elle ira promener son enfant sous les fenêtres de Mlle Josèphe et faire des scènes à M. Jean.
Tandis que le Héron parlait, le visage de M. Anatole s’était éclairé d’un rayon de froide méchanceté :
– Hé ! dit-il, tu as pourtant l’air d’un imbécile, quand on ne te connaît pas, mais tu es un fier homme tout de même !
– Quand je veux une chose, faut que j’y arrive ! répondit le Héron. Voyez-vous, monsieur Anatole, je n’ai pas grande instruction, mais j’ai de l’entendement tout de même, et j’ai mon idée.
– Tu veux que j’épouse ma cousine !
– Pardine ! ce n’est pas plus pour vous que pour elle, c’est pour moi ; car, voyez-vous, le bien doit servir le bien, et tout paysan que je suis, j’ai des idées d’aristocrate.
– En vérité ! dit M. Anatole en riant.
– J’ai été élevé par le vieux marquis, votre grand-père ; car on ne m’ôtera pas de l’idée, quoi qu’en dise le commandant, que vous êtes, non pas son neveu, mais son fils.
– Parbleu ! personne n’en doute.
– Alors, ça m’est bien égal que vous soyez légitime ou non. Vous aurez la Bertaudière, pas vrai ?
– Dame ! et le reste avec.
– Eh bien, les idées de feu M. le marquis votre grand-père étaient que ni la Bertaudière ni Pré-Gilbert ne fussent jamais séparés, et les idées de M. le marquis, c’est les miennes.
Le commandant et M. le baron sont brouillés ; mais quand Mlle Josèphe sera votre femme, ils feront la paix. Voilà !
Et le Héron, en parlant ainsi, sauta en bas du tilbury.
– Tu me quittes ? fit M. Anatole.
– Oui... mais nous nous verrons demain.
Le tilbury était arrivé au pont de Cravant.
– À demain donc, répondit le jeune homme.
Et il s’engagea sur le pont, tandis que le Héron sautait dans les champs et prenait ses longues jambes à son cou pour regagner les bois au milieu desquels il vivait.
VII
Nous l’avons dit, le château de la Bertaudière est situé entre Vermenton et Cravant ; mais, de l’autre côté de la Cure, une jolie rivière un peu tapageuse qui vient se jeter dans l’Yonne.
M. Anatole passa donc sous les murs de Cravant, suivit la grande route jusqu’au pont d’Accolay, sur lequel il passa la Cure, et s’engagea dans un joli chemin, bordé de haies vives, qui conduisait à la grille du château. La lune brillait toujours au ciel et faisait resplendir les girouettes de fer-blanc et les tourelles d’ardoise de la Bertaudière.
Cependant M. Anatole vit une lumière à une des croisées du premier étage.
– Bon ! se dit-il, le vieux n’est pas couché... Peut-être bien qu’il a sa goutte ; ou bien il m’attend pour me faire quelque semonce... Mais je m’en moque !...
Arrivé à la grille du parc, M. Anatole mit pied à terre, passa son bras sous la porte et retira une clef qu’il mit dans la serrure.
La jument, habituée sans doute à ce manège, ne bougea pas, attendant patiemment que la grille fût ouverte.
Puis elle entra et fit quelques pas en avant.
M. Anatole referma les deux battants de la grille et, remontant en voiture, il suivit la grande allée d’arbres qui menait au perron.
Cette allée était sablée et le tilbury roulait dessus sans faire le moindre bruit.
Parvenu devant le château, le jeune homme appela à mi-voix un domestique qui l’attendait toujours et sommeillait sur une botte de paille, à l’entrée de l’écurie.
Cet homme se leva aussitôt et vint prendre le cheval par la bride.
– Blaise, dit M. Anatole, est-ce que mon oncle est malade ?