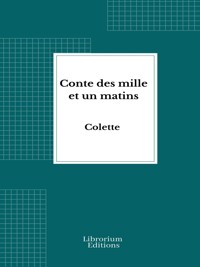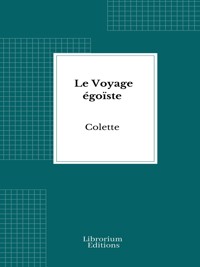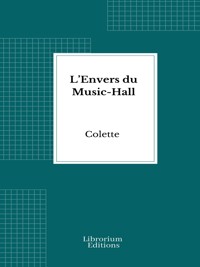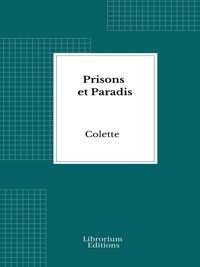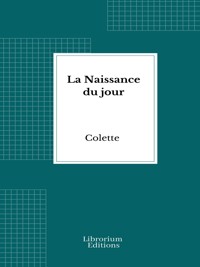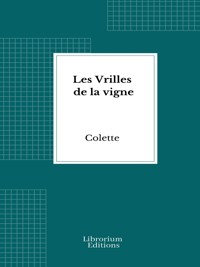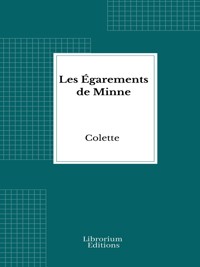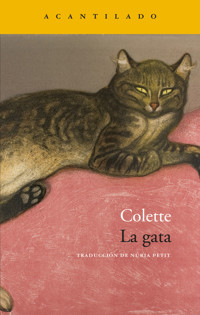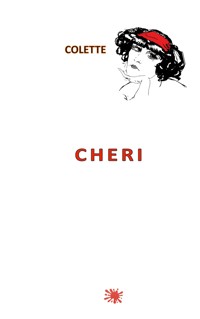Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: A verba futuroruM
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Recueil de textes variés écrits pour la plupart dans les années 1917-1918, "La Chambre éclairée" offre un échantillon des multiples talents de
Colette. Des scènes de mœurs traitées avec humour voisinent avec des textes intimistes, des chroniques d'une ironie vengeresse avec des témoignages sur la vie quotidienne pendant la Grande Guerre, des parodies avec des poèmes en prose.
À PROPOS DE L'AUTRICE
Sidonie Gabrielle Colette, née en 1873 en France, fut une icône littéraire intemporelle. Connue sous le nom de
Colette, elle brilla par sa plume unique et sa rébellion subtile. Ses œuvres emblématiques, dont "Claudine à l'école" et "Gigi", captivèrent le public du début du 20e siècle.
Colette n'était pas seulement une auteure, mais une femme audacieuse qui bouscula les conventions sociales. Son art saisissant et son regard perspicace sur la condition féminine lui ont valu une place permanente dans le cœur des lecteurs du monde entier.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 65
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Colette
La chambre éclairée
contes et récits
(1920)
La chambre éclairée
Pas de pétrole, Pas de l’essence, Pas de la bougie, Quel-le malheu-re !
En sautant d’un pied sur l’autre, en chantant à pleine voix, ainsi Bel-Gazou va, propageant l’expression de la triste vérité. C’est un fait : le pétrole manque à Brive et à Varetz, l’essence a vécu, la bougie coûte quatre francs vingt-cinq la livre, et devient rare...
Pas de pétrole, Pas de l’essence...
Bel-Gazou, baignée de soleil, clame ironiquement le deuil des lumières artificielles. Juin finit, et la voici cuite comme un pêcheur breton. Mon nez, surpris par l’insolation, pèle ; le sien, bien raccordé aux plans des joues par des couleurs empruntées aux bronzes, aux céramiques, aux fruits vernissés, me fait envie. Ses pieds de romanichelle, nus, sonnent sur la dalle et sur les vieux parquets. Un chapeau de toile blanche voltige au bout de ses bras, coiffe le chien, ou se perche dans un arbre ; Bel-Gazou se contente de son calot de cheveux châtains, coupés droit au-dessus du sourcil et sur la nuque
Quel-le malheur-re ! Quel-le malheur-re !
Elle bondit, rayée de rouge et de blanc dans son maillot marin, et s’enfonce, bue soudain par l’ombre de la maison. Midi. Un milieu de journée sans nuage, sans brise, un midi qui dilate les boiseries vermoulues, fane la rose enlacée aux balustres de la fenêtre, assagit les oiseaux. Le soleil perce de part en part la bibliothèque et cloue sur un panneau l’ombre cornue de l’araucaria. Les abeilles qui logent dans le mur travaillent avec une frénésie innocente, tissent un filet d’or volant dans la pièce, heurtent unevitre, butinent la digitale rose debout dans un long vase, cinglent ma joue, la joue de Bel-Gazou, et ne piquent point. Jusqu’à sept heures, le jour d’été va triompher de l’épaisseur des murs, de la profondeur des embrasures obliques. En déclinant, le soleil fera, des plats pendus aux murs, autant de miroirs pour sa gloire. Mais, après sept heures, il quittera ce large pan de ciel libre tendu devant nous, et tombera derrière les peupliers d’abord, puis derrière une tour... Nous tirerons sur le balcon la table à lire, et le fauteuil, et aussi le pliant de Bel-Gazou, et je pourrai compter encore sur une grande heure de jour. Lorsqu’une fraîcheur à peine sensible, perçue seulement par les narines et les lèvres, ignorée des surfaces grossières de la peau, montera de la vallée, je lèverai la tête, étonnée que la page du livre, rose tout à l’heure à cause du couchant, bleuisse à présent comme une pervenche... Ce ne sera pas encore la nuit, non, non, pas encore ! En approchant de la porte-fenêtre le guéridon nappé, nous dînerons, Bel-Gazou et moi, – « Bel-Gazou, on ne dessine pas des allées dans les épinards avec sa fourchette ! Bel-Gazou, je t’ai vue mettre la cuiller à sel dans ta poche ! » – nous dînerons sans lampe ni bougie. Mais quand Bel-Gazou sautera à bas de sa chaise et me souhaitera son « bonsoir » qui commence si cérémonieux et finit si tendre, il faudra bien que je me rende à l’évidence : noire est la porte ouverte sur le salon, noir le vestibule ; et seule Bel-Gazou court partout comme un petit lynx, saisit les loquets, évite les angles sculptés, trouve la boîte d’allumettes dans sa chambre. J’entends sa voix appeler : – Nursie-Dear ! Et le claquement de sa porte me séquestre dans les ténèbres. Oh ! je sais bien que, si je voulais, je me donnerais le luxe d’allumer les deux flambeaux à deux lumières, ou même cette mirifique lampe où l’on me verse, goutte à goutte, le peu de pétrole disponible... Les quatre bougies vont haleter contre l’ombre captive sous les poutrelles peintes, et ne seront pas les plus fortes. La flamme de la lampe basse et son halo rosé ne forcent pas jusqu’aux murs un tel cube de nuit. Ce ne sont pas les fantômes que craignent mes yeux faibles, mais justement la certitude que personne n’erre ici, la certitude que le pas du maître de cette demeure ne fera plier, ni cette nuit ni la nuit de demain, les lames amincies des parquets anciens et sonores. Il n’y a pas de nuits courtes à qui attend. Mais, avant d’accepter la nuit, je sais encore une chambre... Une chambre à la porte de laquelle je vais m’asseoir, la tête appuyée contre le bois. Derrière la porte, Bel-Gazou est déjà couchée. Nursie-Dear a emporté l’unique bougie, et vaque à des soins quotidiens, avant de revenir. Pendant une demi-heure, Bel-Gazou a le droit de ne pas s’endormir. Et seule, dans sa chambre noire, sans veilleuse, elle jette son chant impérieux de rossignol d’ombre. Bavardages anglais, apostrophes en patois limousin, refrains interrompus, improvisations sur un thème qu’elle chérit : « Viens, Noël, viens ! » variantes brodées sur des fables, et « Madelon, Madelon ! » et « Where are you going, oh ! my pretty maid ? »... La voix est éclatante, l’accent se fait caressant ou despotique ; entre les mots, entre les chansons, il y a les rires... Ô cascades d’argent sur des graviers blancs, ô fusées ascendantes que l’instant de retomber allume, gammes dont la note la plus aiguë est comme un brandon, paillettes, bluettes d’un cristal à mille feux, il y a là, derrière la porte, dans cette chambre noire, mon dernier trésor de lumière : la voix, les rires de Bel-Gazou.
Fantômes
De la porte-fenêtre du salon, je vois tout ce que fait Bel-Gazou sur la terrasse. Elle est en pleine possession de ce monde invisible que nous avons tous, jadis, mérité, créé, puis perdu. Enfant solitaire, elle marche partout accompagnée, comme je fus autrefois, de favoris, de serviteurs et d’adversaires qui sortent quand elle le veut de l’inconnaissable et qu’elle bannit, d’un signe, à la desséchante approche des grandes personnes. Pour l’instant, elle m’a oubliée. Elle joue avec feu. Sûrement j’assiste à une heure de brillante inspiration, à une débauche imaginative. Elle occupe toute la longue terrasse chaude où ce n’est presque jamais l’hiver. Pas d’autres accessoires qu’une pelle, un râteau, deux fauteuils de rotin, deux tas de sable. Mais le plus beau du décor m’échappe, car Bel-Gazou va, vient, porte dans ses bras, en geignant sous leur poids, des fardeaux qui n’existent pas, ouvre avec peine une porte d’air dont la serrure dit « cric, crac », gravit un escalier que je ne discerne point, se penche vers des espaces vertigineux et crie des avertissements trilingues, où le français et l’anglais s’agrémentent de patois limousin... Elle redescend, rouvre la porte d’air (cric, crac), passe devant quelqu’un d’impondérable à qui elle adresse en même temps un raide salut militaire et un « oh ! pardon » très mondain. Puis elle se laisse tomber dans un des fauteuils de rotin, soupire « ouf ! » et s’essuie le front... Goûtera-t-elle un repos bien gagné ? Non, car un souci urgent la remet debout ; elle ouvre un intangible bureau dont le couvercle dit : « Couin ! » comme celui qui est dans la bibliothèque, et elle écrit. Elle écrit, sans papier, sans encre ni plume ; elle écrit, la bouche pincée, avec des pauses, des mordillements hésitants du petit doigt, des ratures, une mimique parfaite d’écrivain, elle qui ne sait pas, ou si peu, écrire... Ah ! qu’écrit-elle ? Et à qui ? Je n’y peux tenir. Je tombe lourdement au milieu de son jeu raffiné : – À qui écris-tu, Bel-Gazou ? Par chance, le charme résiste à ma voix. Bel-Gazou ne s’éveille pas à la réalité et répond du fond de son rêve : – J’écris à mon frère. – À ton frère ! Tu as un frère ? Petit sourire dédaigneux. Petit haussement d’épaules. D’où est-ce que je sors, pour ignorer qu’elle a un frère ? – Comment s’appelle-t-il ?