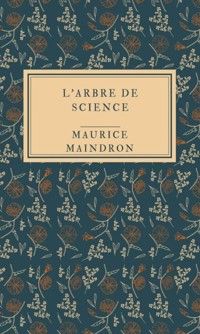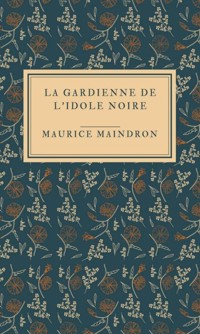
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Französisch
Je suis arrivé à l'extrême vieillesse, et, dans ce couvent, tous me croient sourd. A parler franc, je les entends très bien, ces moines, se répéter à l'envi que je ferai une bonne fin. Je le veux croire. Bientôt, sans doute, ma triste dépouille, sous un drap noir croisé de blanc, semé d'ossements en sautoir et de têtes de mort, s'en ira rejoindre au cimetière ceux qui l'y ont précédée. Porté par des pénitents en cagoule, j'atteindrai ma demeure dernière. Puis il ne sera plus question de moi sur la terre. Aussi bien mourrai-je tranquille, sans ce souci dernier de savoir à qui laisser mes biens. Je ne possède rien ici-bas que la jambe de bois que je gagnai, en combattant dans le tercio napolitain, au service du défunt empereur.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 247
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
MAURICE MAINDRON
La Gardienne de l’Idole noire
La Gardienne de l’Idole noire
A Henri Lavedan.
I
Je suis arrivé à l’extrême vieillesse, et, dans ce couvent, tous me croient sourd. A parler franc, je les entends très bien, ces moines, se répéter à l’envi que je ferai une bonne fin. Je le veux croire. Bientôt, sans doute, ma triste dépouille, sous un drap noir croisé de blanc, semé d’ossements en sautoir et de têtes de mort, s’en ira rejoindre au cimetière ceux qui l’y ont précédée. Porté par des pénitents en cagoule, j’atteindrai ma demeure dernière. Puis il ne sera plus question de moi sur la terre.
Aussi bien mourrai-je tranquille, sans ce souci dernier de savoir à qui laisser mes biens. Je ne possède rien ici-bas que la jambe de bois que je gagnai, en combattant dans le tercio napolitain, au service du défunt empereur.
Deux vices principaux m’ont condamné à ne réussir en rien dans cette vie : un penchant immodéré pour l’amour et une cupidité que rien ne put satisfaire. Des plaisirs de l’amour et des richesses il ne m’est resté que le souvenir, tant il est vrai que tout cela compte au rang des choses essentiellement périssables. De même que les femmes reprennent toujours leur personne après nous l’avoir donnée, — mieux vaudrait dire prêtée, — la fortune sait se dégager à miracle quand elle croit s’être confiée à un homme indigne. Tenir et retenir sont deux. J’ai souvent tenu, mais je suis toujours demeuré les mains vides. Seul le souvenir ne m’a pas fui.
Ainsi mon existence a passé, jusqu’au jour où, privé d’une jambe par les hasards de la guerre, — qui sont non moins considérables que ceux de l’amour, — j’ai dû à la charité d’un vénérable prieur d’entrer dans cette abbaye qui m’abrite. Mon sort n’est point malheureux. Une arquebuse légère sous le bras, je parcours, à certaine heure de la nuit, le jardin potager dont je partage la garde avec deux autres estropiés comme moi. Pour le reste, on me nourrit bien. J’ai mon escabelle, aux offices, non loin du chœur. Chaque année, je reçois un habit complet de serge et de drap.
A la vérité, nul regret ne me travaille quand je fais un retour sur moi-même. L’âge a glacé mes sens, et je ne suis plus bon à rien. Mais mon esprit est toujours lucide et ma mémoire fidèle. C’est pourquoi le père confesseur me laisse entendre que je porte l’enfer en moi, tant je semble trouver de satisfaction à descendre au plus profond de ma mauvaise nature.
Peu m’en chaut. L’amour et la cupidité ne cessèrent point de lutter en moi jusqu’au jour où, faute d’objet, ils renoncèrent à la lutte. Je meurs pauvre et délaissé, et c’est bien ma faute. Audacieux et habile pour gagner, j’ai été incapable de garder — je me répète, c’est de mon âge — tous les trésors d’amour et d’argent que me valurent mon activité et mon courage.
A l’exemple de mes bénéfices, mes amours furent éminemment transitoires. Ils ne sont plus représentés que par des souvenirs aussi inconsistants que ces cendres légères que le vent disperse après que le feu s’est éteint.
Et pourtant à quelqu’un de ces souvenirs je crois sentir une ardeur singulière s’allumer en moi et une apparence de désir me fournir l’illusion d’une cruelle morsure aux entrailles. Vieillard impotent et qui n’est plus qu’un objet de pitié, je revis par la pensée ces heures d’ivresse qu’est toujours venu troubler le souffle empoisonné de la cupidité. Tels ces ombrages de l’Inde qui rendent mortelles les rives des plus claires rivières.
En plein amour, je songeais trop souvent à l’or ; toujours de l’or, j’étais distrait par la vision de l’amour. Je ne parle que de l’amour profane, — vous m’entendez, — car, au vrai, il n’en est point d’autre qui vaille.
Sans me sentir piqué par cette mouche poétique qui étourdit tant de mes contemporains et les oblige à coucher par écrit des incidents choisis de leur vie qu’ils entremêlent de maximes morales, je ne veux pas devenir muet à jamais avant d’avoir raconté l’aventure la plus singulière d’une vie où l’extraordinaire fut cependant la chose la plus commune. Quand j’aurai écrit cette histoire, je cacherai mon manuscrit avec tant de soin que personne ne le saura jamais dénicher avant qu’on n’ait détruit l’église de l’abbaye où j’aurai passé mes derniers jours. Moi, Gianbattista Capoferro, ancien alfier dans les armées de l’Empereur, qui suis allé aux Indes avec les Portugais et en Afrique avec les Espagnols, je raconte ces choses pour me divertir une fois encore avant que de m’endormir de l’éternel sommeil. Et j’ai dûment paraphé cette page de ma signature — marque d’ailleurs sans valeur, ce 31e d’octobre 1583.
En cette année 1529, qui était la vingt-huitième de mon âge, je me trouvais errant dans les Indes orientales et en proie à une si dure misère qu’à l’exception de mes armes je ne possédais rien ; car, de mes dettes, au contraire de bien des gens, je n’ai jamais tiré sujet d’orgueil. Logé, la plupart du temps, à la belle étoile, nourri de vent, j’allais, plus maigre que les corneilles qui abondent en ces contrées, et je les valais en noirceur. Les proies étaient rares. La fortune, qui, ainsi que je l’ai déjà dit, ne se lassa jamais de m’humilier de ses bienfaits, pour, sans doute, se donner ce plaisir de me les reprocher quand je les avais perdus, la fortune, donc, mit sur mon chemin un tyranneau de Golconde ou de quelque autre pays voisin. Ce musulman désirait vivement s’emparer de la capitale d’un rajah — un chef, dans le langage des païens — de Vijianagar.
De ces villes ou de ces régions ne m’obligez pas à vous tracer un fidèle tableau. Il y a si longtemps de tout cela que je crois, en vérité, qu’il n’en subsiste plus même la place. Quoi qu’il en soit, ce Maure m’engagea à son service et me confia le commandement d’une centaine de cavaliers. La solde m’était payée exactement. J’avais des chevaux, des domestiques sans nombre. Quant aux femmes, je n’en manquais certes pas. En prenait qui voulait, et dans les temples des faux Dieux et ailleurs. Notre conduite était la même chez les amis ou les ennemis.
Lorsque nous investîmes la ville du païen adorateur des idoles, nous en trouvâmes les défenses extérieures à ce point fortes que nous fûmes d’avis de tourner le dos sans tarder. Me souciant moins de la gloire que du bel argent, j’avais pu déjà réaliser des économies considérables. Et je songeais, avant tout, — qui ne m’approuvera ? — à les mettre en sûreté derrière des murs aussi solides que ceux dont nous étions les peu déterminés assiégeants.
Cependant, appelé au conseil de guerre, — tant ces Maures et autres indigènes nourrissent de confiance en nous autres, hommes de l’Occident, — j’opinai dans ce sens qu’on pouvait tenter toujours un assaut. Le prince mahométan adopta mon idée sans deviner mes raisons. Mon intérêt était de faire durer la guerre pour être payé plus longtemps. Sachant combien sont longs à se décider ces Orientaux indécis, je me réjouissais à l’avance des délais qu’ils apporteraient à aborder une pareille entreprise. D’ailleurs pouvais-je croire que nous emporterions de haute lutte une enceinte défendue par plus de cinquante tours, sans compter les courtines crénelées, les ravelins et autres ouvrages, sans compter surtout les fossés larges et profonds, où des crocodiles gigantesques nageaient à l’instar des grenouilles qui s’ébattent dans les bassins de notre potager ?
Tout arrive, pourtant, ainsi que dit l’auteur dont j’ai oublié le nom. Un certain soir, l’assaut fut donné par nous, et j’emportai, à moi seul, les avancées de la porte principale. J’avais charge de garder l’avenue de cette porte et de passer au fil de l’épée les fuyards qui tenteraient de sortir par cette voie. Mais, quand je crus comprendre que les nôtres avaient escaladé les remparts du quartier opposé, — supposition d’ailleurs entachée d’erreur, — je me sentis étrangement désespéré à l’idée de tout ce butin qui allait m’échapper.
— « Garder une porte est bien, me dis-je ; l’enfoncer est mieux ! Et, après, chacun pour soi ! La ville gagnée est au premier occupant. »
Mes soldats n’eurent pas besoin d’être prêchés longtemps pour entendre. Pleins de confiance dans ce blanc sage et audacieux qui les avait toujours commandés sans qu’ils eussent beaucoup à obéir, ils mirent pied à terre et jurèrent de périr à mes côtés. Je me fis déchausser les éperons, et, la bourguignote en tête, la rondache au bras, l’épée à la main, je montai à l’assaut de cette porte que nos esclaves eurent tôt jetée à bas à coups de hache, les défenseurs s’étant enfuis dès que mon visage leur apparut.
Taillant du cimeterre dans cette foule éperdue, mes Maures se dispersèrent par la ville, et je demeurai presque seul. Je retrouvai bientôt une partie de mon monde occupée à maltraiter un malheureux, fou de terreur, qui se débattait en invoquant Isaac et Jacob. Ce juif infortuné ne m’eut pas sitôt aperçu que, échappant à ses persécuteurs, il roula comme une boule jusqu’à mes pieds. Les serrant au point que je sentais l’étreinte de ses doigts noueux à travers le cuir de mes bottes, il criait, avec des sanglots capables d’attendrir les rocs mêmes de l’Inde :
— Salam ! Salam ! Seigneur Gianbattista, protecteur du pauvre, sauvez-moi de la mort ! Sauvez ma famille et ma maison ! Seigneur Gianbattista, vous êtes mon père, vous êtes ma mère !
Puis, se redressant sur les genoux, il chuchota rapidement :
— Sauvez-moi, et je vous ferai gagner, foi d’Azer, une somme d’argent vraiment extraordinaire.
Depuis longtemps, je connaissais cet usurier nomade qui trafiquait de toutes choses. Il m’avait rendu plusieurs fois service, remettant « au jour où je serais riche » le terme pour m’acquitter envers lui. Le tenant pour un homme subtil et qui ne parlait pas en vain, je donnai des ordres sévères à mes cavaliers. Sans murmurer pour ce que je les privais du plaisir de tuer un juif, ils s’éloignèrent pour butiner ailleurs.
Rajustant tant bien que mal ses pagnes et son caftan, déchirés en mille pièces, mon ami Azer me poussa dans sa maison puis fixa la barre et cadenassa la porte. Ensuite, il m’obligea à me rafraîchir avec un vin dont je n’ai, si ma mémoire est fidèle, jamais retrouvé le pareil. Et quand j’eus bu à ma soif, qui était grande, je sommai mon juif de s’expliquer et de me permettre de sortir pour que je pusse continuer de me distinguer.
Mais, en vérité, c’était un autre Azer qui se dressait devant moi. Frais, souriant, avec des habits d’une blancheur immaculée, tuyautés, plissés, c’en était un rêve. Des floches de soie verte retombaient du bec crochu de ses babouches rouges. Et les petites tresses contournées en cornes s’avançaient de chaque côté, sous son bonnet pointu, comme pour défendre ses tempes. Cela donnait à l’usurier illustre du Deccan une ressemblance assez grande avec le diable, auquel il est licite de ne pas croire mais qu’il convient toujours de redouter, en toute sagesse.
Avant que de répondre, Azer se prosterna quatre et cinq fois, baisa la terre entre mes pieds, me supplia de m’asseoir sur un coffre que recouvrait un tapis, me fatigua de ses bénédictions, des souhaits de sa famille, « dont vous êtes le père, la mère ! » puis il commença de parler sérieusement :
— J’ignore, seigneur Gianbattista, si vous savez ce qu’il en est de la ville. Moi, je le sais. Vous avez été trahi par le prince Mohammed Ali Khan. Il est parti cette nuit même en vous laissant prendre Krichnaveram avec vos cent chevaux. A cette heure, vos Maures sont ou massacrés ou enrôlés dans les troupes de notre rajah. Telle est la vérité. Écoutez !… Est-ce là le silence, ou ne l’est-ce pas ? Les bruits d’une ville à sac parviennent-ils à vos oreilles ?… Regardez par cette fenêtre. Une partie de la cité est sous vos pieds. Voyez-vous monter la lueur des incendies ?… Maintenant, reculez-vous et laissez-moi tirer ce volet. Il n’y a aucune utilité que l’on vous voie dans ma maison… Mais, rassurez-vous ! Étant mon hôte, vous ne courez nul danger.
Me voyant froncer le sourcil, le prudent Azer crut que Je l’accusais de douter de mon courage. Il se pelotonna donc à mes pieds : « Protecteur du pauvre ! Seigneur Gianbattista !… Vous êtes mon père, vous êtes ma mère ! Avec vous, la prospérité rentre sous mon toit ! »
Il reprit enfin son discours. Je le résume ainsi :
— « Pour un homme de votre mérite et de votre courage, il n’est rien d’impossible. Une entreprise se présente. Si vous l’exécutez, on vous payera un lak de roupies, en espèces, — somme énorme ! Et l’on vous donnera tant de pierreries que vous pourrez jouer avec, aux ricochets, sur la Cavery. L’entreprise est telle : dès la cinquième heure de la nuit, et elle est proche, vous enlèverez, du temple où je vous mènerai, une jeune princesse et la mettrez en sûreté. Les instructions, on vous les donnera. Vous aurez pour guide la grande gardienne de l’idole… Une femme très belle ! »
Ici le juif salua, les mains croisées sur sa poitrine, avec une mine où il n’était pas difficile de lire qu’il se moquait et du sort et de la vertu de toutes les Indiennes, idolâtres, étrangères et à son épouse à lui, Azer, et à ses filles.
Je n’étais pas assez ignorant des choses de l’Inde pour rejeter parmi les fables grossières les propos mystérieux de cet hôte de hasard. Mais il me fallait quelque apparence de garanties. Azer m’en fournit. Et la meilleure de ces garanties, comme il me l’expliqua, était que lui, homme de confiance du prince qui attendait tout de mon audace, allait me mener auprès de son maître.
— Et puis, dit-il pour conclure, n’oubliez pas que vous êtes mon débiteur, seigneur Gianbattista. Je vous rappellerai même que quatre mille cent quarante roupies que je vous prêtai, il y aura tantôt deux ans, en font bien six mille, et… Ne vous fâchez pas, protecteur du pauvre, J’embrasse vos genoux !… Vous êtes mon père !…
II
Le juif m’enveloppa d’une pièce de toile qui me recouvrit de la crête de ma bourguignote jusqu’aux talons. De ma personne on ne distinguait plus que les yeux. Je tenais mon bouclier serré sous le bras gauche, mon épée ramenée sur le sein. Ainsi ressemblais-je à un Hindou courant vers un temple avec un plateau dissimulé sous ses pagnes.
Nous sortîmes comme la lune se couchait à l’abri d’un gros nuage noir. Personne ne s’occupa de nous, car les rues étaient désertes. Les curieux de la ville, en quête de nouvelles, avaient reflué vers le centre. Par des chemins à lui familiers, Azer, tel un rat vêtu de blanc, rasait les murailles et me guidait par le dédale des bazars. Des chiens errants venaient flairer nos jambes, et le juif lapidait cette vermine nocturne avec des fragments de briques. A travers les treillis de pierre, les verres de couleur laissaient filtrer une lumière irisée qui se jouait sur les façades sombres. Nous entendions des caquetages de femmes. Parfois une face encadrée de bijoux, casquée d’or, apparaissait entre les volets. Des voix douces nous appelaient. Des bras chargés d’anneaux luisants et sonores semblaient sortir des maisons et des rires frais voltiger sur nos pas.
Je me serais bien arrêté dans ce quartier solitaire dont un canal délimitait les confins. La vie est si courte que tout ce qui peut l’adoucir ne devrait jamais être négligé. Mais, pareils à ces officiers auditeurs qui ont pour mission de pourchasser les traînards, Azer m’emmenait tout en s’excusant sur la nécessité et l’heure. Et je le suivais sans m’associer aux malédictions qu’il proférait, sourdement, contre les prêtresses du plaisir.
Bientôt nous atteignîmes une maison dont les lumières palpitaient sous les manguiers, les tamarins et les figuiers, sous d’autres arbres aussi que chargeaient des fleurs jaunes, rouges et violettes, plus larges que des assiettes. On nous introduisit dans une sorte de jardin entouré d’arcades. A notre approche, une nuée de femmes fondit, se dispersa dans la vibration de joyaux et d’écharpes de soie qui bruissaient encore dans l’ombre après qu’elles étaient parties. Des jeunes hommes, vêtus de tuniques roses et de caleçons incarnadins, s’inclinaient sur notre passage. L’un d’eux reçut la pièce de toile dont on me débarrassa fort civilement à l’entrée d’un second jardin. Là, des jets d’eau bondissaient pour retomber en pluie dans leurs vasques de marbre. Une fraîcheur délicieuse régnait. Des rosiers grimpants tapissaient les murs. Et plus de dix lampes nous éclairaient sans que leur flamme vacillât, abritée qu’elle était dans une capsule de verre.
Sur un tapis, que je pris d’abord pour un parterre tant les fleurs et les feuillages qui l’ornaient de broderies étaient d’un parfait travail, un petit personnage se tenait assis à la façon d’un tailleur. Son teint était bronzé, son habit de mousseline plus blanc que le crépit des cloîtres qui s’étageaient autour de nous. Son turban, plus vaste qu’une citrouille, se sommait, au droit du front, d’une topaze plus grosse qu’un œuf — il m’en souvient parfaitement — et d’une aigrette très haute. En travers, sur ses cuisses, un cimeterre reposait, garni d’or, de rubis et d’escarboucles qui étincelaient sous les rayons des lampes, mieux qu’en plein midi.
A ce grand de la terre indienne on ne parlait qu’à genoux. Mais, en mon honneur, apparut une manière de trône que portaient quatre serviteurs semblables à des rois, tant on avait peu ménagé le velours noir, le drap d’or et les orfrois pour les vêtir. L’un tint mon bouclier ainsi que l’officiant fait du Corpus Domini ; l’autre se chargea de mon casque ; un troisième serra mon épée engainée entre ses bras ; un quatrième époussetait avec une queue de cheval la poudre qui souillait mes pieds, cependant que deux encore, me soutenant respectueusement les coudes, m’invitaient ainsi à m’asseoir. Entouré de chasse-mouches, sans cesse en mouvement pour nous faire goûter un air plus vif, j’écoutais le prince parler.
Gravement, comptant ses paroles, il m’apprit ce qu’il attendait de moi :
— Étranger de mérite, en tout différent de ces vautours audacieux et rapaces que l’Occident lâche sur nous, sans doute pour la punition de nos péchés, je vous salue. Que tout succède à vos vœux, que vos parents soient grandement vénérés sur cette terre, ô vous, dont les armes frappent dans le combat pareilles à celles du victorieux Rama, et dont le regard est plus redoutable que Yama qui préside à la mort ! Salut à vous, guerrier d’au delà des mers, qui passez en ce moment pour mort dans la ville que vous auriez prise si, au lieu d’un traître maure, vous eussiez trouvé un noble Tchatria pour associé ! Ah ! valeureux étranger, si vous consentiez à servir, ou, pour mieux dire, à commander avec nous !
Je n’en finirais pas s’il me fallait répéter toutes les politesses inutiles dont ce prince m’accabla. Et les serviteurs ne cessaient de m’éventer et d’apporter des sorbets et du vin rafraîchi, par des moyens certainement diaboliques, dans des coupes d’or. On me passait au cou des guirlandes de jasmin dont le parfum m’entêtait. Pour aller au fait, le rajah me régala de toute la tirade de mon juif. Celui-ci se tenait à genoux, dans un coin, avec un air d’humilité qui conviendrait bien à certains mauvais chrétiens de ma connaissance. Mais je ne nommerai personne, pas même Paolo di Monte.
A ce discours le prince ajouta quelques confidences, sans d’ailleurs écarter les serviteurs. Azer m’apprit plus tard qu’ils étaient recrutés parmi des sourds-muets, de père en fils, et qu’on ne communiquait avec eux que par signes.
— Étranger, illustre entre tous, conclut le prince, le bien de l’État oblige à taire les motifs qui font agir les rois. Brahma les conseille. Croyez que rien dans nos affaires n’est contraire à l’honneur. C’est, nous le savons, votre Dieu principal. Que vous couriez risque de la vie, vous le cacher serait indigne de nous. On vous a énuméré les biens dont nous vous comblerons à votre retour. Puissé-je vous revoir prochainement et glorifier nos grands Dieux par le sacrifice du cheval où l’on fêtera le succès de votre entreprise !
Quand je me retrouvai dans les ruelles désertes où me guidait le juif qui tressaillait au moindre bruit, je crus sortir d’un rêve. L’aventure, au vrai, était de celles qui tentent. La vie des chevaliers errants, dont nous parlent les vieux livres, devait abonder en circonstances gracieuses. Je me promis d’en créer au besoin. Et je serrais entre mes doigts la moitié d’une pièce d’or mince qu’un fil suspendait à mon hausse-col. De cette monnaie profondément gaufrée les bords se relevaient en une série de globules. Le rajah m’avait remis de sa main cette pièce mutilée. C’était là le talisman qui, montré à la gardienne du temple, m’en ouvrirait l’accès. Alors, Dieu aidant, je délivrerais la princesse, dussé-je lutter corps à corps contre mille Diables et peut-être autant de dragons. Puis je la rendrais à son père, sauverais l’État et toucherais une somme aussi grosse que la rançon payée par le roy François de France à mon Empereur, après cette bataille de Pavie d’où je rapportai, pour ma part, une oreille à moitié fendue, le bras gauche percé d’un coup de pique et beaucoup de gloire.
Trottinant par ces voies étroites et sombres, le juif Azer m’entraînait sur ses pas. Tout autour de nous des murs se dressaient nus, sans une fenêtre, et, par endroits, nous tombions au milieu de buffles qui dormaient, vautrés dans un cloaque, ou nous nous heurtions contre le timon d’une charrette. Nous franchissions les seuils des porches, des grands bœufs gris se relevaient en beuglant, et j’entrevoyais leurs cornes peintes, leurs frontaux de perles, la bosse de leur dos et leurs fanons festonnés. Un éléphant, qui secouait ses entraves de fer, nous effleura de sa trompe. Des portes s’ouvraient et se refermaient sur nous. Comment nous sortîmes de ce labyrinthe de venelles, de cours, de passages voûtés, d’escaliers que l’on montait et descendait, c’est là ce que je ne saurais expliquer. Azer s’y dirigeait aussi aisément qu’un chat sur le faîte des maisons. Ses yeux distinguaient tout dans cette nuit obscure. Il m’empêcha de me rompre le cou au milieu d’animaux gigantesques que je ne voyais pas, et je me cognai contre un paon de terre cuite plus haut que moi et qui se brisa en mille pièces.
Mais Azer s’était arrêté brusquement. Il m’imposa silence d’une voix tremblante, hésita, revint sur ses pas. Une lueur dorée filtrant au ras du sol nous servit de guide. Alors, me montrant une porte de bois rouge chargée de ferrures dorées, le juif murmura :
— C’est là !
La porte basse, étroite, dressait ses pieds-droits moulurés entre deux massifs de maçonnerie pleine, dans un cul-de-sac qui paraissait sans issue. Par une fente de cette porte passait un rayon de lumière qui se dessinait, ainsi qu’une flèche d’or, sur le sol poudreux. Et une vague odeur d’encens, âcre et fine, arrivait jusqu’à nous.
— Frappez deux, puis deux, puis trois coups, seigneur Gianbattista ! Puis, en réponse à la question qui vous sera adressée, répondez : « L’arc est tendu, que Draupadi se rassure. » — On vous ouvrira. Montrez votre pièce d’or, on vous présentera l’autre moitié. Et, pour le reste, je vous souhaite heureux succès. N’oubliez pas alors, Seigneur, notre petit compte de sept mille… Allons, adieu, protecteur du pauvre !… Au revoir, seigneur Gianbattista, vous êtes mon père, vous êtes ma mère…
Sa voix se perdait dans la nuit comme je franchissais le seuil de la porte rouge. Une femme drapée dans des pagnes violets et jaunes, qui la cachaient de la tête aux pieds et ne laissaient voir que ses yeux, m’emmenait en me tenant par la main, pendant que le battant claquait derrière moi et rentrait dans son cadre.
III
… Cette femme tenait une lampe, et nos ombres dansaient sur les dalles du couloir où nous courions muets et rapides. Le contact de sa main communiquait à la mienne une délicieuse sensation de fraîcheur. Je m’enivrais du parfum violent qu’elle exhalait au mouvement de ses voiles, et, quoiqu’elle se tînt un peu en avant de moi, je croyais voir briller ses yeux. Mais l’ardeur amoureuse qu’ils allumaient dans mon cœur s’éteignit à ce moment même où l’Indienne disparut. Elle le fit d’une façon si furtive et si douce que je m’aperçus de son absence lorsque je me trouvai seul dans une salle où je continuais machinalement d’avancer. Posée dans une niche où grimaçait un faux dieu à tête d’éléphant, la lampe éclairait mal ce lieu obscur, et le plafond était si bas que je craignais de le voir descendre pour m’écraser sous son poids. De cette lampe en cuivre, abandonnée par l’Indienne, l’huile dégageait les effluves sensuels dont j’avais cru que la porteuse était la dispensatrice. Et j’en conclus que cette fille de pagode appartenait à la plus basse condition.
C’était une salle très vaste, carrée et dont les parois et les mille piliers sculptés ne mesuraient point huit pieds en hauteur. Autour de moi, au halètement de la lampe, les monstres de pierre semblaient danser le long des murs, descendre des fûts et se ruer vers l’obscurité du fond, dans un brouillard bleuâtre qui sentait le sandal, l’aloès et la myrrhe. Un autel se dressait là, avec une idole, et à ses pieds luisait, ainsi qu’un charbon ardent dans les ténèbres, une autre lampe dont j’entrevoyais le cuivre incrusté d’argent.
Debout, près de l’autel, une femme veillait, et ses bras, qu’armaient des épaulières et des spirales d’or, étaient tendus dans un mouvement d’adorante. Elle jeta des aromates sur des braises, et un nuage embaumé s’éleva qui la cacha à mes yeux. Mais avant qu’elle ne s’évanouît, pareille à un fantôme de cauchemar, j’avais aperçu sa tête coiffée d’ornements dorés et couronnée de jasmin, les gemmes étincelant sur sa face, sa taille souple et fière que dégageait la courte brassière de brocart, et ses pagnes plissés qui empruntaient à la lumière rougeâtre leurs reflets couleur de sang. Puis la lampe de l’autel avait cessé de palpiter dans la nuit.
Je la sentis, la magicienne, s’avancer vers moi, sans la voir et sans l’entendre : ses pieds glissaient sans bruit sur le pavé. Je sentis, à travers mon collet de buffle, sa main aux doigts chargés de bagues se poser sur ma poitrine à la place où battait mon cœur, alors que les anneaux d’argent fin de ses chevilles n’avaient pas même sonné. Sûre d’elle-même, elle saisit la monnaie qui pendait au bout de son fil. La lampe se raviva subitement. Une flamme haute de deux pieds peut-être vint lécher les genoux de l’idole, se refléta sur le basalte poli de son corps, illumina d’un coup les joyaux qui de son ventre à la pointe de sa tiare lui formaient un vêtement continu. Et cette image de femme sembla vivre. Je crus voir sa gorge s’enfler plus fière, ses paupières battre, ses narines se gonfler. On eût dit que la Déesse voulait aspirer le parfum des fleurs pâles qui retombaient en guirlandes des deux côtés de son cou.
Et, tandis que la princesse, — car son port me l’avait dénoncée, — attentive à confronter ma moitié de pièce d’or avec celle qui s’attachait à son collier par une courte chaîne, se penchait sans défiance, je l’emprisonnai dans mes bras. Son cri d’angoisse ne monta pas plus haut dans le temple désert que la flamme de la lampe sacrée qui s’en allait mourant. Je pus croire que l’idole se taisait, complice de mon désir amoureux.
Qui ne m’excuserait ! Cette femme de l’Inde était si belle qu’après plus d’un demi-siècle je me trouverais capable d’en retracer le portrait. Mais qu’importe !
Ainsi donc je soumis à ma loi cette créature du Diable, sans songer au calice d’amertume que je me condamnais à épuiser. Mais, si la sagesse intervenait toujours à point pour endiguer nos folies, aucune joie ne serait goûtée en ce monde et mieux vaudrait ne pas naître. Il n’en est pas moins vrai que, lorsque je dus quitter ma victime, — un Français dirait « ma conquête », mais, grâce à Dieu, je suis né à Viterbe et n’ai jamais servi que l’Empereur, — une tristesse immense dissipa toutes les fumées de mon amour. Je ne parle pas naturellement de cette tristesse inhérente à l’homme et qui l’accable sous le remords et le dégoût de sa faute sitôt après qu’il l’a consommée. Cela s’était passé si rapidement que je n’avais pas même pesé les conséquences de ma téméraire et trop heureuse entreprise.
Qu’allais-je devenir ? En ce temple, qui, fatalement, serait mon tombeau, j’avais, avec une douce violence, abusé d’une femme de haute caste, et cela sous les yeux de rubis de son idole ! Ridicule en tout autres temps, le simulacre enguirlandé m’inquiétait à cette heure au delà du possible. Le rire de sa mine impassible avait je ne savais quoi de formidable et de tragiquement mystérieux. M’enfuir ? Il n’y fallait pas songer. Et, de toutes manières, ma mission de sauveur prenait sa fin. Adieu les trésors promis par le rajah ! Hélas ! une fois de plus, mon ardeur amoureuse avait traversé ma cupidité dans ses voies. En cette ville inconnue, loin de tout secours, j’étais condamné à périr obscurément, après avoir senti la fortune perfide me caresser de son aile.