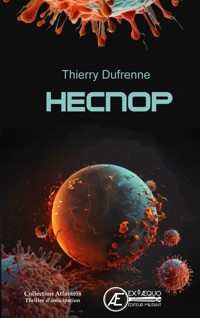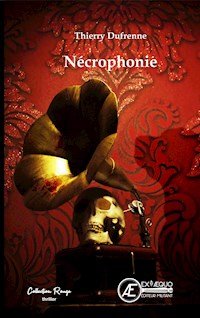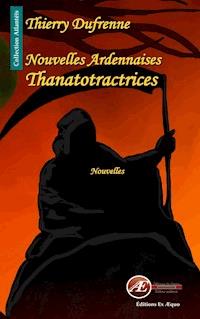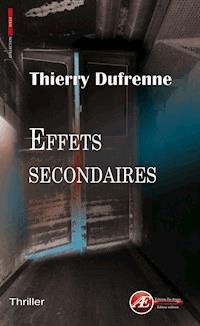Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editions Ex Aequo
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Atlantéïs
- Sprache: Französisch
Le cadavre d'une femme est retrouvée, tuée d'une morsure dans le cou.
« …Lorsque le médecin légiste réussit à désolidariser le corps de la fillette de celui de sa grand-mère, tout un monde grouillant et rampant — avec ou sans pattes —, fut surpris par la soudaine clarté. Sous les expressions de dégoût des policiers, l’écosystème se tortilla un peu plus ou s’enfuit, leur prouvant qu’il existait bien une vie après la vie mais pas celle qu'ils imaginaient. »
Août 2013 - Des pentagrammes et d'étranges graffitis, tracés à la craie, recouvrent les fondations de l'hôpital de Semier. Juste au-dessous : le cadavre d'une femme tuée d'une morsure au cou. Quels liens avec la série de meurtres et de disparitions qui terrorisent la ville ? En déchiffrant les inscriptions, le lieutenant Cathy Thomassin va remonter la piste du tueur et le temps, jusqu'à son propre passé.
Suivez pas à pas les investigations du lieutenant Cathy Thomassin, confrontée à son passé dans sa recherche du tueur qui terrorise la ville.
EXTRAIT
Il bat.
Une artériole gonflait au rythme de son cœur sur sa tempe droite.
Il bat.
— Je suis en vie !
Pourquoi cette évidence lui semblait-elle brusquement si importante ?
L’univers entier disparaissait derrière ces pulsations primitives qu’elle ne pouvait compter.
Elle frissonna, lutta contre un abîme ouvert sur des ténèbres épaisses, sirupeuses, qui l’aspiraient au ralenti.
En vain.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Thierry Dufrenne est né dans les Ardennes, il vit à Reims et travaille dans la santé. Pour cet auteur, le monde médical est une source inépuisable d'inspiration. Ce quatrième thriller fantastique donne une suite au Labyrinthe de Darwin. Il replonge le lecteur dans le décor du C.H.U de Semier pour y retrouver Cathy Thomassin, l'enquêtrice d'Effets secondaires.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 241
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Table des matières
Résumé
La Némésis de Darwin
Résumé
« …Lorsque le médecin légiste réussit à désolidariser le corps de la fillette de celui de sa grand-mère, tout un monde grouillant et rampant — avec ou sans pattes —, fut surpris par la soudaine clarté. Sous les expressions de dégoût des policiers, l?écosystème se tortilla un peu plus ou snfuit, leur prouvant qul existait bien une vie aprluès la vie mais pas celle qu'ils imaginaient. »
Août 2013
Des pentagrammes et d'étranges graffitis, tracés à la craie, recouvrent les fondations de l'hôpital de Semier. Juste au-dessous : le cadavre d'une femme tuée d'une morsure au cou.
Quels liens avec la série de meurtres et de disparitions qui terrorisent la ville ?
En déchiffrant les inscriptions, le lieutenant Cathy Thomassin va remonter la piste du tueur et le temps, jusqu'à son propre passé.
Thierry Dufrenne est né dans les Ardennes, il vit à Reims et travaille dans la santé. Pour cet auteur, le monde médical est une source inépuisable d'inspiration. Ce quatrième thriller fantastique donne une suite au Labyrinthe de Darwin. Il replonge le lecteur dans le décor du C.H.U de Semier pour y retrouver Cathy Thomassin, l'enquêtrice d'Effets secondaires.
Thierry Dufrenne
La Némésis de Darwin
thriller
ISBN : 978-2-35962-639-1
Collection Atlantéïs
ISSN : 2265-2728
Dépôt légal septembre 2014
©couverture Ex Aequo
©2014 Tous droits de reproduction, d’adaptation et de traduction intégrale ou partielle, réservés pour tous pays.
Toute modification interdite.
Suite du Labyrinthe de Darwin, ce livre peut cependant être lu indépendamment. Certains paragraphes vous permettront de faire le lien avec ce précédent roman.
De même, la Némésis de Darwin n’est pas sans rapport avec Effets secondaires et 7 morts sans ordonnance
Remerciements :
Par ordre alphabétique :
Alain, Florence, Inès, Laurence, Lucille, Lydie, Marie-José, Marie-Pierre, Maryse, Mélanie, mes lecteurs qui depuis le début me font l’honneur de perdre leur temps à lire mes délires, Muriel, Pascal.
Ce n’est pas le plus fort de l’espèce qui survit, ni le plus intelligent. C’est celui qui sait le mieux s’adapter au changement.
Charles Darwin
Un philosophe m’a dit un jour : la reproduction est ce que la Nature a inventé de mieux pour préserver la Vie et vaincre la Mort.
Toutefois, sans la mort, il n’y aurait pas de sélection naturelle, donc pas d’évolution possible.
3 mars 1992
7h13
Il bat.
Une artériole gonflait au rythme de son cœur sur sa tempe droite.
Il bat.
— Je suis en vie !
Pourquoi cette évidence lui semblait-elle brusquement si importante ?
L’univers entier disparaissait derrière ces pulsations primitives qu’elle ne pouvait compter.
Elle frissonna, lutta contre un abîme ouvert sur des ténèbres épaisses, sirupeuses, qui l’aspiraient au ralenti.
En vain.
Quelques bribes de conscience jaillirent comme des étincelles à travers un engourdissement poisseux : le froid ambiant, la rudesse du sol dans son dos, une migraine sourde, l’articulation endolorie de son coude droit. Elle ne sentait plus sa main gauche, écrasée sous une fesse. Ses paupières lourdes barricadaient la sortie de l’abysse, comme un couvercle fermé à la lumière, la réalité, le présent... Elle tira sur son bras gauche, dégagea des doigts paralysés, insensibles, qu’elle palpa de sa main droite comme s’ils ne lui appartenaient plus. Une substance visqueuse en humidifiait la peau. La circulation sanguine reprit avec un fourmillement douloureux qui éloigna un peu plus sa torpeur.
Son passé lui revint comme une certitude, un appel à l’éveil, à la lucidité. Elle s’appelait Cathy Thomassin, récemment promue lieutenant de police judiciaire à Semier. Elle enquêtait sur la mort d’une élève infirmière retrouvée noyée, elle avait assisté à l’autopsie. Borlin, son collègue n’avait pas voulu l’accompagner. Il ne supportait pas les hôpitaux.
Elle se raidit, soudain tétanisée par une bouffée d’angoisse. Les souvenirs revenaient, effroyables : le regard lubrique de Vuillaume, l’assistant du légiste, les couloirs du C.H.U. de Semier, l’école d’infirmière... Elle avait interrogé un étudiant ; il lui avait parlé d’un fantôme qui terrorisait les élèves. Puis il y avait eu ce médecin avec qui elle avait discuté, un dernier appel téléphonique dans lequel Vuillaume lui révélait que la future infirmière avait été droguée. Droguée puis violée... Oui, c’était cela !
Et après ? Après plus rien ! Comme si parvenue au bord de l’infini, plus aucune étoile ne brillait dans le cosmos. Que s’était-il passé juste avant ? Cathy fouilla sa mémoire. Elle mélangeait sa propre vie avec l’histoire de cette pauvre fille tranchée et étudiée sur la table en inox de la morgue, l’étudiante était enceinte. Comment s’appelait-elle ? Impossible de retrouver son nom !
Une piqure dans la cuisse, le décor qui tournoie, les bras du médecin qui la retiennent, empêchent la chute, son souffle chaud sur sa nuque. Ce n’était pas le passé de cette fille qui revenait, c’était... le sien !
La terreur l’envahit. Ses yeux s’ouvrirent avec difficulté sur la pâleur bleutée du plafond au-dessus d’elle, puis se refermèrent.
— L’aube ! pensa-t-elle, j’ai passé la nuit ici. Qu’est-ce qu’il m’a fait subir ?
Cathy tenta de s’asseoir, se hissa sur un bras. Sa main dérapa sur un liquide gluant, elle retomba à plat ventre, le menton amorti par une matière flasque et froide.
Elle renouvela son effort, ses gémissements rompirent un silence oublié. Peu à peu, elle retrouvait tous ses sens, l’ouïe, l’odorat... Cathy connaissait cette odeur métallique, fade, synonyme de violence et de mort.
Ses paupières se firent moins pesantes. La vue revint... Un œil grand ouvert, flétri et sans vie quelques centimètres à côté du sien. Elle sursauta, recula et découvrit le corps ensanglanté du docteur Vuillaume. Cathy pataugeait dans une flaque rouge et coagulée.
Elle finit par se mettre debout, chancelante, découvrit un second cadavre éventré, égorgé, émasculé.
Blottie dans leurs sangs, bercée par leurs chaleurs évanescentes, elle avait passé la nuit dans ce panorama résolument pourpre, leur dernier coucher de soleil.
Elle aperçut l’empreinte rouge de son pied nu sur le carrelage gris.
Alors elle cria toute son horreur.
Son hurlement ricocha sur le mur, lui revint comme une assonance.
Elle ne s’aperçut même pas qu’elle était à moitié nue.
Dix-neuf ans plus tard...
Jeudi 29 septembre 2011
07h01
Journal de frère Emmanuel
J’ai vu un démon. Je le croyais mort depuis longtemps.
Je pressens un grand danger pour Tes enfants Seigneur.
Ma foi est immense, mais je suis Ton dernier soldat !
J’aurai la force de le vaincre si Tu guides mon bras.
Car ainsi parle le Seigneur Dieu : j’exercerai contre eux de terribles vengeances, des châtiments furieux et ils sauront que je suis Dieu lorsque je leur imposerai ma vengeance.
Combien de fois ai-je voulu frapper les démons par manque de foi en Toi ? Rien ne sert de tuer Lilith et Abrahel alors qu’elles me mèneront à Satan.
Jeudi 29 septembre 2011
23h22
Le feu tricolore passa au vert, mais elle ne démarra pas. Un sentiment de culpabilité l’empêchait de relâcher la pédale d’embrayage, de l’éloigner du C.H.U. de Semier où Augustine allait encore passer la nuit, hospitalisée pour ces maudites fièvres dont elle souffrait occasionnellement depuis quelque temps.
Deux boules de lumière grossirent dans ses rétroviseurs avant de glisser vers la gauche. Le conducteur avait déboîté juste à temps. L’automobile frôla la sienne qui oscilla sous le déplacement d’air. Le coup de klaxon retentit comme un hurlement de rage.
Jeannette Berthus réprima la tentation de faire demi-tour. C’était plus un besoin qu’une envie, mais cinq kilomètres plus loin Marie-Jeanne attendait son retour. Rien n’atténuerait son tiraillement, mais elle devait se raisonner et rentrer chez elle.
Veuve ? Célibataire ? Parent isolé ? Comment les autres gens la qualifiaient-ils ? Les trois à la fois ? Les termes étaient-ils assez explicites pour affirmer les difficultés d’élever seule ses jumelles ?
Un rond orange surplomba la lumière verte. Jeannette trouva le point mort, relâcha l’embrayage.
Feu rouge. Juste au-dessus du spot pourpre, effleurant un nuage, apparut la lune mince comme une griffe dans le ciel noir. Elle eut envie de pleurer. Sa solitude lui éclata au visage comme les phares du véhicule démarrant en sens inverse. Seule sur sa route, elle ne faisait que croiser d’autres humains sans que jamais l’un d’eux ne l’accompagne un bout de chemin.
Vert. L’avenue était déserte. Elle se demanda si le feu n’était repassé au vert qu’une seule fois depuis qu’elle se morfondait à ce carrefour.
Jeannette Berthus réussit un peu à dominer son angoisse, elle travaillait en radiologie dans ce même hôpital. Elle connaissait le sérieux des services de pédiatrie du centre hospitalier. Augustine y était en sécurité et elle n’en était pas à son premier séjour.
L’idée d’embrasser les cheveux de Marie-Jeanne qui devait déjà dormir, retrouver la chaleur et l’odeur de son autre fille la motiva suffisamment pour qu’elle redémarre. Ses jumelles étaient toute sa vie, écartelée ce soir-là entre une chambre blafarde de la médecine pédiatrique et son domicile.
Jeannette se permit de parler tout haut pour tenter de se convaincre. Dans l’habitacle, personne ne l’entendait.
— Je ne t’abandonne pas, Gust ! Ils vont te soigner et Marija à besoin de moi, personne ne s’occupe d’elle, je dois rentrer à la maison !
Elle fit le tour d’un rond-point, resta prudente dans la courbe du boulevard suivant et franchit un pont au-dessus d’une voie de chemin de fer. Derrière elle le logo bleu de l’hôpital de Semier s’éteignit d’un coup puis les huit étages du bâtiment principal devinrent une masse sombre, un trou noir dépourvu de la moindre lueur, contrastant avec les lumières du reste de la ville.
23h30
Une partie de l’équipe du service de réanimation prenait une pause lorsque l’incident se produisit.
Sans aucun bruit, tous les locaux, bâtiments, sous-sols, parkings et routes intérieures furent soudain plongés dans le noir. Les ventilations stoppèrent, les ascenseurs bloqués entre deux étages retentirent d’appels de panique. Privés d’énergie, les appareils de radiologie, d’analyse, scialytiques et équipements électriques multiples cessèrent tout à coup leur contribution précieuse et indispensable aux soins.
Dans la seconde qui suivit, toutes les alarmes des appareillages de maintien en vie des patients réanimés retentirent ensemble, couvrant les jurons du personnel incapable d’y faire face simultanément.
Marie, la responsable du secteur réanimation ne perdit pas son calme. Elle demanda immédiatement à chaque infirmière et aide-soignante de regagner le chevet des patients sans affolement. Le groupe électrogène de l’hôpital allait prendre le relais, les batteries des dispositifs de respiration artificielle et de surveillance pallieraient la coupure quelques dizaines de minutes.
Effectivement, venant des sous-sols, le grondement de l’énorme moteur couplé à l’alternateur commença à faire résonner le béton des premiers étages. Chaque fois, il lui semblait que le C.H.U. se transformait en cargo prêt à larguer les amarres et prendre la mer. Marie fut rassurée par les vibrations, le courant électrique allait revenir, cette coupure deviendrait une anecdote et serait oubliée au petit matin.
Mais la lumière ne revint pas avec le va-et-vient des pistons, l’énergie électrique non plus.
Les couloirs n’étaient plus éclairés que par des veilleuses dont les accumulateurs tiendraient quelques heures. Dans les chambres, au-dessus des lits occupés par des vies précaires, des voyants clignotaient comme des guirlandes lumineuses, les courbes de paramètres vitaux de chaque patient défilaient encore sur les écrans. Marie espéra que les batteries tiendraient le coup...
Médecins et infirmières attendaient désormais le retour à la normale avec impatience. Impossible de réaliser le moindre soin dans la pénombre ; purger une seringue, piquer une veine devenait soudain dangereux, une simple toilette compliquée par les drains et sondes qui crevaient la peau sous les bandages.
Marie décrocha le téléphone et s’apprêtait à composer le numéro du service de sécurité quand elle s’aperçut de l’absence de tonalité. Inutile d’escompter un quelconque renseignement sur l’origine et la durée de la panne. Elle se sentit brutalement très isolée dans ces locaux à l’écart des autres services de soins. Elle se dirigea vers la réserve de matériel, y trouva à tâtons ce qu’elle cherchait et revint les bras chargés de grosses lampes de secours : une par chambre et une pour elle pour se déplacer dans le service. Elle bénissait tout ce qui pouvait repousser la pénombre.
Les soins reprirent avec lenteur sous le maigre cône des torches qui découpaient l’obscurité à l’emporte-pièce.
L’angoisse reprit vigueur lorsque tout le personnel coincé dans les ténèbres entendit le groupe électrogène ralentir puis stopper. Marie comprit alors que le problème était plus grave qu’une simple coupure électrique.
Elle s’assura que chaque chambre disposait de l’équipement manuel pour faire respirer les patients et vérifier les pouls et les tensions. Si la panne persistait, il faudrait s’en tenir à l’essentiel : la survie des malades fragiles. Dans ce service, la nuit des patients n’est pas vouée au sommeil et à la récupération. L’activité ralentit, mais les nécessités de maintien en vie se moquent des aiguilles de l’horloge.
Marie ne pouvait qu’imaginer les services de sécurité en pleine action et savait que des petits alternateurs de secours allaient probablement leur parvenir, mais il fallait le temps de tirer les câbles, rebrancher les bonnes prises. Dans le noir, tout devient rapidement long et difficile. Combien de temps pour tout cela ? Une heure ? Et si la panne s’éternisait ? s’effraya-t-elle. Comment allait-elle organiser les bras disponibles pour éviter les catastrophes, ou pire, les décès ? En premier, trouver le médecin réanimateur et ensemble, ils devraient aviser très vite.
Elle éclaira le planning et localisa la chambre où travaillait Alphonse. Marie avait une confiance sans limite dans cet aide-soignant. Son expérience et sa connaissance de l’hôpital, des couloirs, des services, jusqu’aux gens qu’il y croisait, résolvaient souvent bien des problèmes.
— Alphonse ? J’ai besoin de toi pour aller demander de l’aide dans les services qui peuvent nous fournir quelques bras supplémentaires et si tu peux, te renseigner sur le temps que va durer la panne électrique ! Le téléphone est muet, il faut se déplacer ! Je t’envoie seul, j’ai besoin du reste de l’équipe ici !
Elle devina son regard dans le halo lumineux de sa lampe. Il éclairait les chairs blafardes d’un ventre où Vincent, un infirmier, tentait de finir un pansement. Alphonse réfléchit un instant avant d’accepter sans autre explication.
— Tu crains pour les batteries des respirateurs c’est ça ?
Il avait tout compris. Marie hocha la tête.
— C’est la nuit, les services d’hospitalisation sont en personnel réduit ! Une infirmière, deux aides-soignantes tout au plus... Je ne vais pas te ramener un bataillon !
Marie le savait déjà, mais deux mains qui pompent de l’air dans les poumons d’un patient, c’était une vie de sauvée quand les accumulateurs seraient épuisés.
— Tu me remplaces auprès de Vincent ?
Alphonse confia l’éclairage portatif à Marie, lui donna une petite tape sur l’épaule au passage pour lui rendre confiance et se fondit dans la pénombre du couloir. Le dédale de l’hôpital ne lui posait aucun problème même dans l’obscurité totale, mais il espérait que rien n’encombrerait son chemin. Dans l’empressement, il n’avait pris ni son briquet, ni son téléphone portable comme maigre source lumineuse en cas de besoin.
Tourner à droite, marcher quinze mètres, passer la porte automatique bloquée en position ouverte, tourner à gauche… Alphonse jeta un œil vers le sas vitré du bloc opératoire : aucune lueur. Il espéra pour ses collègues de garde et les patients qu’aucune intervention n’était en cours.
Cinquante mètres de couloir avant l’escalier menant aux étages. Il stoppa. Les ténèbres étaient totales. Les ampoules des veilleuses étaient-elles grillées ? Syndrome de la roue de secours dont on oublie souvent de vérifier le bon état ! pensa Alphonse.
Il tendit le bras gauche devant lui en protection, sa main droite palpant le mur. Une porte fermée puis les deux battants d’un portail coupe-feu, vingt pas encore et il arriverait à la cage d’escalier.
Dans la nuit et les ténèbres, des bulles malsaines de peurs ancestrales cherchaient à refaire surface. Il sursauta. Ses craintes étaient-elles vraiment injustifiées ? Il venait d’entendre un bruit sur sa gauche, un froissement de toile, puis un léger souffle lui parvint. Quelque chose se déplaçait et remuait très discrètement. Il balaya l’espace obscur de son bras en gardant le mur comme repère, n’y rencontra que la fluidité de l’air entre ses doigts.
— Il y a quelqu’un ? … avec moi dans le noir ! hasarda-t-il.
Le silence lui répondit. Alphonse était pourtant sûr d’avoir senti une présence.
Il reprit sa marche vers l’escalier, se retint de courir pour ne pas se blesser ni trébucher en percutant un mur ou un objet abandonné. Enfin les premières marches apparurent, faiblement illuminées par un éclairage sur batterie en bonne santé.
L’aide-soignant se retourna, scruta ses arrières sans parvenir à percer l’opacité du corridor aveugle.
De l’autre côté de la paroi, il entendait des cliquetis, les grincements et les voix assourdies des agents de sécurité qui tentaient d’extirper des gens coincés dans les ascenseurs paralysés.
Il repensa à sa mission : trouver des bras pour venir en aide au service de réanimation. Il escalada les marches vers le premier étage, certain d’y trouver des têtes connues et de la vie.
00h22
En réanimation, la moitié des batteries avaient accordé leurs derniers watts. Désormais l’assistance respiratoire, la surveillance des pouls et des tensions se faisait à la main. Revenus à l’époque de Laennec, tous les soignants concentraient leur vigilance sur l’essentiel. Il ne manquait que les bougies et les becs de gaz pour retrouver l’ambiance hospitalière fin dix-neuvième. Marie refoula une bouffée d’angoisse. Elle était confiante dans l’équipe, mais dans quelques minutes, le personnel ne serait plus assez nombreux et les minces lueurs des veilleuses faiblissaient, ce qui la terrorisait.
Devait-elle vraiment se résoudre à laisser mourir des patients faute de quelques mains pour les aider ?
— Alphonse, tu fais quoi ? se surprit-elle à chuchoter. L’aide-soignant était parti depuis plus de trente minutes.
00h31
Le jeune praticien de garde n’aurait jamais cru avoir à faire ce choix si tôt dans sa carrière. Avec l’aide et les conseils de Marie, il avait dû se résoudre à donner des priorités pour la distribution des soins vitaux aux malades sous sa responsabilité. L’anesthésiste et l’infirmière avaient pris du recul, s’étaient détachés des sentiments humains, avaient réduit l’identité des patients à leur numéro de chambre et tranché. Le dix était jeune, le huit plus vieux, la quatre avait trois enfants... il ne fallait pas s’acharner sur le deux... Les choix étaient faits, ce n’était pas un jeu, il y avait des vies à la clé. Les téléphones portables fonctionnaient, il avait appelé les pompiers, la police, pour prévenir de leur désarroi face à la pénurie électrique persistante, mais n’était pas certain que ces appels apporteraient une aide immédiate ; il fallait se rendre sur les lieux et se déplacer dans la pénombre jusqu’au service. Rien n’était gagné !
Marie recommença à distribuer généreusement son aide d’une chambre à une autre, apporta du matériel, conseilla ou rassura les plus pessimistes. Elle était inquiète de l’absence d’Alphonse parti depuis trois quarts d’heure. Pourquoi le service de sécurité n’était-il pas venu s’inquiéter de leurs besoins ?
— Merde ! Plus de jus chez moi non plus ! jura Vincent dans la chambre derrière elle. Elle le vit mettre en œuvre le matériel de secours avec assurance. Il était compétent, la vie resterait scotchée à son patient tant qu’il demeurerait près de lui.
Que faire de plus ? Partir elle-même chercher de l’aide ? Cela faisait encore deux bras en moins. Elle se planta hésitante au milieu du couloir sombre, les mains sur les hanches, le regard perdu vers l’entrée du service, espérant y voir revenir Alphonse. Son sang se glaça. À quinze mètres, au bout du couloir, deux silhouettes campées dans le clair-obscur l’observaient. Un homme assez grand vêtu d’une longue cape et couvert par une capuche se tenait immobile entouré d’un personnage plus petit, une tignasse ébouriffée sur une tête qu’il balançait de droite à gauche comme le font parfois les aliénés et d’un animal sur quatre pattes dont elle vit les oreilles dressées. Elle pensa d’abord à des visiteurs qui se seraient perdus dans le dédale sombre du C.H.U. puis se ravisa. À cette heure avancée de la nuit, il ne restait que le personnel et un chien n’aurait pas été autorisé à dépasser la grille d’entrée.
L’anxiété face au besoin fait germer des idées bizarres : pouvait-elle demander de l’aide à ces gens ou devait-elle les chasser ? Oubliant ses peurs, elle s’élança vers le trio pour leur parler, mais le groupe s’éclipsa avant qu’elle arrive à leur hauteur. Marie déboucha dans le couloir emprunté par Alphonse presque une heure plus tôt et stoppa net quand elle vit les ténèbres engloutir cet étrange groupe. L’infirmière anesthésiste ne pouvait pas s’aventurer dans l’obscurité opaque comme du goudron liquide.
— Après tout, ils se dirigent vers le hall de sortie. Je leur ai fait peur et peut-être retrouveront-ils leur chemin seuls ! se rassura Marie en refoulant la vraie raison.
Elle qui repoussait quotidiennement la mort au-delà des murs du service de réanimation avec une expérience substantielle et des techniques sûres n’avait jamais su dominer sa peur du noir. Les ténèbres la pénétraient des pires superstitions et Marie, enfant comme adulte, y devenait la proie d’une panique viscérale.
Pétrifiée, elle en oublia ses devoirs et pourquoi elle était là. Elle ne quittait plus des yeux le rectangle noir mat et insondable du couloir et s’en éloignait à reculons lorsqu’elle vit s’y mouler de nouvelles silhouettes. L’infirmière reconnut rapidement Alphonse accompagné de quatre autres personnes en blouse blanche. Elle ne cacha pas son agacement :
— C’était long ! lui reprocha-t-elle. Il faut faire vite maintenant !
— Parce que tu crois que nous sommes les seuls à avoir des problèmes ? se défendit-il sans se défaire de son calme. Il y a aussi des patients dans les huit étages au-dessus de ta tête ! Ramener huit bras supplémentaires relève de l’exploit !
Marie le savait et n’allait pas épiloguer. Elle regretta aussitôt d’avoir fait cette critique.
— Tu as croisé deux personnes avec un chien, juste avant de me voir ?
Alphonse écarquilla les yeux pour manifester son incompréhension.
— Non ! Le couloir est vide, on n’a vu personne !
Les quatre infirmières confirmèrent.
— Bon... Ils ont dû sortir ! éluda l’infirmière avant de se figer en levant un index.
— Écoutez ! ordonna-t-elle à voix basse.
Dix oreilles entendirent distinctement une petite mélodie qui semblait venir du hall d’entrée, un thème très simple joué sur un petit instrument à vent, un piccolo ou un ocarina, une dizaine de notes répétées comme en ritournelle.
— Quelqu’un écoute la radio ? hasarda Lucie à la droite d’Alphonse.
— Une radio à piles alors ! ajouta l’aide-soignant.
— Je connais cet air ! assura-t-il.
— C’est du classique, mais je ne sais plus de quel compositeur… ! Ça va me revenir !
Devant la futilité du sujet et les problèmes auxquels ils devaient faire face, Marie changea de sujet.
— Et à part ça, des nouvelles de la panne électrique ? Ça devient vraiment long !
— J’ai croisé un gars de la sécurité dans l’escalier et il m’a expliqué pourquoi c’est aussi laborieux ! Alphonse se lança dans l’explication tout en se dirigeant vers le service de réanimation.
— Le groupe électrogène a été arrêté, car il ne sert à rien ; les transformateurs qui alimentent tout l’hôpital sont hors service, suite à des actes de malveillance. Les câbles ont été coupés, arrachés, à coups de hache et de masse, l’isolant brûlé par endroits... Tout s’est mis en court-circuit quand a eu lieu la première coupure. Même topo pour les armoires du central téléphonique au premier sous-sol, ajouta Alphonse. Les électriciens sont intervenus très vite, mais ils ne peuvent pas réparer ces composants de plusieurs tonnes en quelques minutes : ils y travaillent. Les petits groupes de secours auraient dû être distribués et branchés dans les postes sensibles, comme dans notre service, le bloc opératoire et l’éclairage de secours... Alphonse marqua une pause en repassant devant les blocs opératoires toujours plongés dans le noir... Mais les serrures des locaux où sont stockés ces matériels de secours ont été sabotées aussi ! Il y a eu du fil de fer glissé dans les barillets et cassé à ras ; impossible d’y pousser une clé ! Les agents de sécurité ont enfoncé les portes, mais ça a pris plus de temps, tu penses bien ! Ensuite, ils ont appelé du renfort avec leurs téléphones portables. Dans peu de temps, on devrait les voir débarquer avec les groupes électrogènes et des câbles, mais pour le retour à la normale, il faudra attendre demain !
— Alors, tout est la faute de cinglés qui ont dévasté les transformateurs électriques ! C’est du terrorisme ! s’emporta Marie.
— Ça y ressemble fort ! acquiesça Alphonse.
Ils n’eurent pas le temps d’en discuter plus longtemps, un vent de panique semblait s’être levé en réanimation pendant la brève absence de l’infirmière-anesthésiste. Toutes les batteries étaient désormais hors service, les petits appareils de secours étaient tous à l’œuvre, mais en quantité insuffisante et le personnel devait se relayer au chevet de certains patients pour permettre une respiration artificielle.
Marie calma les esprits et les bras supplémentaires réquisitionnés par Alphonse furent salvateurs, mais la nuit allait être longue.
Dans le renfoncement le plus sombre du grand hall d’entrée du C.H.U. de Semier, un homme vêtu d’une longue cape noire observait les va-et-vient fiévreux du personnel. Devant toute cette agitation pour une simple coupure électrique, il apprenait vite les points faibles de la société occidentale. À côté de lui, une femme ricanait doucement en se tordant les mains, la bouche ankylosée par un méchant sourire. Un curieux petit animal à fourrure montait la garde à leurs pieds.
Des semelles couinèrent sur le revêtement plastique, le bruit de pas lents et maladroits de quelqu’un qui cherchait à les approcher sans parvenir à dissimuler sa présence. Ils échangèrent un regard, reculèrent d’un même mouvement, s’esquivèrent et disparurent en silence dans l’escalier juste derrière eux, comme dissous dans l’ombre.
Vendredi 30 septembre 2011
7h22
Camille regrettait de ne pas avoir été plus capricieuse ou colérique ; elle aurait dû se rouler par terre, s’égosillant en suppliques et en pleurs pour ne pas passer la nuit chez grand-mère. La fillette ne l’aimait pas. Cette longue femme hautaine aux cheveux blonds décolorés avait des genoux qui lui arrivaient aux épaules. Elle la regardait souvent dédaigneusement, aussi snob que son mètre quatre-vingts lui permettait. En dessous, la petite fille devait se tordre le cou pour voir le visage de son austère aïeule. La méprisante silhouette à contre-jour masquait le soleil, écrasait sa gaieté naturelle, obscurcissait un ciel où tout aurait dû inspirer le jeu et l’insouciance. Rien n’éveillait la gentillesse chez cette vieille dame divorcée et aigrie. Lorsque sa mère lui imposait une visite ou pire, une nuit chez sa génitrice, Camille avait envie de se recroqueviller sur elle-même et devenir une boule de tissus repliée au fond d’un tiroir comme on fait avec les chaussettes. L’enfant pensait ne jamais rien subir de pire que dormir chez sa grand-mère. Mais quand l’affreux bonhomme à la cape noire, sa femme qui puait et leur drôle de chien avaient fait irruption dans la triste demeure, la nuit était devenue un cauchemar comme Camille n’en avait encore jamais fait.
Pourquoi ces gens étaient-ils aussi méchants avec eux ? Même Hugo qui frappait ses camarades d’école et la pinçait souvent dans le dos n’était jamais aussi cruel. Camille n’avait pas dormi. La dame aux cheveux ébouriffés et qui sentait mauvais avait appuyé la lame du gros couteau de cuisine sur sa gorge et menacé de lui couper le gosier pour que sa grand-mère exécute leurs ordres. Sa peau tendre d’enfant de cinq ans en était entamée. Camille le sentait bien, ça la piquait sous le menton. Pourtant ils avaient l’air gentil avec leur chien. Au début, elle aurait bien aimé le caresser, mais l’animal restait en retrait, peureux, dans un coin sombre.
Ensuite, ils étaient tous partis dans la voiture de l’aïeule. Ses mains attachées dans le dos lui faisaient mal, encore plus depuis qu’elle était enfermée dans le coffre de l’automobile. Ballottée dans les virages et projetée au fond à chaque coup de frein, Camille commença à pleurer doucement. Elle aurait tant voulu retrouver sa maman ! Où était-elle en ce moment ?
L’homme en noir lui avait fait mal en la bâillonnant de sa large main pour qu’elle ne hurle pas et fasse ce qu’il voulait.
L’automobile cahotait, Camille l’imagina rouler sur un chemin de terre juste avant qu’elle ne stoppe. Elle entendit les portières s’ouvrir, des gens descendre puis sa grand-mère se mit à hurler. Les cris s’éloignèrent, mais devinrent plus aigus avant de finir dans un gargouillis. Elle n’avait jamais entendu Nestorine crier de la sorte.