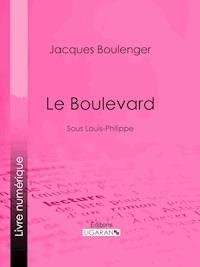
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Extrait : "Le Palais-Royal est bien déchu de sa splendeur passée. A la fin de l'Ancien Régime et jusque sous la Restauration même, le cœur de Paris battait fiévreusement dans ses galeries aujourd'hui désertes et démodées. Les Tuileries et les autres jardins royaux ne furent longtemps ouverts qu'aux gens bien vêtus ; on y empêchait les rassemblements populaires. Au Palais-Royal, au contraire, dans la maison de Philippe-Égalité, le peuple était chez lui."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 291
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
D’APRÈS L’ATLAS PITTORESQUE DE PERROT ET MONIN (PARIS 1836)
Le Palais-Royal est bien déchu de sa splendeur passée. À la fin de l’Ancien Régime et jusque sous la Restauration même, le cœur de Paris battait fiévreusement dans ses galeries aujourd’hui désertes et démodées. Les Tuileries et les autres jardins royaux ne furent longtemps ouverts qu’aux gens bien vêtus ; on y empêchait les rassemblements populaires. Au Palais-Royal, au contraire, dans la maison de Philippe-Égalité, le peuple était chez lui. Ce tranquille jardin vit une foule tumultueuse promener en hurlant les bustes du duc d’Orléans et de Necker ; il entendit Camille Desmoulins pérorer furieusement debout sur une chaise : c’est à l’ombre de ses marronniers que s’exalta la colère révolutionnaire.
Tout alentour, sous les colonnades, s’ouvraient des boutiques, des maisons de jeu, des lupanars. Philippe-Égalité avait jugé profitable de louer en détail son palais et en 1790, sur cent quatre-vingts arcades, il en avait cédé à bail cent soixante-dix, qui lui rapportaient plus de dix millions. Les oisifs et les badauds du monde entier, les provinciaux, les filles publiques, les joueurs, les agioteurs, les aigrefins, les bourgeois musards achalandaient les étalages, se pressaient dans les galeries et les jardins, envahissaient les cafés, les tripots, les mauvais lieux et les boutiques. Vers 1800, on aurait pu parier à coup sûr que chacune des cent quatre-vingts arcades, à la prendre des fondements aux combles, contenait au moins un objet de scandale. On y trouvait la table toujours servie, la banque ouverte et des filles à foison : « Deux marchands qui se séparent dans le port de Canton, à la Chine, se retrouvent au Palais-Royal », disait-on en 1830.
Le soir et sous les galeries de bois, les prostituées se montraient à peu près nues. La foule envahissait les estaminets où l’on fumait et les cafés où quelque fat, accoudé au comptoir, lançait de tendres œillades à la caissière : ainsi le café Corazza, le café de Foix, le café de la Rotonde, le café des Mille Colonnes, de qui la « belle limonadière » attirait les galants ; le café Lemblin où naguère, sous Louis XVIII, les demi-soldes s’entretenaient passionnément du prochain retour de l’Empereur et provoquaient les royalistes triomphants du café de Valois ; le souterrain café des Aveugles, célèbre par son orchestre de Quinze-Vingts et fréquenté par le peuple et les petits-bourgeois.
Nombreux étaient les tailleurs à bon marché et les restaurants à quarante sous. Mais à côté d’eux luisaient les vitrines précieuses des joailliers ; Véry, Véfour, les Frères-Provençaux offraient leur cuisine illustre ; Chevet et Corcellet, aux deux extrémités d’une même galerie, étalaient leurs fruits, leurs primeurs coûteuses, leurs monstrueux poissons et leurs glorieux pâtés.
Où sont-ils aujourd’hui ? Où sont les maisons galantes ? où, les maisons de jeu que nous décrit Balzac dans la Peau de Chagrin ? Le Numéro neuf s’étendait de l’arcade neuvième à la vingt-quatrième ; le Cent vingt-neuf de l’arcade n° 129 à l’arcade n° 137 ; le Cent Treize, du n° 102 au n° 118 ; le Cent cinquante-quatre, du n° 145 au n° 154. C’est au n° 113 que Raphaël de Valentin perdait son dernier louis et que Rastignac gagnait une fortune en quelques minutes, tandis que madame de Nucingen l’attendait à la porte, en voiture.
Sous les galeries de bois, qu’on surnommait le Camp des Tartares et le Four aux gueux, vivait un peuple de prostituées. Philippe-Égalité, afin d’augmenter ses énormes revenus, avait abattu toute une allée de marronniers séculaires, plantés autrefois par Richelieu, pour construire en leur place ces sordides baraquements. « Provisoires », ils durèrent plus de quarante ans. C’était le domaine des modistes, des fripiers, des filles publiques et des libraires. Dentu, le grand-père de l’éditeur, Barba et d’autres y étalaient leurs livres et leurs brochures ; non loin des chapeaux défraîchis et des soieries douteuses, s’élevait, au centre de la boutique de Ladvocat, le buste de lord Byron où le libraire avait glorieusement inscrit les noms des auteurs qu’il éditait.
C’est le futur roi des Français qui en 1829 fit abattre les galeries de bois : à leur place s’éleva la galerie vitrée d’Orléans. Il avait entrepris d’assainir son Palais-Royal : par son ordre, on effaça les inscriptions grossières qui couvraient les colonnes, on construisit des bornes en bois réservées aux affiches à qui les murs furent interdits ; on fit disparaître les lanternes et les enseignes qui menaçaient par trop la tête des passants ; on obligea les marchands à restreindre leurs étalages et à dégager les piliers ; puis, « un beau soir, le gaz s’élançant de ses canaux en langues de feu vint éclairer cette brillante toilette » ; enfin Louis-Philippe, devenu roi, fit expulser les filles qui erraient encore timidement sous les arcades trop claires… Et quand tout cela fut fait, quand les galeries furent devenues définitivement saines, propres et décentes, la foule cessa de s’y rendre ; elle ne reconnaissait plus son Palais-Royal. Seuls, les tripots y maintenaient encore la vie. Un soir, en 1837, on ferma toutes les maisons de jeu. Dès lors c’en fut fait : le Palais-Royal perdit ses derniers flâneurs et Paris émigra sur le Boulevard.
On sait que les boulevards sont un chemin de ronde au sommet d’un terrassement, chemin de plus en plus fréquenté et devenu une promenade. Au XVIIIe siècle un bon nombre d’hôtels, bâtis dans les rues voisines, étendaient leurs jardins jusqu’à ce Grand Cours (comme on l’appelait), sur lequel ils avaient souvent des terrasses. Confisqués à la Révolution, ces jardins furent vendus et des maisons construites, petites, basses et espacées tout d’abord, mais de plus en plus hautes et serrées, à mesure que l’importance de la voie nouvelle augmentait.
Sous l’Empire pourtant, sous Louis XVIII même, le Boulevard restait vraiment un cours, planté de deux rangs de vieux arbres feuillus et hauts, avec ses bas-côtés en terre battue (les futurs trottoirs). Les beaux hôtels, les pavillons que les grands seigneurs du XVIIIe siècle y avaient bâtis subsistaient pour la plupart ; de grands morceaux de leurs jardins se voyaient encore, et aussi les petites constructions à bon marché qui avaient poussé çà et là le long de la promenade fameuse. Mais déjà bien des immeubles à appartements avaient été construits, et peu à peu ils se multiplièrent ; les petites bâtisses basses poussèrent, les jardins rétrécirent et disparurent presque tous ; des cafés, des lieux de plaisir, des boutiques s’établirent de plus en plus nombreux, et à la fin du règne de Charles X l’aspect du Boulevard avait déjà beaucoup changé. La chaussée était faite de gros pavés ; une rangée de bornes la séparait de l’espace ombreux réservé aux piétons : ce trottoir, si l’on peut dire, ne fut dallé que peu avant la révolution de Juillet.
En 1829, la Madeleine était toute tendue d’échafaudages ; avec ses colonnes inachevées et coiffées de chapeaux pointus, elle avait l’air d’un jeu de quilles colossal. Jusqu’aux alentours de la Chaussée d’Antin, le Boulevard traversait un quartier neuf et cossu, mais calme et sans mouvement, et il était bien loin lui-même d’être brillant, avec ses petits marchands, ses maraîchers tranquillement installés au bord de la chaussée sous leurs parapluies rouges. Le premier flot des voitures arrivait par la rue de la Paix (ne pas oublier que la place de l’Opéra n’existait pas) et ce n’est qu’à partir de la pharmacie qui faisait étinceler ses bocaux colorés au coin de la rue du Montblanc (chaussée d’Antin), à l’endroit du Vaudeville et du cinéma qui l’a remplacé, que la grande animation commençait. À l’autre coin de la rue, un café étalait ses tables sous une grande tente rayée ; puis, au-delà de la mince rue du Helder, dont une des maisons d’angle portait encore un cadran solaire du temps de Louis XIV, c’était ce qu’on avait appelé un moment Coblentz, comme on nomma boulevard de Gand le boulevard des Italiens. Là, devant le Café de Paris (ouvert en 1822), devant Tortoni, non loin de la boutique de Schoelcher le porcelainier, les « dandys » causaient et lorgnaient, nonchalamment installés l’été sur des chaises de paille, pendant que leurs grooms grands comme des bottes tenaient par la bride leurs chevaux deux fois plus hauts qu’eux, ou attendaient, les bras croisés et appuyés aux bornes, le bon plaisir de Monsieur ; et parfois un jeune homme mettant pied à terre pour se joindre à un groupe d’amis, attachait tout bonnement sa monture à un acacia. Sur la chaussée, la perruque poudrée des cochers de grandes maisons émergeait de la foule des cabriolets, des coupés, des charrettes. Devant Tortoni, au coin de la rue Taitbout, les laquais ou les chasseurs empanachés sautaient à bas des grandes calèches, des landaus majestueux, et couraient chercher un sorbet pour Madame, qui, étendue dans la haute voiture, minaudait sous le lorgnon des élégants. Un peu plus loin, le café Français et le café Riche, tous deux célèbres, marquaient l’embouchure de la rue d’Artois (Laffitte), la future rue des banquiers. En face, le pavillon de Hanovre et les baroques Bains Chinois étalaient vainement leurs façades disparates : les élégances ne voulaient connaître que le trottoir de Tortoni. Et tel était le « Boulevard » par excellence, car il cessait au coin de la rue Grange-Batelière (aujourd’hui Drouot) ; au-delà ce n’était plus que les boulevards, une large route pavée courant entre ses deux rangs d’arbres épais, fortement escarpée par endroits (car on n’avait pas encore nivelé le boulevard Bonne-Nouvelle et le boulevard Saint-Martin), coupée par la grande fontaine qu’avait bâtie Napoléon et qu’on appelait le Château d’Eau (on l’a transportée à La Villette). Elle se prolongeait par le boulevard du Temple, bordé de ses petits spectacles, pour aboutir enfin à l’Éléphant de la place de la Bastille, la gigantesque maquette de plâtre élevée par l’empereur à l’endroit de la présente gare de Vincennes, qui servit de logis à Gavroche vers 1831-1832, comme on sait, et ne fut démolie que peu après l’achèvement de la colonne de Juillet en 1842.
Beaucoup d’entre eux, mêlés, hélas ! à la sainte canaille, faisaient des barricades, et sur les boulevards les insurgés, en même temps qu’ils arrachaient les gros pavés, abattirent un bon nombre d’arbres antiques, à quoi les boutiquiers aidèrent d’ailleurs vigoureusement en faisant sournoisement tomber ceux qui s’élevaient au bord de leurs boutiques et gênaient leur commerce, à ce qu’ils croyaient (la seconde ligne des arbres se trouvait au pied même des maisons). Cela fit un grand changement. Car on les remplaça, ces arbres abattus, bien sûr ! – mais on n’en replanta qu’un seul rang presque partout, et au bord de la chaussée. En outre ceux qu’on avait coupés dataient pour la plupart de Louis XIV : ils avaient grandi avant les bâtisses, comme de vrais arbres de la campagne, au grand air et au grand soleil, bref, ormes et frênes, acacias et marronniers (car leurs essences étaient variées) étaient des géants antiques et feuillus ; tandis que ceux qu’on mit en leur place durent pousser entre de hautes maisons ; il fallut protéger leur enfance par des barreaux ; ils furent bientôt emprisonnés dans l’asphalte du trottoir et ne reçurent l’eau du ciel qu’à travers une grille, comme à travers un soupirail ; plus tard les émanations des conduites de gaz commencèrent à les empoisonner : il fallut sacrifier toutes les essences, sauf une… Non, ce ne fut plus du tout la même chose.
« L’on se donne à Paris, sans se parler, comme un rendez-vous public, mais fort exact, tous les soirs, au Cours et aux Tuileries, pour se regarder au visage et se désapprouver les uns les autres », a écrit en son temps M. de La Bruyère. Aujourd’hui c’est des rendez-vous qu’il faudrait dire : le Tout-Paris cosmopolite est devenu trop nombreux pour s’assembler en un seul lieu. Mais, durant les premières années du règne de Louis-Philippe, il n’en allait pas de la sorte. Le Paris de 1836 ne comptait encore que neuf cent neuf mille habitants, et le monde des boulevardiers élégants n’était pas plus vaste que celui qui peut s’assembler lors de la « saison » dans l’une de nos grandes « plages » mondaines ; on s’y connaissait de vue pour le moins.
La « bonne société » n’allait plus au Cours-La-Reine, quoique la promenade n’en fût pas si délaissée que de nos jours. En revanche, les Tuileries continuaient d’attirer du beau monde : peut-être les grandes dames ne venaient-elles guère dans ce jardin où leurs équipages ne pouvaient pénétrer, mais les lions, les dandys en fréquentaient volontiers la grande allée du milieu. Il y fallait voir Adolphe, Alfred ou Théodore étendu avec grâce sur deux chaises, son chapeau posé sur une troisième, porter d’une main lasse son lorgnon à son œil gauche, mordre la pomme (précieuse) de sa canne, minauder, sourire quelquefois, très souvent bâiller (car le dégoût et l’ennui sont britanniques, donc à la mode). Bientôt il gagnait son cabriolet ou son cheval de selle qui l’attendait à la porte. Un temps de trot l’amenait aux Champs-Élysées (un « désert » le soir, où l’on détroussait les passants : la future avenue Montaigne n’était qu’un coupe-gorge et l’auteur des Mystères de Paris y plaçait avec vraisemblance l’horrible cabaret souterrain de Bras-Rouge). Il saluait là cinq ou six calèches, causait un moment avec quelques cavaliers, faisait admirer sa légère voiture, son « tigre gros comme le poing » et son cheval anglais ; puis il repartait au grand trot, et le « jockey » minuscule assis les bras croisés à son côté criait Gare ! d’une petite voix perçante pour faire ranger les passants. La voiture traversait la place de la Concorde, irrégulière, au terrain à peine aplani, suivait les nouvelles rues de Rivoli et de la Paix, et, passée la rue du Montblanc, arrivait au Boulevard…
Car le « Boulevard », à proprement parler, ne s’était pas encore beaucoup agrandi : outre le boulevard des Italiens, il comprenait à peine le boulevard Montmartre, jusqu’aux Variétés, et d’autre part les premières maisons du boulevard des Capucines : le grand flot de la circulation y déferlait par la rue de Richelieu et, passé la rue Drouot (alors Grange-Batelière), les dandys ne flânaient guère ; après les Variétés, ils ne s’arrêtaient plus. Beaucoup de voitures s’en allaient de l’autre côté, par la rue de la Paix ; mais au-delà le mouvement se calmait soudain, et alentour du boulevard des Capucines et du très calme boulevard de la Madeleine, se formait un quartier peu passant, de rues neuves, bordées d’hôtels cossus. Le « Boulevard » toutefois tendait à s’étendre de ce côté : « En 1860 le cœur de Paris sera de la Madeleine à la place de la Concorde » prophétise Balzac en 1846.
Cependant, la foule et le commerce de luxe envahissaient de plus en plus, à mesure que le Palais-Royal achevait de se démoder, ce qui avait été sous Louis XVIII le rendez-vous des seuls oisifs et des gens à équipages. La construction de l’Opéra de la rue Le Peletier (ouvert en 1821) avait commencé, en quelque sorte, de faire du Boulevard un centre. L’achèvement en 1836 de Notre-Dame-de-Lorette (commencée en 1823), qu’on apercevait au bout de la rue Laffitte, couronnée par la butte Montmartre agreste, verte et plantée de ses moulins, l’édification progressive de la Madeleine et de tout le quartier qui poussait alentour, la disparition des restes de jardins, la transformation des anciens hôtels en immeubles à appartements, les étages ajoutés aux maisons basses, la construction des immeubles de rapport, la multiplication des boutiques de plus en plus luxueuses, l’aménagement des nouveaux passages (galerie Vivienne et passage de l’Opéra, 1823 ; passage Choiseul, 1825 ; passage Colbert, 1826 ; passage Sainte-Anne, 1829 ; petites galeries du passage des Panoramas, 1843) – et quel succès, ces passages ! leur somptuosité, leurs « marbres », leurs « dorures » enthousiasmèrent littéralement : « On se croit transporté dans le pays des féeries en les traversant le soir, tandis qu’ils sont éclairés par les illuminations répétées par les glaces qui reflètent leurs lumières », s’écrie lyriquement un contemporain – tout cela changea singulièrement l’aspect du Boulevard et du quartier environnant. Sans doute on continua de venir là pour se promener, pour déjeuner, pour se rafraîchir dans les cafés élégants, pour s’asseoir sur les chaises et admirer les jolies femmes et les équipages ; mais aux flâneurs se mêlèrent des passants pressés, des gens qui allaient à leurs affaires, qui n’étaient là que pour vendre, acheter, négocier.
Une ordonnance de 1823 avait prescrit aux propriétaires de construire un trottoir devant les bâtisses nouvelles, mais ce ne fut que peu avant 1830 que le préfet de police Chabrol fit daller ceux du Boulevard de pierre d’Auvergne, son pays (et non de granit, comme l’eût souhaité Balzac) ; plus tard on joignit l’asphalte à la pierre.
À partir du 30 novembre 1831, les propriétaires furent obligés à munir leurs maisons de chéneaux et de gouttières ; jusque-là les piétons n’avaient eu d’autre moyen de se garer du Niagara qui tombait des toits les jours de pluie, que de se réfugier sur la chaussée au risque de se faire écraser.
Puis vint l’éclairage au gaz hydrogène inventé par le Français Philippe Lebon (qui mourut assassiné dans les Champs-Élysées en 1804). Le gaz avait suscité une longue opposition : ce ne fut que le premier janvier 1829 qu’après divers essais çà et là, s’élevèrent quatre appareils à gaz sur la place du Carrousel ; le lendemain douze lanternes du même genre furent installées rue de Rivoli. On choisit alors un modèle de candélabre qui fut essayé en avril dans la rue de la Paix et sur la place Vendôme, en août dans la rue de Castiglione ; le nouvel éclairage illumina en novembre les galeries du Palais-Royal. Mais, sur les boulevards, ce ne fut qu’en août 1837 qu’il remplaça les réverbères à huile perfectionnés, pendus, non plus à des cordes, mais à des chaînes de laiton, avec leurs quatre langues de flamme que multipliaient leurs glaces taillées à facettes (il y en avait alors cinq mille trois cent vingt-deux à Paris et le service était si bien fait qu’il ne fallait que quarante-cinq minutes aux deux cent quarante-neuf allumeurs pour les illuminer ; d’ailleurs, à la fin du règne de Louis-Philippe, on en comptait encore deux mille six cent huit contre huit mille six cents lanternes à gaz).
Cette même année 1837, le pavé de la chaussée fut remplacé par l’asphalte : plus tard, en 1841 ou 1842, on y essaya, sans trop de succès, les pavés de bois : la technique n’en était pas au point, et Nestor Roqueplan déclarait qu’ils avaient « pour objet spécial d’empêcher les piétons d’entendre les voitures et les cochers d’arrêter court leurs chevaux » ; qu’aurait-il dit du pavé de liège dont on parlait dès 1843 ?
C’est en cette même année 1842 que le préfet Rambuteau fit niveler les boulevards Bonne-Nouvelle et Saint-Martin, dont la pente était très raide, et Roqueplan encore, conservateur comme tous les boulevardiers, s’écriait sur ce ton mi-figue mi-raisin qui rend si amusantes ses Nouvelles à la main : « C’est une espèce de quai bordant une rivière de pavés !… Quant aux femmes qui voudraient passer sur ces escarpements nous n’avons pas besoin de leur dire que, du bas de la chaussée, des regards indiscrets contemplent leurs mollets… » Depuis longtemps le Boulevard avait perdu toute ressemblance avec une route faubourienne !
Jusqu’à la fin de la monarchie de Juillet, on continua pourtant d’y voir un bon nombre de cavaliers et d’amazones ; les gravures en font foi. À vrai dire, les voitures n’y étaient plus guère celles que nous a peintes Eugène Lami sous la Restauration : les dormeuses, berlines, diligences, chars-à-bancs et carricks à pompe du faubourg Saint-Germain, avec leurs valets poudrés et galonnés, et les grands landaus de la noblesse impériale munis de leurs cochers obèses et de leurs chasseurs à bicornes emplumés, ne sortaient plus guère. Le style plus bourgeois de la Chaussée d’Antin, quartier de la finance, avait pris le dessus avec ses coupés, ses voitures simples – oh ! relativement, car un coupé élégant était doublé de satin jaune, on y avait sous les pieds un tapis de la Savonnerie et deux laquais en livrée s’y tenaient debout derrière la caisse, prêts à déployer le marchepied. Mais les gens étaient ordinairement en livrée à l’anglaise, coiffés du chapeau haut de forme et guêtrés. Ce n’est qu’aux cérémonies, aux grands mariages par exemple, comme celui de mademoiselle de Talhouët en avril 1836, qu’apparaissaient les chasseurs à plumages, les laquais en perruque et couverts de galons, et les voitures solennelles, conduites par leurs cochers de gala, toujours aussi gros et vermeils. (« C’est un bien bel homme », s’écrie la portière en se bourrant le nez de tabac ; « C’est un fort homme », prononce son époux.) Toutefois, jusqu’à la fin du règne du roi-citoyen des calèches à quatre chevaux, voire à la Daumont, parcourront le Boulevard.
Pour les jeunes gens, la mode a été, durant quelques années après 1830, de conduire soi-même, et des chevaux difficiles. C’est alors que, dans le monde des banquiers, des agents de change, on ne se fait pas faute, du moins au Bois de Boulogne, de monter sur la calèche à la place du cocher, qui n’a plus qu’à crier Gare ! Les dandys paraissent au Boulevard dans des tilburys si hauts sur roues qu’on les appelle des morts subites, fumant un cigare immense à côté du tigre microscopique, qui siège tout raide et les bras croisés, et criant dans un nuage de fumée : « Bonjou, mon cher, comment ça vâ ? » pour s’entendre répliquer dans une gloire de tabac : « Ça vâ pâs mal, et toi ? »… Un tigre, oui, non un groom, comme disent « les gens qui ne savent rien du monde », un enfant de dix ans ou un peu plus, « irlandais, nommé Paddy, Joby, Toby (à volonté), trois pieds de haut, vingt pouces de large, figure de belette, des nerfs d’acier faits au gin, agile comme un écureuil, menant un landau avec une habileté qui ne s’est jamais trouvée en défaut ni à Londres ni à Paris, un œil de lézard, fin comme le mien, montant à cheval comme le vieux Franconi… enfin une vraie fleur de perversité, jouant et jurant, aimant les confitures et le punch, insulteur comme un feuilleton, hardi et chiqueur comme un gamin de Paris… » Voilà ce que c’est qu’un tigre (voyez Balzac).
D’ailleurs cette mode sportive des chevaux chauds n’a pas duré et l’on y a tôt renoncé. Vers 1836 a paru le phaéton, lancé par lord Seymour. L’année suivante on peut voir sur le Boulevard des jaunting cars que madame de Girardin décrit ainsi : « Figurez-vous une immense table longue posée en travers sur quatre roues et traînée par un cheval. À l’un des bouts de cette table est assis le domestique, les pieds suspendus dans l’espace ; à l’autre bout est placé le maître » qui, pour conduire, « se penche gracieusement comme un fleuve sur son urne ou comme un joueur de billard qui a un coup difficile à exécuter », car il est assis de profil ; et elle n’a pas tort de constater que c’est une drôle d’idée que d’exhiber fièrement à Paris une voiture faite pour la campagne.
En 1839, les voitures légères (petites calèches, briskas, cabriolets à quatre, voire à six roues) ont décidément remplacé sur la chaussée les berlines de famille et les massifs landaus, et si l’on n’accorde plus grande importance aux chevaux, la mode veut qu’on en donne extrêmement aux harnais, parés de fleurs aux frontails et couverts de cuivre ciselé.
En 1843, c’est au Boulevard que la marquise d’Aylesbury, une vraie « lionne », celle-là, promène chaque jour son cabriolet à quatre roues, suivie de deux hommes à cheval en livrée marron, et poussant ses deux poneys d’un fouet au milieu duquel elle a fait adapter une ombrelle (elle est si contente de cette invention qu’elle en use même en hiver).
Et c’est au Boulevard encore que, jusqu’à la fin du règne de Louis-Philippe, on viendra faire un tour et arrêter sa voiture à la porte du Café de Paris, de la Maison Dorée, du Jockey Club, en s’en retournant des Champs-Élysées ou d’une expédition lointaine au Bois de Boulogne ; c’est là qu’on arrivera, à cheval et tout couvert de poussière, pour conter le succès d’un pari. Les jours de grand froid, quand s’étend entre la rue Grange-Batelière et la rue de la Paix un tapis de neige qu’on n’a pas encore l’art de transformer en boue, paraissent les traîneaux que l’on conduit à califourchon sur une selle de bois derrière la passagère. Sibériens, « moscovites », « kamtschatdales », en forme de rennes, en forme de cygnes, en forme de dragons, noirs, blancs, dorés, sculptés, dont les chevaux aux harnais décorés de houppes rouges, de clous, de ciselures, de clochettes d’argent, ils volent « avec la rapidité du vent » et narguent au passage le pauvre fiacre versé et la marche pénible des omnibus.
Les premiers omnibus ont passé sur les boulevards en 1828. Quelques années plus tôt, un sieur Godet, ayant demandé d’organiser à Paris un service de voitures publiques, se l’est vu refuser sous prétexte que les arrêts trop nombreux embarrasseraient la circulation ; mais un certain Baudry, revenant à la charge peu après, a fait remarquer qu’il en avait établi qui fonctionnaient bien à Bordeaux depuis 1817, à Nantes depuis 1824, et s’est vu accorder l’autorisation. L’affaire lancée avec l’aide de la duchesse de Berry, qui paria avec le roi qu’elle monterait dans ce qu’elle appelait le « carrosse des malheureux », et le fit, réussit très bien ; malheureusement on contrôlait si mal le prix des places que le pauvre Baudry pensa faire faillite et se suicida en 1830. Son privilège passa à d’autres gens qui installèrent d’autres lignes, et bientôt Paris entier résonna du trot des calmes paires de chevaux qui, comme dira plus tard Gozlan,
Jamais sous leur galop n’ont soulevé l’arène,
et dont on ornait pieusement le collier d’un brin de buis bénit le dimanche des Rameaux.
Les voitures publiques ne différaient guère que par la couleur et l’extérieur de leur carrosserie : toutes, elles étaient munies de deux banquettes placées dans le sens de la longueur, parallèlement à leur axe, et d’un strapontin au fond, ce qui donnait quinze places, et le contrôleur s’y tenait debout sur le marchepied d’entrée. Le 10 août 1832, dans certaines d’entre elles, les places furent séparées par des tringles, afin d’éviter les discussions orageuses entre les maigres et les gras, les jolies femmes et leurs voisins trop entreprenants ; les lampes y éclairèrent aussi bien l’intérieur que l’extérieur, et le plafond y offrit une voûte grâce à laquelle on pouvait se tenir debout sans risquer d’être décoiffé, chose fort à craindre pour les hommes eux-mêmes par ces temps de chapeaux hauts de forme et de toupets. Les voyageurs payaient six sous quelle que fût la longueur du parcours (au moins 1 franc 50 d’à présent) ; mais en 1835 on avait arrangé une « correspondance » et, dûment muni d’un billet spécial, on pouvait passer d’une voiture à l’autre (pourvu qu’elles appartinssent à la même entreprise) sans payer à nouveau. Voici celles qu’on pouvait voir sur les boulevards en 1835 :
Les Omnibus premièrement. C’est la principale compagnie ; elle dessert cinq lignes avec soixante-dix-huit voitures. Saluons Madeleine-Bastille, qui parcourt le premier et le plus ancien itinéraire qu’on ait établi à Paris. La quatrième ligne traverse le Boulevard en quittant la rue Richelieu pour entrer dans la rue Grange-Batelière (présentement Drouot). La cinquième, qui va de l’Odéon à la Barrière Blanche (au-delà de la place Saint-Georges), suit les boulevards Montmartre et des Italiens et file par la rue Laffitte.
Vient ensuite la compagnie des Favorites, peintes en jaune. Leur seconde ligne franchit le boulevard Montmartre en passant de la rue au faubourg du même nom. La troisième, partant de Vaugirard pour gagner Saint-Lazare, descend les boulevards entre la rue des Capucines et la rue Caumartin.
Il y a les Tricycles d’un blanc jaunâtre, jadis à trois roues pour échapper à l’impôt, mais qui ont fini par en prendre quatre comme les autres, et qui mènent de la Madeleine à la Bastille, mais par les rues Saint-Augustin, des Petits-Champs, de la Vrillière, etc.
Il y a les Diligentes qui traversent entre la rue Louis-le-Grand et la Chaussée d’Antin.
Il y a les Écossaises, peintes à la semblance des plaids des montagnards de Walter Scott, lesquels, partant du boulevard Montmartre, s’en vont par la rue du même nom jusqu’à celle des Fossés-Saint-Victor.
Il y a les vertes Joséphines, qui parcourent dans les deux sens les rues du Faubourg-Montmartre, de Provence, de la Chaussée-d’Antin, le boulevard des Capucines et la rue de la Paix.
Il y a les jaunes Hirondelles, ainsi nommées en raison des oiseaux peints sur leurs panneaux, dont une des deux lignes suit le faubourg et le boulevard Montmartre, puis la rue Vivienne et s’en éloigne par la rue des Petits-Champs.
Enfin il y a les Algériennes, où l’on ne peut monter et d’où l’on ne peut descendre qu’aux stations : on paie deux sous pour la distance d’un bureau à l’autre, mais le prix ne peut excéder six sous. Elles se rendent de Bercy à Neuilly, et suivent tous les boulevards depuis celui des Filles-du-Calvaire jusqu’à la Madeleine.
Les omnibus, à peine créés, ont été blagués dans plusieurs revues de fin d’année. Dans celle de Dupeuty, Courcy et Lavergne que le Vaudeville représenta le 23 mai 1828, intitulée les Omnibus ou la Revue en voiture, on a vu trois cochers armés de leurs fouets, et symboliquement nommés Coucou, Pour Boire et La Course, protester avec énergie contre la concurrence que leur font les nouveaux véhicules. Pourtant il ne paraît pas que ceux-ci aient diminué le nombre des fiacres, au contraire.
Sous la Restauration, les fiacres n’étaient que de vieilles voitures de maître réformées, de « véritables tombereaux de sapin » qu’on appelait carrosses, portant un immense numéro de six pouces de haut, tirés par de minables haridelles attelées par paires et garnis de bottes de paille en guise de coussins. Quant aux cochers, Auvergnats ou Savoyards pour la plupart, vêtus d’une houppelande haillonneuse à pèlerine et grand collet, chaussés de gros sabots fourrés de paille, leur pipe passée dans la ficelle qui servait de ruban à leur chapeau, leur mauvaise humeur et leur grossièreté étaient déjà célèbres, et leur plaisanterie traditionnelle, outre les injures qu’ils échangeaient, c’était de demander au client : « Not’maître, faut-il vous conduire à Charenton ? ou à Bicêtre ? » En revanche ils avaient une réputation de probité : c’est pourquoi un bon nombre de marchands de vin s’intitulaient Au cocher fidèle et montraient sur leur enseigne un cocher rapportant une bourse perdue, pleine d’or, qu’il tenait à la main.
La concurrence des omnibus fit améliorer les fiacres. En janvier 1829 parurent les Citadines gris rosé, chocolat ou jaune, les Berlines du Delta grises, les Berlines du Marais vert foncé, les Célestines bleu de ciel, toutes timbrées d’un écusson au nom de leur entreprise sur la portière, et toutes à deux chevaux encore : les mylords à un seul cheval n’étaient pas encore inventés. La course coûtait trente sous dans Paris ; la première heure, deux francs soixante-quinze et les suivantes un franc vingt-cinq seulement ; mais après minuit et jusqu’à six heures du matin on payait deux francs la course et trois francs l’heure ; joignez le pourboire. Certaines voitures avaient adopté un tarif réduit et l’annonçaient par un petit pavillon qui flottait sur leur impériale ; mais comme les cochers ôtaient souvent ce drapeau après avoir « chargé » des clients et exigeaient ensuite le prix ordinaire, ou bien le faisaient disparaître en se rendant à la maison où ils avaient été appelés, ou encore refusaient de marcher au prix réduit quand la course leur semblait trop longue, une ordonnance du préfet de police leur imposa en 1841 de remettre à leurs clients une carte imprimée portant leur numéro et leur tarif (elle ne fut d’ailleurs pas beaucoup mieux respectée que ne le sont les ordonnances de police d’aujourd’hui).
On ne pouvait contraindre les cochers à recevoir plus de quatre personnes et un enfant, ni de paquet plus encombrant qu’un sac de voyage. Les stations proches du Boulevard se trouvaient rue Louis-le-Grand et rue du Faubourg-Montmartre. On y voyait encore quelques sordides fiacres d’autrefois, avec leurs cochers crasseux en houppelandes bleues, chaussés de leurs sabots, fumant leurs pipes, supportant stoïquement les intempéries sur leurs sièges et sans pitié pour leurs pauvres rosses. D’ailleurs on ne connaissait pas encore les bouillottes : l’hiver, dans toutes les voitures de louage, on entassait de la paille sous les pieds des clients, un vrai fumier les jours de boue : « Il n’y a qu’un académicien ou un joueur de whist un peu âgé qui puisse entrer dans un salon en traînant derrière lui quelques brins de paille du fiacre d’où il sort », déclare en riant Nestor Roqueplan.
Outre ces voitures-là, il existait des cabriolets de place à deux roues, munis de capotes et dont le cheval unique portait un grelot à son collier. Le voyageur s’y asseyait à côté du cocher, mais il ne payait qu’un franc vingt-cinq pour la course, et un franc cinquante pour la première heure, un franc vingt-cinq pour les suivantes. Certains cabriolets, même, marchaient à tarif réduit (un franc la course) et l’annonçaient par une inscription sur leur capote. Il y en avait des stations, environ le Boulevard, dans les rues d’Anjou, du Mont-Thabor, Taitbout et Le Peletier.
Le cocher de cabriolet passait pour plus « dégourdi », plus « à la coule » (comme on parle aujourd’hui) que celui de fiacre. Mieux tenu dans sa petite veste bleue, sous sa casquette de cuir ciré, avec sa fausse manche traditionnelle au bras droit, souvent une rose à la bouche ou une fleur à la boutonnière, il passait volontiers sa couverture au client, lui poussait la paille sous les pieds. Fier de ses bonnes fortunes, il lui confiait tout bas : « Demain je vais à Mémorency avec mon illégitime » ; et quand il demandait : « Où allez-vous, notre maître ? » et qu’on lui répondait : « À l’Arsenal » ou « Rue de la Tour-des-Dames », il savait bien s’écrier : « Bon ! chez monsieur Nodier !… chez mademoiselle Mars ! Encore une fameuse… J’ai mené monsieur Talma chez elle… Quel homme que ce Talma !… dans Manlius… hem !… n’est-ce pas ? »
Il était d’autres cabriolets, non numérotés, qui n’avaient pas le droit de stationner sur la chaussée, mais se tenaient sous des portes cochères, sous de « factices remises » ornées de l’inscription « Cabriolet à volonté », la tête du cheval sortant à demi sur le trottoir, le cocher faisant claquer son fouet pour attirer l’attention des « personnes jalouses de faire proclamer qu’elles sont propriétaires des voitures qui les conduisent ». On les payait, ceux-là, cinq sous de plus que les autres.





























