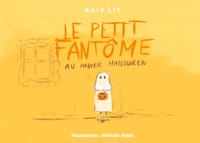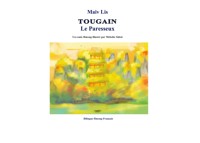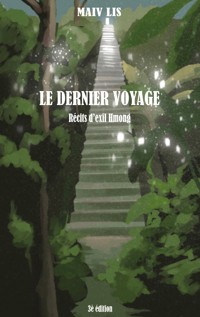
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Französisch
Lorsque nous faisons halte le soir pour dormir, mes rêves me ramènent à notre longue marche, comme un film cauchemardesque que quelqu'un de mal intentionné passe et repasse, sans fin possible. Toujours cette peur qui tenaille... Comment fermer les yeux lorsque l'ennemi peut surgir à tout moment ?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 202
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
De la même auteure :
Tougain, le Paresseux
Le petit fantôme au panier Halloween
À ma mère,
et à toutes les femmes qui font la douceur
de ce monde.
Avant-propos
« Le dernier voyage » relate le périple qui a conduit une famille Hmong de sa province du Laos jusqu'à la Région Parisienne, à la fin de la Guerre du Vietnam (1955-1975).
Il s'agit de deux récits de vie : la première partie est racontée par Mao, ma mère. Elle évoque son enfance, sa vie de femme et de mère, la fuite jusqu'en Thaïlande, puis l'arrivée en France.
Dans la deuxième partie, je reprends la narration de notre fuite jusqu'à l'intégration à la vie occidentale.
Les événements se croisent et l'angle de vue est différent, du ressenti de chacune. Cependant, je voulais montrer que cette histoire pourrait très bien être celle de toute personne déracinée, obligée de fuir la guerre pour survivre.
En outre, ce livre évoque le voyage d'un lieu à un autre et le grand voyage de la vie, qui commence par la naissance et se termine par la mort.
Puisse ce livre vous ramener à la maison, en prenant le temps d'être avec vos proches. Rien n'est plus précieux que d'avoir un « chez-soi », la source de chaque individu.
« En mai 1975 Notre pays entra en guerre Nous fûmes obligés de quitter nos maisons, nos champs et nos animaux
[…]
Nos larmes coulèrent sans fin mais nous ne pouvions nous confier à personne…»
Chanson de l’exil
(extrait de l’interprétation de la chanson par Ci Vaj)
Prologue
Ma mère a enregistré le récit de sa vie sur une cassette audio le 11 juillet 1997. Comment un enregistrement de quarante-cinq minutes a-t-il pu durer soixante-dix-sept ans ?
Elle est décédée en 2012.
Aujourd'hui, quatre ans après, j'ai l'impression que c'était hier. C'est le moment de finir mon deuil, ou de le commencer vraiment. J'ai mis la cassette dans le lecteur : j'ai d'abord tremblé. Je reconnais sa voix que je croyais avoir oubliée.
Mais, c'est bien réel, maintenant elle nous a vraiment quittés. Puis la réalité me plonge dans la tristesse que je ne voulais pas accepter jusqu'à présent. Mon cœur semble vouloir quitter ma poitrine et mes larmes se mettent à couler comme une rivière.
Je l’imagine dans sa chambre, face au petit radiocassette qu’elle a donné à ma sœur et dont je me sers à présent pour l’écouter.
J’entends son aiguille pénétrer le tissu blanc où elle pose ses points de croix pour constituer une broderie.
Comme le fil chante lorsqu’elle le tire jusqu’au-dessus de son épaule !
Quelle est la couleur de ce fil ? Il y a du rouge, du vert et du bleu. Ses couleurs préférées, c’est certain. Des bouts de ces fils en lin parsèment le salon et ressortent quelquefois du canapé où ils s’étaient logés, oubliés pendant plusieurs années.
Une légère déviation de la voix suivie d’un petit claquement me fait comprendre qu’elle mouille un autre fil, le découpe en biais pour filer l’aiguille.
Sur mon petit ordinateur, je tape mes notes, traduites instantanément en français. Je colle et rassemble les morceaux de souvenirs, parfois pleins d'incohérences. Je suis triste de ne pas avoir fait cette traduction de son vivant. J'aurais pu poser des questions, obtenir plus de détails... J'ai peut-être pensé qu'elle ne mourrait jamais.
Sa vie se résume en labeurs, depuis sa naissance dans une famille d’agriculteurs Hmong du Laos. Avant de devenir une mère dont l’objectif est la survie de sa fratrie.
Dans cette transcription, j'ai essayé de rester fidèle à son récit. Alors, ne soyez pas surpris de certaines incohérences de dates, de lieux ou de faits historiques qui ne sont que son point de vue.
Suivez-la dans sa vie de « mère oiseau ».
Sommaire
Mao Comme une « mère oiseau »
Chapitre 1
Chapitre 2
Chapitre 3
Chapitre 4
Épilogue
Maiv Comme un souvenir
Chronologie
Le récit de May
Chapitre 1
Chapitre 2
Chapitre 3
Chapitre 4
Chapitre 5
Chapitre 6
Chapitre 7
Chapitre 8
Chapitre 9
Chapitre 10
Chapitre 11
Épilogue
Table des principaux noms propres
Les villes du Laos et de la Thaïlande cités dans le livre
POUR EN SAVOIR PLUS…
UN PEU D’HISTOIRE
ENTRE COUTUMES, TRADITIONS ET CULTES
Naître
Être un garçon
Être fille
Se marier
Se soigner
Cérémonies Hmong : Khi tes et hu plig
Devenir un homme
La broderie
Le Nouvel An
L’écriture
Entre Hmong
Mourir
RÉFÉRENCES
Mao
Comme une « mère oiseau »
1
Je suis née au Laos et ma vie est déjà destinée à une vie de labeurs, comme celle de beaucoup de filles Hmong de mon village. Depuis la nuit des temps, je pense que les femmes ne naissent que pour connaître ce destin de labeur. Ainsi, nos mères, et avant elles, les mères de nos mères ont toutes labouré les terres de nos ancêtres...
Pendant des années de mariage, mes parents ne parviennent pas à avoir d’enfant. C’est très mal vu par la communauté Hmong. Un couple sans enfant est considéré comme un couple qui n’a pas fait beaucoup de bien dans sa vie antérieure. Ma mère entame un traitement contre la stérilité, à base de plantes. Elle met au monde mon frère Tcha.
Trois ans plus tard, toujours grâce au traitement, je nais. Mes parents me prénomment Mao, mais, comme je suis de santé fragile, mes parents pensent que ce prénom ne me convient pas. Ils décident donc de demander à une femme du clan Heu, de me « renommer ». C'est une pratique courante qui consiste à se faire baptiser par une personne de son choix et, souvent porteuse de chance.
Depuis, je m'appelle Mao Heu. Mais sur les papiers, je porte le nom de mon père. Il est du clan Xiong.
Nous vivons dans un village très fréquenté, dans les montagnes Hmong appelé « Té-Niou-Crou1 ». Mes parents sont agriculteurs : ils cultivent le riz. Avant que le soleil ne se lève, bien avant même le chant du coq, sous les derniers rayons de lune, mes parents sont déjà levés et, tandis que ma mère s’affaire à préparer le repas du matin puis à nourrir les animaux, mon père nettoie les derniers outils : bêches, faux, lames de couteaux dentelées et usées par la rouille...
Il secoue les paniers dehors et retouche les parties dénouées par l’usage. Puis ils partent aux champs et nous ne les revoyons que le soir, très tard. Malgré leurs absences, mon frère et moi ne nous plaignons pas. C’est quelque chose de normal et nous n'avons même pas la pensée de dire qu'ils nous manquent.
Nous sommes gardés par des voisines bienveillantes qui ont le droit de rester au village pour s’occuper des tâches de la ferme : nourrir les animaux, préparer les repas, s’occuper des plus jeunes…
La vie au village est rude et heureusement que les habitants sont solidaires et s’entraident. Il arrive même que certaines femmes permettent à d’autres enfants de venir téter leurs seins, lorsque la mère est occupée ou rentre tard dans la nuit, ou lorsqu’elle n’arrive pas à produire suffisamment de lait.
J’ai souvent très faim et lorsqu’un jour, la « tante2 » qui me garde me propose son lait, je me jette sur ses seins, tète goulûment avant d’aller me cacher de honte. Je salive aussi lorsque je vois les autres manger et même, lorsqu’il ne s’agit pas de nourriture, mon imagination me fait croire que dans les bambous transportés par des oncles venant de Paksé, il y a du riz. Il est vrai que le bambou, fraîchement coupé, dégage un parfum de riz tout juste sorti du feu...
Mes parents ont pitié de moi. Ils voudraient tant pouvoir nous nourrir tous les jours, mais, malgré leur travail, ils n’arrivent pas à subvenir à nos besoins et nous passons notre temps à déménager. Ils souhaitent trouver une terre assez généreuse qui donne suffisamment de riz où nous pourrions nous installer durablement. Que ce soit de Phao-Khao à Long-Cheng ou de Té-Niou-Crou à Phu-Mou, nous parcourons ces différents villages plusieurs fois dans notre vie et n’arrivons pas à trouver un endroit qui puisse nous accueillir pour de bon.
Heureusement, ils ne baissent jamais les bras et tentent la culture sur brûlis. Ils canalisent le feu à l’intérieur d’immenses carrés de terre qui sont brûlés pour servir d’engrais. Mais les mauvaises herbes des hauteurs sont trop humides. Le seul moyen est de les couper, faire des petits tas avant de les brûler : quelques plants de riz poussent timidement par endroit.
Les champs cultivables sont à une journée de marche, dans un lieu où il est impossible de s’installer seul. Dans ces montagnes, il faut être entouré d’autres groupes pour survivre. De plus, la rudesse des lieux et la topographie accidentée ne permettent pas de construire de logements solides. Les habitations sont donc éloignées des champs. Mes parents doivent, à l’issue de la récolte, charger plusieurs sacs de riz sur le dos de robustes chevaux pour les ramener au village. Le retour est semé d’embûches : l’humidité et la pluie rendent les chemins de terre boueux et glissants. Pendant qu’ils cultivaient leurs champs, les mauvaises herbes ont eu le temps de pousser et la nature a repris ses droits, rendant chaque voyage difficile. Épuisés par les allers-retours, ils profitent de plusieurs jours pour s’occuper des travaux de la maison et le stock de riz s’écoule rapidement.
Il nous arrive très souvent de souffrir de la faim pendant deux ou trois ans, avant que la terre ne soit assez chaude pour permettre la poursuite de la culture. Autrement, nous mangeons ce qu’il y a : des racines ou des écorces d’arbres que mes parents transforment astucieusement en farine. Pour cela, il faut abattre les arbres situés à flanc de colline, les traîner jusqu’aux endroits accessibles afin que les femmes et les enfants puissent les tronçonner pour les ramener à la maison. Ensuite, on enlève l’écorce, puis le tronc est dépecé en lamelles qu’il faut faire sécher au-dessus du feu, ou au soleil la journée.
Une fois sèches, les lamelles sont émiettées et mises dans des sacs pour être tamisées pendant des heures. On récupère la poudre puis on y ajoute de l’eau et on mélange sans s’arrêter pour permettre à la farine de s’agglomérer au fond du récipient, sans cela, le travail est perdu. On enlève l’eau tout doucement et on récupère enfin une petite quantité de farine, comme une décoction précieuse qu’on fait sécher près des cendres. On le mélange avec du riz ou de la semoule pour le rendre plus consistant et meilleur. Cela représente souvent le repas de la journée, avec à la place de la viande, un bouillon de lianes tiré d’une autre source de la nature.
La malnutrition est quotidienne et mon frère et moi avons bien du mal à grandir correctement : nos ventres sont souvent gonflés, nos bronches encombrées. Nos os se fragilisent, nos lèvres deviennent blanches et nos joues sont blafardes.
Dans ces conditions de vie difficile, la mortalité infantile est importante et mes parents font en sorte d’avoir le plus d’enfants possible. Ma mère entame un autre traitement contre la stérilité. Elle met au monde un garçon qui meurt à l’âge de neuf mois. Dans les campagnes, on est très superstitieux. Quand un malheur arrive, il est souvent signe de mauvais sort. Soit on a été mauvais dans notre vie antérieure, soit quelqu'un nous a jeté un sort…
Je pense qu’il est mort de malnutrition : ma mère n’a pas beaucoup de lait et elle travaille beaucoup trop. En plus, il n’y a pas d’hôpitaux et beaucoup de personnes ne se soignent qu’avec l’opium. C’est le seul remède qui soulage rapidement. Pour le reste on fait appel au chaman. C’est lui qui guérit tous les maux. Malgré cela, mon père, qui est lui-même chaman, se soigne souvent avec l’opium, ce qui ne l’empêche pas d’avoir des douleurs dans tout le corps.
Un malheur n’arrivant jamais seul, lors des funérailles de mon petit frère, mes parents font l’objet de critiques de toute sorte sur leur façon de pratiquer ce rite mortuaire des plus lourds et des plus pénibles. Pendant plusieurs jours et plusieurs nuits, il faut veiller le mort. Les invités connus ou inconnus défilent pour lui rendre hommage, même s'il n'était qu'un petit bébé. La famille endeuillée qui doit veiller à toujours approvisionner les tables des convives. Cela fait partie de la solidarité des paysans agriculteurs : si personne ne vient aux funérailles, cela voudrait dire que la famille n’est pas appréciée.
Les gens vivent au jour le jour et ce genre de drame montre les rapports humains ambigus et parfois impitoyables. Les plus médisants disent :
— Puisque les funérailles sont si étranges, tout le monde peut coucher avec tout le monde, ou se marier avec tout le monde, dans votre clan3.
Ce qui est différent dans le clan de mon père, c’est que le défunt est allongé la tête contre le pilier comme lorsqu’on dort.
Après les funérailles, mon père décide donc de nous emmener vivre parmi les siens à Long-Cheng. Auprès d’eux, la survie au quotidien est moins difficile et mon frère et moi pouvons enfin grandir facilement, en étant moins malades. Mon frère commence même à draguer les filles.
Il en est ainsi, depuis la nuit des temps. Mon frère deviendra père et portera le poids de la famille sur ses épaules. En tout cas, c’est ainsi dans la famille Hmong. C’est l’homme qui supporte la charge de la famille et qui doit subvenir à leurs besoins. Il doit à tout prix préserver le nom de ses ancêtres et leur honneur.
Quant à moi, je suis préparée à devenir une bonne belle-fille, bien éduquée, bien obéissante et sachant gérer toute une maisonnée. Comme pour beaucoup de jeunes gens, ce sont les parents qui arrangent les mariages de leurs enfants, et spécialement des filles.
Les mariages d’amour sont rares.
1 Té-Niou-Crou : s'écrit « Teb nyub qus », lieu connu sous le nom de Montagne aux Gaurs, littéralement la plaine aux buffles sauvages.
2 Il est d'usage d'appeler les adultes « tante » ou « oncle », par respect et pour éviter d'expliquer les liens souvent très compliqués.
3 Chaque famille Hmong appartient à un clan. Au sein d’un même clan les rituels peuvent différer.
2
Mes parents me sollicitent peu. Comme je suis une fille unique au caractère un peu rebelle, ma mère, après m'avoir inculqué ses tâches principales d'éducation, me laisse vaquer à mes occupations. Un jeune homme me courtise, mais il est sans le sou et il n'ose pas venir demander ma main. Je me retrouve alors mariée à un fils de bonne famille. Le jeune homme s'appelle Tou Lis, dont la famille vit à une journée de marche de mon village.
Peu avant mon mariage, je perds soudain la voix à cause d’un mal de gorge intense et je ne peux que murmurer mon consentement.
À dix-sept ans, me voilà épouse4 et je quitte mes parents le cœur lourd. Je sais que c’est pour toujours. On ne revient jamais chez soi, lorsqu'on part pour construire sa propre famille.
Dès que je franchis le seuil de la porte de la maison où j'ai grandi, mes larmes et mes regards en arrière n’ont aucun impact sur le cœur de ceux qui me volent mon adolescence et ma famille. Aujourd’hui, je deviens une étrangère pour tout le monde : pour les miens et pour la famille que j’épouse. En effet, une fille Hmong n'épouse pas seulement l'homme qui deviendra le père de ses enfants, mais toute sa famille, incluant sa lignée, ses coutumes et ses traditions.
Je trouve cette situation injuste, mais je suis résignée, puisque toute protestation est inutile : cela ne servirait à rien de lutter et de se rebeller, cela ferait seulement du tort à mes parents et à ceux de son clan.
Je poursuis docilement le cours de ma vie, ma mère m’y a préparée assidûment, depuis toute jeune. Mais la séparation est difficile et je mets quelque temps à m’y faire. Au bout de trois jours5, je suis résignée. Je consens à sortir de mon mutisme et à participer à ma nouvelle vie.
. *
Je représente une bonne acquisition pour mon époux qui, lui aussi, a obéi à ses parents en me prenant pour épouse. Il n'a aucun sentiment pour moi et il semble m'accepter uniquement pour rendre ses parents heureux. Malgré cela, je ne suis pas bien appréciée : je ne suis pas l'épouse obéissante et soumise qu’un homme de son clan mérite.
Mon époux fait partie d’une famille de très bonne réputation dont l’arrière-grand-père vient de Chine. Mon beau-père est un homme qui possède un immense domaine familial hérité de ses parents, avec des chevaux, des buffles, des cochons et des poules. Tous les animaux de la ferme, ainsi que d’immenses champs font partie de ce patrimoine qui fait la fierté de son clan. Sa famille est appréciée de tous. À table, il y a toujours à manger et au bout de la table, une place vide pour un invité surprise, ainsi qu’une couchette. C'est de coutume pour la réputation de la famille.
Ma belle-mère dirige la maison à coup de semonces et de baguettes, avec un regard sur le trésor amassé à la sueur du front des femmes ménagères, cultivatrices, à la limite de l’esclavage.
Mes belles-sœurs travaillent à un rythme soutenu, du matin au soir : désherber les champs de bas en haut, de haut en bas, nourrir les animaux, faire à manger pour la famille entière, composée des beauxfrères, des belles-sœurs, des oncles, des tantes… Avec, comme récompense, de quoi remplir seulement l’estomac, ce qui est un luxe sans nom. Pas un savon, pas un bijou, pas un vêtement neuf, sauf pour la fête du Nouvel An. Alors seulement, les filles peuvent se montrer dans de jolis costumes brodés, aux couleurs vives, dans l’espoir de trouver un riche époux qu’elles pourraient servir avec la même ferveur qu’à la maison…
Mais, comme toujours, aucune plainte ne vient écorcher cette éducation qui semble naturelle et l’idée ne leur vient pas qu’une autre façon de faire puisse exister.
Je suis tout de suite plongée dans leur vie, comme on jette une éponge dans l’eau. Il faut absorber les remarques, les on-dit, le choc éducatif. Il y a beaucoup à faire et je contribue largement aux tâches ménagères et aux travaux des champs.
Un an après mon mariage, je donne naissance à mon premier enfant : c’est un garçon. Après l’abattage des arbres et le labourage des terres agricoles, je tombe gravement malade. Les joues creusées et complètement amorphe, je ne dois ma guérison qu’à un message envoyé à mes parents qui accourent avec poules et cochons pour me nourrir. Je suis heureuse de constater que les parents restent présents pour toute notre vie. Ils prennent soin de moi jusqu’à ce que je guérisse.
Puis les naissances s’enchaînent, quasiment tous les ans. Comme à chaque naissance, Tou est absent, et ne sachant ni lire, ni écrire, je ne pense pas à faire noter les dates de naissance des enfants.
*
Les champs de riz et de maïs sont proches de la maison. Ils sont par ailleurs si grands que lorsqu’on tire un coup de fusil d’un côté, on n’entend pas de l’autre. À présent, je vis le labeur de mes parents. C'est comme si l'histoire se répétait sans cesse : désherber, moissonner, ramasser les bottes de riz pour les battre, séparer les grains des branches, les piler, enlever les écorces, stocker dans des sacs... Entourée d’une ribambelle d’enfants, tous en bas âges (un accroché à mes jambes, un collé au ventre et un sur le dos), on ne me dispense pas des travaux, même les plus pénibles. Au contraire, ces nombreuses couvées desservent ma disponibilité, au regard des autres belles-filles qui ont peu d’enfants, et qui, pourtant, n’en font pas plus que moi. Avoir des enfants, c’est un gros handicap, ne pas en avoir, c’est une malédiction et cela donne le droit à l’époux d’aller prendre d’autres épouses. Mais je me défends avec beaucoup de caractère et Tou n’a jamais pu prendre une autre épouse.
Pendant les périodes où je suis enceinte, piler le riz est pour moi une des tâches les plus usantes : après avoir battu les bottes de riz à la force des bras avec l’aide d’une grosse massue, je dois ramasser les graines encore couvertes de leurs écorces pour les mettre dans le pilon. Le pilon à riz est composé d’un gros récipient en bois ; le bout arrondi est accroché à un gros tasseau avec un repose-pied. Il faut appuyer sur le repose-pied de toutes mes forces pour que le pilon, en s'écrasant sur le riz posé dans le récipient, en enlève les écorces. Après une demi-journée de ce travail, je sens que mon ventre se gonfle, comme s’il était sur le point d’éclater.
Cela dure des années, jusqu’au jour où mon beau-père fabrique un pilon qui fonctionne à l’eau. Il ne reste plus que le travail de surveillance qui se tarde dans la nuit. Grâce à ce pilon hydraulique, je peux piler un panier de dix bottes et si je me lève tôt, avant d’aller aux champs, je peux en faire un peu plus. C’est une victoire, lorsque c’est le cas, mais la nuit est courte et la journée encore plus longue, puisqu’elle ne se termine pas au retour des champs. Il faut ensuite faire à manger, nettoyer les outils pour préparer le travail de la journée suivante. Il n’y a pas de repos, seulement quelques heures de sommeil pendant la nuit.
Le matin, aux premiers chants du coq, je dois me lever pour aller chercher l’eau à la rivière. Il faut ramener cinq seaux d’eau de la rivière, des seaux tellement grands et lourds que je ne peux pas les monter remplis sur le dos. Je dois donc faire preuve d’astuce, car il faut être malin pour survivre : je remplis le seau à moitié que je mets ensuite sur le dos, puis, à l’aide d’une petite bassine, je complète le seau jusqu’à atteindre un poids que je peux transporter raisonnablement. Il faut qu’il soit bien rempli, pour éviter de revenir trop souvent. Ensuite, c’est au prix d’un effort surhumain, un genou à terre que je me redresse en poussant des cris pour libérer mon corps endolori de ce fardeau qui doit représenter bien plus que mon propre poids. L’eau sert à faire à manger, à donner aux animaux, à certains de pouvoir se laver…
Je prépare une grande casserole de riz, si lourde qu’il faut être deux pour la soulever. Lorsque le repas est prêt, il est rare que je puisse m’attabler avec tout le monde. Avec ma ribambelle d’enfants de tous âges, je dois d’abord les nourrir pour les calmer, car souvent la faim les tenaille. Lorsqu’enfin je m’installe, il n'y a plus de bouillon pour accompagner le reste de riz. Quelquefois même, je dois racler le fond du pilon à piments pour assaisonner le riz, collé à la paroi de la casserole, que j’ai la chance de récupérer.
La journée, à la fin de mes périodes de grossesse où je ne sers à rien dans les champs, je reste au village pour les corvées quotidiennes.
Je donne à manger aux animaux ; la graisse des plus vieux cochons sert pour cuire les aliments, les plus jeunes sont abattus pour leur viande. Lorsqu’on en sacrifie un, le village entier est invité. C’est de coutume, la fête se fait avec tous les voisins et amis. Si certains ne viennent pas, c’est qu’ils sont fâchés, et s’il y a peu de monde, c’est que la famille n’est pas appréciée et qu’elle ne sera pas invitée si une occasion se présentait ailleurs…
Durant ces fêtes, je peux espérer avoir un peu de reste de viande, mais j’ai rarement droit à la viande de poule. C’est trop petit et je me contente toujours et encore du bouillon. Lors de ces moments, je ressens une grande solitude et je me cache souvent pour pleurer silencieusement sur mon sort. Qu’importe les sentiments qu’une belle-fille peut exprimer : il n’est nulle place à la joie, aux rires, seulement aux larmes…