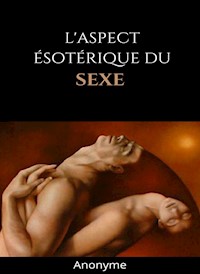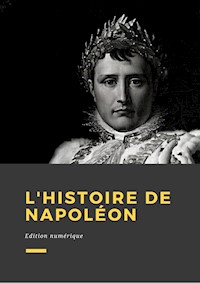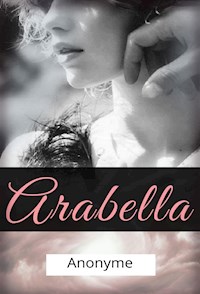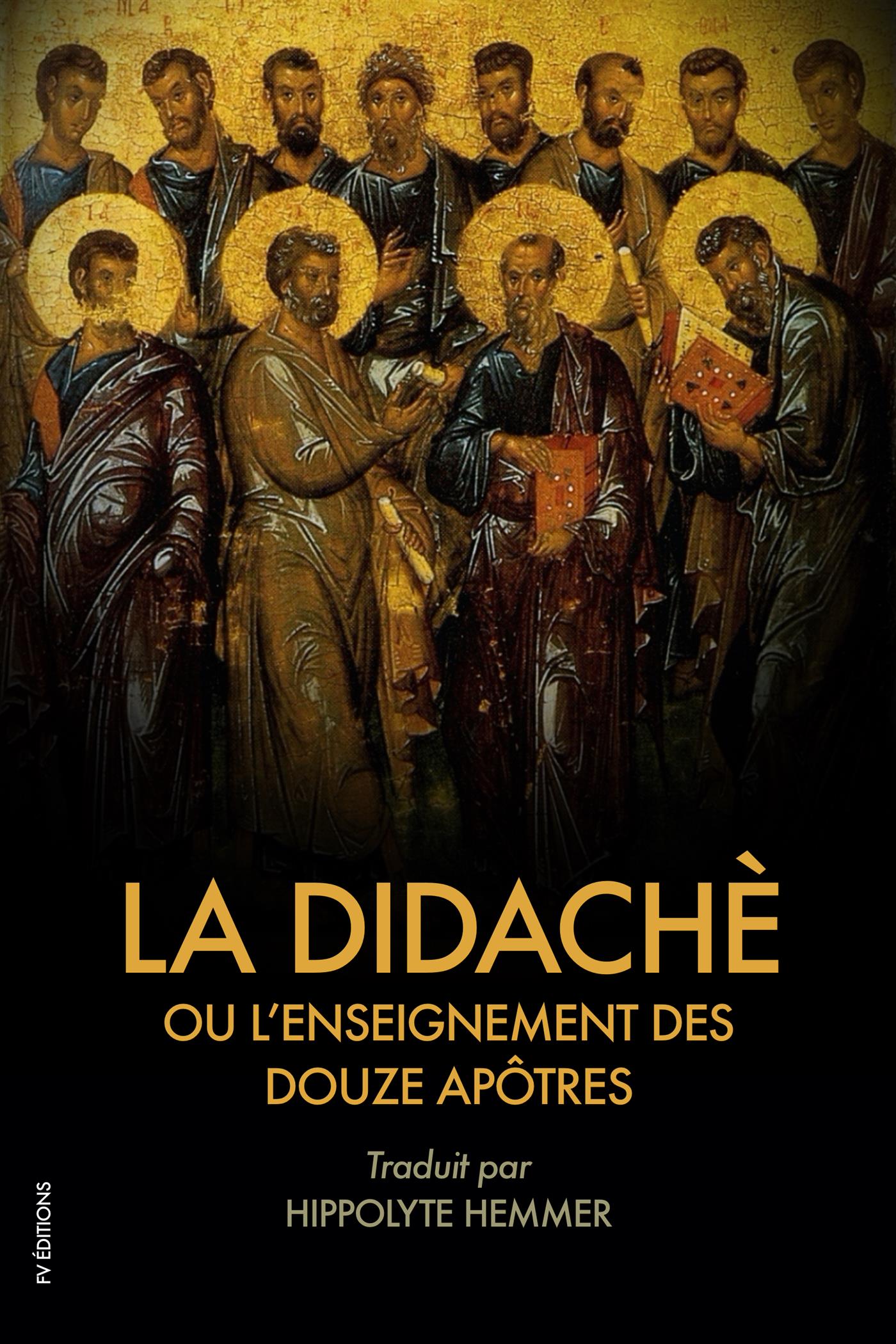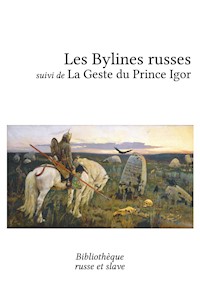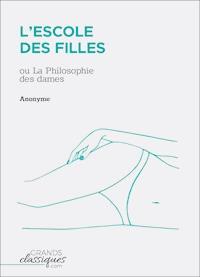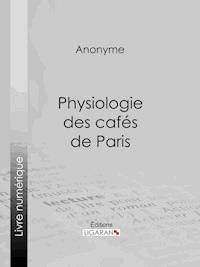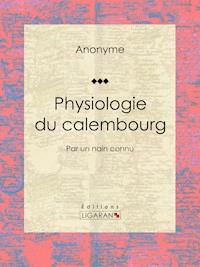Extrait : "« Dans la société antique, la volupté était une science et un art, comme la philosophie et la poésie. » Ainsi les Grecs avaient organisé leur existence amoureuse de la façon la plus artistiquement scientifique : « Nous avons, disaient-ils, des courtisanes pour la jouissance, des concubines pour nos besoins quotidiens, et des épouses pour qu'elles nous donnent des enfants, pour qu'elles règlent fidèlement l'intérieur de nos maisons. »
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de qualité de grands livres de la littérature classique mais également des livres rares en partenariat avec la BNF. Beaucoup de soins sont apportés à ces versions ebook pour éviter les fautes que l'on trouve trop souvent dans des versions numériques de ces textes.
LIGARAN propose des grands classiques dans les domaines suivants :
• Livres rares
• Livres libertins
• Livres d'Histoire
• Poésies
• Première guerre mondiale
• Jeunesse
• Policier
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 391
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335092028
©Ligaran 2015
« Dans la société antique, la volupté était une science et un art, comme la philosophie et la poésie. »
Ainsi les Grecs avaient organisé leur existence amoureuse de la façon la plus artistiquement scientifique :
« Nous avons, disaient-ils, des courtisanes pour la jouissance, des concubines pour nos besoins quotidiens, et des épouses pour qu’elles nous donnent des enfants, pour qu’elles règlent fidèlement l’intérieur de nos maisons. »
Pour le baiser de volupté, la recherche du plaisir, la satisfaction de l’instinct lubrique enfin, l’Athénien a l’hétaïre et la courtisane.
Pour les exigences quotidiennes ou, plus modestement périodiques de ses sens, il garde à sa portée une concubine, qui peut, en quelque façon, être associée à sa vie familiale.
Enfin, pour perpétuer sa race, veiller au foyer, élever les enfants, il choisit une jeune fille de famille honorable et l’enferme au gynécée, à l’abri de toute sensation.
Les Romains, eux, ont exprimé par la bouche d’un magistrat irréprochable, aussi distingué par l’éclat de ses honneurs que par la dignité de sa vie, leur sentiment sur l’amour légal, obligatoire, l’amour conjugal : « Si nous pouvions, disait Metellus Numidicus, homme grave et disert, nous perpétuer sans épouses, ô Romains, il n’est pas un seul d’entre nous qui voulût se charger d’un pareil embarras ; mais, puisque la nature a voulu, d’un côté, qu’il fut absolument impossible d’être heureux avec les femmes, et de l’autre, qu’elles fussent nécessaires à la propagation de l’espèce humaine, il faut sacrifier le bonheur de notre vie à la conservation de l’État. »
De leur côté, les matrones romaines, croyant un jour que les Pères conscrits allaient délibérer sur le point de savoir lequel serait le plus utile et le plus avantageux à la République, qu’un homme épousât deux femmes ou qu’une femme fût mariée à deux hommes, supplièrent qu’on les mariât chacune à deux hommes, plutôt que de donner deux d’entre elles à un seul.
Chez les anciens, en somme, les devoirs et les sentiments de famille étaient une chose, une chose grave, étroitement liée à la religion nationale ; et c’en était une autre, tout aussi grave peut-être, peut-être aussi religieuse, que de satisfaire aux besoins de la chair.
Du moins les dieux auraient eu mauvaise grâce à les condamner, puisqu’eux-mêmes se livraient à ces plaisirs avec impétuosité, avec voracité. Il est, en effet, très curieux de constater que les habitants de l’Olympe étaient gloutonnement amoureux et que, chez eux comme sur la terre, les liens conjugaux étaient très relâchés, très souples, ne s’opposant jamais à la satisfaction des plus charnelles, des plus libidineuses passions.
Comme il convient, Jupiter, le dieu des dieux, donne l’exemple. Amoureux de Thétis, fille de Nérée et de Doris, la plus belle des Néréides, il ne renonce à coucher avec elle que parce que Prométhée le met en garde contre les conséquences de ces amours : « Défends-toi bien, Jupiter, d’avoir commerce avec la Néréide : si elle devient grosse de tes œuvres, son enfant te traitera comme tu as traité Saturne. » Et Jupiter court à d’autres maîtresses.
Il a eu moins de scrupules avec la belle Thébaine Sémélé, fille de Cadmus et d’Harmonia, qui, d’ailleurs, ne se fit guère prier pour tomber pâmée dans les bras de Jupiter et qui ne tardait guère à voir son ventre s’arrondir. Pour comble de malheur, Sémélé périssait dans un incendie sottement allumé par le dieu lui-même. Mais Mercure, le fidèle messager de l’Olympe, l’homme à tout faire de Jupiter, se précipita sur terre, alla fendre le ventre de Sémélé, apporta l’embryon imparfait, qui n’avait que sept mois, et déposa l’enfant dans la cuisse du dieu, pour qu’il vînt à terme.
C’est à Thèbes encore que Jupiter s’émancipa avec Alcmène, dans une intrigue comique dont la scène latine et Molière après Plaute se sont emparés. Amoureux de la femme d’Amphytrion, il profita d’une absence du mari pour prendre sa figure et se rendre auprès d’Alcmène. En même temps Mercure allait donner l’ordre au soleil de prolonger la nuit pendant trois jours. « Jupiter, dit-il, est chez Amphytrion, dont il aime la femme, avec laquelle il est couché. »
« LE SOLEIL. – Eh quoi ? n’a-t-il pas assez d’une nuit ?
MERCURE. – Non pas ; car de ce commerce doit naître un dieu grand, illustre par de nombreux travaux ; et l’achever en une seule nuit, c’est chose impossible.
LE SOLEIL. – Qu’il l’achève donc ! À la bonne heure ! Mais tout cela, Mercure, n’arrivait pas du temps de Saturne, entre nous soit dit. Ce dieu passait toutes ses nuits près de Rhéa, et il n’abandonnait pas le ciel pour aller coucher à Thèbes. Le jour était le jour et la nuit durait en proportion des saisons : il ne se faisait rien d’étrange, rien d’extraordinaire ; personne n’avait d’intrigue avec les mortelles. Aujourd’hui, pour une misérable femelle, il faut tout mettre sens dessus dessous. »
Mais malgré tout, Jupiter n’est pas heureux dans ses amours adultères : il n’est pas payé de retour par les mortelles qu’il honore de ses embrassements. Avec une certaine amertume, il s’en plaint à l’amour lui-même.
« Vois, petit misérable, si ce n’est pas un grand mal que de m’insulter à ce point, qu’il n’y a pas de forme que tu ne m’aies fait prendre, satyre, taureau, or, cygne, aigle. Tu n’as rendu aucune femme amoureuse de moi-même, et je ne sache pas que par toi j’aie su plaire à quelqu’une : il faut, au contraire, que j’use d’enchantements avec elles et que je me cache : il est vrai qu’elles aiment le taureau ou le cygne, mais si elles me voyaient, elles mourraient de peur. »
De même le jour où Jupiter, qui décidément a tous les vices, veut jouir des embrassements de Ganymède, le beau berger du mont Ida, il est obligé de se transformer en aigle pour s’abattre sur lui, l’enlever du milieu de son troupeau et le transporter au ciel. Encore doit-il instruire le jeune et trop naïf Troyen des belles destinées qui l’attendent.
« GANYMEDE. – Mais où coucherai-je la nuit ? Sera-ce avec mon camarade l’Amour ?
JUPITER. – Non pas ; je t’ai enlevé pour que nous dormions ensemble.
GANYMEDE. – Ah ! tu ne peux pas dormir seul, et tu trouves plus agréable de dormir avec moi ?
JUPITER. – Sans doute, surtout quand on est joli garçon comme tu l’es, Ganymède.
GANYMEDE. – Comment ma beauté te fera-t-elle mieux dormir ?
JUPITER. – C’est un charme puissant et qui rend le sommeil plus doux.
GANYMEDE. – Cependant mon père se fâchait contre moi quand nous couchions ensemble, et il me racontait le matin comment je l’avais empêché de dormir, en me retournant, en lui donnant des coups de pied, en rêvant tout haut, aussi m’envoyait-il souvent dormir auprès de ma mère. Je te conseille donc, si tu m’as enlevé pour cela, comme tu le dis, de me redescendre sur la terre ; autrement, tu auras fort à faire à ne pas dormir, et je t’incommoderai en me retournant sans cesse.
JUPITER. – Tu ne peux rien faire qui me soit plus agréable que de me tenir éveillé avec toi, car alors je ne cesserai de te donner des baisers et de te serrer dans mes bras.
GANYMEDE. – Tu verras : moi, je dormirai, pendant que tu me donneras tes baisers.
JUPITER. – Nous saurons alors ce qu’il faudra faire. »
Tous ces hauts faits d’ailleurs ne sont point du goût de Junon qui, tout comme une simple mortelle, fait à son divin mari une vulgaire scène de ménage.
« JUNON. – Depuis que tu as amené ici ce jeune Phrygien que tu as enlevé de l’Ida, il me semble, Jupiter, que tu fais moins attention à moi.
JUPITER. – Eh quoi ! Junon, en es-tu jalouse ? Il est si simple ! si inoffensif ! Je croyais que tu ne te fâchais que contre les femmes que j’avais pour maîtresses.
JUNON. – Tout cela n’est ni beau, ni convenable. Toi, le maître souverain des dieux, tu me laisses, moi qui suis ta femme légitime, pour aller courir en bas les aventures galantes, transformé en or, en satyre ou en taureau. Toutefois ces maîtresses demeurent sur la terre ; mais ce jeune pâtre de l’Ida, que tu as enlevé sur tes ailes, ô toi le plus vaillant des dieux, le voilà fixé chez nous et toujours sur notre tête, sous prétexte d’échansonnerie. Manques-tu donc d’échansons ? Hébé et Vulcain sont-ils las de nous servir ? Mais tu ne prendrais jamais la coupe de ses mains sans l’avoir d’abord embrassé, sous les yeux de tout le monde, et ce baiser te semble plus doux que le nectar. C’est pour cela que souvent, sans avoir soif, tu demandes à boire : quelquefois même, content de goûter la coupe, tu la lui rends aussitôt, puis, quand il a bu, tu la lui redemandes pour boire le reste du breuvage qu’il y a laissé du côté où se sont posées ses lèvres, afin de boire et de baiser tout ensemble. Dernièrement, enfin, toi le roi, toi le maître des dieux, tu as déposé ton égide et ta foudre pour jouer aux osselets avec lui, malgré cette longue barbe qui te pend au menton. Oui, je vois tout cela, et tu ne dois pas songer à m’échapper.
JUPITER. – Et quel mal y a-t-il, Junon, à embrasser, en buvant, un si joli garçon, à me plaire tout ensemble aux baisers et au nectar ? Ah ! si je lui permettais de t’embrasser une fois, tu ne me reprocherais plus de trouver le nectar moins doux que ses baisers.
JUNON. – Voilà les discours de nos amateurs de garçons ! Moi, je ne serais jamais assez folle pour toucher des lèvres ce mol enfant de la Phrygie, tout efféminé qu’il est.
JUPITER. – Cessez, très noble dame, d’insulter à mes amours : cet efféminé, ce barbare, cet enfant plein de mollesse, m’est plus agréable, plus désirable que… je ne veux pas dire qui, de peur de vous irriter davantage.
JUNON. – Il ne vous manque plus que de l’épouser pour me plaire. Souvenez-vous de votre conduite indigne envers moi à propos de cet échanson.
JUPITER. – Non, ce n’est pas lui qu’il fallait choisir pour vous verser à boire, mais Vulcain, votre fils boiteux, sortant de sa forge, tout couvert de limaille brûlante, et déposant à peine ses tenailles ! C’était de ses doigts mêmes qu’il fallait recevoir la coupe, c’était lui qu’il fallait tirer à nous et embrasser, lui dont vous, qui êtes sa mère, ne pouvez sans répugnance baiser le visage tout barbouillé de suie ! Voilà qui serait agréable, n’est-ce pas ? Voilà un échanson bien fait pour la table des dieux ! Il faut renvoyer Ganymède au mont Ida ; il est propre, il a les doigts roses, il est adroit à présenter la coupe, et, ce qui vous chagrine le plus, il a des baisers plus doux que le nectar.
JUNON. – Aujourd’hui Jupiter, Vulcain te paraît boiteux, ses doigts ne sont pas faits pour la coupe, il est tout noir de suie, et sa vue te donne la nausée, depuis que l’Ida nous a produit ce beau garçon aux longs cheveux ; jadis tu ne voyais rien de tout cela, et la limaille brûlante et la forge ne t’empêchaient pas de recevoir le breuvage de ses mains.
JUPITER. – Tu te fais du chagrin à toi-même, Junon, et sans autre profit que d’accroître mon amour par ta jalousie. S’il te fâche de prendre la coupe des mains de ce gentil garçon, fais-toi servir par ton fils. Et toi, Ganymède, ne présente la coupe qu’à moi seul, et, chaque fois, tu me donneras deux baisers, d’abord en me la présentant pleine, et puis en me la reprenant. Eh quoi ! tu verses des larmes ? Ne crains rien. Je ferai pleurer celui qui voudra te faire de la peine. »
Pour son compte personnel, Jupiter n’affecte pas une jalousie bien vive ; mais plutôt, au gré de Junon, une tranquillité quelque peu outrageante. Son épouse le prévient que Ixion, ex-roi des Lapithes, auquel le roi des dieux a offert une généreuse hospitalité, a voulu la séduire, elle, la femme de Jupiter.
« JUNON. – Oui, moi, et non pas une autre, Jupiter ; et il y a déjà quelque temps. D’abord, je ne pouvais m’expliquer pourquoi il avait sans cesse les yeux fixés sur moi ; il poussait des soupirs, il versait des larmes. Si parfois, après avoir bu, je rendais la coupe à Ganymède, il la lui demandait pour boire dans le même, vase que moi ; puis, après l’avoir reçue, il y appliquait ses lèvres, l’approchait de ses yeux et tournait de nouveau ses regards vers moi. Je compris dès lors que tout cela n’était que trébuchements d’amour, et pendant longtemps j’eus honte de t’en parler, espérant que cet homme ferait trêve à sa folie. Mais du moment qu’il a osé me tenir d’amoureux propos, je l’ai laissé tout en larmes, se roulant à mes genoux, je me suis bouché les oreilles pour ne pas entendre ses injurieuses prières, et je suis venue te dire ce qu’il en est. Vois maintenant toi-même comment te venger du galant.
JUPITER. – À la bonne heure ! Le scélérat ! s’attaquer à moi, à la couche de Junon ! S’était-il donc si bien enivré de nectar ? Mais aussi c’est notre faute, et nous avons tort d’aimer les hommes au point de les faire asseoir à notre table. Ils sont excusables, lorsque, abreuvés de la même boisson que nous, voyant des beautés célestes et telles qu’ils n’en voient point sur la terre, ils désirent en jouir et se sentent pris d’amour. L’Amour est un maître tyrannique ; il ne règne pas seulement sur les hommes, mais parfois aussi sur nous.
JUNON. – Il se montre bien ton maître : il te fait aller, il te mène, comme on dit, par le bout du nez, et tu le suis partout où il lui plaît de te conduire : il te fait changer en tout ce qu’il veut ; en un mot, tu es l’esclave et le jouet de l’Amour. Et je sais bien pourquoi tu pardonnes aujourd’hui à Ixion : c’est qu’autrefois toi-même tu as séduit sa femme, qui t’a rendu père de Pirithoüs.
JUPITER. – Tu te souviens encore des parties de plaisir que je suis descendu faire sur la terre ? Maintenant sais-tu ce que je veux faire d’Ixion ? Le châtier, non pas, ni le renvoyer de notre table : ce ne serait pas poli. Puisqu’il est sérieusement amoureux, puisqu’il pleure, dis-tu, et souffre des maux cruels…
JUNON. – Que vas-tu dire ? J’ai peur que tu ne me fasses à ton tour quelque proposition outrageante.
JUPITER. – Pas du tout. Nous allons former avec une nuée un fantôme qui te ressemble, et, quand le repas sera fini, lorsque l’amour, suivant toute apparence, le tiendra éveillé, nous porterons ce fantôme et le ferons coucher près de lui : ainsi se calmeront ses douleurs, quand il croira tenir l’objet de sa passion.
JUNON. – Fi donc ! Qu’il lui arrive malheur, pour avoir désiré ce qui est au-dessus de lui !
JUPITER. – Laisse un peu faire, Junon. Qu’as-tu à craindre de ce fantôme, puisque c’est une nuée qu’Ixion caressera ?
JUNON. – Oui, mais cette nuée semblera être moi-même, et la honte retombera sur moi, à cause de la ressemblance.
JUPITER. – Ce que tu dis ne signifie rien : jamais une nuée ne pourra être Junon, ni Junon une nuée. Ixion tout seul sera bien attrapé.
JUNON. – C’est juste : seulement, comme tous les hommes sont mal élevés, il se vantera sans doute, une fois redescendu sur la terre, et ira disant partout qu’il a obtenu les faveurs de Junon et partagé la couche de Jupiter. Peut-être même dira-t-il que je l’aime et les autres le croiront, ne sachant pas qu’il n’a caressé qu’une nuée.
JUPITER. – Alors, s’il tient de semblables propos, je le plonge dans les enfers, je l’attache à une roue qui tournera sans cesse ; je lui inflige un supplice éternel ; et il portera la peine, non de son amour, la faute est légère, mais de sa jactance. »
De son côté, Apollon, le dieu du soleil et de la lumière, se déclare malheureux en amours. « De deux personnes que j’ai le plus tendrement aimées, dit-il, Daphné et Hyacinthe, l’une me fuit et me déteste au point d’aimer mieux se voir changée en arbre qu’avoir commerce avec moi ; l’autre, je le tue d’un coup de disque. »
L’amour enfin, ce petit dieu malin, lance ses traits à contretemps, sur les dieux comme sur les hommes ; et sa mère elle-même, la belle Vénus, doit lui reprocher sa conduite légère :
« VÉNUS. – Amour, mon fils, vois ce que tu fais : je ne parle pas de ce qui a lieu sur la terre, ni des excès où tu entraînes les hommes, soit contre eux-mêmes, soit les uns contre les autres, mais de ce qui se passe dans le ciel : tu nous montres Jupiter sous mille formes, tu lui imposes le changement qu’il te plaît ; tu fais descendre la Lune du ciel, tu forces le Soleil à s’arrêter quelquefois chez Clymène, où il oublie de donner l’essor à son char, sans compter les outrages dont tu m’accables, moi ta mère, avec une audace… Enfin, scélérat, tu vas jusqu’à inspirer à Rhéa, cette vieille déesse, cette mère de tant de dieux, un tendre amour pour un enfant, une vive passion pour ce jeune garçon de la Phrygie. La voilà tout affolée par toi, attelant ses lions, se faisant suivre des Corybantes aussi fous qu’elle, et parcourant l’Ida tous ensemble du haut en bas : elle, appelant à grands cris son Atys ; les Corybantes, se pratiquant des incisions aux coudes, ou courant furieux, les cheveux épars, au travers des montagnes, sonnant de la corne, battant du tambour, frappant des cymbales : ce n’est que bruit et frénésie par tout le mont Ida. Aussi, je crains, moi qui ai donné le jour à un monstre comme toi, que Rhéa, dans un accès de fureur, ou plutôt de bon sens, n’ordonne aux Corybantes de sauter sur toi, de te mettre en pièces ou de te livrer aux lions : je tremble de te voir exposé à un pareil danger.
L’AMOUR. – Rassure-toi, ma mère ; je suis déjà familier avec les lions : souvent je monte sur leur dos, les saisis par la crinière, et les conduis comme une monture : eux, de leur côté, me caressent de leur queue, reçoivent ma main dans leur gueule, la lèchent et me permettent de la retirer. Quant à Rhéa, comment aurait-elle le temps de songer à moi, tout occupée qu’elle est de son Atys ? D’ailleurs quel mal fais-je en montrant où est la beauté ? Vous-mêmes, déesses, n’aimez-vous pas ce qui est beau ? Ne me le reprochez donc pas. Et toi, ma mère, voudrais-tu cesser d’aimer Mars ou d’en être aimée ?
VÉNUS. – Que tu es terrible ! Comme tu es maître de tout ! Cependant, songe quelquefois à ce que je t’ai dit. »
Mais Vénus n’oserait pas trop élever la voix ; elle a trop à se faire pardonner. Elle est descendue du ciel sur le mont Ida pour se laisser aimer par Anchise d’Ilion ; elle est allée sur le Liban donner ses lèvres au bel Adonis, que Proserpine lui a ravi. Elle a, de combien de pères, mis au monde trois fils très différents de figure et d’humeur : l’Amour, Hermaphrodite et Priape, ce dernier « plus mâle que ne le veut la décence ». Elle a enfin oublié son devoir conjugal dans les bras du séduisant dieu de la guerre et suscité dans l’Olympe un scandale sans précédent, qu’Apollon conte à Mercure, non sans saveur :
« APOLLON. – Pourquoi ris-tu, Mercure ?
MERCURE. – Parce que je viens de voir, Apollon, une chose des plus risibles.
APOLLON. – Dis-la-moi, afin que je puisse en rire avec toi.
MERCURE. – Vénus et Mars viennent d’être pris couchés ensemble, et Vulcain les a tous deux enveloppés dans un filet.
APOLLON. – Comment cela ? Ce que tu racontes est piquant.
MERCURE. – Depuis longtemps, je pense, Vulcain, se doutant du jeu, les épiait : il avait posé autour du lit des liens invisibles, et s’en était allé travailler à sa forge. Bientôt, Mars entre, croyant n’avoir été vu de personne ; mais le Soleil, qui l’avait aperçu, va le dire à Vulcain. Quand les deux amants, montés sur le lit, se furent mis à l’œuvre et que, pris dans les filets, ils se furent enlacés dans les liens, Vulcain arriva. Vénus, qui était nue, ne savait comment se couvrir, toute honteuse ; Mars essaya d’abord de fuir, espérant briser les liens ; mais se voyant pris sans issue, il recourait aux prières.
APOLLON. – Eh bien, Vulcain les a-t-il relâchés ?
MERCURE. – Non pas ; il appelle tous les dieux et les rend témoins de l’adultère : les deux amants, nus et les regards baissés, rougissent d’être ainsi liés ensemble ; et ce fut un spectacle délicieux pour moi que celui de l’œuvre amoureuse, presque accomplie sous nos regards.
APOLLON. – Et le forgeron n’avait pas honte d’étaler ainsi son déshonneur conjugal ?
MERCURE. – Par Jupiter ! il était là, riant comme les autres : pour moi, s’il faut dire le vrai, j’étais jaloux de Mars, en le voyant non seulement aimé d’une si jolie déesse, mais attaché avec elle.
APOLLON. – Te laisserais-tu donc attacher à ce prix ?
MERCURE. – Et toi, Apollon, refuserais-tu ? Viens un instant les voir, et je te louerai fort si tu ne fais le même souhait après les avoir vus. »
L’Amour épargne cependant Minerve ; contre elle, son flambeau n’a pas de feux, son carquois est vide de flèches. C’est que l’air imposant et mâle de la déesse de la sagesse et des arts, son œil terrible et défiant effraye l’Amour et le met en fuite. Quant aux Muses, il les respecte : elles sont toujours en méditation, toujours occupées de quelque chant ; et il s’approche souvent d’elles, séduit par leurs mélodies.
Enfin il ne blesse pas Diane, « parce qu’il n’est pas facile de l’atteindre, elle fuit toujours à travers les montagnes. » Et puis elle a, depuis longtemps, un autre amour au cœur, celui de la chasse, des cerfs, des faons, à la poursuite desquels elle s’élance, pour les percer de ses flèches : elle est tout entière à cette passion.
Ainsi tous, mortels et immortels, déesses ou simples mortelles, tous, l’Amour nous guette, et nous ne saurions lui échapper… À moins que nous ne soyons, ou hideusement sages comme Minerve, ou respectablement méditatifs comme les Muses, ou bien passionnés de chasse comme Diane !
La jeune fille grecque, sévèrement enfermée dans un appartement réservé, le Parthénon, se mariait très jeune et, par conséquent, très ignorante ; elle suivait un étranger, dès l’âge nubile, sans être consultée sur son choix, sans le connaître, quelquefois sans l’avoir vu. Elle n’était élevée, d’ailleurs, que pour l’hyménée. Les épigrammes funéraires des jeunes filles mortes prématurément, au lieu de célébrer la virginité inviolée, expriment toujours le regret du lit nuptial : « Tu es donc morte avant l’hyménée, Philénium, et ta mère Pythias ne t’a pas conduite dans la belle chambre de ton fiancé ; mais en se déchirant les joues à faire pitié, elle a enseveli dans ce tombeau une fille de quatorze ans. (Persès.) »
« Hélas ! Aristocratie, tu es descendue aux sombres demeures de l’Achéron, morte avant l’hyménée, et il ne reste plus à ta mère que les larmes dont elle arrose sans cesse ta tombe dans son désespoir. (Mnalsaque.) »
« Ici reposent les cendres de Timade qui, morte avant l’hyménée, est entrée dans la sombre demeure de Proserpine. Elle morte, toutes ses compagnes ont, avec le fer aiguisé, coupé leur chevelure, et l’ont déposée sur sa tombe. (Sappho.) »
« Je pleure la jeune Antibia. Pour la demander en mariage, des prétendants étaient venus en foule chez son père, attirés par sa beauté et sa sagesse ; mais la Parque cruelle a emporté loin d’eux celle qui était l’objet de leurs espérances. (Anyté.). »
Plus brutalement l’avare de Plaute se lamente de ce que sa fille, bien vivante, a l’âge de l’hymen ; car il faut la marier, la doter : « Me voilà avec une grande fille sur les bras, sans dot, et je ne sais où la caser. »
Toutefois l’union de l’homme et de la femme n’étant formée que pour la procréation d’enfants légitimes, l’âge légal du mariage est l’âge de la puberté, c’est-à-dire l’aptitude à engendrer chez l’homme, l’aptitude à concevoir chez la femme : douze à quinze ans pour celle-ci, quatorze à dix-huit ans pour celui-là. La femme impubère peut bien être donnée par contrat, mais la consommation du mariage ne peut avoir lieu que lorsque la femme a atteint la majorité requise pour le mariage.
Les cérémonies matrimoniales célèbrent religieusement l’amour physique, le désir mutuel de l’accouplement qui crée la jouissance et perpétue la race. Tout le rituel préparatoire est accompagné de « vers fescennins », d’épigrammes licencieuses célébrant la vierge livrée à l’époux frémissant de désirs, lui conseillant de ne rien refuser à son mari, quelles que puissent être ses exigences. Ils célèbrent aussi les chastes matrones chargées de placer la jeune épouse dans la couche nuptiale, dans le lit que décore l’ivoire, le lectus genialis, dans lequel seront conçus et engendrés les enfants. Et les exhortations ne manquent pas à l’époux. Il doit renoncer dorénavant au mignon qui charmait ses nuits, et auquel l’épouse elle-même coupera les cheveux au lendemain du mariage.
Mais qu’il soit vigoureux et audacieux. « Courage, jeune homme, ne laisse pas échapper la vierge de tes bras, quand elle te déchirerait de ses ongles inhumains. Le plaisir disputé est cent fois plus doux, et la beauté qui nous fuit nous enflamme davantage. Rougis d’un sang virginal les tissus de Sidon… Puis vainqueur et glorieux des blessures que te coûta cette nuit, quitte l’humide théâtre du combat.
Allez, enfants, mêlez la sueur de vos corps ; que les colombes ne soupirent pas plus amoureusement que vous : que vos bras s’entrelacent comme le lierre, et, dans vos tendres baisers, soyez unis comme deux coquilles le sont entre elles. Courage, jouissez, mais n’éteignez pas ces lampes vigilantes. Témoins muets des mystères de la nuit, elles n’en révèlent rien au jour. »
Et les époux sont conduits à la maison nuptiale au son des chants d’hymen :
« Ô Hymen ! ô Hyménée !
Vous aurez une jolie maison, pas de soucis et de bonnes figues. Ô Hymen ! ô Hyménée !
Ô Hymen ! ô Hyménée !
Le fiancé en a une grande et grosse ; la fiancée en a une bien douce. »
Avant d’entrer dans la chambre nuptiale, l’épousée devait manger un coing, fruit qui passait pour le symbole de la fécondité. Sous ces auspices d’une heureuse précision, elle allait à sa besogne de reproductrice.
Les époux sont enfermés, solus cum sola, et l’esclave cubiculaire se retire, emportant dans une cassette la chaussure de la mariée et veillant toute la nuit à la porte. Mais la chambre nuptiale, vide de témoins, est remplie d’une foule de divinités, préposées à la délicate mission de favoriser la consommation du mariage. La déesse Virginensis aide à dénouer la ceinture de l’épouse ; le dieu Subigus et la déesse Prema la couchent, la subjuguent et l’empêchent de se débattre sous les assauts impatients de l’époux ; la déesse Pertunda vient en aide au mari pour pénétrer la fosse vaginale. C’est encore Mutunus et Tutunus qu’on invoque, personnification de Priape, au membre viril énorme que devaient chevaucher les vierges, à la veille de leur initiation, pour assurer leur fécondité.
Sous tous ces auspices, l’époux accomplit les rites de la nuit de noces, chantés par Ausone dans le Centon nuptial, constitué par un ingénieux assemblage d’hémistiches empruntés au virginal Virgile.
Arrivés sous les voûtes de pierre de la chambre nuptiale, les époux se livrent en liberté à de doux entretiens : ils se rapprochent, enlacent leurs mains et se placent sur la couche. Mais Cythérée, et Junon qui préside à l’hymen, sollicitent des exploits nouveaux et les excitent à commencer des combats inconnus. L’époux échauffe la jeune fille de ses tendres caresses, et soudain embrasé de cette flamme accoutumée du lit conjugal : « Ô vierge, beauté nouvelle pour moi, gracieuse compagne, tu es enfin venue, toi mes seules délices, si longtemps attendues ! Ô douce compagne, ce n’est point sans la volonté des dieux que ce bonheur nous arrive : pourras-tu combattre un amour qui te plaît ? » Il dit, elle le regarde et détourne la tête : elle hésite, craintive, elle sent le trait qui la menace, elle tremble. Incertaine entre la peur et l’espérance, elle lui adresse ces paroles : « Par toi, par ceux qui t’ont donné la vie, ô bel enfant, je t’en conjure ; je ne te demande qu’une nuit encore, que cette seule nuit. Console une pauvre fille, aie pitié de sa prière. Je succombe, la langue me manque, mon corps ne trouve plus sa force accoutumée, ma voix et mes paroles expirent. » Mais lui : « Ce sont là de vains prétextes et d’inutiles détours ! » et il renverse tous les obstacles et brise les liens de la pudeur.
Jusqu’ici, pour me faire entendre des chastes oreilles, j’ai voilé ces mystères de circonlocutions et de mots détournés. Mais comme la solennité du mariage aime les fescennins, et que cette fête, connue par l’antiquité de son institution, admet la licence dans les paroles, je vais révéler les autres secrets de la chambre et du lit, et je les tirerai du même auteur, afin d’avoir deux fois à rougir, en faisant ainsi de Virgile un libertin. Vous, si vous le voulez, suspendez ici votre lecture et laissez le reste au curieux.
« Ils se rapprochent, seuls et dans l’ombre de la nuit. Vénus leur donne de l’ardeur ; ils essayent des combats nouveaux pour eux. Il se lève roidi : elle s’efforce en vain de lui résister : il s’attache à ses joues, à ses lèvres, et tout brûlant, du pied lui presse le pied. Mais le traître vise plus haut. Une verge se dérobait sous son vêtement, la tête nue et rouge comme le vermillon, comme la baie sanglante de l’hièble. Quand leurs pieds sont entrelacés, il tire de sa cuisse ce monstre horrible, informe, démesuré, privé de la vue, et se jette avec feu sur sa tremblante victime. Dans un réduit où mène un étroit sentier, s’ouvre une fente chaude et luisante : de ses profondeurs s’exhale une vapeur impure ; nul homme chaste ne doit pénétrer dans ce coupable lieu. C’est une caverne horrible, un gouffre ténébreux qui vomit des exhalaisons dont l’odeur blesse les narines. Le jeune héros s’y porte par des routes connues, et, pesant sur le ventre et rassemblant ses forces, il y plonge sa javeline noueuse et d’une dure écorce. Elle s’y enfonce et s’abreuve à longs traits d’un sang virginal. Les cavités retentirent et les cavernes rendirent un long gémissement. Elle, d’une main mourante, veut arracher le trait ; mais, à travers les os pénétrant les chairs vives, le dard se fixe dans la blessure. Trois fois avec effort elle se soulève appuyée sur le coude, trois fois elle retombe sur sa couche. Lui, rien ne l’émeut, rien ne l’étonne : il ne connaît ni trêve ni repos : il s’acharne, tient ferme, et n’abandonne jamais son clou. Les yeux tournés vers le ciel, il va et revient dans ce ventre qu’il ébranle, il perce les côtes et les meurtrit de sa dent d’ivoire. Bientôt enfin ils arrivent tous deux au bout de la carrière : fatigués, ils atteignent le but. Leur haleine pressée agite leurs flancs et leurs lèvres arides, la sueur ruisselle de leurs membres. Le héros se pâme et succombe : de l’engin le virus découle. »
La jeune épousée ne sera, malgré tout, que l’intendante de la maison de son mari, la mère des enfants qu’elle lui donnera. Si elle est stérile, elle doit être répudiée comme inutile, et, dans tous les cas, supporter à côté d’elle la concubine qui apportera quelque variété dans le geste d’amour, assurera l’intérim pendant les grossesses.
Pour elle, d’après le règlement solonien, le mari lui doit au moins trois preuves d’amour conjugal par mois. Et si un mari impuissant a épousé une riche héritière, celle-ci pourra solliciter le baiser d’un des parents de son mari, à son choix.
Plutarque ajoute à ce code un peu sec des préceptes plus tendres :
On demandait à une jeune Lacédémonienne si elle s’était approchée de son mari : « Non, répondit-elle, mais il s’est approché de moi. » C’est ainsi que devra se conduire une épouse pudique ; ne fuyant ni ne recevant d’un air morose les avances de son mari, jamais non plus elle ne les provoquera. L’une se sent de la courtisane effrontée, l’autre manque de grâce et d’amour et devient une preuve d’indifférence ou de dédain.
Partout et toujours il faut que les époux évitent de s’offenser ; mais ils le doivent surtout lorsqu’ils reposent ensemble sur l’oreiller ; car il serait difficile de trouver le temps et le lieu où puissent s’apaiser les discordes, les querelles et les colères qui naîtraient dans cet asile du repos et de la tendresse.
Saint et respecté doit être l’acte mystérieux qui, comme le labourage pour la terre, est l’origine de la fécondité conjugale, dont la naissance des enfants est le but et la fin naturelle. En raison de son caractère sacré, l’homme et la femme unis par le mariage ne doivent s’approcher que religieusement et sagement de cette source de la vie, et il n’est pas pour eux de devoir plus impérieux que de s’abstenir de toute conjonction illicite, de regarder comme un crime toute tentative de n’en recueillir aucun fruit, ou de se laisser aller, quand ce fruit est produit, à en rougir ou à le cacher. »
Plus brutalement le Romain dira à sa femme : « Laisse-moi satisfaire mes désirs sur d’autres femmes ; le nom d’épouse est un titre de dignité et non de plaisir. »
Et Pétrone, non sans aigreur, ajoutera : « On doit aimer son épouse comme un revenu légitime ; et je ne voudrais pas être condamné à n’aimer que mon revenu. » D’ailleurs, les femmes n’y mettent guère plus de pudeur, puisque Sénèque s’écrie avec indignation : « Qui aurait aujourd’hui aucune honte de l’adultère, depuis qu’on en est venu au point que nulle femme ne prend un mari que pour piquer un amant ! La chasteté n’est plus qu’une preuve de laideur. Quelle est la femme assez misérable, assez repoussante pour se contenter d’une seule paire d’amants, qui n’ait ses heures pour chacun, sans que le jour lui suffise pour tous, qu’on ne voit en litière chez l’un, au lit chez l’autre ? Il n’y a qu’une niaise et une femme du vieux temps qui ne sache pas que l’adultère avec un seul est appelé mariage.
Quelle femme rougit aujourd’hui d’être répudiée, depuis qu’il se trouve des matrones nobles et illustres qui comptent leurs années, non par le nombre des consuls, mais par celui de leurs maris, qui divorcent pour se marier, se marient pour divorcer ? On a redouté ce scandale aussi longtemps qu’il a été rare ; mais depuis qu’aucune de nos audiences ne se passe sans un divorce, à force d’en entendre parler, on a appris à en user. »
Mais qu’avons-nous parlé de pudeur ? Gardons-nous de donner à ce mot le sens restrictif et prohibitif que nos mœurs lui ont assigné ; n’oublions pas qu’il s’agit d’un peuple trop près encore de la nature pour considérer déjà l’instinct sexuel comme chose honteuse et qui, loin d’attacher une idée libertine à la représentation de l’organe de la génération, lui donne la plus haute signification symbolique.
Et c’est ainsi qu’un grave philosophe épicurien, étudiant un long et superbe poème de la Nature, a consacré quelques pages remarquables à l’examen philosophique du baiser charnel, de l’attraction sexuelle :
Quand les premiers feux de l’adolescence pétillent dans les cœurs des jeunes gens ; quand la nature a mûri dans leurs jeunes membres le suc générateur, les simulacres émanés en foule de tous les corps brillants de fraîcheur et de beauté, les poursuivent, irritent leurs désirs, le nectar de l’amour bouillonne, franchit sa limite et leurs vêtements sont inondés de flots voluptueux.
Oui, ce n’est qu’au temps où l’adolescence a développé nos corps que le fluide créateur abonde et s’épanche. Chacun de nos organes est excité par la sympathie des objets qui l’entourent : l’organe des plaisirs n’est enflammé que par les formes humaines. Dès que le nectar fécond, échappé de ses réservoirs, se répand dans les membres, se précipite vers les conduits destinés à son cours, et abreuve le siège même de la volupté : soudain les vaisseaux tendus se gonflent à la fois ; irrités, ils demandent à s’épancher. Le désir a fait son choix et s’élance ardemment sur l’auteur de sa brûlante blessure : une guerre active, un combat amoureux s’allume ; les coups répondent aux coups ; on s’approche, on frémit, des pleurs coulent, un ennemi succombe, et le vainqueur téméraire ensanglante sa lubrique victoire.
Ainsi, lorsque Vénus nous a blessés de ses traits, soit en empruntant les charmes d’un adolescent, soit en faisant briller la volupté sur le corps ravissant d’une femme, notre cœur s’élance à son tour vers l’objet d’où le coup est parti, il veut s’unir à lui et l’inonder de flots amoureux. Voilà Vénus ! voilà l’origine de ce nom d’amour et la source de cette suave rosée, qui filtre goutte à goutte au fond du cœur enivré de délices et devient bientôt un océan de douleurs. Car si l’objet aimé est absent, son image assiège, captive notre âme et son doux nom résonne sans cesse à notre oreille.
Ah ! fuyons ces simulacres dangereux : écartons loin de nous les perfides aliments de l’amour, appelons d’autres idées dans notre âme. Qu’un heureux partage ne nous laisse point épancher tous les flots du plaisir sur un unique objet et bannisse ainsi les tourments d’une exclusive ardeur. La plaie de l’amour vit et se creuse dès qu’on la nourrit : sa fureur est toujours croissante et féconde en tourments ; elle s’embrase sans cesse, si par une nouvelle blessure chaque blessure remplacée ne s’affaiblit tour à tour ; si une tendresse volage n’efface la première trace du mal et ne donne un nouvel aliment aux caprices du cœur.
Mais, en réprimant l’amour, se prive-t-on des doux fruits de la volupté ? Ah ! plutôt on recueille ses charmes en évitant ses peines : la volupté est le partage de l’esprit libre et ferme et fuit ces forcenés dont les ardeurs flottent incertaines ; qui, dans l’ivresse de l’amour, ne savent quels attraits ils doivent livrer à l’avidité de leurs mains et de leurs regards ; qui, dans l’étreinte de leur fureur lubrique, semblent courroucés, fatiguent l’objet de leur désir, et, d’une dent frémissante, impriment sur la lèvre des baisers douloureux. Non, leur volupté n’est pas pure ; ils sont irrités, par des aiguillons secrets, contre l’auteur de cette ardeur frénétique : mais Vénus amortit le trait dans le sanctuaire du plaisir et répand sur la blessure le doux nectar de la volupté.
Oui, l’insatiable amant espère qu’à la source même de sa brûlante ardeur il pourra en éteindre la flamme ; mais la nature répugne à des résultats si opposés. L’amour est l’unique désir qui s’irrite par la jouissance. La faim et la soif s’apaisent aisément parce que les breuvages et les sucs des aliments se distribuent dans nos membres et font partie d’eux-mêmes ; mais un visage charmant, un teint brillant de fraîcheur n’introduisent en nous que de légers simulacres, qu’un stérile espoir soudain emporté par le vent. Tel, dans le sommeil, un homme consumé par la soif cherche vainement Tonde qui peut éteindre l’ardeur de son sein ; il tend ses lèvres avides au simulacre d’un limpide ruisseau, il s’épuise en vains efforts et succombe, dévoré par la soif au milieu de cette onde trompeuse. Ainsi, par de fugitifs simulacres, Vénus se joue des amants ; l’aspect des formes enchanteresses les embrase et ne les rassasie pas ; leurs mains avides parcourent les plus secrets appas, et, sans pouvoir en détacher la moindre portion, elles errent incertaines sur un corps voluptueux.
Et lorsque, dans la fleur de l’âge, deux amants réunis frémissent aux brûlants accès du plaisir, lorsque Vénus, descendue dans leurs corps, va semer le champ de la maternité, leurs membres s’entrelacent ; sur leurs lèvres humides, que presse une dent amoureuse, leurs âmes se cherchent et se confondent. Mais la nature ne permet pas cette intime fusion : leurs corps, l’un dans l’autre, ne peuvent se fondre tout entiers. Car tel est le but de leurs ardents efforts, tant Vénus les enlace étroitement, tandis que leurs membres palpitant au choc brûlant du plaisir se résolvent en sucs voluptueux ; enfin, quand l’amour a rompu la barrière de ses flots jaillissants, sa violente ardeur se calme un moment, mais elle se rallume avec une fureur insatiable, toujours trompée dans son but, elle ne peut trouver aucun moyen de triompher de son mal : les amants dans leur incertitude sont consumés par une secrète blessure.
Ajoutez à ces tourments la fatigue du vice ; ajoutez une vie courbée sous un joug ignominieux, une fortune détruite, la dette rongeuse, les devoirs oubliés, un honneur malade et chancelant. On prodigue les parfums, on fait briller à ses pieds l’élégante chaussure de Sicyone ; les émeraudes les plus grandes et du vert le plus éclatant sont enchâssées dans l’or, et les tissus les plus précieux prodigués dans les joutes du plaisir, s’usent en étanchant la sueur amoureuse. Les voluptueux convertissent les biens de leurs ancêtres en voiles, en ornements, en meubles somptueux ; ils les transforment en parures de débauches, de festins et de jeux, ils respirent de suaves parfums, ils se parent de guirlandes et de couronnes ; mais du milieu même de la source des plaisirs surgit l’amertume, et l’épine déchirante sort du sein brillant des fleurs. Soit que le remords crie au fond du cœur et leur reproche des jours oisifs et honteusement perdus ; soit qu’un mot équivoque, échappant de la bouche d’une amante comme un trait déchirant, pénètre dans leur âme et s’y conserve pareil au feu qui s’accroît sous la cendre ; soit que la défiance jalouse épie dans les regards distraits un éclair pour un rival, ou surprenne sur des lèvres trompeuses un souris ironique.
Ah ! si tant de peines accompagnent l’amour fortuné, les innombrables tourments d’un amour sans succès ne frappent-ils point tous les yeux ? Il faut donc, je le répète, veiller sur soi-même, réfréner ses désirs et se prémunir contre les pièges de l’Amour. Car il est plus aisé de les éviter que de s’en affranchir quand ils nous ont captivés, et de rompre les chaînes dont Vénus nous accable.
Quoique enlacé dans le piège fatal, l’homme pourrait encore s’y soustraire si lui-même n’y précipitait ses pas, s’il ne fermait les yeux sur les vices de l’âme et du corps de l’objet qui l’asservit. L’aveugle délire des amants enfante des perfections imaginaires ; leur cœur séduit transforme en beautés, en vertus, les difformités et les vices. En vain ils se prodiguent une mutuelle et mordante ironie, ils se conseillent alternativement de conjurer Vénus de les affranchir de leurs nœuds avilissants, et le plus implacable censeur ne voit pas que lui-même est le plus coupable. Chacun embellit les défauts de son idole. La noire est une brune piquante. L’immonde négligente dédaigne la parure. La louche est l’image de Pallas. La maigre, aux nerfs vaillants, une biche légère. La petite, la naine, l’une des Grâces, une beauté, une perfection sans mélange. La taille colossale, sans altération, a de la noblesse et de la dignité. Celle qui balbutie des mots inachevés, c’est la modestie qui bégaie. La muette est la pudeur même. La querelleuse, ardente et loquace, est une flamme qui pétille sans cesse. Une maigreur qui semble ne plus appartenir à la vie offre les traces d’un brûlant amour. Celle dont la toux est mortelle devient une beauté languissante. D’énormes mamelles sont les appas de l’amante de Bacchus. Le nez court promet la volupté. La lèvre épaissie appelle le baiser. Mais où m’arrêter, si je tentais de retracer toutes les illusions de l’amour ?
Eh bien, j’y consens : ton amante mérite les éloges de ta bouche. Tout son corps voluptueux exerce la puissance des attraits de Vénus ; mais n’en est-il pas d’autres aussi parfaites, et tes jours coulaient-ils sans charmes avant de la connaître ? Oublies-tu que, comme la plus difforme, elle subit les infirmités de la vie ; que souvent, son souffle corrompu l’infecte elle-même, et que ses suivantes s’échappent pour exhaler loin d’elle leur rire satirique ?
Cependant, l’amant à qui sa demeure est interdite vient suspendre des guirlandes de fleurs sur sa porte dédaigneuse : il y brûle des parfums, et, plaintif, il imprime ses baisers sur le seuil ; mais s’il parvient à le franchir, l’illusion s’évanouit : l’air qu’il respire blesse ses sens, il médite une adroite retraite ; soudain, il oublie ses plaintes amoureuses méditées si longtemps, il s’accuse de folie et ne conçoit pas comment il supposait à la faiblesse humaine ces perfections que la nature ne lui départit pas. Aussi les prêtresses des amours ne s’abusent point : aux amants qu’elles veulent attirer dans leurs chaînes, elles cachent avec art les arrière-scènes de la vie ; mais l’imagination porte sa clarté dans ces mystères ; active, elle en pénètre les plus profonds secrets. Tandis que la femme, dont l’esprit est facile et complaisant, vous permet elle-même d’acquitter les tributs que l’humanité vous impose.
Oui, les soupirs d’une femme sont quelquefois exempts de feinte, lorsque, pressant contre son sein le sein de son amant, elle l’étreint avec ivresse ; lorsque, sur la bouche qu’elle aime, ses lèvres humides s’abreuvent de volupté : son ardeur est sincère ; heureuse de faire partager à son amant le plaisir qu’elle éprouve, elle l’excite à fournir la course à l’amour. C’est ainsi que la femelle des légers oiseaux, des monstres féroces, des troupeaux et du fier coursier succombe avec docilité aux ardeurs de son époux ; car le bouillonnement du désir livre un sexe timide à la douce réaction des ébats amoureux.
Ne vois-tu pas les êtres unis par une mutuelle ardeur, tourmentés en secret dans leurs communs liens ? Vois ces chiens lascifs, au détour des chemins ; par des efforts opposés, ils tentent de se désunir, mais ils resserrent encore les liens plus puissants de l’amour. En serait-il ainsi sans l’attrait impérieux d’un plaisir mutuel, qui les précipite dans le piège et les retient captifs ? Il faut donc l’avouer, tous les sexes ont une part commune à la volupté.