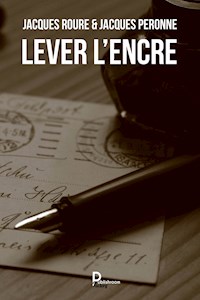Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Publishroom
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Französisch
Avec une enfance marquée par les guerres mondiales, Albert Ducreux s'engage à vivre libre, suivant ses propres désirs et ses propres rêves.
Dans un style alerte et réjouissant, Albert Ducreux vous conte combien nos souvenirs sont nos plus belles richesses, lorsque Le passé se lève à l’aube.
Albert Ducreux suit les traces de son auteur, avec tendresse, humour et insolence. Il se livre, en même temps, à une analyse critique et souvent irrévérencieuse de ces chemins, tout aussi ludiques que tortueux, qui dessinent sa vie. De son enfance durant la seconde guerre mondiale à aujourd’hui, vous suivez les péripéties détonantes, qui le mènent à quitter une vie certaine de neuropsychiatre, pour l’univers redoutable du spectacle.
D’Hippocrate, où la médecine et la psychiatrie de cette époque le confronte à des pratiques devenues aujourd’hui dérisoires et parfois redoutables, à Pagnol, Lacan, Béjart, Reggiani et bien d’autres, il parsème son récit d’anecdotes et de confidences.
Découvrez ce récit de vie captivant, qui traverse les multiples périodes du XXe siècle : des années sombres marquées par la guerre aux années folles et au succès de la chanson française et de ses icônes. Une vraie immersion dans la culture et l'histoire de France !
EXTRAIT
Allez savoir pourquoi, je suis arrivé le premier à la porte de l'ovule. Il en faut de la chance pour un jour exister. La chance d'un spermatozoïde sur cinq milliards. Dans la fusion intime de mes parents, ce jour-là, le destin m'avait souri. A partir de là et jusqu'à ma naissance, rien dans ma mémoire. Même en fouillant dans les méandres d'un inconscient prénatal, il ne m'est apparu aucune image aquatique. Je devais donc sortir par là même où j'étais rentré neuf mois plus tôt. Il y avait dehors de la lumière. Je suis arrivé dans le monde des êtres à respiration pulmonaire. Un premier cri annonça le déploiement de mes alvéoles, une première grimace pour regretter déjà la chaleur humide et aqueuse de l'aquarium abandonné. Deux couilles, une toute petite bite, permirent à l'entourage médicogynécologique d'affirmer :
-C'est un garçon.
-Vous allez l'appeler comment ?
-Albert.
Le sort en était jeté.
A PROPOS DE L'AUTEUR
Jacques Roure est né en 1938. Après avoir exercé la profession de neuropsychiatre et psychanalyste, il crée à Aix-en-Provence le théâtre de la Fonderie. Comédien et metteur en scène, il s’oriente en même temps vers l’écriture de chansons pour de nombreuses personnalités.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 412
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jacques Roure
Le passé se lève à l’aube
Roman
À Colette
Du temps que j’étais écolier
Je restais un soir à veiller
Dans notre salle solitaire
Devant ma table vint s’asseoir
Un pauvre enfant vêtu de noir
Qui me ressemblait comme un frère
Alfred de Musset
Préface
« Si les mots justes vous font peur ne lisez pas ce livre ! Mais si vous aimez la vie, sa violence et sa poésie, alors mettez vos pas dans ceux d’Albert Ducreux. Suivez-le sur le chemin accidenté d’une existence où le subtil côtoie le trivial, où les rencontres abondent, si disparates et si riches, jalonnant une trajectoire peu commune. De l’oral au phallique jusqu’à la sublimation, ne craignez pas de franchir avec lui, une à une, ces étapes semblables aux stades du développement psychique décrits par le père de la psychanalyse, sans éviter celui auquel la littérature a laissé peu de place : le stade anal. En France, dit-on, tout se termine par des chansons, il en est de même pour le parcours d’Albert Ducreux: c’est pourquoi, arrivé au dernier chapitre, vous aurez le sentiment d’avoir visité le « Musée d’Athènes », chanson chère au cœur de la communauté des carabins à laquelle l’auteur a appartenu et faute d’y avoir croisé la femme d’Hercule ou le père Platon, c’est Freud, Lacan, Béjart, Brel ou Reggiani qui seront venus à votre rencontre dans cet impertinent, joyeux et si riche maelstrom… le tourbillon de la vie ! »
Philippe Grimbert
1
L’aube. Le soleil se lève et des milliards de culs se lèvent aussi.
La vie matinale tourne autour d’un orifice. On va commencer la journée en mettant déjà un peu sa merde. Les toilettes se ferment de l’intérieur, se referment sur notre moi-même, concentré sur une seule chose, l’exonération.
Quel bonheur ! D’abord péter plusieurs fois, sèchement. Obligatoire. Puis un vent continu et moins bruyant et derrière ce dernier cri le premier excrément, un peu sec, qui a passé la nuit dans le rectum. Enfin des choses plus fines et plus molles amenant une tout autre odeur.
Drôle d’aube. Un jour nouveau commence dans le parfum de décomposition de la matière. On s’essuie, on se lève, on scrute l’intérieur de la cuvette. Le petit bouton pressé, au-dessus du réservoir, libère le flot sonore de l’eau longtemps retenue. Un coup de balai pour enlever les traces colorées sur la porcelaine. Un peu de liquide bleu pour traquer les microbes. Enfin un coup de bombe pour masquer ce mélange d’odeurs que même, en été, la fenêtre ouverte ne parvient pas à laisser s’enfuir.
Belle journée. Je viens de dire bonjour à la vie.
Je m’appelle Albert Ducreux. On s’en souvient facilement. D’abord, à l’école :
–Vous, Ducreux, par exemple, qui portez bien votre nom, vous pourriez répéter ce que je viens de dire ?
Il avait fait de l’esprit, le con. Il s’appelait Archibald Matamore. Avec son nom, j’aurais aussi fermé ma gueule. Les coliques ont commencé à cette époque. J’avais sept ans. Je restais de longues minutes à écouter le lent cheminement d’une douleur, d’abord sourde puis brûlante progressant le long de mes boyaux. Je contractais longtemps l’ultime orifice. Je savais qu’à l’intérieur, il n’y avait rien de consistant. Je levais le doigt.
–M’sieur, M’sieur, je peux sortir ?
Il me regardait de son œil torve. J’avais l’impression qu’il lisait au travers de mon corps le conflit noué entre le petit déjeuner du matin et mes tripes.
–Vous attendrez l’heure de la récréation.
Le sort en était jeté. J’allais une fois de plus me chier dessus. Liquide puant, traversant d’abord ma culotte « Petit Bateau » puis imbibant le tissu laineux de mon pantalon. Je pleurais.
Le programme suivant était écrit d’avance. Mon plus proche voisin se pinçait le nez en hurlant :
–M’sieur, m’sieur, ça pue, ça pue.
Toute la classe sur l’air du pin-pon des pompiers reprenait en chœur « ça pue, ça pue ». Honteux et merdeux je me levais pour suivre la direction du doigt vengeur de Matamore qui m’indiquait la porte.
Ah ! Cette cour de récréation. Je la retrouvais avec bonheur. Une rangée de petits cabinets, presque clos par une demi-porte laissant passer vers le bas une souveraine aération. Nettoyés le matin, ils sentaient encore l’eau de Javel. Je pouvais enlever les chaussures pour baisser mon pantalon. Les dégâts n’étaient pas irréparables. Je retirais le slip par la même occasion et les deux pieds posés sur le bord de la cuvette à la turque, je poussais. Après les quelques pets habituels, tout le flot de mon dérangement venait tigrer le réceptacle. De la joie. Je baissais un peu la tête pour regarder entre mes jambes et humer les effluves de ma liberté retrouvée.
Qu’elle sent bon notre propre merde ! J’avais, pour moi, à cet instant, un amour quelque peu excessif. La vie tournait bien autour du trou du cul.
Toutes ces manifestations ont commencé, le jour de ma naissance, en 1938, cet âge où l’innocence est encore un vêtement relativement pur et trop large pour être souillé par les questions existentielles. Bien sûr, ne sont présents, qu’à l’état de souvenirs racontés, les premiers résultats de l’absorption des « blédines » et des laitages. Les premières expulsions sont vécues, par un entourage admiratif, comme des cadeaux :
–Oh ! Il a dû nous faire encore un beau caca. Viens, mon amour, je vais te changer.
Nous voilà, le cul à l’air. On se laisse tranquillement décoller d’une paire de fesses un peu rougies la garniture, qui dans l’instant d’avant faisait doubler l’importance de notre arrière-train. Premiers émois sensuels dans ce tripatouillage tiède. Que de précautions prises sur cette table à langer, table à démerder, à contempler la couleur, la consistance de ces matières fécales.
–Qu’elles sont belles. Tu nous as fait un beau caca.
Cette nauséabonde constatation finit dans la poubelle refermée précipitamment pour que le chien, si l’on n’y prend pas garde, ne cherche à en bouffer une partie.
Un nouvel emballage vient clore l’incident jusqu’à ce que la prochaine tétée ne reconstitue, après une digestion plus ou moins longue, le contingent suivant. Pipi, caca. Ça va nous faire des souvenirs pour chaque jour de notre vie.
Allez savoir pourquoi, je suis arrivé le premier à la porte de l’ovule. Il en faut de la chance pour un jour exister. La chance d’un spermatozoïde sur cinq milliards. Dans la fusion intime de mes parents, ce jour-là, le destin m’avait souri. À partir de là et jusqu’à ma naissance, rien dans ma mémoire. Même en fouillant bien les méandres d’un inconscient prénatal, il ne m’est apparu aucune image aquatique.
Je devais donc sortir par là même où j’étais entré neuf mois plus tôt. Il y avait dehors de la lumière. Je suis arrivé dans le monde des êtres à respiration pulmonaire. Un premier cri annonça le déploiement de mes alvéoles, une première grimace pour regretter déjà la chaleur humide et aqueuse de l’aquarium abandonné. Deux couilles, une toute petite bite, permirent à l’entourage médico-gynécologique d’affirmer :
–C’est un garçon.
–Et vous allez l’appeler comment ?
–Albert.
Le sort en était jeté.
Je n’eus conscience, que beaucoup plus tard, du fonctionnement de cette usine à merde. J’ai très tôt pensé au magma plus ou moins compact, transitant journellement dans nos conduites intérieures. À un moment ou un autre il devait être expulsé. J’imaginais le poids et l’importance d’un individu, normalement constitué, accumulant, au fil des jours les tonnes d’excréments métabolisés par notre usine interne.
J’ai assez vite trouvé merveilleux le fonctionnement de cette cuisine invisible, gérée par des millions et des millions de bacilles, tous plus difficiles les uns que les autres, à identifier et demeurant « troglodytement » parlant dans notre monde secret.
Je me suis rapidement contemplé, comme un entrelacs de tuyaux et de réservoirs, constituant une incroyable usine à trier, détruire, digérer, métaboliser le monde extérieur.
Et puis, ces chevauchées avançant tantôt tranquillement, coulant des jours paisibles jusqu’à la dissolution finale. Lovées, benoîtement, dans toute la largeur des conduits, avant de s’échapper, au cours de poussées successives et vigoureuses, pour terminer leur route, par un ploc, humidifiant délicatement la partie postérieure de notre corps, avachi sur la lunette. Parfois serpentant, tel un ruisselet de printemps, dans un gargouillis à peine perceptible, et venant éclabousser, d’un seul coup la cuvette, comme un orage d’été.
Et cette aube toujours recommencée autour de ces préoccupations matinales.
Que de pensées nous assaillent, à nouveau, sur ce siège occupant la partie proximale de notre réveil.
Voyons, que vais-je faire de cette journée. D’abord ce rendez-vous avec la porte du collège. Vais-je encore entendre, à peine le cul posé sur le petit banc de ma classe :
–Voyons, voyons, Monsieur Albert Ducreux si vous êtes ce matin dans de bonnes dispositions.
Mais ce matin-là, triomphant de mon habituelle constipation j’avais déjà accompli cet acte de première nécessité. Archibald Matamore pouvait toujours essayer de me faire chier.
En 1938, j’étais un produit d’avant-guerre. Quand elle arriva, j’avais six ans, l’âge des premiers souvenirs, me permettant d’emmagasiner des images et des sons, pour mieux comprendre, les bouleversements provoqués par les forces alliées, débarquant sur notre sol. La guerre a toujours envoyé au front des soldats assez jeunes. Mieux vaut mourir avec peu de souvenirs. On n’a pas encore, à ce moment-là le temps de regretter beaucoup la vie. Par la même occasion, elle faisait entrer à l’école, des élèves au sortir des langes. Ça permettait de compter et de recompter une population en voie de devenir. Si le conflit durait, celle-ci viendrait grossir, à son heure, le peuple de la relève. On faisait, à cette époque, pas mal d’enfants.
–Vous savez, on en perd toujours un ou deux à la guerre.
Comme s’il était plus facile, avec le nombre, d’oublier les absents. Étant resté petit assez longtemps, j’eus le bonheur de connaître la fin des hostilités, dans une relative indifférence.
Tout marchait bien pendant le conflit. On devait manger quand même pas mal, malgré les restrictions, car mes évacuations quotidiennes demeuraient stables.
À l’avant, dans les troupes, il y avait d’autres évacuations, appelées, pudiquement, sanitaires. Toujours le sanitaire en place, pour récupérer les restes transformés, par ces suppositoires d’acier, des victimes de ces combats.
Drôle de genre que le genre humain. Méchant comme une teigne, si on lui en donne l’ordre. Prêt à créer quelques trous de balle supplémentaires, dans un buffet garni de rata, sans lui laisser le temps de terminer son parcours.
Bref, tout ça pour vous dire que j’étais heureux. Les jours avaient le même nombre d’heures, de minutes, de secondes. Les saisons ressemblaient à des saisons. Les maisons ne ressemblaient déjà plus, dans certains endroits à des maisons. Le toit manquait à l’appel.
Les étés demeuraient beaux à la campagne. On labourait les champs. On y semait de l’orge et des pois chiches. On tuait le cochon à l’automne et on finissait par tout lui bouffer. Là, les tripes, servaient à quelque chose de plus. Emballer le sang coagulé par une dose de vinaigre finissant en boudin, créer des serpentins de saucisses et produire de quoi assurer le remplissage de nos tubes digestifs. Ils allaient avoir, malgré tout, la satisfaction de pouvoir continuer à déjectionner.
L’école, ce n’était pas de la rigolade, à partir de quatre ans on te mettait à la maternelle. Tu y restais toute la semaine, samedi compris. On te cousait, l’hiver, les gants aux manches du manteau, pour pas que tu les perdes. Des gens heureux de nous accueillir. On les écoutait avec respect et tendresse. Six ans, pas vieux ! Mais j’ai quand même gardé au fond de ma mémoire ces feuilles de mûrier, cueillies dans la cour de récréation, pour nourrir les vers à soie, bien à l’abri dans une boîte en carton. On avait plus qu’à attendre que la chenille s’entortille et voir sortir, devant nos yeux émerveillés, le papillon.
Et le spectacle de fin d’année où, dans la crèche vivante, sur les planches de notre petite salle de spectacle, j’avais tenu le rôle de l’enfant Jésus, avec en première partie un drame amoureux torride « Aucassin et Nicolette », entre un enfant de Beaucaire et une esclave sarrasine. Drame de sang, de soufre et d’amour, à faire basculer dans le stupre les demoiselles du Pensionnat, dont certaines n’avaient encore entendu le loup péter sur la pierre du bois. J’avais compris « mocassin » et fus déçu de ne pas voir apparaître les Indiens. La guerre avait dû les laisser enfermés dans leur réserve.
Elle est belle l’enfance. On allait pisser tout seul. Pour le reste, c’était un peu plus compliqué. On ne savait pas encore s’essuyer. Il restait, sur le fond de la culotte, de petites traces de caca.
Le papier n’était pas très hygiénique. Des dames devaient certainement nous torcher les fesses avec des feuilles de journaux, découpées en petits carrés. Il demeurait tatoué sur la tendre peau de notre postérieur, imprimé à l’envers, d’abord, la dernière offensive des Allemands sur le front de l’est et plus tard le débarquement allié sur les plages de Normandie. J’ai dû prendre à ce moment-là le goût de l’Histoire.
Ma maîtresse, mademoiselle Blondie avait des lunettes. Elle m’a dès le premier abord paru constipée. Lèvres étroites, une robe noire à pois blancs, serrée à la taille, comme pour empêcher le contenu de son abdomen de remonter par mégarde au-dessus de la ligne de flottaison. Elle avait mauvaise haleine. Elle suçait à longueur de journée des pastilles à la menthe et à la saccharine en oubliant évidemment de nous en offrir. Ses retenues intestinales se traduisaient dans le quotidien par la même avarice. Elle prenait délicatement au fond d’un cartable en carton un bonbon, sans jamais sortir la boîte et tout en toussant légèrement elle plaçait son pouce et son index devant la petite fente qui lui tenait lieu de bouche. Elle enfournait, s’imaginant ne pas être vue, la gourmandise à travers le petit trou laissé par le manque de deux dents sur le côté droit de sa mâchoire. Quelques instants après, elle pouvait se remettre à parler. Nous percevions tout de suite un changement d’effluves dans l’atmosphère de la classe. Pendant longtemps j’ai cru que l’odeur de cette haleine venait du fait qu’elle ne devait jamais péter. J’imaginais qu’elle avait entre les fesses, à force d’oublier d’aller au petit coin, une sorte de soudure. Une cicatrice en quelque sorte due au non fonctionnement de son orifice naturel. On l’avait surnommée : Cul Pincé. Ne connaissant pas encore l’autre orifice en avant de cette voie naturelle j’avais décidé, une fois pour toutes, qu’elle ne devait plus, grâce à cette mutation anatomique, porter de culotte.
J’essayais en vain de percer ce mystère en laissant rouler jusqu’au pied de l’estrade un crayon, à l’aplomb de la table pour jeter un coup d’œil entre ses deux chaussures et en remontant le long de ses bas de laine, l’obstruction définitive de cette voie. La nuit était trop profonde. Au-delà des genoux : obscurité totale. Je renonçais à en savoir davantage, mais de peur d’avoir un jour un fondement aveugle, je me jurai, pour le reste des temps, de considérer les cabinets comme le passage obligatoire de chacun des matins de ma vie. Comme il fallait compter environ, chaque jour, entre quatre et sept minutes pour déposer quelques crottes, sans calculer les passages successifs des évacuations vésicales, j’en conclus être dans l’obligation de passer, pendant les soixante et quinze années suivantes, quarante-deux heures par an, dans cette entreprise. Ces trois mille cent quatre-vingt-treize heures, ne faisaient au bout du compte, que cent trente-trois jours réservés à nos besoins.
Conscient de la brièveté toute relative de cette activité, comparée à l’importance existentielle de cette fonction j’imaginai que la rareté temporelle de ces exigences, nécessitait une attention toute particulière. J’eus l’impression, en même temps, de posséder un penchant certain pour les mathématiques. J’appris, durant mes premières années d’étude, facilement la table de multiplication, les quatre opérations, les fractions. Quand vint le moment d’aborder des choses plus complexes, dont même les noms commençaient à m’effrayer, je décidai que la mathématique ne serait pas ma spécialité.
C’est en allant un matin à l’école, en observant les chiens, parsemant les rues de leurs déjections, qu’arriva l’illumination. En effet, avez-vous observé un chien en train de satisfaire sa fonction. Il hume, sent, s’arrête, plie un peu les pattes arrière, soulève sa queue, expulse le contenu de son intestin, contracte à plusieurs reprises son petit trou, gratte un peu parfois le sol comme s’il voulait recouvrir le tout puis s’en va, sans avoir été essuyé. Et pourtant le petit orifice, sitôt son action terminée, paraît propre comme un sou neuf. Je décidai de comprendre un jour l’assainissement immédiat de cette partie de son corps et de permettre aux humains de pouvoir en faire de même. J’optai, immédiatement, pour un avenir de vétérinaire pour soulager dans l’avenir le monde entier de l’emmerdement supplémentaire de se torcher le cul, ruinant en même temps les fortunes colossales accumulées par les fabricants de papiers hygiéniques. J’imaginais, par cette action révolutionnaire sauvegarder pour les oiseaux tous les perchoirs de la terre.
Je regardais les arbres d’une autre manière. Eux, savaient qu’ils pouvaient compter sur moi. Ils ne seraient plus obligés de pomper les substances nutritives contenues dans les diverses matières organiques pour voir leur tronc transformé en pâte à papier. Ils se contenteraient désormais de nous donner de l’ombre, des fleurs et des fruits. J’allais réinventer le paradis terrestre.
Nous quittions très souvent Marseille, direction la campagne. La maison de mon cœur, la bastide de Solliers, nichée aux alentours d’Aix-en-Provence. Le dîner tournait autour d’une soupe au lait dans laquelle étaient broyés des grains de blé. Une quantité suffisante pour une exonération dans les heures suivantes, en s’adaptant à l’installation sanitaire de ces lieux.
Cela se passait à la fosse. À quelques mètres de la maison, une petite bâtisse surmontée d’un grand trou, dans lequel on jetait, outre le fumier des chevaux, quelques déchets alimentaires. À travers ce trou, en soulevant le couvercle de bois, on pouvait humer des effluves mêlant la décomposition des matières animales, à l’odeur aigrelette de quelques résidus d’aliments. Sur le tas trônaient les matières plus ou moins desséchées des derniers visiteurs des lieux. Ces merdes entrecroisées dégageaient un fumet tout à fait supportable. J’allais la rafraîchir par un nouvel apport.
Je m’asseyais sur le bord de l’orifice en m’agrippant bien à la planche pour éviter de tomber dans le réceptacle. Bonheur de cet exercice de plein air. J’avais presque le temps de compter les chutes de corps devenus, au cours de cette séparation, étrangers. Nouvelle constatation de la gravitation universelle. Délice de cette fonction sans cesse renouvelée. Béatitude de rendre à la nature tout l’amour dont elle nous entourait.
Les jours suivants furent sans histoire. Les nuits constituaient des aubaines propres à satisfaire nos imaginations enfantines. Dans la chambre avec mes deux sœurs, nous étions regroupés pour veiller les uns sur les autres.
–Vous dormez ?
–Je ne dors pas.
–Si on jouait à Dodo.
–Allo Dodo, tu viens réparer la cuisinière ?
Fallait en avoir de l’imagination pour transformer un fourneau en ustensile à égayer les prémices du sommeil.
–Je viendrai demain matin.
–À quelle heure ?
–Dès que je serai réveillé. Si j’ai trouvé les pièces.
Brillante conversation qui allait faire plonger rapidement dans l’inconscience les deux tiers des participants.
–Allo Dodo…A llo Dodo…
Cette dernière question et l’absence de réponse éteignaient définitivement l’ultime velléité de dialogue.
Conscient que toute la chambrée était endormie, j’en profitais pour chasser impulsivement, de l’intérieur de mes boyaux, l’air emmagasiné dans la soirée. En un mot j’allais péter. Je cherchais d’abord, avant de passer à l’action, à imaginer l’impact sonore de mon mini-concert. Fallait savoir si l’air seul était présent à la porte. J’essayais de sentir s’il n’existait pas une interposition de matières, mêmes minimes, qui seraient entraînées par le passage des gaz. Cet instant de réflexion finit par me convaincre que l’issue était libre. Je lâchai un premier frémissement, quelque peu prolongé, une petite brise retenue par un doigt posé délicatement entre mes fesses. Tout s’était bien passé. J’humai mon index. C’était l’odeur habituelle, un mélange de fragrances de méthane mêlées à des effluves aigrelets assez concentrés. Je lui donnai d’entrée la note de huit sur dix. Je soulevai un instant le drap en l’agitant doucement de haut en bas pour me baigner de cette atmosphère. Je récidivai. Cette fois le bruit fut plus sec. Un claquement de fouet. Un coup bref suivi d’un deuxième presque imperceptible se perdant dans l’aigu. Tout s’était bien passé. Je m’endormis, tranquille, dans la voluptueuse ambiance de cette récréation odoriférante.
L’aube à nouveau. Le coq de la ferme voisine venait de chanter, posé béatement sur les déjections jonchant le poulailler. Les deux pieds dans la merde il saluait le lever du soleil. S’étant tu, je l’imaginais en train de gratter de ses petites pattes nerveuses la terre. Après deux ou trois mouvements brefs et saccadés de la tête il plongeait à différentes reprises son bec dans le sol entrouvert, picorant les résidus alimentaires et les vers qui leur tenaient compagnie. Sa viande allait se gorger de ces déchets organiques qui, mêlés à quelques grains d’orge, allaient donner à ce volatile le bon goût du poulet de ferme. Solide et bien en chair il viendrait, un dimanche, améliorer l’ordinaire.
Cette période militaire et campagnarde donnait aussi aux fraises des saveurs exceptionnelles. Les engrais demeurant naturels, le fermier, le père Bagnis, avait l’habitude de les arroser une fois par semaine du jus délié de la tinette, seau dit hygiénique, servant à ses exonérations nocturnes. Au matin, après avoir tiré de l’eau du puits, il délayait délicatement l’urine et les matières fécales pour obtenir une substance assez liquide. Il écrasait les deux ou trois étrons dont le délitement allait constituer la nourriture azotée de ces fruits encore verts.
–Il n’en faut pas trop, disait-il, car c’est assez fort.
Si l’enfance est bénie, la mienne était sereine. J’y puisais des lueurs et des ombres, des sentiments dans la lumière des regards, des émois dans la nature, colorée par la tendresse des miens. Papa, debout de bonne heure, allumait sa première cigarette pour couvrir l’odeur de l’ersatz de café, composé d’orge grillé. On partageait avec les poules cet agrainage quotidien, mais torréfié. On échangeait les premières tendresses. Je présentais chaque fois un endroit différent de mon visage. Après maman et ma tante j’avais, collé sur ma peau, trois pastilles d’amour. Je réservais tout le reste à ma grand-mère. Je me serrais très fort contre elle, une joue après l’autre sur son visage à peine fripé, pour imprégner plus profondément les empreintes de tous ces baisers. J’avais déjà, pour la journée, du bonheur quoi qu’il arrive.
C’était la guerre et la vie passait quand même. La vie, une écluse je vous dis. Ça vous fait monter pas bien haut et ça vous emmène, finalement, jusqu’à la mer. Ne pas s’emberlificoter si le gouvernail s’étrangle. Ce n’est pas toujours vous le maître à bord. L’eau, sous le navire, était glauque. Les poissons dégueulaient des saletés. Je ne les voyais pas, ces bêtes idiotes, nager sur les fonds troubles des fureurs belliqueuses.
Si j’avais su ça, à ce moment-là, est-ce que j’aurais voulu naître ? Mais quand on a l’âge de glapir, on ne sait pas encore penser. Et plus tard on pense, va savoir à quoi ? La vie c’est pouvoir et pognon. Ces deux-là dirigent à ta place, étranglés, on essaie de vivre. La vie, ce sursis face à la mort. Joseph, il n’avait pas voulu engrosser Marie, il a laissé faire le Saint-Esprit. Il savait peut-être ! Et Jésus a fini comme une peau de lapin. Pas vieux, 33 ans, pas même un miracle pour le décrocher du panneau. Pourtant, c’était si beau, quand tout a commencé.
Alors, pourquoi : 1944 ? Une trentaine d’années après la « der des ders ». Tu savais, toi, qu’après rien, il y avait encore quelque chose ? Les neurones perdent la mémoire, comme les chênes se déplument. Des trous dans les hémisphères, dans la couche d’ozone du ciboulot. Des plages de débarquement à se fissurer sous les obus. Et déjà des morts en avance sur l’horaire, des jeunes plutôt, c’est plus fringant. La patrie ? Patatras, ça bombe le torse avant de se faire miter les éponges, raboter les fémurs, dégonder les articulations. Pantins de pantomime macabre, bidoche à décorer la nature, comme des arbres de Noël. Et des pleurs anonymes pendant que les généraux se mouchent.
Bon, on était envahi. Des cohortes armées venues prendre leur revanche sur 14-18. Des immigrés à l’assaut de la Tour Eiffel. Et nous pendant ce temps ? Putain… Pétain, que sa vie était finie et juif ou pas juif, il en avait rien à tondre. L’État c’est moi. En amont Laval, tirant sur ses clopes, aussi vide et avide que les autres, béat d’être là, président de quelque chose.
Chez nous, on ne savait pas grand-chose. On bouffait mal, à cause du rationnement ou on bouffait mieux grâce au marché noir. Mais pourquoi, les pommes de terre ne poussent pas en temps de guerre, seulement les rutabagas ? Ces tubercules, il faut aussi les planter, les arroser au jus de tinette. Rien que le nom te fait peur. Au goût c’est entre l’artichaut et le carton-pâte, mais ça tient au corps et puis quand tu as faim, tu ne regardes pas, tu ne sens pas, tu mastiques
Car la guerre… Ah ! La guerre. Saloperie de bordel de merde. Mais les chefs s’en foutent. Ils envoient sur les champs de bataille les soldats et les ambulances. Eux demeurent aux commandes dans les États-majors, toujours hors des champs de tir et l’Hitler il se l’était placé sur les hauteurs le « Kehlsteinhaus », son nid d’aigle où avec sa couille unique, il galipéttait avec l’Eva Braun. Lui a pas beaucoup fait de mal, paraît-il. L’était resté longtemps collé à sa mère, avant se faire dépuceler dans les tranchées par quelques compagnons d’armes. Il avait testé avec sa nièce Géli Raubal le sado, le maso, le scato, que la petite finira par se suicider. Cognait finalement sur tout ce qui bougeait. Seules, les éructations publiques, le faisaient bander. Qu’il s’était plaint à son médecin de ces érections gênantes pendant ses harangues. La faculté refusa d’adoucir ces pulsions, craignant de le voir perdre de la persuasion dans ses discours. Par contre ils firent valser la piquouse… Des flots de vitamines dans les veines et des amphétamines à te faire sortir, deux mille ans après, Lazare de terre. L’a fallu un Anglais pour le finir, un certain Parkinson, qui lui colla ce qu’il avait de mieux, la maladie portant son nom…
Même lui avait les préoccupations de tout un chacun : le pipi, le caca et quelques amorces sur le zizi que semble-t-il il ne maîtrisait pas terrible.
Imagine l’Adolf, cerné de fripouilles, autour d’une carte d’État-major où selon, son humeur il faisait avancer ses drapeaux, pris soudain d’une colique. Il délaisse cette compagnie de tordus, prétextant un ordre urgent à donner, pour se diriger vers les « cagouinces » et après avoir baissé son froc, il badigeonne la porcelaine des résidus de sa nourriture végétarienne. Il se torche le cul, prend soin de remonter son futal et après avoir reboutonné sa vareuse, il sort triomphal, pour aller retrouver ses « joyeux » compères et à nouveau penché sur la carte, complète ses ordres rapidement, dans la crainte de survenue brutale d’une autre alerte.
T’imagine l’Adolf dire à Goëring : « Dis, grosse enflure, je vais caguer, n’en profite pas pour de talquer le pif, car, si je te retrouve en forme à mon retour je saurai que tu viens de te faire un rail. Et les rails, ils sont réservés à Himmler pour le transport de ces tas de merde, que sont la juiverie internationale. Il aurait dit ça sans s’étrangler, à cette grosse vache, qui devait plomber les fosses de gigantesques étrons. Eh ! Oui, la saloperie, la pourriture, la trahison, la barbarie, la cruauté, la putasserie, en un mot la merde, ça existe au propre mais aussi au figuré.
Quand je me retourne sur tout ça, à soixante et quinze balais, je me demande ce qu’il me resterait sans tout ce bastringue. Peut-être des souvenirs de cache-cache, de vélo, de pique-nique, de couillonnades. On en fait, à cet âge, des couillonnades. Après aussi, mais ça ne porte plus le même nom. Un adulte ne peut pas être couillon. Enfin c’est eux qui le disent. Faut toujours laisser les grandes personnes à leurs illusions.
La guerre c’est le plus vieux truc du monde. Des siècles de déraison, d’inventions à la troue-moi-les-tripes, des gaz à te miter les éponges plus vite qu’un bacille de Koch, un gigantesque concours Lépine d’inventions à trucider. D’accord, maintenant que la vie s’étire et que les centenaires seront bientôt à la recherche d’un emploi, faudra dégager la planète pour éviter les embouteillages. Déjà à l’âge de pierre ils savaient se fracasser le crâne, même avant d’avoir taillé leurs premiers cailloux. Des sauvages, je vous dis. Depuis on a eu la civilisation mais le monde est toujours du même genre, pas plus sapiens qu’avant. Aujourd’hui, on organise, pour de délirantes raisons, des zigouilleries en tous genres. Même la paix devient dangereuse parce que là, on ne se méfie pas…
M’a fallu bien un quart de siècle pour comprendre. C’était beau pour moi quand tout a commencé.
Les guerres, ça finit toujours par finir. Trêve, armistice, patin couffin. On s’embrase puis on s’embrasse. Péril en la demeure jusqu’à épuisement des stocks de munitions. Après la paix jusqu’à la prochaine. Depuis, ça se bouscule. Il y a toujours quelque part des raisons d’aller se foutre sur la gueule. Je ne me plains pas, je suis passé à travers tout. Même « l’Algérie » ils ne m’ont pas voulu. Sursitaire, échappatoire légale. Des évènements qu’ils ont appelés cette expédition. Des évènements ! Ce qui arrive, quoi ! Dans la vie tout n’est qu’évènement. De l’évènementiel, cinéma permanent, scénario à trouver des fêtes pour le calendrier. Entre deux saints, ça vous a de la prestance. Et puis, des défilés pour montrer les joujoux accrochés sur les poitrines. Pathétiques breloques, bons points distribués à ceux qui ont oublié de mourir.
Des gentils, il y en avait chez les Allemands. Tous ceux qui n’étaient pas contents d’avoir délaissé leurs turnes, leurs femmes. À l’avant ils tiraient en pensant à celles qui se faisaient sauter à l’arrière. À l’arrière on copule toujours. La libido redouble quand l’absence se prolonge. Elles ne savaient pas s’ils reviendraient vivants ou si vivants, ils seraient encore entiers. Parce que la guerre ne fait pas dans le détail. Même Jean Bouin en 14 il n’avait pas couru assez vite. Pourtant courir il savait faire. Il avait quand même décroché une médaille d’argent aux 5.000 des Jeux olympiques de 1912. Fallait le mettre estafette mais pas en première ligne avec une pétoire. Les pointes, il connaissait, au bout de ses chaussures mais pas celles des casques de ceux d’en face. Xivray dans la Meuse que ça s’appelait, Xivray ou Xivray pas… Poussé au cul, c’est un ordre et tu avances. Que c’est pour la France et que la France pour le moment ce n’est pas le demi-fond qui l’intéresse, c’est la victoire. T’as vu la tronche des vainqueurs. Ils étaient surtout contents de rentrer chez eux même cabossés. Des gazés, des manchots, des unijambistes qui avaient quand même rallongé l’heure de la sortie de route. Et « Les gueules cassées » ! Ils se sont mis à vendre des billets de la Loterie nationale. Le pays leur devait bien ça. Avec la tronche en biais tu ne peux pas retourner enseigner les gosses, si t’étais instituteur.
Près de chez nous, à la campagne s’étaient pointés les « frisés », dans une auto pas catholique, vert de gris avec des petites fenêtres où tu glissais juste un œil. Pas du panoramique. Rien que pour le passage d’un cinéma, couleur sang et merde, étal de boucherie et craquemuche en tous genres. Dedans, quand ça roulait t’avais pas un poil de sec, que même tu pissais en roulant, comme autrefois au Tour de France. Maintenant, tu pourrais plus, hygiène, hygiène.
Ils étaient arrivés, nos vainqueurs, dans un cliquetis de ferraille et s’étaient garés le long du pré devant la maison. On m’avait dit : ce sont les Allemands. Leur véhicule paraissait fatigué. Leurs occupants s’étaient approprié l’ombre d’un grand chêne pour une nuit paisible. À une centaine de mètres de chez nous, ils paraissaient encore ensommeillés. Je décidai de leur rendre visite. Mes espadrilles se frayaient un passage dans l’herbe un peu haute, couverte de rosée. Cette déambulation humide, m’amena au pied de l’engin. Un jeune homme sortit de l’habitacle et vint près de moi.
–Bonjour, dit-il en souriant.
–Bonjour, répondis-je.
–Toi, enfant de la maison ?
–Moi, enfant de la maison.
–Toi, réveillé tôt !
–Toi, aussi.
–Mauvaise la guerre. Enfants à moi, loin.
–Tu as des enfants ?
–Deux petits et un grand.
–Qu’est-ce que tu fais ici ?
–J’obéis.
–À qui ?
–À des idiots.
–Tu es seul ?
–Nein, chef à moi encore endormi. Lui, conduire longtemps, très fatigué.
–Tu as un lit là-dedans.
–Ja, mais dur, très dur.
–Tu me fais voir ta maison ?
–Ja.
Il me fit grimper sur sa carriole. Il se dégageait de l’engin une odeur nauséabonde, un mélange de vieilles fripes et de sueur, mêlée à un parfum plus corsé. J’essayai d’identifier les différentes composantes de ce mélange. Je pensai qu’il y avait positionné à l’intérieur de l’habitacle une sorte de cabinet permettant de satisfaire les besoins des occupants pendant la marche de ce gros tas de ferraille.
Je humai l’air à plusieurs reprises. Mon hôte s’en aperçut et se mit à rire.
–Ça va pas sentir la campagne, dit l’allemand.
En effet ce n’était pas une odeur de bouse, même pas l’odeur de l’écurie. Je la connaissais bien l’odeur des chevaux. Ce mélange de pailles fermentées, roulées en petites boules parsemant la litière de « Blond » et de « Gari », les deux plus belles conquêtes de l’homme remisées chez le fermier. J’y allais de temps en temps pour caresser le museau tendre et soyeux de « Blond », une espèce de velours au-dessus des narines laissant échapper à chaque exhalaison, une chaleur douce et humide. Un peu de paille fraîche répandue le soir avant le nettoyage de la litière apportait sur ce tas de déjections, l’odeur d’une fin de moisson après le passage de la batteuse où une fois le grain chassé des épis, elle sortait compressée de la machine, pour donner la future litière de ces travailleurs infatigables.
–Ça sent le caca, dis-je.
–Caca…Qu’est-ce que c’est ? reprit l’Allemand.
Je me pinçai le nez pour essayer de traduire le mieux possible mon affirmation.
–Ah ! Caca ! Oui caca, à la guerre comme à la guerre.
La guerre était vraiment une faiseuse de merde. Il en fallait du courage pour affronter l’adversité dans une ambiance pareille. Déjà loin de chez eux ils emportaient, dans leur maison ambulante, les remugles de la transformation de leur rata. Il finit par m’apprendre qu’il était professeur de français dans un collège de Berlin, mettant fin immédiatement, à la croyance que j’avais, de comprendre une langue étrangère. Il sortit d’un étui de cuir deux photographies. Sur la première, une femme blonde chevauchait un vélo. Une jupe longue lui couvrait les chevilles et l’échancrure de son corsage me montra le visage d’un été de là-bas. Sur la deuxième il y avait deux garçons. L’un paraissait avoir mon âge, le deuxième un peu plus grand, posait délicatement sa main sur l’épaule de ce qui devait être son frère.
–Ça Siegfried et ça Willem, et toi ?
–Moi c’est Albert.
–Ah ! Beau prénom Albert. Comme Albert Camus, Albert Londres.
Je me demandai bien qui pouvaient être ce Camus et ce Londres mais comme il paraissait bien les connaître je ne voulus pas paraître ignorant de ces gens, qui étaient peut-être mes voisins. Je répétai machinalement.
–Oui, c’est ça.
–Vous les connaissez ?
–Moi non, mais papa sûrement et maman aussi. Ils ont beaucoup d’amis.
Il me tendit la main et je grimpai sur la machine. Escaladant la chenille je me retrouvai en compagnie de mon guide à côté de la tourelle. Je regardai autour de moi, heureux de cette nouvelle vision de la campagne environnante.
Papa revenait de ramasser des pois-chiches. Il salua nos hôtes de passage et du haut de mon perchoir, je sautai dans ses bras. Me prenant la main nous partîmes vers la bastide.
Ah ! Les pois-chiches. Des choses qui poussent quand même sans trop de soins. Tu n’arroses pas souvent, tu les oublies. Ça se cueille comme les fraises. C’est moins goûteux mais ça tient au corps. En soupe, en salade, ça te fait l’entrée et le plat de résistance.
En matière de résistance on en avait besoin, vu que les « Résistants » n’avaient pas encore pris leurs marques. Sur la fin on en a trouvé de partout, même chez les trafiquants du marché noir. Façon de se blanchir. Le courage, c’est d’être là au bon moment. Résistants de la vingt-cinquième heure, tu résistes d’autant mieux que ça ne pète plus. Il en sortait même de la rue Lauriston, colonisée par la Gestapo. Tous les tire-au-cul, câlineurs de l’occupant, planquouzars demeurés à l’ombre. Fiers à bras de pacotille, héros ignorés d’eux-mêmes, pères tranquilles et délateurs, canailles à montrer du doigt le juif, le tzigane. Tout ça on ne le savait pas encore. Que je te criais : vive Pétain, puis, aussi fort, après vive de Gaulle. Le général savait tout ça, mais il fallait réconcilier les Français. Alors, même Bousquet, le spécialiste de la rafle du Vel d’Hiv, bien épaulé par la maréchaussée française, est devenu membre bienfaiteur de la nouvelle république. Il a fallu tout à l’heure un demi-siècle pour lui faire comprendre, qu’il avait mis les doigts dans le pot de confiture.
Vous allez me dire « mais tout ça n’occupait pas tout le paysage ». La douce France n’avait pas disparu. Elle s’était un peu endurcie, façon nougat de Montélimar laissé trop longtemps à l’air libre. Les familles se reproduisaient moins vite. Les bouches que l’on nourrissait le plus étaient celles des canons.
Le Pétain, de son côté, il n’avait pas besoin de ça pour bander, vu qu’à son âge il furetait encore dans les petites culottes. À Vichy il ne suçait pas que des pastilles : gaga, gâteux, gâtés, gâteries. Il se frisait la moustache sur les monts de Vénus, entre deux signatures sur la dernière loi raciale et l’entretien de sa haine personnelle contre ce Laval, léchant les bottes d’Otto Abetz et marchant à pieds joints sur l’autorité du « vieux ». Le Laval, il avait même fourgué l’or des Belges, confié à la Banque de France. Pour une fois, qu’un politique ne grevait pas le budget de son pays, on aurait dû le gracier. On l’avait déjà fait pour Pétain. Il était pas flambard quand il s’est rendu. Son procès, une tristesse. Mornet en accusateur public c’était déjà prémonitoire et Mongibeaux en président du tribunal, que la presse avait déjà surnommé « Mongibet ». Pouvait pas s’en sortir. Il a eu l’île d’Yeu pour pleurer et Laval au poteau, ficelé pour qu’il tienne debout après sa tentative d’empoisonnement. C’était pas pire que pour la famille Ceausescu, à part que là c’était Français…
C’est bien, les souvenirs, tu peux te les rembobiner chaque fois que le présent ne te fait pas un cinéma terrible. Quand tu t’emmerdes à trois sous l’heure et qu’à part le foot à la télé y a pas grand-chose de comestible. Les souvenirs c’est ton archéologie à toi, ce que personne ne peut te prendre et ça reste même quand tu finis un jour par voir tes méninges labourées par les oublis de l’âge. Tu te souviens plus de ce que tu as bouffé la veille mais tu peux décrire en long, en large et en travers le goût des confitures aux mûres cuisinées par ta grand-mère. Dans les souvenirs, y a pas comme les guerres pour laisser partout des traces. Des breloques, sur la poitrine des combattants, encadrées plus tard sous verre et pendues au-dessus de la cheminée. Des commémorations pour fabriquer parfois des jours de congé, comme l’angine attrapée dans un courant d’air, une chute de neige pour faire demeurer ta bagnole tranquille le long du trottoir. Pas plus, pas moins. Et des stèles où tu peux lire le nom de tous les allongés, tous ceux qui étaient là, pas au bon moment. Tu cherches un nom qui ressemble au tien. Pour t’attendrir un peu plus, en pensant à la connerie humaine qui aurait fait de la viande morte avec un lointain parent. Car faut une belle dose de connerie pour fabriquer des héros. Une grande dose d’inhumanité pour croire encore qu’il faille mourir pour des idées.
Quand ça commence la guerre, ça finit quand même par finir. Faudrait débuter par là. L’Hitler, on le sait maintenant, il n’avait pas inventé l’eau tiède. En 36 déjà, l’était pas copain avec les juifs. Il aurait mieux valu l’accepter aux Beaux-arts. Il aurait pu barbouiller à l’aise et pas se prendre pour le « Messie » de la nation allemande. Ce n’était pas sa faute si le pays était cul par-dessus tête. Les politicards de tous bords avaient soigneusement préparé la mouscaille à venir. Que l’inflation était telle, qu’il te fallait une brouette de billets pour acheter une flûte de pain. Lui, il se préparait devant son miroir à prendre des allures martiales pour cracher sur le peuple anéanti des slogans à te réveiller un ossuaire. Et de profiter d’un petit passage en prison pour nous rédiger « Mein Kampf ». Là, il s’était documenté l’Hitler, et de te passer en revue toutes les élucubrations fantasmatico-séculaires sur les juifs à travers les âges, trouvées dans les bibliothèques de l’époque. Historien qu’il aurait dû être, pas chef de troupe. Il lui a suffi de regarder en arrière, de piocher dans les décrets promulgués depuis le début du monde, pour fixer son délire sur « l’Aryen Prométhée de la nation ».
Louis IX avait déjà collé la rouelle, devant et derrière le dos de ses juifs à lui. L’autre dézingué avait trouvé plus poétique. Des relents d’artiste beauzartesques, un design original, l’étoile du berger, cousue sur la laine des moutons, précautionneusement tondus. Il voyait plus des ghettos, rien que des voies lactées.
Après, il a fait dans l’industriel, le con, suivi par une horde d’aboyeurs à sa botte, et de fonctionnaires assidus. Il a fallu les pendre pour qu’ils se rendent compte des horreurs commises. Et même là ils gardaient la tête haute, mais les bourreaux leur ont placée encore plus haute, en leur allongeant le cou.
Avant de naître, j’aurais su tout ça, j’aurais refusé de mettre le nez dehors. Pourtant l’enfance est un pays extraordinaire, même si on n’y fait pas deux fois le voyage. On peut toujours imaginer dans sa tête les paysages, les retrouver sur des photographies. La photo, c’est la seule machine à arrêter le temps, un moment volé dans l’espace, une mémoire de la mémoire. Si on te cambriole un jour, on peut tout t’emporter sauf tes souvenirs, ce qu’il y a sur la péloche, tu ne le retrouveras jamais. Même avec du fric, le temps arrêté ne s’achète pas. On le saisit, sur le vif, on le conserve, on y jette un regard furtif ou attendri, on l’agrandit, on l’encadre, on le biche, on le dorlote.
Tout ça pour vous dire qu’à six ans encore j’étais heureux. Famille, rien à dire, que du bon. On zigzaguait entre Marseille et Puyricard, un petit village près d’Aix-en-Provence et on terminait la guerre comme on l’avait commencée… Peinards !
Ils ne devaient pas rester paisibles longtemps, les frisés. Le débarquement avait commencé en Provence et les premiers amerloques avaient pointé leurs frimousses dans les environs de chez nous. Tatave, le garde canal, revenant à bicyclette de la ferme voisine, racontait volubilement, qu’il avait laissé au carrefour de la Glacière un camion carbonisé par une attaque en piqué venue bombarder le pont du chemin de fer. « Coquin de sort », éructait-il, l’œil sorti de son orbite dans une jubilation guerrière, affichée d’autant plus ouvertement que tout danger semblait pour le moment écarté…
–Le con, il était cramé avec un citron dans une main… L’avait pas fini de sucer… Ah ! Le con.
On l’avait entendu ce bombardement. Pendant que ça pétait pas mal, notre tata, la bien-nommée Gracieuse, si elle ne souriait pas c’est qu’elle dormait, nous avait tous réunis contre le mur de la cuisine. Pourquoi le mur de la cuisine ? C’était le lieu où elle officiait avec tendresse. Elle aurait mal vu son laboratoire partir en fumée sous les coups d’une quelconque pétoire. Elle y cuisait là, avec amour un des rares gâteaux qu’on pouvait s’offrir dans ces périodes de restrictions : le castagnacci : de l’eau, de la farine de châtaigne, deux œufs généreusement fournis par les volatiles de la mère Bagnis, et du beurre… Parce que même en temps de guerre les vaches continuent de faire du lait et celle qui paissait dans le pré en face de la maison ne pratiquait pas le marché noir et se laissait écraser les pis tout en continuant de ruminer un peu de paille tirée du râtelier. Je plantais mes petits doigts dans le trou de mes oreilles.
–Dis ! Tata, c’est quoi tout ça ?
–Tout ça quoi mon chéri ?
–Tout ce bruit…
–C’est la fête de la sainte Vierge.
–Et pourquoi elle fait tant de bruit ?
–C’est pour réveiller les consciences.
–J’imaginais que les consciences étaient des sortes d’animaux ayant sorti de leur sommeil un prince charmant arrivé par les airs. Une espèce de Père Noël pour bestioles.
–Et c’est méchant les consciences ?
–Tu verras, mon chéri ; il y en a de toutes sortes mais la plupart du temps elles sont gentilles.
Rassuré, j’entendais survoler ces réveilleurs de consciences et j’imaginais, après leur passage, voir défiler au milieu des champs et des prés une armada ordonnée de drôles d’animaux que ce ballet aérien avait fait sortir de terre. En allant, le lendemain, sur le pont surplombant la voie ferrée, près de notre bastide, je vis le travail effectué par le passage des bombardiers.Dans le concert du ronronnement des moteurs ils avaient buriné en deux ou trois passages les rails, le ballast, le pont et la route. Un entrelacs de fonte tordue, mêlée à du goudron et des pierres éclatées constituant, dans ce paysage champêtre, le premier musée en plein air. J’en fus persuadé sur les lieux de cet exploit. Une foule de badauds admirait le résultat de ce travail. J’étais moi-même subjugué par la rapidité et l’efficacité de ces machines créatives, ayant créé, en plein air, un musée de sculptures non figuratives. Je bénissais le génie qui les avait conduites jusque-là. Je ne vis pas les consciences, elles avaient dû déjà s’enfuir.
Je compris dans le regard éperdu de certains spectateurs que le spectacle n’avait pas plu à tout le monde. À l’odeur répandue sur les lieux je sentis que quelques-uns s’étaient chiés dessus. Ce devait être la joie de voir une telle merveille. Le bonheur était aussi un vidangeur de tripes.
Quand les raids reprirent, j’étais heureux à l’idée d’entendre se bâtir, peu à peu, cet ensemble artistique. J’imaginais la beauté du monde et l’avenir radieux dans lequel je posais mes pas. Je ne regrettais pas un seul instant d’être né.
Quelques heures après ce feu d’artifice, l’automitrailleuse avait quitté le pré, juste avant l’arrivée terrestre de nos libérateurs. J’allais découvrir, en même temps que la venue inopinée d’autres envahisseurs, l’étiquette de mon petit déjeuner : « Y’a bon Banania ». C’était permis de saliver devant, ce qu’on appelait encore un nègre et l’on bénissait tous les matins ce zouave, noir ébène, souriant sur la boîte, dégusté gloutonnement, en le remerciant de produire de si bonnes choses.
J’allais enrichir ma réserve de tendresse, de douceur et de joie à la vue de Bill, un grand noir américain venu camper avec toute une escouade près de chez nous. Je le vois encore croquer, avec ses grandes dents blanches encore plus blanches sur cet environnement sombre, une tomate écarlate qu’il dévorait avec gourmandise, dans la plénitude d’un bonheur retrouvé. Avec ses compagnons il venait de se castagner avec quelques occupants attardés, avait perdu sûrement des amis, des compagnons d’arme, oublié depuis pas mal de temps sa famille et là, tout d’un coup, il était remué jusqu’au plus profond de ses tripes par le goût sucré d’une tomate fraîchement cueillie, se demandant si le monde n’aurait pas dû simplement commencer par-là, sans aller plus loin.
On avait toujours dans le séjour un piano. Papa, merveilleux musicien libéra les touches du couvercle qui les protégeait, se mit à jouer. Il attaqua « Moonlight Cocktail » de Glenn Miller. Bill s’était arrêté de croquer sa tomate et vint poser la main sur l’épaule de papa. Il écouta, avec toute son âme la mélodie et attira, petit à petit, tous ses compagnons se prélassant encore sur la terrasse. Ils s’approchèrent de l’instrument, puis Bill s’écarta, les autres firent cercle autour de lui et tandis que la musique inondait la pièce, les fleurs, les arbres et peut-être le monde il se mit à danser en rythmant sa danse avec des claquettes. Il résonnait dans la pièce un goût d’éternité, comme une nouvelle aurore crée par un artiste génial, la matérialisation d’une paix, pleine d’amour et de soleil.
Il se tourna vers maman qui ressemblait, à ce moment-là, à une petite fille, la salua, lui tendit la main et l’invita à danser. Elle avait ouvert le bal et dans la foulée, les soldats deux par deux se prirent dans les bras les uns des autres et dansèrent. Ce fut, sans Alice, le monde au pays des merveilles et l’on se mit à pleurer de bonheur.
Quand la musique s’arrêta, au milieu des applaudissements je me précipitai contre Bill, qui me souleva au-dessus de sa tête et me serra contre lui, en déposant sur mes petites joues roses de grands et gros baisers dont je garde encore aujourd’hui la trace.
Quand le lendemain ils montèrent tous dans le camion qui les avait conduits jusqu’à nous je me mis à chialer comme une fontaine :
–Pars pas… Pars pas… Je viens avec toi.
Bill, redescendu du camion, décrocha de sa poitrine l’insigne US, l’accrocha à mon tricot, m