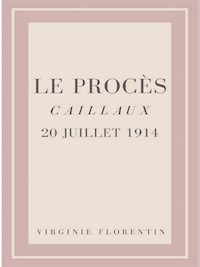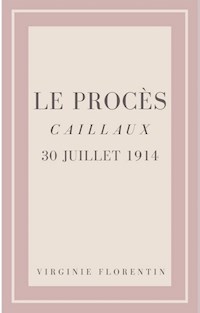
6,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Französisch
Le 16 mars 1914, une femme se rend au siège du Figaro, vers dix-huit heures des coups de feux éclatent, un homme s'effondre mortellement blessé, il succombera à ses blessures. L'homme c'est Gaston Calmette, patron du Figaro. La femme n'est autre que l'épouse de Joseph Caillaux le ministre des Finances. Le procès qui en découlera tournera vite au vaudeville.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1288
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Le procès Caillaux
20 juillet 1914
Virginie Florentin
© 2014 -2021 Virginie Florentin
BoD – Books on Demand,
12/14 rond-point des Champs-Élysées, 75008 Paris
ISBN : 9782322272358
Dépôt légal : Janvier 2021
Introduction
Première audience
Deuxième audience
Troisième audience
Quatrième audience
Cinquième Audience
Sixième Audience
Septième Audience
Huitième audience
LE VERDICT
La justice, c’est quand on gagne le procès.
Samuel Johnson
Introduction
Le 16 mars 1914, une femme se rend au siège du Figaro, vers dix-huit heures des coups éclatent, un homme s’effondre, mortellement blessé, il succombera à ses blessures quelques heures plus tard.
L’homme, c’est Gaston Calmette, patron du Figaro, qui depuis quelques mois mène une virulente campagne de presse contre le ministre des Finances Joseph Caillaux.
La femme n’est autre que Henriette Caillaux, femme du ministre des Finances. C’est une femme blessée dans son honneur, dans sa dignité qui se rend le 16 mars au siège du Figaro.
Il faut se remettre dans le contexte de l’époque. En France, deux camps s’affrontent, les nationalistes et les pacifistes. Les nationalistes n’ont pas oublié la défaite de Sedan et la perte de l’Alsace-Lorraine, pour eux, l’Allemagne est l’ennemie à abattre. Pour les pacifistes, une autre guerre entraînerait l’Europe dans la tourmente. Joseph Caillaux, ancien président du Conseil et ministre des Finances sous la présidence Doumergue, chef du parti radical, allié au pacifiste Jean Jaurès, souhaite mener une politique d’ouverture envers l’Allemagne.
Ses prises de positions et sa forte personnalité déclenchent une haine parmi ses anciens partisans et les nationalistes. En janvier 1914, Gaston Calmette lance une violente campagne de presse contre le ministre des Finances, l’instigateur de cette campagne n’est autre que Louis Barthou, ancien président du Conseil sous la présidence de Poincaré.
Louis Barthou fournit divers documents à Gaston Calmette, dont ceux de l’affaire Rochette et de la crise d’Agadir.
Dans l’affaire Rochette, Caillaux est accusé de collusion avec Henri Rochette, spéculateur véreux, qui alimente les caisses noires de différents partis politiques et certains journaux.
Lors de la crise d’Agadir, on reproche au gouvernement Caillaux d’avoir négocier avec l’Allemagne pour qu’elle renonce à une quelconque présente au Maroc. En effet, l’Allemagne voulait stopper l’expansion de la France au Maroc et ainsi affaiblir l’entente cordiale entre la France et l’Angleterre. Sentant le danger d’une guerre, le gouvernement Caillaux négocie avec l’Allemagne, un traité est signé entre les deux protagonistes le 4 novembre 1911.
A la suite des différentes publications du Figaro, une vaste polémique s’ensuit dans les partis et dans les journaux. Mais ça ne suffit pas pour briser l’homme qu’est Joseph Caillaux.
Calmette, que son entourage qualifie de courtois et d’homme discret, continue de plus belle sa campagne calomnieuse, il accuse Caillaux de trafics d’influence, de délits d’initiés, de captation d’héritage et il enfonce le clou en l’attaquant sur sa vie privée.
Le bruit court dans tout Paris que Calmette va publier des lettres intimes que Caillaux a écrit à sa maîtresse, alors qu’il était encore marié à sa première femme. Cette dernière, a gardé des copies de cette correspondance ou l’intime se mêle à la politique.
Le 13 mars 1914, paraît la lettre « Ton Jo », d’autres lettres intimes doivent suivre. Affolée, indignée, Henriette Caillaux décide qu’il faut mettre un terme à cette campagne.
Dans la journée du 16 mars, elle se rend dans une armurerie, achète un browning, demande à ce qu’il soit chargé. Après cet achat, elle rentre à son domicile, écrit une lettre destinée à son mari. En fin de journée elle se rend au siège du Figaro, fait passer sa carte sous enveloppe, elle patience une heure dans le salon d’attente. Calmette l’a reçoit vers dix-huit heure, à peine a-t-il le temps de pénétrer dans son bureau et d’échanger quelques mots, que Mme Caillaux étant resté sur le pas de la porte, vide son chargeur sur Gaston Calmette. Calmette essaye de se protéger comme il peut mais rien n’y fait, il s’écroule mortellement blessé.
Elle sera arrêtée quelques instants plus tard, elle n’a cherché ni à fuir ni à justifier son geste. Ceux qui l’ont approché après l’on trouvé très calme, voir froide. Elle n’a pas conscience de la gravité de son acte, d’ailleurs elle est persuadé de ne l’avoir que blessé.
L’Histoire a oublié Joseph Caillaux, son nom reste lié au meurtre commis par son épouse, alors qu’il fut l’un des hommes politiques les plus importants de la IIIe République.
Joseph naît au Mans le 30 mars 1863. Son père, Eugène, est ingénieur, diplômé de Polytechnique. En 1874, il entrera en politique et sera appelé au gouvernement en tant que ministre des Travaux publics, il n’y restera que deux ans et par la suite sera élu sénateur de la Sarthe. En 1877, retour express au gouvernement au ministère des Finances ou il sera contraint de démissionner. Sa carrière politique s’achève après plusieurs revers électoraux. Jusqu’à sa mort il sera président du P.L.M. Sa mère, Anna Dounet est issue d’une grande famille d’industriel. Deux enfants naîtront de cette union, Joseph et Paul de seize mois son cadet et qui décèdera en 1900.
Après de brillantes études, Joseph deviendra inspecteur des Finances, il y restera pendant dix ans. En 1898, il sera élu député radical de Mamers dans la Sarthe. En 1899, il sera nommé ministre des Finances dans le gouvernement Waldeck-Rousseau.
Il rejoindra Poincaré dans l’Alliance républicaine et démocratique. Il sera de nouveau ministre des Finances sous le gouvernement de Clémenceau. Il crée l’impôt sur le revenu, mesure impopulaire et mal comprise, ce qui lui vaudra une renommée très particulières, car il le dira lui-même : « J’ai écrasé l’impôt sur le revenu en ayant l’air de le défendre. »
En 1911, il devient Président du Conseil, ce qui l’amènera à négocier pacifiquement avec l’Allemagne lors de la crise d’Agadir. Il aura le sentiment d’avoir sauvé la paix.
Cette affaire provoque la chute de son gouvernement. Il retrouvera le ministère des Finances sous le gouvernement Doumergue.
Son élection en tant que président du parti radical sera la raison de sa brouille avec ses amis Poincaré et Barthou. Deux fois, il va les défier en faisant campagne contre Poincaré lors de l’élection Présidentielle, puis en renversant Barthou.
La chute de Barthou provoquera les élections législatives qui sont prévues en avril 1914. Joseph Caillaux à toutes ses chances d’être appelé à devenir le président du Conseil, cette opportunité l’amènerait à s’allier à Jaurès, ce qui permettrait d’améliorer les relations entre la France et l’Allemagne.
Mais va-t-on lui permettre de gagner ces élections ? Poincaré ne veut pas de Caillaux, ils sont en désaccords total sur les points essentiels de la politique que veut mener Poincaré. La solution, le stoppé net, et tous les coups sont permis.
En 1906, il épouse Berthe Gueydan née en 1869. Quand ils se rencontrent, elle est encore mariée et a un fils. Sa rencontre avec Caillaux est un coup de foudre, ils échangeront une correspondance très tendre, dont la fameuse lettre signée « Ton Jo », elle divorcera en 1904. Joseph ne met aucun empressement à l’épouser. Lors du procès ils s’affronteront publiquement, se faisant des reproches, chacun donnera une vision différente de leur couple. Pour madame Gueydan, ils étaient un ménage admirable, heureux, le plus uni. Joseph répondra : « Nous avons été des amis admirables ». Il se lassera vite de cette vie mondaine que lui fait vivre son épouse. Fin 1907, il rencontrera celle qui sera la cause du drame, Henriette Rainouard. Elle est le contraire de Berthe. Elle aussi est une femme mariée et a deux filles. Elle divorcera en 1908. Une correspondance amoureuse s’échangera entre les deux amants. Berthe aura des soupçons quand elle verra la lettre « Ta Riri » Elle mènera sa petite enquête et découvrira qu’elle est trompée. Le 14 juillet 1909 c’est le drame, Caillaux est contraint d’avouer sa liaison, mais il ne veut pas de séparation ni de scandale, c’est un homme public. Il lui fait des promesses, lui jure son amour…
Berthe volera les lettres compromettantes à son mari, et ses lettres sont édifiantes, elles révèlent tous les projets des deux amants. La guerre est déclarée entre les deux époux. Joseph ne veut pas divorcer avant les élections de 1910. A peine réélu, il quittera le domicile conjugal et après d’âpres négociations pécuniaires obtiendra le divorce. Il récupéra ses lettres mais ce qu’il ignore c’est que sa femme en a conservé des photocopies. Pour Caillaux Berthe Gueydan appartient au passé.
Une fois libre, il épousera le 21 octobre 1911 Henriette Rainouard. Mais quelque part, dorment des photocopies qui détruiront ce bel édifice.
Le procès Caillaux commence le 20 juillet 1914, ce fut l’un des grands procès du XXe siècle et le dernier de la Belle Epoque. La France entière suivis les débats jusqu’au 28 juillet, juste avant l’assassinat de Jaurès et la déclaration de guerre de la France à l’Allemagne.
Ce sera un procès surréaliste sur fond de déclaration de guerre.
Le procès
Cour d’Assises de la Seine
Paris, 20 juillet 1914
Première audience
PRELIMINAIRES
Au moment où la Cour entre à l’audience, des bruits se font entendre, et des cris de : « Albanel ! Albanel ! »
M. le Président. – Quel est ce bruit ?
M. Beau, président du Syndicat de la presse judiciaire – Monsieur le président, permettez-moi respectueusement de vous dire qu’on ne s’explique pas pourquoi les membres de la presse n’ont pas été admis à prendre les places qui leur avaient été assignés ?
Le président. – MM. les membres de la presse qui ont leurs noms sur les chaises occuperont leurs places et on fera évacuer ces places par les personnes qui les occupent. Mais la Cour va, pour le moment, rendre simplement un arrêt de forme.
Mr le procureur général vous avez la parole.
M. le procureur général. – Messieurs, en raison de la longue durée prévue pour les débats qui vont s’ouvrir, nous requérons qu’il plaise à la Cour s’adjoindre un magistrat supplémentaire et adjoindre au jury deux jurés suppléants.
Le président. – La Cour, sur les réquisitions de M. le procureur général, vu l’art. 4 de la loi du 25 frimaire an VIII et l’art. 394 du Code d’instruction criminelle, ordonne qu’il sera adjoint à la Cour un conseiller assesseur et deux jurés suppléants.
(Après une courte suspension d’audience, les jurés entrent en séance. La Cour prend place ensuite, et M. le Président adresse à l’auditoire les quelques mots suivants) :
Le président. – Il est bien entendu, n’est-ce pas, que personne ne restera debout. Jusqu’à l’appel des témoins, je veux bien laisser quelques personnes et quelques avocats qui se trouvent là debout, mais lorsque les témoins se seront retirés, il faudra qu’il n’y ait personne debout, excepté dans le couloir des avocats, au rang qui pourra leur être réservé.
Messieurs les représentants de la presse ont reçu satisfaction, tout le monde a sa place ?
Je vous prie de ne pas faire de bruit. Nous sommes ici pour remplir un devoir de justice ; je pense bien que vous allez nous le laisser remplir avec tranquillité et dignité, je l’espère. S’il y avait la moindre manifestation, je ne la tolérerais pas.
Comment vous appelez-vous, madame ?
Mme Caillaux. – Henriette Rainouard.
Le président. – Je rappelle à MM. les défenseurs les dispositions de l’art. 311 du Code d’instruction criminelle.
Messieurs les jurés, veuillez-vous lever, la Cour va recevoir votre serment.
(Les jurés, titulaires et suppléants, prêtent serment ; la Cour leur en donne acte.)
Le président. – Madame, soyez attentive à ce que vous allez entendre.
Monsieur le greffier, veuillez donner lecture de l’arrêt de renvoi et de l’acte d’accusation.
Le greffier. – Vers 6 heures du soir, le 16 mars dernier, six balles de révolver étaient tirées sur M. Calmette, directeur du Figaro, dans son cabinet de la rue Drouot. Deux projectiles avaient occasionné des blessures superficielles au thorax, un troisième avait traversé la cuisse gauche ; un autre enfin, pénétrant dans la cavité abdominale, avait atteint l’artère iliaque et provoqué une hémorragie qui détermina la mort au cours d’une intervention chirurgicale tentée vers minuit par les docteurs Hartmann, Cunéo et Reymond.
M. Calmette avait été frappé par Mme Caillaux, femme du ministre des Finances. On sait qu’au cours de l’instruction, l’accusée a soutenu qu’elle n’avait pas l’intention de donner la mort à M. Calmette, mais seulement de lui donner un avertissement brutal provoqué par une violente campagne de presse et la crainte de voir publier une correspondance où serait étalé son passé le plus intime.
« Mon intention, a-t-elle déclaré à M. Boucard, juge d’instruction, était de me rendre auprès du directeur du Figaro, d’obtenir de lui la remise de deux lettres photographiées qu’il devait avoir ou l’engagement formel de ne rien publier me concernant. L’idée m’est alors venue que, dans le cas où M. Calmette ne me donnerait pas satisfaction, il me faudrait faire du scandale au Figaro. Et c’est ainsi que je songeai à m’y rendre avec une arme. »
Cependant, à peine Mme Caillaux était-elle introduite dans le cabinet de M. Calmette, que, sans même exposer le but de sa visite, elle déchargeait sur lui son arme et le frappait à bout portant.
Pour expliquer les minutes d’affolement dans lesquelles elle dit avoir agi, elle a déclaré que pendant l’attente de plus d’une heure qu’elle fit dans le salon du Figaro, il lui a semblé que les garçons de bureau se moquaient de son mari et qu’elle avait entendu plusieurs personnes appartenant à la rédaction du journal poursuivre une conversation sur la campagne dont il était l’objet. Elle a ajouté qu’au moment de pénétrer dans le cabinet directorial elle avait entendu soudain l’appel répété de son nom.
« Ainsi m’apparut, dit-elle, la gravité de ma démarche en même temps que ce qu’il y avait en elle d’irréprochable. » - « Enfin, a-t-elle encore dit, en entrant dans ce cabinet où tout était si sombre qu’on distinguait à peine la silhouette de M. Calmette, j’ai ressenti une impression effroyable, à laquelle s’est mêlé un sentiment de peur irraisonnée, en me trouvant seule en présence de cet homme qui était mon ennemi et dans ce cabinet rendu encore plus mystérieux par cette demi-obscurité. »
Or, les personnes qui étaient dans le salon, auxquelles fait allusion Mme Caillaux, ont affirmé que dans leur conversation, il ne fut question à aucun moment de la campagne dirigée contre le ministre des Finances. D’autre part, le nom de Mme Caillaux ne fut prononcé à haute voix ni par l’huissier ni par M. Calmette et c’est sur un simple signe qu’on la fit entrer dans le cabinet de ce dernier. Enfin, à ce moment, le garçon de bureau Sirac venait de tourner les commutateurs électriques et la pièce se trouvait complètement éclairée.
Dans sa matérialité, l’acte de Mme Caillaux ne peut que constituer un homicide volontaire, et elle-même paraît bien en avoir reconnu toute la portée lorsque au moment où le garçon de bureau Nicet la désarmait, elle a déclaré : « Je viens de faire justice ! » et ensuite, devant M. Giraudeau, rédacteur au Figaro : « C’était le seul moyen d’en finir ! »
Le ministère public. – Mme Caillaux a-t-elle prémédité son acte ?
Il suffit pour s’en convaincre et achever par là même d’établir l’intention homicide, d’exposer l’emploi du temps de l’accusée à partir du moment où chacun de ses actes semble concourir à l’accomplissement du geste final.
Entre heures et 3 h. 30, Mme Caillaux se rend chez M. Gastinne-Rénette, armurier, et demande à acheter un révolver. Elle en essaie un dont elle trouve la détente trop dure, et arrête son choix sur un browning du calibre 6, dont elle se fait expliquer le maniement et qu’elle essaie sur une silhouette placée à 10 mètres. Elle charge alors l’arme de six balles, la glisse dans une gaine et regagne son automobile.
Elle a déclaré elle-même au juge d’instruction que pendant que la voiture roulait, craignant d’oublier les indications qui lui avaient été données chez l’armurier, elle avait fait mouvoir la glissière de façon à faire passer la première balle du chargeur dans le canon, avait mis ensuite le cran de sûreté et avait replacé l’arme dans son étui.
Après avoir fait son acquisition, elle se rendit au Crédit Lyonnais, retira divers papiers d’un coffre-fort et rentra à son domicile où elle rédigea à l’adresse de son mari la lettre suivante que M. Caillaux a fait parvenir au magistrat instructeur :
« Mon Mari bien-aimé,
Quand ce matin je t’ai rendu compte de mon entretien avec le président Monier, qui m’avait appris que nous n’avions en France aucune loi pour nous protéger contre les calomnies de la presse, tu m’as dit que ces jours-ci tu casserais la g… à l’ignoble Calmette. J’ai compris que la décision était irrévocable. Mon parti à moi fut alors pris. C’est moi qui ferai justice. La France et la République ont besoin de toi. C’est moi qui commettrai l’acte. Si cette lettre t’est remise, c’est que j’aurai fait ou tenté de faire justice. Pardonne-moi, mais ma patience est finie. Je t’aime et je t’embrasse du plus profond de mon cœur.
Ton Henriette. »
Me Caillaux pénétrait au Figaro vers 5 heures, et, s’adressant au chef des huissiers, demandait à voir M. Calmette. On lui dit que celui-ci n’était pas encore arrivé ; elle répondit qu’elle l’attendrait, ajoutant qu’elle ne donnait pas son nom, mais que le directeur du Figaro la connaissait et la recevrait.
Elle fut aussitôt introduite dans le salon du premier étage et elle y resta un peu plus d’une heure assise dans un fauteuil, les deux mains enfouies dans un manchon où elle dissimulait son révolver. A deux reprises, cependant, elle se leva pour se rendre auprès des bureaux des huissiers et s’enquérir de l’arrivée du directeur.
Celui-ci fit son entrée au journal à 6 heures et pénétra dans son cabinet en compagnie de M. Paul Bourget. Entre temps, Mme Caillaux avait déposé entre les mains de l’huissier une carte dans une enveloppe fermée. A 6 h. 15, MM. Calmette et Bourget quittèrent le cabinet directorial en se dirigeant vers l’escalier pour sortir ensemble. C’est alors que l’huissier remit l’enveloppe fermée au directeur. Celui-ci l’ouvrit, montra la carte à M. Paul Bourget, et regagna son cabinet en disant : « Je ne peux pas ne pas recevoir une femme. »
Quelques secondes plus tard, Mme Caillaux était introduite dans le cabinet. « Tout en me levant, a-t-elle déclaré, j’avais tiré mon révolver de l’étui. » A peine en présence de M. Calmette elle lui dit : « Vous devez sans doute vous douter de l’objet de ma visite ? – Mais non, répondit-il, veuillez-vous asseoir. » « J’ai alors, avec ma main gauche, précise Mme Caillaux, abaissé le cran de sûreté du pistolet. » Et immédiatement elle a tiré.
L’homicide volontaire et la préméditation étant ainsi établis et résultant de l’exposé des faits, le Ministère public recherche les mobiles qui ont pu pousser Mme Caillaux à commettre un tel crime. Et voici textuellement ce que dit l’acte d’accusation.
Mme Caillaux, née Henriette Rainourd après avoir contracté un premier mariage en 1894, tandis que M. Caillaux, marié en 1906 à Mme Gueydan, devait lui-même divorcer en 1911.
Dans le courant de l’année 1909, M. Caillaux, qui entretenait de très amicales relations avec Mme Henriette Rainouard, adressa à celle-ci deux lettres renfermant, paraît-il, de nombreuses allusions à des questions d’ordre politique étroitement mêlées à des sujets d’ordre plus intime.
Or, ces lettres que M. Caillaux avait prié Mme Rainouard de lui retourner, furent soustraites par Mme Gueydan, sa femme. C’était aux mains de celle-ci une arme redoutable tant contre son mari que contre Mme Rainouard, et M. Caillaux paraît en avoir éprouvé une appréhension telle qu’en dépit d’une profonde passion, il écrivait le 25 septembre 1909 à Mme Rainouard pour lui proposer une rupture qu’il envisageait comme le seul moyen de la préserver du scandale et de sauvegarder sa réputation de femme et de mère.
Cependant, au bout de quelque temps, M. Caillaux et Mme Gueydan tombèrent d’accordj pour détruire les lettres en question, ce qui fut fait en présence d’un ami.
Mais si les originaux avaient cessé d’exister, Mme Gueydan, ainsi qu’elle l’a reconnu elle-même, en avait conservé des épreuves photographiques, et après le divorce, dès le début du mariage de M. Caillaux et de Mme Rainouard sa femme actuelle, vers la fin de l’année 1911, M. Caillaux, étant président du Conseil, des rumeurs inquiétantes parvinrent aux époux au sujet de ces photographies dont la divulgation leur apparut dès lors comme une imminente et perpétuelle menace.
Ils apprirent que ces lettres avaient été montrées à un journaliste, ainsi qu’une troisième adressée en 1901 à Mme Gueydan, celle-là même signée « Ton Jo », relative à l’impôt sur le revenu, qui fut publiée dans le numéro du Figaro du 13 mars 1914, et dont il sera parlé ci-après.
Cependant après la retraite du ministère Caillaux, une accalmie relative se produisit, quand, au mois de décembre 1913, après la constitution du ministère Doumergue et l’attribution du portefeuille des Finances à M. Caillaux, le Figaro entama contre ce dernier une campagne des plus vives.
Rien au début ne paraissait de nature à raviver des craintes au sujet de la publication des lettres intimes dont il a été question plus haut.
L’auteur des articles, M. Calmette, se maintenait dans le domaine des choses de la politique et de la finance ; mais jamais depuis longtemps polémique de presse n’avait revêtu un caractère aussi personnel et atteint un tel degré de virulence.
Les allégations de M. Calmette ne tendaient à rien de moins qu’à représenter M. Caillaux comme un homme d’argent coupable de forfaiture et de concussion et presque chaque jour paraissaient, sous la rubrique qui lui était consacrée dans le Figaro, de nouvelles imputations et de nouvelles invectives.
Tout cela, certes, était de nature à surexciter au plus haut point les personnes visées, et l’on comprend que l’inculpée, qui aime son mari ait été ulcérée par les attaques dont il était l’objet.
Jusque-là, cependant, rien dans cette série d’articles ne permettait de supposer que leur auteur pût aller chercher des armes ailleurs que sur un terrain politique, parlementaire ou financier.
Tout d’ailleurs dans le caractère comme dans le talent de M. Calmette devait, semble-t-il, contribuer à rassurer sur ce points les intéressés quand, le 13 mars 1914, fut publiée dans le Figaro la lettre signée « Ton Jo » dont en dépit de la suppression de certains passages d’ordre privé et eu égard au commentaire qui l’accompagne le caractère intime de lettre écrite par un homme à une femme apparaît indiscutable.
Du reste, M. Calmette, en toute franchise, précisait lui-même ce caractère dans les termes suivants : « C’est la première fois, depuis mes trente années de journalisme que je publie une lettre privée, une lettre intime, malgré la volonté de son détenteur, de son propriétaire ou de son auteur. »
Dès lors, d’après les déclarations de Mme Caillaux, une corrélation très étroite s’établit sans son esprit, entre la publication de cette lettre et l’imminence d’une autre divulgation qu’elle appréhendait par-dessus tout, celle des deux lettres à elle adressées en 1909, par M. Caillaux et soustraites par Mme Gueydan. Et voici quel aurait été son raisonnement : la lettre signée « Ton Jo », avait été en la possession de Mme Gueydan, qui détenait également les photographies des deux autres, la même source qui avait permis au Figaro de se procurer la première avait dû procurer le reste, et puisque cette première lettre était publiée la publication des autres allait suivre.
Il ne semble pas cependant que ces deux lettres aient jamais été en la possession du directeur du Figaro ni même qu’il ait tenté de se les procurer. Eussent-elles été entre ses mains, M. Calmette se fut interdit de les reproduire, si comme le déclare M. Caillaux, les considérations politiques y étaient tellement dispersées dans les développements sentimentaux que toute sélection dans leur texte était impossible.
Quoi qu’il en soit, Mme Caillaux paraît avoir été hantée par la crainte de leur divulgation qui lui avait même été annoncée comme imminente et son mari ressentait le contre coup de cette anxiété au point de faire dans la matinée du 16 mars une démarche auprès du Président de la République en vue d’arrêter la publication de ces lettres intimes.
Il subissait lui-même les impulsions de la colère et lorsque sa femme vint dans la matinée du 16 mars, au ministère des Finances lui rendre compte d’un entretien qu’elle venait d’avoir avec M. Monier, président du tribunal, au sujet des difficultés et des dangers d’un procès en diffamation, il ne put retenir que ces paroles : « Puisqu’il n’y a rien à faire, je me défendrai seul et j’irai casser la g… à Calmette. »
Enfin, dans cette même matinée du 16 mars, les inquiétudes de l’inculpée avaient puisé un nouvel aliment dans l’article même du Figaro consacré à son mari : « Intermède comique. » Pour moi, a-t-elle déclarée, cet intermède était la transition entre la publication de la lettre « Ton Jo », et celle des deux autres lettres.
M. Delbos, qui l’a vue à midi au ministère des Finances, a déclaré qu’elle lui avait donné l’impression d’un « être traqué. »
Tel était l’état d’esprit de Mme Caillaux dans la journée du 16 mars 1914 jusqu’à l’instant où elle a commis son acte criminel.
Mais quelle que soit l’agitation moral sous l’empire de laquelle elle a pu se trouver on ne peut que constater la facilité avec laquelle elle s’est arrêtée à l’idée du crime, l’enchaînement logique des faits par lesquels elle l’a préparé et le sang-froid dont elle a fait preuve dans son exécution.
En conséquence, Rainouard Geneviève-Joséphine-Henriette, épouse Caillaux, est accusée :
D’avoir le 16 mars 1914, à Paris, commis un homicide volontaire sur la personne de Gaston Calmette, avec cette circonstance que l’homicide dont il s’agit a été commis avec préméditation, crime prévu par les articles 295, 296 et 302 du Code pénal.
Le président. – Ainsi, madame, vous êtes accusée d’avoir commis un homicide volontaire sur la personne de Gaston Calmette et ce avec préméditation. Vous allez entendre les charges qui sont produites contre vous. Veuillez-vous asseoir.
(S’adressant à M. l’huissier-audiencier.)
Veuillez faire l’appel des témoins.
(Il est procédé à cet appel.)
Le bâtonnier Chenu. – Je crois devoir donner une indication à la Cour. Avertis ce matin, par la liste de témoins de la défense, de l’effort qui se porterait sur le terrain médical, nous nous réservons aujourd’hui même de faire citer comme témoin M. le professeur Delbet. J’espère ne rencontrer de difficulté ni du côté du ministère public ni du côté de la défense.
Le procureur général. – Aucune.
Le bâtonnier Labori. – Aucune.
Le bâtonnier Chenu. – La citation sera notifiée dès ce soir même.
Le président. – Vous vous appelez Geneviève – Joséphine – Henriette Raynouard, vous êtes née le 6 décembre 1874 à Rueil (Seine-et-Oise). En 1894, vous avez épousé M. Léo Claretie, vous avez eu deux enfants de ce mariage, et vous avez divorcé d’avec lui en 1908.
Vous vous êtes remariée avec M. Caillaux en octobre 1911, c’est exact ?
Mme Caillaux. – Oui.
Le président. – A l’instruction, outre ces renseignements d’état civil, vous avez donné d’autres indications concernant votre existence passée, veuillez les fournir à nouveau à MM. les jurés et dire en cette occasion tout ce qui vous paraîtra utile.
Mme Caillaux. – Monsieur le président, j’ai été élevée comme l’on été toutes les jeunes filles de mon époque, je n’ai jamais été en pension, je n’ai jamais quitté mes parents jusqu’au jour de mon mariage. Je me suis mariée à l’âge de dix-neuf ans avec M. Léo Claretie, l’homme de lettres ; des dissentiments sont survenus aussitôt dans notre ménage, nos caractères ne s’accordaient pas ; plusieurs fois, j’ai été sur le point de rompre cette union, mais j’avais deux enfants, deux filles, et pour elles, j’ai attendu. Enfin, au mois de mars 1908, de nouveaux dissentiments étant survenus entre nous, j’ai demandé le divorce que j’ai obtenu très rapidement, j’obtenais en même temps la garde de mes deux filles. Quelques mois après j’avais le très grand malheur de perdre la seconde à l’âge de neuf ans.
Au mois d’octobre 1911, je me remariai avec M. Joseph Caillaux, alors président du Conseil des ministres. J’ai trouvé dans ce mariage le bonheur le plus complet, j’avais tout, j’ai tout. Si nous n’avions pas été empoisonnés par la calomnie, j’aurais tout pour être heureuse. J’ai un mari qui me rend au centuple l’affection que j’ai pour lui, j’ai une fille qui a maintenant plus de dix-neuf ans et qui est la joie de notre maison. M. Caillaux m’avait apporté une belle situation, la situation de ministre était brillante ; nous avons une belle fortune qui nous permet de vivre largement, et je tiens à dire ici tout de suite que ce n’est pas cette abominable et considérable fortune que la calomnie nous prête depuis notre mariage, mais que nous avons une bonne et loyale fortune que nous avons reçue de nos parents chacun par parts à peu près égales. Cette fortune (M. le bâtonnier en a les preuves et vous les donnera si vous le voulez), cette fortune ne s’est pas augmentée depuis le jour où, chacun de notre côté, nous avons reçu notre part de l’héritage de famille.
Malheureusement, monsieur le président, la calomnie est entrée tout de suite dans notre maison. A peine étions-nous mariés – je ne sais pas si c’est avant ou après mon mariage – qu’aussitôt nous avons été avertis par la première femme de mon mari, Mme Gueydan, avait conservé par devers elle des photographies de lettres et qu’elle cherchait à en faire un scandale pour se venger de notre mariage. Ces bruits nous sont revenus à plusieurs reprises, en particulier au moment de la chute du ministère Caillaux.
En même temps… ah ! Cette calomnie, des bruits ignobles sur mon mari ont été répandus ; tout Paris sait bien qu’on a dit à ce moment-là qu’il était malade, qu’il devenait fou, qu’il se livrait en public à mille extravagances. Tout le monde les racontait….
Le président. – Madame, pour ne pas nous perdre dans les détails de l’affaire et les circonstances qui l’ont précédée, je vais vous poser des questions spéciale pour vous permettre de répondre d’une façon précise à tous les faits qui vous sont reprochés, et pour vous permettre également de préciser toutes les circonstances qui les ont précédés ou suivis. Vous vous expliquerez tout à l’heure sur l’acte criminel dont vous êtes accusée, mais je tiens tout d’abord à vous faire préciser les circonstances qui l’ont précédé, et j’arrive tout de suite à vos déclarations dès le début de l’information. Vous avez dit au moment de votre arrestation – je cite vos paroles : « Irritée d’être l’objet d’injures et de diffamations dans les journaux, et plus particulièrement dans le Figaro, il m’a semblé que mon mari ne pouvait se défendre, à cause de sa situation, et qu’il m’appartenait de le venger des outrages qui rejaillissaient sur nous deux. » Veuillez sur ce point faire connaître à messieurs les jurés quelle influence avait sur votre esprit la campagne du Figaro.
Mme Caillaux. – Quand la campagne du Figaro a commencé ; j’étais déjà dans un esprit que l’opinion publique avait préparé. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, c’est pour cela que j’aurais voulu vous dire ce qui s’était passé avant la campagne, si ce n’est pas abuser…
Le président. – Non, vous en avez le droit. Je croyais que vous aviez terminé en ce qui concerne les circonstances précédentes.
Mme Caillaux. – On a répandu des bruits sur mon mari ; j’ai commencé à souffrir de la calomnie lorsque j’étais nouvellement remariée. Tout le monde m’accueillait avec des sourires d’ironie ; vous comprenez, tout le monde racontait que c’étaient des soi-disant folies de mon mari. Je sentais bien qu’on se moquait de moi et j’étais un peu ridicule.
Ce n’est pas tout. Au même moment, des bruits abominables de fortune mal acquise ont commencé à circuler dans tout Paris : on disait que mon mari – oh ! Des journaux l’ont raconté ! – avait fait un coup de bourse à Berlin, au moment de la discussion franco-marocaine, que ce coup de bourse lui avait rapporté beaucoup d’argent ; ce qu’on disait surtout ; c’est qu’il avait vendu le Congo à l’empereur d’Allemagne, tout Paris a connu cette histoire d’une couronne de 750 000 francs, qui m’aurait été donnée comme cadeau de noces et qui aurait été payée par l’empereur d’Allemagne. Je voyais ces bruits ce répandre non seulement dans un certain monde, mais pénétrer un peu dans toutes les couches de la société. C’était très pénible pour moi.
Enfin, il y eut un moment d’accalmie. Nous avons voyagé. Les passions politiques étaient très surexcitées et à un moment, je me suis aperçue combien la calomnie avait fait ses ravages ; plusieurs faits me l’ont prouvé. Je ne pouvais plus assister aux séances de la Chambre, j’entendais toujours dire autour de moi quelque chose de désagréable pour mon mari dans les tribunes. Permettez-moi, monsieur le président, de vous citer un fait, si vous ne trouvez pas mes explications trop longues !
M. le président. – Non, expliquez-vous.
Mme Caillaux. – Un jour, c’était au moment de la discussion de la loi militaire, mon mari s’apprêtait à monter à la tribune, j’étais dans la galerie. Il y avait un jeune ménage derrière moi qui, au moment où mon mari est monté à la tribune, s’est mis à piétiner et à crier de toutes ses forces : « Caillaux, Congo ! Caillaux, Congo ! À Berlin ! À Berlin ! » Toutes les personnes qui étaient dans la galerie leur ont donné raison. Il y avait là, la femme d’un chef de cabinet de ministre, la femme d’un député de la droite. J’ai été obligée de m’en aller, honteuse ; je suis sortie comme une folle. J’ai raconté ce fait au chef des huissiers. J’étais très bouleversée. Ce n’est pas la première fois qu’on lançait devant des calomnies comme celle-là contre mon mari. Je sentais toujours monter cette réputation de fortune mal acquise, il m’en venait des échos de tous les côtés. C’étaient mes amis, mes domestiques qui me racontaient, qu’ils étaient félicités d’être chez un homme qui avait tant volé d’argent et chez lequel ils devaient faire tant de bénéfices. Tout le monde, mes fournisseurs, mes couturières, me racontaient cela, ne se doutant pas du mal qu’ils me faisaient. Ils me disaient qu’ils se disputaient avec leurs clients et avec leurs amis pour déclarer que mon mari n’avait pas vendu le Congo.
A l’automne, lorsque le ministère Barthou est tombé, on a demandé à mon mari de reprendre le pouvoir. Je savais combien l’opinion publique était contre lui, je savais que, s’il revenait au pouvoir, on allait reparler de l’impôt sur le revenu, car c’était cela qui excitait beaucoup les gens contre lui. Cela m’avait fait très peur ; je ne voulais pas qu’il redevienne ministre. Mais on lui a fait valoir des considérations de devoir vis-à-vis de son parti et je me suis inclinée. Je lui aie dit à ce moment-là que cela lui porterait malheur… Hélas ! Je ne prévoyais pas comment. Je ne me trompais pas ! C’est alors que commença la campagne du Figaro. Ah ! Elle fut tout de suite implacable, elle n’avait rien de politique, elle était personnelle, et à mesure que les affirmations du Figaro soulevaient des dénégations, on voyait que cela excitait l’auteur des articles, que ceux-ci devenaient de plus en plus violents. Tous les jours, il y avait une nouvelle attaque, contre mon mari. Enfin, je sentais que l’auteur des articles s’exaspérait ; en voici la preuve. Au mois de février, il disait qu’il ne ferait jamais ce qu’il a fait le 13 mars. Il écrivait que tous les moyens lui seraient bons pour abattre Caillaux, qu’il ne reculerait devant aucun procédé. C’est alors que la lettre « Ton Jo » a paru. Beaucoup de raisons me faisaient penser que les miennes allaient suivre… Alors, je souffrais tellement que j’ai perdu la tête… Voilà !
Le président. – Vous en étiez au moment où votre mari est devenu président du Conseil et où la campagne du Figaro a repris très vive contre lui ; mais, jusqu’au 8 mars, cette campagne paraissait avoir un caractère politique, vous, vous avez pensé qu’elle point ce caractère-là. Veuillez-vous expliquer sur ce point devant messieurs les jurés.
Mme Caillaux. - Je crois, monsieur le président, qu’il n’est pas une personne qui, ayant lu les 138 articles du Figaro, puisse dire que la campagne n’avait qu’un caractère politique. J’ai compté au moins 138 articles en trois mois ; en 95 jours exactement, il y a eu 138 articles ou dessins injurieux contre mon mari. Ils étaient presque tous à la première page. Dans ces 138 articles, je ne compte pas les comptes rendus de la Chambre et du Sénat dans lesquels mon mari n’était pas ménagé, bien entendu. C’était le droit du directeur du Figaro d’attaquer la politique de mon mari, mais ce n’est pas cela qu’il a fait. Dans toutes ces attaques, il l’accusait d’avoir employé des moyens déshonorants pour parvenir à des buts de politique personnelle. Il y a bien quelques articles sur le traité franco-marocain, c’est certain, mais si on veut bien comparer ces critiques aux articles élogieux que sur le même sujet, M. Calmette consacrait à mon mari deux ans plus tôt, ces critiques semblent étranges. D’ailleurs, elles sont pleines de diffamations, il est facile de s’en rendre compte. On n’a qu’à se reporter aux ouvrages qui ont été écrits sur ce sujet, surtout au livre qui fait foi sur tout ceci, « Le Livre jaune », qui a été édité par le ministère des affaires étrangères. Non, ce n’est pas la politique de M. Caillaux que l’on a surtout attaquée. Il y a bien quelques critiques à propos de l’impôt sur le revenu, mais ce pas sur ce point qu’a porté le grand effort du Figaro. On répétait toujours la même chose, c'est-à-dire que M. Caillaux avait abusé de sa situation de ministre pour atteindre des buts de politique personnelle.
Monsieur le président, me permettez-vous de lire quelques petites phrases que je détache, presque au hasard ?
Le président. – Parfaitement, vous pouvez lire tout ce que vous voudrez, il n’y a que les témoins qui n’ont pas le droit de lire au cours de leur déposition. Mais il est bien entendu que votre lecture portera toujours sur le même point, afin que nous ne nous perdions pas et que nous puissions préciser tout ce qui va être dit.
Mme Caillaux. – Je vous prierai, monsieur le président, de m’avertir, si j’abuse… A un moment donné le Figaro parla d’un grand scandale, de l’affaire Prieu. Ce n’était pas de la politique, cela. Mon mari était accusé de vouloir se procurer de l’argent pour ses besoins politiques. Il y avait aussi l’affaire du Comptoir d’Escompte, de la Société Générale, l’affaire de la banque Périer, d’une soi-disant autorisation d’admission à la cote. Mon mari était accusé d’avoir consenti à l’émission de 28 valeurs, alors qu’il n’en avait autorisé que 3. Il y a eu aussi l’affaire Rochette, enfin des quantités d’autres prétendus scandales.
Pour l’affaire Prieu, Caillaux prélevait sur les contribuables 5 ou 6 millions sous le prétexte enfin de les restituer à titre d’indemnité aux héritiers Prieu, auxquels il abandonnait 20 % de cette manne.
Les 80 % c’était pour lui. Pour l’affaire Prieu, le directeur du Figaro a cherché à acheter des faux témoins contre mon mari ; ceci peut être prouvé. Mais cela ne le gêne pas du tout et il entreprend une nouvelle affaire. C’est l’affaire du Comptoir d’Escompte… Je ne voudrais pas abuser de ces messieurs. Nous avons obtenu, au sujet du Comptoir d’Escompte les démentis les plus formels en notre faveur ; M. Rostand, le président du conseil d’administration ; M. Ulmann, le directeur, tous ces messieurs ont dit qu’il n’y avait rien de vrai, qu’on ne leur avait rien demandé, que par conséquent, ils n’avaient rien donné.
Voyez M. Ulmann, par exemple, qui donne sa parole d’honneur que le ministre des finances ne lui a rien demandé. Savez-vous ce qu’on répond dans le Figaro ? On injurie M. Ulmann, on dit : « Je le croyais seulement l’ami du ministre, hélas ! Il est son complice ». Et puis quand on a écrit tout cela et que tout le monde a montré qu’il n’y avait rien de vrai, on dit : « Nous réclamons l’orgueil et la joie d’avoir par notre force diminué, supprimé peut-être les ressources que M. Caillaux recueillait peut-être facilement sur la peur ». Eh bien, est-ce de la politique ? Mais ce n’est pas tout, il y a plus grave encore. Le directeur du Figaro accuse mon mari d’avoir également abusé de sa situation de ministre, pour se procurer des ressources personnelles, non seulement pour se créer une caisse noire pour ses besoins politiques, mais de se faire donner par la peur de l’argent pour lui et de se faire donner des conseils d’administration. Naturellement, il fait comme s’il ignorait que mon mari… mon Dieu, en dirigeant deux sociétés de crédit qui n’ont rien en commun avec l’Etat, faisait autre chose que d’exercer son métier, comme beaucoup d’autres députés, quand ils ne sont pas ministres, bien entendu. Eh bien, mon mari, c’est la même chose ; c’est quand il n’était pas ministre qu’il exerçait son métier. Enfin, c’est tout naturel, et beaucoup de députés sont avocats, avocats-conseils, membres de conseils d’administration, et bien souvent rien ne les désigne pour ce genre d’affaires. Mais c’est défendu à mon mari, qui est financier de métier ; celui lui est défendu d’exercer son métier, quand il n’est pas ministre, cela, on le lui défend.
Et alors, ce ton, messieurs… Vous permettez que je lise deux ou trois passages ? … monsieur le président.
Le président. – Continuez, madame : MM. les jurés doivent connaître toute votre défense et par conséquent vous avez le droit de dire ce que vous croyez utile.
Mme Caillaux. – On dit que mon mari conserve cette présidence de conseil d’administration alors que sa démission est régulièrement donnée ; on l’accuse de présider les banques les plus extraordinaires. Mais vous allez voir. Le 22 décembre : « Le ploutocrate démagogue du Crédit foncier algérien » - il n’en a jamais fait partie – « du Crédit foncier algérien » et des « prébendes grassement rétribuées par l’étranger… » Mais tenez, messieurs : « Sur le milliard apporté par ses amis et pour ses amis, le quart au moins est irrémédiablement perdu ; en six mois, un milliard est sorti de nos villes et de nos campagnes sur le visa de cet homme officiel pour augmenter sa fortune personnelle. »
Eh bien, vraiment, je me demande si c’est de la politique, cela : on ne peut pas accuser plus franchement quelqu’un d’être un traître à son pays, mais aussi d’être un voleur. Voyons, je pourrais en lire indéfiniment comme cela. Mais ce n’est pas tout. On dit aussi que mon mari est une honte pour l’étranger, qu’il travaille pour la Banque sud-américaine, pour le roi de Prusse, et il est dit en grosses lettres dans le Figaro : « On se demande comment on fera quand viendront les souverains étrangers », parce qu’il est la honte pour notre pays, et alors tous les potins sur lesquels je ne veux pas insister, qui concernent le roi d’Angleterre et le roi d’Espagne. Eh bien, vraiment, quelqu’un d’indépendant peut-il dire que cela touche à la politique ? Je ne le crois pas. Je pourrais encore vous en citer de nombreux exemples, mais je ne veux pas vous ennuyer ; mais la mauvaise foi qui préside à tout cela est extraordinaire. Tenez… je me garderai bien de prononcer des noms ou des chiffres : « Les démentis du ministre des finances ; quoique plus rares depuis trois jours, étant trop faciles sur le chapitre où aucune preuve ne peut être apportée, arrachée au domaine des conversations privées » - on ne dit pas avec qui. Et plus loin : « Je souhaite que bientôt le crime soit porté à la tribune de la Chambre, pour le malfaiteur officiel reçoive le châtiment public. » Puis on dit encore : « Tout se résume par un mot : infamie ; par un seul nom : Caillaux ».
Enfin l’auteur s’exaspère ; il voit bien qu’il ne ruine pas le ministre qu’il attaque, dans un certain public… Oh ! Je sais bien que c’est dans le public ennemi de l’impôt sur le revenu, qu’il l’attaque, mais je sais aussi qu’il ne l’atteint pas au Parlement où tout le monde rend hommage à sa parfaite honorabilité.
Mais on veut aller plus loin, la menace est plus directe : « C’est l’instant décisif où il ne faut reculer devant aucun procédé, si pénible qu’il soit pour nos habitudes, si réprouvé qu’il soit par nos manières et nos goûts. » C’est le 10 mars que le directeur du Figaro écrit cela. Le 13, la menace est exécutée ; la première des trois lettres paraît ; c’est la lettre « Ton Jo ». Au début, on nous avait bien prévenus que cette lettre allait paraître, mais nous n’avions pas voulu le croire…
Le président. – Madame, avant d’arriver à cette lettre, c'est-à-dire au 13 mars, il serait bon que nous sachions un peu tout ce qui s’est passé relativement aux trois lettres intimes, qui comme vous l’avez dit dans un de vos interrogatoires, formaient une sorte de trilogie, et je crois que le moment est venu de vous demander quelques précisions à cet égard.
Avant votre mariage, vous étiez pendant l’été de l’année de 1909 chez Mme Guillemard, en villégiature, je crois, à Saint-Enogat. M. Caillaux vous a écrit à cette date deux lettres, une très longue de seize pages, celle qui vous a le plus préoccupée tout à l’heure, c'est-à-dire celle où la politique était mêlée à des choses intimes, et une autre plus courte, dont il n’est pas grandement question dans l’affaire. Ces lettres vous sont arrivées au mois de septembre 1909, et vous les auriez montrées, je crois, à Mme Guillemard, qui, elle, s’est expliquée sur ces lettres.
Voulez-vous dire à MM. les jurés dans quelles circonstances vous avez reçu ces deux lettres de M. Caillaux et dans quelles circonstances vous les avez renvoyées à M. Caillaux ; puis vous vous expliquerez pour ne pas multiplier les questions, sur la teneur même de la lettre en question, la lettre de seize pages ?
Mme Caillaux. – Oui, monsieur. Comme vous le savez, j’étais à Dinard chez mon amie, quand M. Caillaux m’écrivit deux lettres à deux ou trois jours d’intervalle ; puis, quelques jours après, sous un prétexte que je n’avais pas à discuter, M. Caillaux me pria de les lui renvoyer poste restante au Mans. Je me rendis à son désir. Avant, j’avais montré ces lettres à mon amie en effet, et je les ai renvoyées poste restante au Mans, comme M. Caillaux me l’avait demandé.
Voilà ce qui s’est passé. D’ailleurs le récit en est dans une lettre…
Le président. – Parlons tout de suite de la lettre de M. Caillaux du 25 septembre dans laquelle il vous raconte dans quelles circonstances les deux lettres avaient disparu, avaient été détournées par sa première femme. Expliquez à messieurs les jurés également ce fait-là.
Mme Caillaux. – J’ai renvoyé les lettres ; M. Caillaux les avait rangées dans le tiroir de son bureau au rez-de-chaussée. Le lendemain matin… Je suis extrêmement gênée pour expliquer tout cela.
Le président. – Ne dites que ce que vous voulez dire, vous n’êtes pas obligée de dire ce que vous ne voulez pas dire.
Mme Caillaux. – Je vais être obligée de mettre en cause plusieurs fois la première femme de mon mari, Mme Gueydan ; elle est le pivot de toute mon affaire ; je m’efforcerai de le faire avec le plus de discrétion possible. Enfin mon mari apprenait le lendemain que sa femme, à l’aide d’une fausse clef ; la nuit, avait pris les lettres, et lui avait dit que les lettres étaient en sûreté, qu’elle ne voulait pas s’en servir pour divorcer, qu’elle avait voulu avoir des armes contre son mari et contre moi, qu’elle allait avec ces lettres me déshonorer. Elle voulait les porter à mon père pour qu’il me déshérite, à mon ancien mari pour qu’il me reprenne la garde de ma fille, à ma fille elle-même (une enfant de quinze ans !) elle voulait les lui faire parvenir pour qu’elle les lise.
Enfin, M. Caillaux eut tellement peur pour moi qu’il me fit comprendre que nous devions renoncer l’un à l’autre. Il craignait même tant pour ma vie qu’il m’obligea à partir secrètement en voyage. Je suis partie justement avec mon amie !
Le président. – C’est Mme Guillemard ?
Mme Caillaux. – Oui. J’étais dans un tel état de désespoir que je ne suis pas partie toute seule. A Florence où je me trouvais avec elle dans les premiers jours de novembre, je reçus une dépêche du secrétaire de M. Caillaux.
Le président. – Ah ! Oui…
Mme Caillaux. – Non, monsieur le président, ce n’est pas celle-là. J’ai reçu une dépêche du secrétaire de M. Caillaux me disant que je n’avais plus rien à craindre, que les lettres étaient brûlées, que M. Caillaux s’était embarqué la veille pour l’Egypte avec sa femme avec laquelle il était réconcilié.
Je rentrais à Paris le cœur brisé. J’y appris qu’en effet M. Caillaux avait bien pris toutes ses précautions pour moi, que les lettres avaient été brûlées en présence de M. Privat-Deschanel et que Mme Caillaux-Gueydan avait donné sa parole d’honneur qu’elle en avait gardé ni copie ni photographie : c’était le gage de la réconciliation.
Pas besoin de vous dire l’hiver que j’ai passé, mon chagrin.
Mais tout d’un coup, au mois de juillet suivant, le hasard me redevint favorable…
Le président. – Juillet 1910 ?
Mme Caillaux. – Oui ; monsieur le président, 1910.
A ce moment, on demanda le divorce… Bien entendu, je m’étais inclinée, j’étais dans le chagrin, dans le désespoir par suite de cette rupture douloureuse que j’avais acceptée, mais je m’étais inclinée devant les raisons que M. Caillaux m’avait données, si douloureuses qu’elles fussent pour moi. Mais enfin, comme je viens de le dire, le hasard me devint favorable : Mme Gueydan ne voulait pas divorcer, les pourparlers traînèrent. Cela nous mène au mois de février 1911. Au mois de février 1911, la veille du jour où le divorce demandé par M. Caillaux allait être plaidé, Mme Gueydan sortit une lettre dont elle n’avait jamais parlé, que M. Caillaux lui avait écrite à peu près dix ans auparavant. C’est la lettre « Ton Jo » que le Figaro a publié. Elle avait montré cette lettre à différents hommes politiques. Mme Gueydan pensait que la menace de la lecture de cette lettre au débat du divorce empêcherait M. Caillaux de divorcer. Mais M. Caillaux n’était pas homme à reculer devant un argument de cette espèce et la veille du jour où le divorce allait être plaidé on s’entendit pour un divorce d’accord. Il fut entendu que les lettres qu’on avait échangées de part et d’autre dans le ménage seraient détruites, parmi elles bien entendu, la lettre « Ton Jo » et pour cette lettre, Mme Gueydan cette fois encore donna sa parole d’honneur qu’elle n’en avait gardé ni la copie ni la photographie. Les avoués Me Duplan et Me Thorel peuvent le certifier.
Mais, monsieur le président, si vous voulez bien me le permettre, je voudrais faire remarquer à messieurs les jurés qu’il y avait eu une rupture complète et sincère de notre part, M. Caillaux et moi, que je n’étais pour rien dans le divorce qui est survenu.
Mon nom même, je crois, n’a pas été prononcé.
Il est utile d’établir que si Mme Gueydan était divorcée c’est parce qu’elle l’avait voulu, que cela lui avait convenu ou enfin qu’elle en était responsable. Moi, je n’y suis pour rien, mon nom n’a pas été prononcé.
Le président. – Nous ne connaissons pas le jugement de divorce, il n’est pas au dossier, je n’ai pas à en parler. Revenons un peu en arrière pour ne pas perdre le fil de tous les événements qui se sont succédé.
Au mois de novembre 1909 vous avez dit que vous aviez su que les lettres dont vous avez parlé tout à l’heure avaient été brûlées par M. Privat-Deschanel, deux ou trois lettres, une lettre de sept pages, d’autres lettres plus courtes, peut-être la lettre « Ton Jo », peut-être d’autres encore, peu importe. Mais vous avez reçu vers cette date, le 25 novembre 1909, je précise, un télégramme qui venait du Caire. Ce télégramme qui est au dossier, puisqu’il a été saisi en même temps que la lettre adressée par M. Caillaux le 25 octobre dans laquelle il vous disait que les lettres dont nous avons parlé tout à l’heure avaient été soustraites par Mme Gueydan. Ce télégramme était ainsi conçu :
« … Vous mettre en garde, preuve de cette trahison. »
A quelle date avez-vous reçu ce télégramme et à quoi se rapporte-t-il ? Indiquez-le-nous, si toutefois cela intéresse l’affaire, car dans le dossier il n’y a rien à cet égard.
Mme Caillaux. – Il intéresse l’affaire de bien loin, je ne demande pas mieux de m’expliquer, mais cela va m’obliger à entrer dans des détails.
Le président. – Si cela n’intéresse pas directement l’affaire, ne vous expliquez pas.
Mme Caillaux. – Si, tout de même, je vais m’expliquer, puisque vous me le demandez.
Du jour où Mme Gueydan a pris ces lettres, j’ai été l’objet d’un espionnage continuel chez moi. Ma femme de chambre, ma concierge – ce sont là de tout petits détails, mais je vous les indique puisque vous me demandez de m’expliquer – allaient rendre compte à Mme Gueydan de tout ce qui se passait chez moi. Mon père donnait un déjeuner, on répétait ce qui s’était passé. Naturellement, mon père n’a jamais su tout cela. Mais tous les petits propos qui étaient tenus chez moi, étaient immédiatement rapportés. Aussi, bien que nous ayons rompu toutes relations, M. Caillaux et moi, il ne pouvait me laisser en but à cet espionnage perpétuel.
Il m’avait promis de me faire savoir, par l’intermédiaire de notre avoué, s’il arrivait à se faire dire qui m’espionnait.
Le président. – C’est une chose tout à fait simple : c’est quelqu’un de votre entourage ou de votre service qui allait raconter ce qui se passait chez vous. Voilà l’explication.
Mme Caillaux. – Comme nous avions complètement rompu, même toute correspondance, M. Caillaux ne voulait même pas m’écrire qui me trahissait ; il m’a fait dire d’aller chez Me Thorel pour le demander.
Le président. – Vous avez su que les lettres sur lesquelles vous vous êtes expliquée avaient été brûlées… A quel moment avez-vous su que des photographies en avaient été conservées ?
Mme Caillaux. – Ne voudriez-vous pas, monsieur le président, que j’explique un peu ce qu’il y avait dans ces lettres ?
Le président. – C’est en effet le moment. Si vous désirez vous expliquer là-dessus, faites-le tout de suite.
Mme Caillaux. – Je dois dire que ces malheureuses lettres, c’est peut-être moi qui les connais le moins ; je les eues quelques jours en ma possession, il y a cinq ans, mais enfin je peux donner quelques renseignements dessus.
Ces lettres étaient, bien entendu, tendres. Elles étaient écrites dans les termes que peut employer un homme bien élevé écrivant à une femme bien élevée ; mais c’était surtout comme une espèce de biographie depuis le mariage que M. Caillaux avait fait trois ans auparavant. Il me disait combien il avait été heureux de me rencontrer et il me parlait de l’espoir, assez vague d’ailleurs, qu’il avait formé de se rendre libre un jour. Il me disait aussi – toute la lettre est écrite dans un style assez élevée et toujours d’une haute portée morale, cela je le garantis, - M. Caillaux me disait – et là toute la délicatesse de son caractère se montrait – il me disait les scrupules qu’il avait à briser des liens qui pourtant lui avaient donné peu de bonheur.
Mais, ce qui pouvait rendre très intéressantes les lettres pour le Figaro, c’est qu’il y disait aussi les raisons de politique locale pour lesquelles il jugeait ne pas devoir divorcer six mois avant la période électorale. Il me faisait la psychologie moyenne des électeurs.
C’est là ce qui pouvait faire craindre la publication de fragments de cette lettre dans le Figaro, c’est qu’au moment où allait s’ouvrir une nouvelle période électorale, à côté de la phrase sur l’impôt sur le revenu, il aurait été intéressant d’afficher en grandes lettres sur les murs de toutes les communes de France les raisons pour lesquelles M. Caillaux jugeait ne pas devoir entamer une procédure en divorce avant la période électorale. Et, monsieur le président, ces raisons étaient très mêlées aux raisons intimes ; on pouvait difficilement les séparer les unes des autres, et cela se comprend. Dans cette lettre, M. Caillaux naturellement parlait aussi de moi, de ma situation de femme seule. J’étais divorcée depuis dix-huit mois. Il parlait de ma vie.
Quant à la seconde lettre…
Le président. – La plus courte ?
Mme Caillaux. – La courte… J’ai deux souvenirs de cette lettre. Elle était écrite sur papier à entête de la préfecture de la Sarthe, et elle était fort courte, comme vous le disiez, monsieur le président. M. Caillaux y racontait qu’il avait fait un placement d’une partie de sa fortune, placement qui lui avait rapporté un certain bénéfice.
Voilà, en mon âme et conscience, tout ce que je peux dire sur ces lettres tout à fait convenables, je le répète.
Le président. – Je répète ma question de tout à l’heure ; à quel moment avez-vous su que des photographies de ces lettres avaient été conservées ?
Mme Caillaux. – Je l’ai su presque aussitôt après mon mariage ou peut-être quelques jours avant, je ne peux pas le préciser ; je l’ai su par M. Pierre Mortier qui est venu le dire à mon mari ; M. Desclaux est également venu dire à mon mari que ces lettres avaient été offertes par Mme Gueydan à M. Vervoort.
Le président. – Vous avez dit tout à l’heure que c’était un peu avant ou un peu après votre mariage que l’on vous parla de ces lettres que Mme Gueydan avait conservées. Est-ce à ce moment que vous avez su que Mme Gueydan les aurait offertes à M. Vervoort, lequel aurait raconté à M. Declaux l’entretien qu’il aurait eu avec Mme Gueydan ?
Mme Caillaux. – Oui, monsieur, nous en avons entendu parler de plusieurs côtés.
Le président. – Parlez du fait Vervoort d’abord.
Mme Caillaux. – Mon mari vous donnerait des explications plus précises. C’est lui qui est venu me dire que nous étions menacés de la publication de ces lettres, qu’elles avaient été offertes à M. Vervoort. M. Vervoort en citait les termes absolument connus de nous seuls et identifient ces lettres.
Le président. – M. Caillaux vous a raconté qu’il tenait de M. Desclaux la substance d’un entretien que celui-ci avait eu avec M. Vervoort, à l’occasion d’une entrevue de M. Vervoort avec Mme Gueydan… Nous reviendrons tout à l’heure sur cet incident au moment où M. Vervoort sera là.
D’autres personnes vous ont-elles parlé de ces lettres après votre mariage ?
Mme Caillaux. – Oui, monsieur le président. De plusieurs côtés, nous étions prévenus, nous avions été avertis qu’elles avaient été offertes à M. Bailby, directeur de l’Intransigeant. Or, j’étais en relations avec Mme Chartran, et comme Mme Chartran est une amie de M. Bailby, nous lui avons demandé d’intervenir auprès de ce dernier. Mme Chatran le fit avec sa bonne grâce habituelle et elle vint nous donner la réponse. Elle nous dit que M. Bailby lui avait dit m’avoir rencontrée dans le monde autrefois, et qu’il s’était engagé à ne pas publier les lettres.
Quelques temps après, Mme Chatran me demanda d’intervenir auprès de mon mari pour obtenir un petit service – je ne me rappelle plus lequel, - pour M. Bailby. Plusieurs fois elle est revenue me demander d’insister auprès de mon mari, me disant : « Vous savez combien M. Bailby a été gentil pour vous, combien il s’est conduit en galant homme. » C’est donc bien de mes lettres qu’il était question et pas d’autres, puisqu’elles me concernaient personnellement et que Mme Chartran me demandait en retour de rendre un service à M. Bailby.
Le président. – D’autres personnes vous en ont-elles parlé ?
Mme Caillaux. – Tout le temps nous en entendions parler : c’était à la Chambre, dans les couloirs… Tous les journalistes en parlaient. Elles avaient été un peu partout ces lettres, mais je ne peux pas vous donner à ce sujet d’autres précisions que celles que je viens de vous fournir.
Le président. – Alors, avant la publication de la lettre « Ton Jo », vous n’aviez pas la certitude que ces lettres pouvaient être entre les mains de M. Calmette. Pensez-vous qu’il désirait se les procurer ou pensez-vous qu’il les avait entre les mains ?
Mme Caillaux. – Je savais qu’il avait désiré se les procurer par une conversation qu’il avait eue. Mon mari et moi avions très peur. C’est une conversation à laquelle Mme la princesse Estradère avait assisté et qu’elle m’a rapportée. C’est par cette conversation que j’ai su que M. Calmette cherchait à se procurer les papiers…
Le président. – A quelle époque cette conversation ? On a dit dans le mois de janvier…
Mme Caillaux. – Oui, mais quand on me l’a rapportée, c’était environ un mois avant la publication.
Le président. – Eh bien, arrivons au moment de la publication… Nous préciserons quand les témoins seront entendus, tous les points qui ne seront pas suffisamment indiqués quant à présent. Vous avez dit à l’instruction qu’en voyant dans le Figaro du 13 mars un extrait de la lettre « Ton Jo », vous avez compris que les deux lettres soustraites à M. Caillaux en 1909 seraient publiées. Vous avez expliqué – c’était là vos paroles, je les cite – qu’il n’y avait pas de doute pour vous à cet égard. Le journal portait « que la personne à laquelle cette lettre avait été adressée avait enseveli dans l’oubli et le deuil ses illusions et sa foi ». Vous avez dit : « Chacun de ces mots était un coup de poignard pour moi ; il constituait une allusion certaine aux autres lettres. » Voulez-vous exprimer toute votre pensée à MM. les jurés et leur dire pourquoi vous craigniez la publication de ces lettres ?
Mme Caillaux.