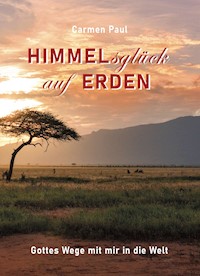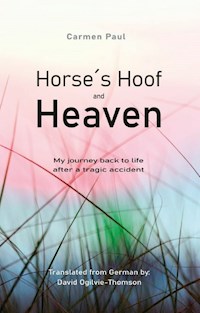Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: MarTONius
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Französisch
La fille voulait faire du cheval et maman achetait trois montures. A Paques 2000 une excursion à la forêt, une faute avec l'animal, et un sabot trouve le visage de Carmen. Les blessures font tout le monde craindre le pire. Pendant l'opération et le coma après Carmen rencontre le Seigneur.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 262
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Carmen Paul
Le Sabot et le Ciel
Mon chemin de retour à la vie après un accident tragique
traduit de l’allemand par Eva Paul
Relecture : Dieter Paul
Original allemand : Pferdefuß und Himmelsglück, KIE-Media, 2019
Tous droits avec la maison d'édition martonius
Copyright © 2020
Martin Korpowski
Inhalt
Préface
1. Marquant
2. Confrontation
3. Klaus
4. Le tournant de 1989
5. Le pépin
6. Chance céleste
7. Une différence colossale
8. Christophe
9. Déménagement au bord de la baltique
10. Aventure à Wiepkenhagen
11. Mère de ma mère à seize ans - le récit de Nicole
12. Sur les genoux de Dieu
13. Le départ de Klaus
14. Adieu Wiepkenhagen
15. Thuringe
16. Les joies d’une mère de famille
17. Merci pour ma vie!
18. Hof mit Himmel
19. Mon nouveau nom est Paul
20. Trouvé - le récit de Dieter
21. Sinistre total
22. Contact avec l’au-delà
Postface : qu’est ce qui serait, si...
Remerciements
Préface
Quelle histoire ! J’ai eu le privilège de rencontrer personnellement Carmen Paul, et aie eu la chance de recueillir le témoignage de son expérience de mort imminente dans une interview pour wunderheute.tv. Des dizaines de milliers de personnes ont été interpellées par son histoire (101 000 visionnages en octobre 2018). Un internaute a répondu : « Dieu, tu es meilleur qu’on ne pourrait l’exprimer par des mots. Je t’aime. »
Une autre internaute a écrit : « Merci beaucoup, Carmen, on se languit d’aller aux Cieux ! Mais plus important encore : nous avons un devoir à remplir ici bas, même si nous nous languissons déjà d’être “là-haut” ». Pour moi, ce message est un résumé parfait de l’expérience impressionnante de mort imminente que Carmen a eu la chance de vivre. Ce livre parle de la vie après la mort dans un amour et une beauté que l’on ne peut décrire, mais il parle aussi de l’« ici et maintenant » dans lequel nous pouvons avoir un aperçu de la beauté et de cet amour unique que Dieu nous apporte.
Nous le ressentons : l’expérience que Carmen a vécue est une expérience très personnelle de sa relation avec le Créateur. Cependant, un message très clair pour toute l’humanité nous transperce : Dieu prend au sérieux notre décision d’être pour ou contre lui – et : nous devons prendre cette décision ici-bas. Lorsque la mort viendra, il sera trop tard !
Je suis si reconnaissant à Jésus Christ d’avoir réoffert la vie à Carmen, en la renvoyant chez nous, les vivants, avec une mission. Jésus a dit : « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n’était pas, je vous l’aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et, lorsque je m’en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis vous y soyez aussi. » (Jean 14:2).
Carmen confirme ce qui est écrit dans la Bible : le meilleur est encore à venir si nous prenons la décision de vivre avec Jésus Christ, car nous aurons alors le droit de vivre l’Éternel avec lui. Je veux absolument en faire partie, et je prie pour vous y retrouver aussi. J’espère que ce livre y contribuera.
Une seconde peut tout changer, c’est ce que nous montre l’expérience de mort imminente de Carmen. Si vous ne l’avez pas encore fait, n’hésitez pas un seul instant à vous décider clairement pour Jésus Christ et de l’accepter comme votre Sauveur
Mai 2018, Weinfelden (Suisse)
Andreas Lange, modérateur et producteur de www.wunderheute.tv
Directeur de l’agence média chrétienne Medialog
1. Marquant
Et cela me faisait peur !
J’avais peut-être quatre ou cinq ans. Comme souvent, j’étais chez ma grand-mère et je jouais dans la cour. En face de celle-ci, il y avait une cabane en bois ; ce genre de cabane était dans presque tous les villages, et abritait la LPG, l’organisation syndicale des paysans.
Ce qui se passait là-dedans ne m’intéressait pas ; mais je savais qu’un homme pour lequel j’avais beaucoup de respect — enfin, soyons honnêtes : de qui j’avais peur — était assis derrière cette fenêtre. Il était tellement grand, il parlait fort et ne souriait jamais, personne ne l’aimait. Et pourtant, cette fenêtre m’attirait comme un aimant.
Pas seulement la sienne, bien entendu, les autres fenêtres de la LPG étaient tout aussi attirantes ! Elles étaient si captivantes, on pouvait voir se refléter le ciel bleu et les nuages blancs dans leurs vitres. Je ne pouvais pas m’en défaire. Y aller, non, mais là, avec la raquette de badminton et ces petites pierres, je pourrais peut-être…
Aussitôt dit, aussitôt fait : j’essayais encore et encore de viser une des vitres – ne dit-on pas que c’est en forgeant que l’on devient forgeron – quand soudain, un éclat ! Je présageais le pire, m’accroupissais au sol, dessina une fleur dans la poussière avec le manche de ma raquette et pris l’air le plus détaché possible.
La porte s’ouvrit soudainement et l’homme sortit en courant – justement celui dont j’avais si peur. C’est au plus tard à ce moment-là que mon appréciation se vérifia : il fulminait et hurlait dans la cour. C’était vraiment très bizarre ! Je réprimais un sourire en le voyant sautiller comme ça. Comme le Nain-Tracassin, pensais-je.
Il vint vers moi en courant : « C’est toi qui as fait ça ? C’est toi qui as cassé la vitre ? » Je répondis du tac au tac « Non ! » Il me regarda avec un air perplexe et ne sut pas tout de suite quoi dire. Je me levais et le regarda. Ce n’était pas facile, de faire face à son regard, d’autant que je me rendais bien compte de mon mensonge. Mais il n’y avait pas de retour possible.
Il commença à parler, comme s’il voulait se convaincre lui-même (et me convaincre aussi, bien sûr !) que ce devait bien être moi, puisqu’il n’y avait personne d’autre ici. Je répétais encore et encore que ce n’était pas moi. J’étais déchirée par les sentiments qui se bousculaient en moi : un sentiment de pouvoir, de supériorité, de victoire, mais aussi un sentiment de culpabilité, puisque je savais bien que j’avais menti.
Finalement, il abandonna. Il ne croyait probablement pas un mot de ce que je disais, mais il ne pouvait pas non plus prouver quoi que ce soit. Dans tous les cas, l’homme me laissa tranquille, l’homme de qui j’avais eu si peur auparavant, et je rentrais à la maison auprès de ma grand-mère pour tout lui raconter.
Je n’ai jamais oublié cette histoire, même des années plus tard ; alors que j’étais déjà adulte, il était toujours convaincu que c’était moi qui avais brisé la vitre. C’était il y a cinquante ans, mais j’ai toujours l’impression que c’était hier.
Eh bien fais-le !
Ma mère avait beaucoup de particularités qui étaient souvent blessantes pour moi. Un jour, j’avais peut-être dix ou onze ans, j’en ai eu marre, « la coupe était pleine ».
J’avais enduré son chantage toutes ces années, et toujours avec la même rengaine – à chaque fois que je devais faire quelque chose selon son bon vouloir et que je me rebiffais, elle prononçait cette rengaine : « Je vais me tuer, je vais me pendre, personne ne m’écoute, personne ne m’aime ».
Un jour, je n’en pus plus. Je me sentais tellement mise sous pression, ce n’était pas tenable à la longue. Ce jour donc, elle se plaignit à nouveau. Sans dire un mot, je me levai, pris un banc en bois et une corde à linge, posa le tout devant elle et lui dit : « tiens, voilà, maintenant fais-le, comme ça nous aurons enfin la paix. »
Cette scène m’a poursuivie pendant des années, et encore aujourd’hui j’y repense parfois. Dans ces moments-là, je revois ce banc en bois, que mon oncle avait lui-même construit ; il était peint dans un bleu moyen clair avec des bordures bleu foncé. Il avait dessiné un personnage de bande dessinée au milieu, une sorte de scène comique entre un homme et une femme ; je pense que je n’ai jamais vraiment compris cette scène, ce qui explique surement pourquoi je ne m’en souviens pas en détail.
Je mis longtemps avant de comprendre pourquoi ma mère et moi avions une relation perturbée ; c’est seulement des années après mon accident que Dieu m’a aidée à y voir plus clair sur notre relation et à l’arranger — en tous cas en ce qui me concerne.
Je me suis sans cesse posé la question de savoir pourquoi je me donnais encore et toujours la peine de répondre à tous ses souhaits, d’être toujours là pour elle (oui, avec le temps j’appris à contenir mon entêtement), et puis Dieu me donna la réponse dans un rêve, à l’époque où je vivais à Schmalkalden. En me réveillant, je me souvins de tous les détails de ce que j’avais vu dans mon rêve, et cela me donna beaucoup à réfléchir. J’appelais donc Friede-Renate, qu’entre-temps je connaissais bien, pour lui demander si je pouvais passer chez elle pour que nous puissions écouter ensemble ce que Dieu avait à me dire.
2. Confrontation
Je n’ai pas vraiment grandi avec la foi ; je savais juste que je devais me donner de la peine, que je devais tout faire et ne pouvais compter sur personne d’autre que sur moi-même.
J’étais une «Jeune Pionnière», et ce avec beaucoup de passion. Les Jeunes Pionniers, c’était la première étape de l’organisation nationale de la jeunesse pour les élèves de la première à la quatrième année. J’étais ensuite également membre avec cœur et âme des «Pionniers Thälmann» (quatrième jusqu’en septième).
Beaucoup d’activités étaient proposées : école, garderie, jeux de vacances, camp de vacances pour enfants – tout ça conçu de manière à ce que nous ne devions pas réfléchir plus loin à comment nous occuper. Tout était avancé d’une manière bien réfléchie et, comme il m’a semblé plus tard, tout cela avait certainement été préparé à l’avance. Nous n’avions qu’une chose à faire : participer.
Personnellement, ce n’était pas difficile pour moi, parce que le système « pour les enfants » de la DDR m’avait déjà complètement sous contrôle. Bien sûr, à l’école, il y avait déjà des situations à la vue desquelles, en y réfléchissant, je remarquais que quelque chose ne tournait pas rond (l’essai sur le stylo plume, par exemple) ; mais j’étais beaucoup trop profondément ancré dans le système pour pouvoir sérieusement protester.
Communisme en direct
La fin des études approchait et mon rêve de carrière n’avait pas changé : devenir vétérinaire ! Mais avant de pouvoir partir étudier à Meissen, je devais d’abord apprendre un métier en lien avec les animaux, je décidais donc d’apprendre à devenir technicienne de zoo.
Alors, on enfile sa salopette et on va s’occuper du singe et de l’éléphant, du crocodile et du zèbre ? Non, le métier de technicien de zoo s’apprenait à la coopérative ! Dans « l’État ouvrier et paysan », le paysan avait été aboli ; il n’y avait plus que la Coopérative de production agricole et des ouvriers qualifiés. Les endroits où je reçus ma formation étaient en substance l’école professionnelle et, pour ainsi dire, la cage à vache.
À ce moment-là, j’appris à connaître le communisme dans mes vêtements de tous les jours. Toutes ces années à l’école, j’en avais entendu parler et assidûment appris, mais ce que je pus voir et ressentir à ce moment-là me montra une chose : rien de ce que j’avais appris à l’école n’était vrai !
Si les instructeurs remarquaient que vous appreniez vite et consciencieusement, on vous plaçait dans toutes sortes d’écuries ou d’autres lieux de travail pour remplacer les adultes, afin qu’ils puissent eux-mêmes avoir au moins deux ou trois jours de congé à la fois. À un moment donné, je commençais à me rebeller et j’exprimais haut et fort ce que je pouvais déceler comme anormalités. Je fus donc transférée dans un autre centre de formation avec un directeur de maison « à cent pour cent ». Au début, je ressentais cela comme une aventure, puis de plus en plus comme du harcèlement pur et simple. Aujourd’hui, je suis heureuse d’avoir eu cette expérience, car je peux ainsi mieux aider ceux qui ont vécu les mêmes choses que moi.
Un exemple des idioties possibles en RDA : un lundi matin pluvieux, alors que je vivais encore avec ma mère à Löbau, je me rendis encore toute endormie à l’autobus, car j’étais de garde tôt le matin. Pour arriver au bus, je devais traverser une intersection, et j’aurais dû traverser chaque rue séparément, mais j’étais beaucoup trop paresseuse pour cela. J’avais donc traversé en diagonale le carrefour dans ma belle veste imperméable jaune Friesennerz, sponsorisée par mon oncle de l’ouest, sur laquelle trônait également l’autocollant «Schwerter zu Pflugscharen».5
Forcément, je n’avais pas vu qu’un policier était là. Il m’arrêta, et s’en suivi une tirade de remontrances – et quand il vit l’autocollant ! Il se mit à crier, et je crus presque qu’il allait complètement perdre les pédales. Il me dit : si je ne retirais pas immédiatement ce symbole honteux venu tout droit du mauvais capitalisme, il ferait en sorte que je doive porter l’uniforme avec la bande jaune.
Je bouillonnais intérieurement. Je sentais que mille paroles me venaient à l’esprit, mais c’est surtout l’idée que j’avais oublié de prendre mon petit-déjeuner qui parlait le plus fort ! Le policier me demanda 20 marks parce que j’avais traversé le carrefour à pied et que c’était interdit.
Je ne doutais pas du fait qu’il puisse me faire aller en prison (pas à cause du raccourci, mais à cause de la veste avec l’autocollant) ; mais ce qui était bien pire pour moi, c’est que j’avais oublié mon petit-déjeuner ! Je lui donnai donc les 20 marks. C’était beaucoup d’argent, c’est ce que j’ai payé plus tard chaque mois pour ma chambre, ou bien cela aurait suffi pour m’acheter une bonne demi-livre de café. Puis j’enleva ma veste que je lui remis en souriant : « Amusez-vous bien avec ! », me retournai et partis en courant à travers l’intersection dans le sens inverse pour aller chercher mon petit déjeuner. Quand je ressortis pour prendre le bus, j’empruntai un autre chemin — on ne sait jamais.
Examen en habit de sport
L’examen final arriva enfin, ensuite ce serait terminé — c’est tout du moins ce que je pensais. Le jour de l’examen, j’enfilai ma chemise de la Jeunesse Libre Allemande et un jean, de la marque « Levi’s » bien sûr, et allais à l’école professionnelle. Par précaution, je portais un pantalon de sport en dessous, et mon pressentiment ne me trompa pas : un des professeurs «tomba des nues» – selon ses propres termes : comment osais-je me présenter à l’examen, accoutrée d’un pantalon capitaliste, surtout porté en combinaison avec la chemine bleue «sacrée» ? (Les couleurs n’allaient vraiment pas ensemble et le tout faisait mal aux yeux, mais ce n’était pas le sujet.)
Il appela le directeur et je dus entendre une autre tirade de remontrances. Tout ça bien entendu le jour de l’examen ! Le directeur et le professeur me dirent que je devrais rentrer immédiatement chez moi pour me changer, et que je pourrais ensuite passer mon examen final.
Je les regardais et ne pus m’empêcher d’éclater de rire ! À ce moment-là, je vis soudain la sottise de ce communisme et du professeur complètement sous l’emprise de cette idéologie — et je retirais mon pantalon en face d’eux. Je les priais de bien faire attention à mon jean, et déambulais en pantalon de sport et chemise de la Jeunesse Libre Allemande jusqu’à ma table d’examen. Quand j’eus fini de passer l’examen, je repartis chercher mon Levi’s et l’enfila directement. Puis je leur dis, en désignant la chemise de la Jeunesse Libre Allemande : «Ça, je n’en ai plus besoin, vous pouvez la garder.»
Bien sûr, c’était clair pour moi que je pourrais dorénavant oublier le travail de mes rêves. Je sentais aussi que les années d’amour pour notre « État ouvrier et paysan » s’étaient transformées en une haine irrépressible pour ce régime ; et la garder sous contrôle m’a coûté beaucoup de force et de discipline.
Après mon apprentissage, je commençai à travailler dans une « exploitation laitière » à Herwigsdorf. Une exploitation laitière est une gigantesque étable, équipée de matériel moderne. Nous ne travaillions pas en deux parties – le matin et le soir – mais soit le matin, soit le soir, c’est-à-dire par équipes.
Collègue préférée
Il m’a fallu un certain temps pour accepter le fait que je ne guérirais jamais un animal, mais je m’étais juré : mieux valait être honnête que de vivre toute sa vie dans le mensonge ! Cette devise m’aida à surmonter la douleur.
Beaucoup de choses que j’ai apprises de Madame la Docteure me sont restées. C’était vraiment une très belle époque et bien que je n’aie pas eu le droit d’apprendre ce métier, j’ai gardé beaucoup de choses à l’esprit. Comme je n’ai jamais perdu mon amour pour les animaux et que j’en ai moi-même toujours eu, beaucoup d’occasions se présentèrent pendant lesquelles je pus les aider.
J’avais de nombreux collègues sympathiques à Herwigsdorf, mais deux de ces collègues, des femmes, étaient spéciales, et c’est elles que je préférais. L’une s’appelait Christine, elle est arrivée à l’exploitation alors que j’étais là depuis deux ans. Notre amitié a survécu à tout, vraiment à tout, et jusqu’à aujourd’hui.
Christine avait été élevée dans l’idéologie communiste par ses parents, mais de manière très différente de ce que je connaissais. Cela me fascinait qu’elle résiste à l’injustice, qu’elle n’a pas peur d’ouvrir la bouche – parfois très haut et très fort, mais c’est justement ce qui m’inspirait tant.
J’ai rencontré très peu de gens qui puissent être autant passionnés par leur idéologie et pourtant être si sensible et affectueux. C’est aussi une forme de foi qu’elle porte en elle, bien que celle-ci soit vouée à l’échec, comme beaucoup d’exemples l’ont démontré. Jusqu’à ce jour, nous avons toutes deux toléré la foi de l’autre, sans la dévaluer et sans vouloir la convertir.
Comme j’aimerais que Christine découvre en elle l’amour de Jésus. Attendons de voir !
Bras de fer
L’autre femme que j’ai rencontrée à Herwigsdorf et qui fut très importante pour moi s’appelle Hanna. Hanna s’exprimait aussi haut et fort, mais de manière complètement différente. Elle n’avait aucun mal à dire librement le fait que tu étais une bonne personne, ce que tu avais fait de mal, ou qu’elle t’aimait bien. Elle était patiente et si naturellement pleine d’humilité que je me demandais tout le temps ce qui la rendait si spéciale.
Elle pouvait te tenir la main et même sans qu’elle n’ait parlé, tu te sentais réconforté. Les murs vibraient quand elle riait et, qu’on le veuille ou non, on était pris du même rire.
Et Hanna était tenace ! Pendant presque une année, elle m’invita au cercle qu’elle réunissait chez elle — et pendant presque une année, je trouvais toutes les excuses possibles et imaginables pour ne pas y aller. Mais toute chose ayant une fin, un jour nous arrivâmes au terme de ce bras de fer : d’un côté, Hanna m’invitait constamment chez elle pour rejoindre son cercle, de l’autre, le secrétaire du parti m’ennuyait chaque semaine pour savoir si je ne voulais pas reprendre les rangs des chemises bleues — il me proposa même de rejoindre le SED !
Ce n’était pas si facile de devenir membre du parti ; il fallait deux membres du parti qui se portaient garants, et au bout d’un an, le secrétaire du parti m’offrait l’admission ! Mais je ne comprenais pas comment cet homme pouvait même envisager de me faire changer d’avis.
Impertinence !
Cette lutte acharnée me fit accepter la proposition d’Hanna un jour de janvier. Cette soirée serait une soirée spéciale, m’avait-elle dit, un pasteur de l’église des frères Herrnhut, Morgenstern, serait là. Je me dit : je vais y aller et lui dirais demain que ce n’est pas pour moi, et puis qui croit encore à ces vieilleries ?
Il y avait une autre collègue qu’Hanna avait invitée plusieurs fois, et nous décidâmes d’y aller ensemble et d’en finir pour de bon. Dehors, il faisait un froid glacial, mais les Heinze avaient bien chauffé la pièce et nous fûmes accueillies de manière très amicale. Il n’y avait que des vieilles dames qui étaient présentes ; nous quatre, mon autre collègue, Hanna et sa sœur Ursel, qui était aussi notre patronne dans l’exploitation, étions de loin les plus jeunes du groupe.
Le pasteur arriva et salua cordialement tout le monde. Puis, il nous expliqua que Dieu lui avait dit de changer de sujet ce soir. Ah, mais comme je me retins de rire ! Enfin, vous pouvez dire ce que vous voulez : comment peut-on parler à Dieu — et l’entendre en plus de cela ?
Mais je me contrôlais. Le prêtre ouvrit la Bible et commença à lire une histoire, une de Jésus bien sûr et d’une femme qui semblait ne pas avoir de nom. J’étais assise là, et je n’en croyais pas mes oreilles ! Qu’est-ce qu’il était en train de lire ? La colère me montait, j’aurais aimé partir immédiatement ! Quelle impertinence, il était en train de parler de moi !
Des images de ma propre vie apparurent devant mes yeux, des choses que j’avais ressenties comme normales, mais qui soudain grondaient en moi, se révoltaient. Car je vivais assez librement, et en ce qui concernait ma sexualité, je prenais ce que je voulais, me fichant de savoir si tel ou tel homme était par hasard marié ou non. Et non seulement le prêtre me fit me regarder dans un miroir – ce qui était déjà bien assez impertinent — mais en plus il le faisait en présence de vieilles dames, et elles entendaient tout !
Le pasteur lisait et lisait, et que je le veuille ou non, je fus obligée d’écouter. Quand il eut fini son texte, je me levais d’un bond, dis : « Ça suffit ! » et je pris la porte. Dehors, il faisait encore froid et je vivais de l’autre côté du village ; mais je ne sentais rien du froid, parce que je bouillonnais intérieurement.
Je ne savais pas à qui j’en voulais le plus : à moi, pour y être allée ? Ou aux vieilles dames qui savaient maintenant quel mode de vie je menais ? Ou à Hanna ? Elle avait certainement tout raconté au pasteur ! Comment le saurait-il autrement ? Cela me travailla toute la nuit. J’aurais aimé effacer ce jour-là de ma vie. Tout ça était tellement embarrassant pour moi !
« Pas un mot sur toi »
Le lendemain, j’allais voir immédiatement Hanna, et laissa exploser ma colère. Elle m’écouta patiemment et sourit même quand je lui dis que je trouvais que c’était vraiment nul qu’elle ait tout dit de moi au pasteur, ça ne le regardait en rien !
Je me tenais devant elle, le visage rouge et complètement hors de moi – et quand j’eus fini, elle me dit simplement que ce que le pasteur avait lu ce soir-là était écrit dans la Bible depuis presque deux mille ans : « Eh bien, ne te prend pas autant au sérieux ! Il n’y a pas un mot sur toi dans la Bible. »
Je la regardai avec étonnement : « Si c’est vrai que le pasteur ne savait rien de moi, si tu ne lui as vraiment rien dit de moi, comment pouvait-il le savoir ? Alors Jésus doit vraiment exister ! »
La réponse d’Hanna fut claire et nette : « Oui, c’est le cas. » C’est tout ce qu’elle dit. « Et qu’est-ce que je fais maintenant ? » Cette fois, sa réponse fut un peu plus longue : « Remets ta vie à Jésus, il fera le reste ». Très bien, c’est ce que je fis, et je le fis immédiatement : je me mis à genoux dans le couloir de l’étable, à côté des arrière-trains des vaches, et c’est là que je remis ma vie à Jésus : « Jésus, viens maintenant dans ma vie et prends-la en main ».
Quand j’eus terminé, je fus subjuguée par une telle joie que je ne pourrais pas la décrire. J’ai ri et pleuré de joie, et pendant des années, cette joie fut ma compagne.
Plus tard, j’appris que cela s’appelle la « Conversion ». D’ailleurs, la jeune collègue avec qui j’étais venue ce soir-là s’était convertie elle aussi ; mais comme j’étais partie au début de la soirée, je ne le savais pas encore.
Tout nouveau
À partir du moment où j’eus donné ma vie à Jésus, ma vie changea. Ce fut une révélation pour moi — je réalisais tout ce que j’avais fait de mal.
J’ai dû changer si vite et de manière si ostensible, que je ne l’ai moi-même pas remarqué ; mais avec le nouveau regard que je portais sur mon entourage, j’arrêtais de faire beaucoup de choses qui avaient été normales pour moi auparavant. Mon entourage s’en rendit compte et on me gratifiait constamment de flatteries comme : maintenant tu es une sainte et tu ne nous parles plus, tu préfères prier le Notre Père du matin au soir ». Ce n’était pas vrai, mais ils ne pouvaient probablement pas comprendre ce qui m’était arrivé.
Ce n’était pas une période facile ; aujourd’hui je sais que Jésus m’a souvent protégée dans ces moments, pour que la douleur n’atteigne pas mon cœur. Au contraire, je continuais à être emplie de sa joie et j’aurais voulu le dire au monde entier, qu’on veuille l’entendre ou non ! Ce dont le cœur est plein, la bouche déborde. Du haut de mes dix-neuf ans, je pensais que je pourrais maintenant faire changer le monde.
Quelques mois plus tard, je fus baptisée et confirmée. Avec notre pasteur de l’époque, Karl-Heinz Kluge, j’appris beaucoup et compris de plus en plus ce qui est écrit dans la Bible. Un an plus tard, je commençais à garder les groupes de jeunes chrétiens et participais bien sûr aux cours hebdomadaires pour les jeunes.
L’« effet secondaire » fut que je découvris à cette époque la joie de jouer de la guitare, ce que j’appris assez rapidement ; si je savais lire une partition à l’époque ou non, je ne m’en souviens plus. Karl-Heinz Kluge me donna un petit livret, le « Mundorgel », et un tableau des doigtés ; en quelques semaines j’appris à l’accompagner à la guitare.
Les « temps de repos » (appelées ainsi parce que les « temps de loisirs » n’étaient à l’époque autorisés pour les Jeunes Pionniers et la Jeunesse Libre Allemande) étaient les points forts de la vie de la communauté, et j’y suis vite devenue employée. Je fus complètement absorbée par le travail de l’église avec les enfants et les jeunes, à travers lequel j’appris à connaître beaucoup de chrétiens, y compris certains de la RFA. Je me suis sentie complètement à l’aise dans la Jeune Communauté.
La Corée du Nord, proche de moi
Au cours de l’été 1979, j’allais pour la toute première fois de ma vie au bord de la mer Baltique. Mon cousin Uwe*, qui avait trouvé un bungalow à Markgrafenheide pour deux semaines de vacances avec sa femme et ses deux enfants, m’avait invitée à passer quelques jours avec eux.
La mer Baltique, c’était mon autre grand rêve ! À l’époque où j’allais à l’école, j’avais découpé toutes les photos de la mer Baltique dans des magazines et j’en avais joliment décoré le mur de ma chambre qui était en pente. À ce moment-là, mon époque d’écolière était passée depuis des années, mais le désir de l’inconnu, de l’exotisme et de la beauté m’était resté.
Et mon rêve allait bientôt se réaliser, bientôt je pourrais voir la mer Baltique de mes propres yeux – je me réjouissais tellement ! Le train allait directement de Dresde-Neustadt à Rostock, je n’aurais même pas besoin de changer de train. Il ne s’arrêtait que dans les grandes villes.
Le train était bondé, et j’étais surprise de voir qu’autant de personnes puissent partir en vacances. Non que cela coûtait une fortune, mais des vacances avaient tout de même leur prix, et je savais ce que gagnait le consommateur moyen en RDA.
Mais je n’eus le temps d’y réfléchir que jusqu’à la gare de Berlin. En arrivant là où le wagon devait s’arrêter, je vis sur le quai qu’il y avait vraiment beaucoup d’agitation, comme dans une grande gare, en fait, mais cela me semblait être un joyeux bazar. Des hommes en uniforme couraient d’un bout à l’autre du quai avec excitation et se passaient des informations les uns aux autres en criant. Puis le train s’arrêta.
Tout se passa rapidement, mais calmement : des hommes en costumes noirs entrèrent dans le wagon, prirent tous les passagers et les relogèrent dans d’autres wagons. En quelques minutes, le wagon était vide. Enfin, sauf moi, qui étais restée assise à ma place.
Ce n’est pas possible, vous pensez ? Oui, c’est aussi exactement ce que je me disais. J’attendis patiemment que quelqu’un vienne pour me dire de quitter la voiture, m’étais même levée pour prendre mes valises, mais personne ne m’avait remarquée. Comme si j’étais invisible – personne ne me regardait, personne ne me disait rien. Maintenant, tout le wagon était vide. J’ouvris la fenêtre, une de celles que l’on rabattait, et je me mis à regarder l’agitation du dehors.
Il y avait maintenant encore plus d’agitation sur le quai : deux hommes déroulèrent un tapis rouge, une fanfare s’était avancée et mise en position, tous vêtus de l’uniforme de notre armée populaire nationale. Puis je vis arriver un petit groupe d’Asiatiques ! Un des hommes, qui marchait un ou deux pas au-devant de ses quatre accompagnants, fut salué par deux dames avec un bouquet de fleurs. Puis, ils pénétrèrent dans le wagon. J’étais encore assise là, me demandant : pourquoi m’a-t-on permis de rester assise alors que tous les autres ont dû sortir ?
Les Asiatiques s’assirent de l’autre côté du couloir et restèrent silencieux. Je regardais les hommes ; j’étais toujours invisible, comme pour ceux d’avant. Puis le train se remit en marche. L’homme qui avait été accueilli avec un bouquet finit par me voir. Il dit quelque chose dans sa langue aux hommes qui l’accompagnaient, et ces derniers me regardèrent alors avec un regard houleux. L’homme qui parlait était leur patron ; je le compris quand je le vis lever la main pour apaiser les autres messieurs, et qu’il se leva pour venir vers moi. Il me sourit et s’inclina très discrètement, puis il me tendit la main et se présenta.
Son nom était imprononçable pour moi, mais ce qu’il me dit dans un très bon allemand m’intéressa beaucoup. Il eut l’air enchanté quand il a appris que je travaillais dans l’agriculture pour une exploitation laitière — car devant moi était assis un des plus hauts fonctionnaires du ministère nord-coréen de l’Agriculture !