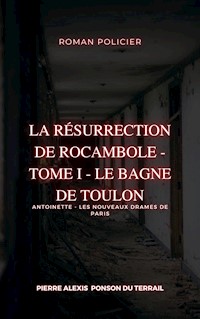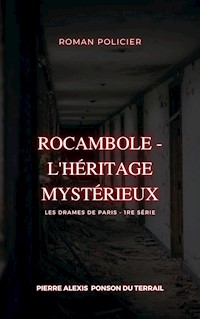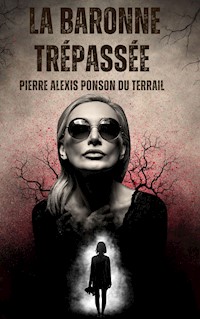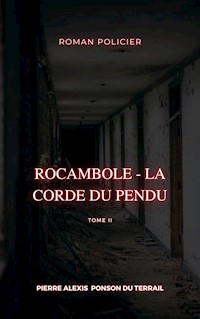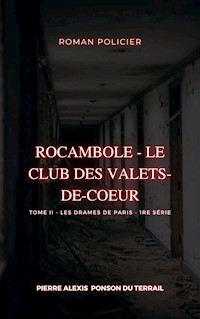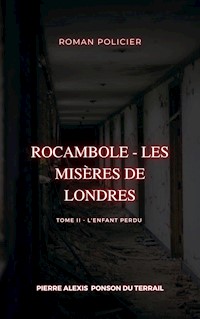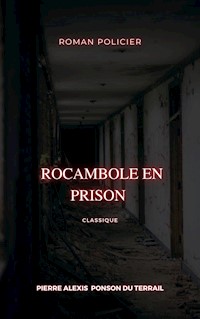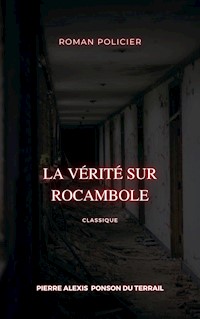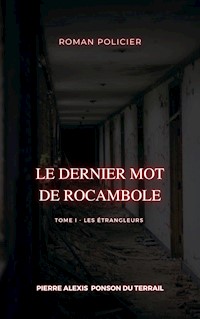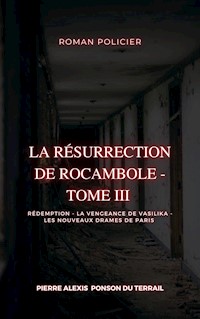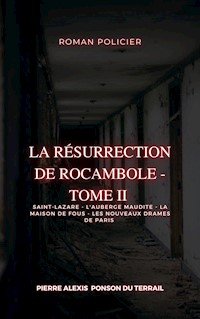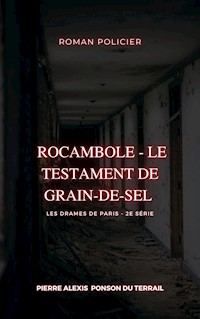2,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Französisch
Et mame Toinon arrondit ses deux bras en les éloignant le plus possible de son corps, de façon à témoigner de l'ampleur de ses futurs paniers. Or mame Toinon était une jolie brune, accorte et souriante, qui n'avait guère plus de trente-quatre ans, en paraissait vingt-huit tous les soirs, et était la coqueluche de son quartier. Mame Toinon était veuve ; elle n'avait pas d'enfant et n'avait pas voulu se remarier. Mais elle avait trouvé un matin, sur le seuil de sa porte, un pauvre petit garçon de huit ans qui grelottait et pleurait, et elle l'avait recueilli. L'enfant abandonné ne savait ni le nom de son père, ni celui de sa mère ; il savait seulement qu'on l'appelait Tony. Il paraissait avoir éprouvé un violent effroi qui lui avait fait perdre la mémoire. Tout ce que mame Toinon en put tirer, c'est que des hommes masqués avaient voulu le tuer.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 585
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Le serment des Hommes Rouges
Pages de titreIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIIIXIVXVXVIPremière partieI - 1II - 1III - 1IV - 1V - 1VI - 1VII - 1VIII - 1IX - 1X - 1XI - 1XII - 1XIII - 1XIV - 1XV - 1XVI - 1XVIIXVIIIXIXXXXXIXXIIXXIIIXXIVXXVXXVIXXVIIXXVIIIXXIXXXXXXXIDeuxième partieI - 2II - 2III - 2IV - 2V - 2VI - 2VII - 2VIII - 2IX - 2X - 2XI - 2XII - 2XIII - 2XIV - 2XV - 2XVI - 2XVII - 1XVIII - 1XIX - 1XX - 1XXI - 1XXII - 1XXIII - 1XXIV - 1XXV - 1XXVI - 1XXVII - 1XXVIII - 1XXIX - 1XXX - 1Page de copyrightLe serment des Hommes Rouges
_________
Ponson du Terrail
Prologue
Amis et rivaux
I
Le duel improvisé
Un soir de janvier de l’année 1746, il y avait bal à l’Opéra.
– Toute la cour y sera, s’était dit madame Toinon, costumière et loueuse d’habits, qui logeait dans la rue des Jeux-Neufs, aujourd’hui des Jeûneurs, à l’enseigne de la Batte d’Arlequin.
Et elle avait ajouté :
– Allons, Tony, fais tes préparatifs, tu m’y conduiras. Je t’habillerai en gentilhomme.
– Et vous, patronne, comment serez-vous ?
– Je me mettrai en marquise.
– Avec des mouches ?
– Mais dame !
– Et des paniers ?
– Comme ça !...
Et mame Toinon arrondit ses deux bras en les éloignant le plus possible de son corps, de façon à témoigner de l’ampleur de ses futurs paniers.
Or mame Toinon était une jolie brune, accorte et souriante, qui n’avait guère plus de trente-quatre ans, en paraissait vingt-huit tous les soirs, et était la coqueluche de son quartier. Mame Toinon était veuve ; elle n’avait pas d’enfant et n’avait pas voulu se remarier.
Mais elle avait trouvé un matin, sur le seuil de sa porte, un pauvre petit garçon de huit ans qui grelottait et pleurait, et elle l’avait recueilli.
L’enfant abandonné ne savait ni le nom de son père, ni celui de sa mère ; il savait seulement qu’on l’appelait Tony.
Il paraissait avoir éprouvé un violent effroi qui lui avait fait perdre la mémoire.
Tout ce que mame Toinon en put tirer, c’est que des hommes masqués avaient voulu le tuer.
La costumière prit l’enfant chez elle et l’adopta.
À partir de ce moment, elle ne songea plus à se remarier, et les mauvaises langues de son quartier prétendirent que l’enfant recueilli était son fils, un péché mignon de première jeunesse dont le mari n’avait jamais rien su. Or, à l’époque où commence cette histoire, Tony avait à peine seize ans, mais il était grand et fort, admirablement bien pris et d’une charmante figure, pleine de malice et d’esprit.
On ne l’appelait dans la rue que le beau commis à mame Toinon.
– Ainsi, vous allez au bal ? demanda-t-il à sa mère d’adoption.
– Tiens, pourquoi pas ? répondit-elle en se jetant un coup d’œil passablement admirateur dans la petite glace placée au-dessus du comptoir. Je ne suis pas encore trop déchirée pour une femme de trente-quatre ans, et je pense que la poudre ne va pas toujours aussi bien à de véritables marquises.
Puis mame Toinon, qui, on le voit, n’était pas précisément la modestie en personne, regarda du haut en bas son commis.
– Et toi, dit-elle, mon petit, sais-tu que tu seras charmant avec ce bel habit bleu de ciel à paillettes, cette veste rouge et cette culotte de satin blanc, que j’ai fait faire dernièrement pour ce gentilhomme de province ?...
– Ah ! oui, dit Tony, et qui vous a laissé le tout pour compte, sous prétexte que vous ne vouliez pas lui faire crédit ?
– Justement.
– Et vous croyez que cela m’ira ?
– À ravir.
Tony, à son tour, se mira dans la glace et ne fut pas trop désolé de l’examen.
– Tu seras à croquer, ajouta mame Toinon, en fixant sur son fils adoptif des regards qui n’étaient peut-être pas très maternels.
– Faudra-t-il me faire poudrer ?
– Mais sans doute.
– Et à quelle heure irons-nous ?
– Tout au commencement. À minuit. Tu me feras danser, j’imagine ?
– C’est que je ne sais pas trop bien.
– Bah ! Je te montrerai !...
– Et qui gardera la boutique ?
– Babet, donc.
Babet était l’unique servante de mame Toinon, – une vieille fille honnête et désagréable, qui baissait les yeux et s’efforçait de rougir quand un homme la regardait par hasard.
Tandis qu’ils causaient, un chaland entra dans la boutique. C’était un gentilhomme d’environ trente ans, de belle prestance, aux airs hautains, et posant avec impertinence le poing sur la garde de son épée qu’il portait en verrouil. Il salua mame Toinon de la main, d’un air familier et protecteur et lui prit même un peu le menton.
– Toujours jolie et toujours veuve ! dit-il.
– Ah ! monsieur le marquis, répondit la costumière, qui ne se fâcha point des petites libertés que le gentilhomme prenait avec elle, vous m’avez dit cela souvent, à pareil jour, ce qui est à la fois une preuve que je vieillis et que vous êtes toujours jeune.
– Plaît-il ? fit le gentilhomme. On dirait que vous tournez une phrase comme M. de Marivaux lui-même, Toinon ?
– Mais non, monseigneur. Je vieillis, puisqu’il y a déjà longtemps que vous m’avez dit la même chose ; et vous êtes toujours jeune, puisque vous revenez, comme jadis, à l’approche du bal de l’Opéra.
Et Toinon prit une pose un peu railleuse.
– Nous nous amusons donc encore ? dit-elle ; nous courons les femmes de la bourgeoisie ?... les caméristes ?... les grisettes ?...
– Silence, madame Toinon, ces choses-là étaient bonnes autrefois.
– Hein ?
– Je suis marié.
Mame Toinon leva les mains au ciel avec une expression lamentable.
– Ah ! mon Dieu, dit-elle, la malheureuse !...
– Tu ne sais ce que tu dis, ma brave Toinon. Le diable s’est fait ermite, et j’adore ma femme.
– Est-elle riche, au moins ?
– Très riche.
– Jeune ?
– Vingt ans.
– Jolie ?
– Comme un ange.
– Et vous allez au bal de l’Opéra, seigneur Dieu ! car, puisque je vous vois, c’est que...
– Chut ! dit le marquis, c’est que ma femme et sa sœur ont eu un singulier caprice.
Mame Toinon regarda le marquis.
– Ces dames, continua-t-il, ont imaginé de s’en aller ce soir au bal de l’Opéra, déguisées en bergères.
– Et vous les accompagnerez, sans doute ?
– Naturellement.
– Déguisé en berger ?
– Ou en faune, je ne suis pas encore bien fixé. Je viens donc vous prier, ma chère Toinon, de m’envoyer, le plus tôt possible, plusieurs costumes complets de bergères. Ces dames choisiront.
La costumière regarda Tony. Tony se tenait immobile dans le coin le plus obscur de la boutique depuis l’entrée du marquis.
– Mon mignon, lui dit mame Toinon, tu iras chez M. le marquis.
– Mais, fit ce dernier, il est bien plus simple que ce garçon vienne avec moi tout de suite.
– Comme vous voudrez, monsieur le marquis.
Mame Toinon, en un clin d’œil, eut assorti des étoffes, empli trois grands cartons et appelé, du seuil de sa porte, un commissionnaire ; puis elle se pencha à l’oreille de son cher commis et lui dit :
– Reviens au plus vite. Il faut que tu te fasses poudrer et que tu te costumes.
Le commissionnaire plaça les cartons sur ses crochets et s’apprêta à suivre le client de mame Toinon.
– De quel côté allons-nous, monsieur le marquis ? demanda Tony.
– Dans l’île Saint-Louis.
Alors le jeune homme, voulant éviter au grand seigneur l’ennui de cheminer côte à côte avec un commissionnaire, invita ce dernier à prendre les rues de traverse et à aller attendre à l’entrée de la rue Saint-Louis-en-l’Isle.
Le marquis, lui, se prit à questionner Tony, tout en marchant. Tony était peu timide ; il avait l’esprit alerte et souple, un peu moqueur, de l’enfant de Paris ; il s’était toujours plu en la compagnie de gens de qualité, lesquels affluaient dans la boutique de mame Toinon, et, le gentilhomme lui ayant quelque peu lâché la bride, le commis se mit à jaser de choses et d’autres.
Le marquis le regarda tout à coup attentivement.
– Tu as la figure fine, dit-il, le pied petit, la main blanche et délicate.
Tony rougit.
– Tu es peut-être le péché mignon d’un homme de qualité.
– Je ne sais pas, répondit Tony ; mais ce que je sais bien, c’est que si je n’aimais pas tant maman Toinon, je me ferais soldat.
– Ah ! et que voudrais-tu être ?
– Garde-française. On a un bel habit blanc à parements bleus.
Le marquis se mit à rire.
– Bon ! dit-il, tu ignores, je parie, que je suis précisément capitaine aux gardes-françaises.
– Vous, monseigneur ?
– Moi, et si tu veux t’enrôler...
Tony allait répondre, sans doute, qu’il aimait trop mame Toinon pour se séparer d’elle ; mais il n’en eut pas le temps, car un troisième personnage vint se mêler à la conversation.
En ce moment le marquis et Tony atteignaient l’extrémité de la rue Saint-Louis-au-Marais et s’apprêtaient à tourner l’angle nord de la place Royale.
Bien qu’il fût à peu près nuit, un gentilhomme, qui cheminait en sens contraire, avait aperçu le marquis et était venu droit à lui, juste au moment où Tony méditait sur la réponse qu’il avait à faire.
À la vue de ce personnage, qui portait d’ailleurs un costume rouge assez étrange, le marquis recula d’un pas et porta la main à la garde de son épée.
– Bonsoir, marquis !
– Bonsoir, comte !
Les deux gentilshommes se saluèrent comme se saluent deux adversaires.
– Je ne vous savais pas à Paris, comte, ricana le marquis.
– J’y suis depuis une heure.
– Ah !
– Et vous devinez que j’y suis venu pour vous.
– Naturellement.
– Allons, fit l’inconnu d’un ton railleur, je vois que vous me comprenez à merveille.
– Certainement. Quelle est votre heure, comte ?
– Celle-ci.
– Et... le lieu ?
– La place est déserte. Nous y serons chez nous.
– Ah ! pardon, dit le marquis, j’aimerais assez remettre la partie à demain.
– C’est impossible, marquis.
– Cependant, j’ai promis à ma femme de la conduire au bal de l’Opéra cette nuit.
L’inconnu répondit sèchement.
– J’en suis désolé ; mais voilà quatre ans que je vous cherche, en Bohême, en Autriche, en Espagne, partout, et je suis pressé de vous tuer.
– Ainsi, vous me refusez ?
– Positivement.
– Mais nous n’avons pas de seconds.
– Nous nous en passerons. Venez, marquis, et flamberge au vent, s’il vous plaît !
Le marquis avait déjà oublié Tony, qui, à deux pas de distance, avait assister à cette provocation.
– Eh bien, soit, dit le marquis avec colère, venez !
Et tous deux se prirent à marcher d’un pas rapide et gagnèrent l’angle le plus obscur de la place.
Tony avait toujours entendu dire, dans le quartier Montmartre, par les bourgeois de sens que les petites gens ne se doivent point mêler des querelles des grands. Aussi se tint-il prudemment à l’écart. Cependant, comme la prudence n’excluait pas chez lui la curiosité, il ne perdit point de vue le marquis et son adversaire.
L’un et l’autre mirent l’épée à la main, et le cliquetis du fer froissant le fer arriva jusqu’à l’oreille de Tony.
Le combat fut long ; chacun des deux gentilshommes laissa échapper à diverses reprises une exclamation de colère qui attestait une blessure ; puis, tout à coup, le commis de mame Toinon entendit un grand cri...
Et tout aussitôt l’un des deux adversaires chancela, tournoya un moment sur lui-même et tomba à la renverse.
Quant à l’autre, il remit son épée au fourreau, s’enveloppa soigneusement dans son manteau et s’éloigna d’un pas rapide, comme si de rien n’était.
Alors Tony accourut.
Le client de mame Toinon gisait dans une mare de sang...
II
Le coffret d’ébène
Tony se pencha sur le gentilhomme qui respirait encore, le prit dans ses bras et l’adossa contre une arcade.
– Mon ami, balbutia le marquis, je suis frappé à mort...
– Au secours ! cria Tony.
Mais la place était déserte, et personne ne vint.
– Tais-toi, dit le marquis, c’est inutile... seulement écoute-moi... et jure-moi de faire ce que je te dirai.
– Je le jure, répondit le jeune homme.
– Il y a, reprit le marquis, dans ma chambre à coucher, une armoire dont j’ai la clef sur moi ; dans cette armoire, tu trouveras un coffret d’ébène... et... tu le porteras...
Un hoquet interrompit le moribond qui, laissant sa phrase inachevée, ouvrit cette brusque parenthèse :
– Surtout n’en dis rien à ma femme... avant demain. Elle veut aller ce soir au bal de l’Opéra. Que le dernier désir... que je lui aie entendu formuler... hélas !... soit au moins réalisé... Tu te présenteras à l’hôtel tout à l’heure... Mon valet de chambre Joseph... t’ouvrira ; tu lui montreras cette clef... et tu prendras le coffret... tu le porteras à mon ami... le baron...
Le marquis n’eut point le temps de prononcer le nom du baron ; il se souleva violemment, poussa un soupir, puis renversa la tête et tomba sur le sol.
– Ah ! il est mort ! s’écria Tony.
Pour la première fois de sa vie, le jeune homme se trouvait dans une de ces situations qui commandent à la fois la prudence et l’énergie.
Cependant il avait seize ans à peine, un âge où la réunion de ces deux qualités est rare.
Mais notre héros les déploya en cet instant critique.
Tout d’abord il fouilla le marquis et trouva sur lui une bourse assez ronde et une clef, la fameuse clef. Il mit le tout dans sa poche et se dit :
– Je restituerai la bourse à la famille et je me servirai de la clef pour avoir ce coffret dont il m’a parlé, et que je dois remettre à un baron... Il n’a pas eu le temps de me dire le nom du baron, mais je le trouverai peut-être dans le coffret.
Or Tony savait que le marquis demeurait dans l’île Saint-Louis, mais il ignorait son nom ainsi que celui de la rue où il avait son hôtel. Il fut donc obligé de revenir rue des Jeux-Neufs.
Là, il trouva mame Toinon qui avait déjà commencé sa toilette.
– Eh bien, dit-elle, te voilà de retour ?
– Oui, patronne.
– Comme tu es pâle !
– Oh ! ce n’est rien !...
– Mais il est arrivé quelque chose... c’est impossible autrement !...
Soudain la costumière jeta un cri :
– Ah ! mon Dieu ! dit-elle, tu as du sang sur les mains.
Alors Tony fut obligé de raconter à sa mère adoptive la scène étrange et terrible dont il venait d’être témoin.
Mame Toinon l’écouta en frémissant et finit par s’écrier :
– Mais il faut absolument informer sa famille ! Cours, c’est le marquis de Vilers, capitaine aux gardes-françaises ; il demeure rue Saint-Louis-en-l’Isle.
Tony secoua la tête.
– Il n’a pas voulu que j’avertisse sa femme ; il me l’a demandé avant de mourir. Je lui obéirai.
– Soit ; mais... ce coffret...
– J’exécuterai la volonté du défunt, répondit Tony avec une gravité qui n’était pas de son âge.
Mame Toinon secoua la tête.
– Mon pauvre enfant, dit-elle, il ne fait jamais bon de se mêler des affaires des gens de cour.
– J’ai juré, répondit Tony avec fermeté. Je tiendrai mon serment ; je vais aller à l’hôtel de Vilers.
– Pour quoi faire ?
– Mais pour prévenir le valet de chambre du marquis.
Et Tony qui, pour la première fois peut-être, se montrait rebelle aux exhortations de mame Toinon, Tony s’en alla, muni des deux renseignements qu’on venait de lui donner, et il reprit sa course vers l’île Saint-Louis.
Mame Toinon s’était laissée tomber tristement sur une chaise en murmurant :
– Adieu, mon bal de l’Opéra !
Tony courut à perdre haleine et gagna l’île Saint-Louis en moins de temps qu’il n’en avait mis à venir de la place Royale à la rue des Jeux-Neufs.
Le commissionnaire attendait toujours à l’entrée de la rue Saint-Louis, appuyé sur son crochet qu’il avait mis bas et placé le bout inférieur en terre.
– Viens avec moi, lui dit Tony.
– Hé ! dit le commissionnaire, je commençais à perdre patience, ma foi !
– Viens
– Et ce gentilhomme, où est-il ?
– Viens toujours.
Le jeune homme jugea inutile de donner des explications à l’Auvergnat et s’en alla avec lui jusqu’à la porte de l’hôtel de Vilers. Là il lui dit :
– Laisse ton crochet, va sonner à la porte, et, quand elle sera ouverte, tu entreras chez le suisse et tu lui diras que tu veux parler à Joseph, le valet de chambre de M. le marquis ; ensuite tu me l’amèneras.
Le commissionnaire exécuta ponctuellement les ordres de Tony.
Tony attendit quelques minutes, puis il vit venir à lui un vieux laquais grisonnant.
– Est-ce vous qui me demandez ? fit-il en regardant curieusement Tony.
– C’est moi.
– Que me voulez-vous ?
– Je viens de la part du marquis votre maître.
– Ah ! fit le laquais, vous l’avez vu ?
– Oui.
– Voici trois fois que madame la marquise sonne pour savoir s’il est rentré.
– Il ne rentrera pas.
– Pourquoi donc ?
Tony répondit sans s’émouvoir :
– Parce qu’il vient de partir pour un voyage de vingt-quatre heures.
– Oh ! c’est impossible ! dit vivement le laquais ; madame la marquise l’attend pour aller au bal de l’Opéra.
– Je le sais bien, puisque j’apporte les costumes.
Et Tony montra les trois cartons superposés sur le crochet du commissionnaire.
– Tiens ! dit le valet, c’est tout de même bizarre.
Alors Tony prit la main de Joseph et lui dit en la pressant affectueusement :
– Vous aimiez donc bien votre maître, mon ami ?
– Mais je l’aime encore, je l’aime toujours !
– Hélas ! votre amitié, votre dévouement lui sont désormais inutiles.
Le valet étouffa un cri.
– Il est mort !... ajouta Tony.
– Mort ? mort ? ? mort ? ? ? répéta le valet sur trois tons différents.
– Oui.
– Oh ! ce n’est pas possible...
– Il est mort... depuis une heure... Il a été tué en duel, sur la place Royale, par un gentilhomme...
– Tué en duel par un gentilhomme ?
– Oui.
– Savez-vous le nom de ce gentilhomme ?
– Je l’ignore ; mais je sais qu’il a fait le tour du monde tout exprès pour se battre avec votre maître.
– Ah ! s’écria le valet qui paraissait posséder les secrets du marquis, c’est un des Hommes Rouges ! il fallait s’y attendre...
Et le valet se prit à pleurer.
Tony lui raconta alors la scène dont il avait été témoin, puis les dernières recommandations du marquis.
– Ainsi, dit Joseph, il veut que sa femme aille à l’Opéra ?
– Oui.
– Mon Dieu ! comment faire ?
Tout à coup, Joseph se frappa le front.
– Je vais dire à ces dames, fit-il, que le roi, qui est à Versailles, a fait demander le marquis, et que, sans doute, il reviendra cette nuit.
– C’est cela !
– Mais... la cassette ?
– Ah ! c’est juste..., venez avec moi.
Le valet, qui était fort troublé, fit entrer Tony dans la cour de l’hôtel, débarrassa le commissionnaire de ses cartons, le paya et le renvoya. Puis il remit les cartons à un autre valet auquel il dit :
– C’est pour madame la marquise ; cela vient de mame Toinon.
Tandis que le valet portait les costumes, Joseph prit Tony par la main, lui fit prendre un escalier de service et le conduisit au premier étage de l’hôtel.
Puis il poussa une porte devant lui et posa sur un meuble le flambeau qu’il avait pris chez le suisse.
– Voilà le cabinet de mon pauvre maître, dit-il ; l’armoire est en face..., cherchez le coffret... Moi, je vais dire à madame que M. le marquis est à Versailles.
Et le valet, qui était en proie à un trouble et à une douleur extrêmes, laissa le jeune homme sur le seuil de la chambre qu’il appelait le cabinet de son maître.
C’était une vaste pièce tendue d’étoffe sombre et d’un aspect assez triste. Tony, un moment immobile sur le seuil, finit par entrer et ferma la porte derrière lui.
Jamais notre héros n’avait eu dans sa vie une heure aussi agitée que celle qui venait de s’écouler ; jamais il n’avait été investi d’une mission pour ainsi dire aussi solennelle.
Il faut croire que la gravité des circonstances lui donna à ses propres yeux une véritable importance, car il s’enhardit tout à fait et se dit :
– J’ai fait un serment, je le tiendrai, et Dieu me punisse si je n’exécute pas fidèlement les dernières volontés de ce gentilhomme qui a eu confiance en moi !
Tony aperçut, en face de lui, l’armoire indiquée par le valet de chambre.
C’était un grand bahut de la Renaissance, à ferrures de cuivre, pourvu d’une fine serrure tréflée, comme on en fabriquait depuis peu.
Il prit la clef qu’il avait trouvée sur le marquis et la mit dans la serrure.
La clef entra, tourna deux fois et le bahut s’ouvrit.
Tony vit alors un joli coffret d’ébène sculpté, après lequel se trouvait une clef.
Il se hâta de l’ouvrir, moins par un sentiment de curiosité que dans le but de trouver dedans un indice quelconque qui pût le mettre sur la trace du destinataire, de ce baron dont le nom avait expiré sur les lèvres du marquis mourant.
À la grande surprise du jeune homme, le coffret ne renfermait qu’un cahier de parchemin, couvert d’une grosse écriture, et une lettre.
La lettre n’était point cachetée et portait cette inscription :
Au baron de C... ou à celui qui trouvera ce coffret.
Tony, que cette initiale ne renseignait pas beaucoup, prit le parti d’ouvrir la lettre et lut :
« Mon cher ami,
« Je puis mourir demain. L’artilleur qui met le feu à une pièce de canon fêlée, le mineur qui travaille sous terre, le pêcheur assailli loin de la côte par une tempête, sont moins près de la mort que moi. Un poignard menace ma poitrine à toute heure ; j’ai, comme Damoclès, une épée suspendue sur ma tête, et j’écris ces lignes en prévision de quelque catastrophe.
« Toi ou celui qui lira le cahier ci-joint, où je raconte l’histoire étrange de mon existence, vous me vengerez, si je meurs !...
« Marquis de Vilers. »
Cette lettre bizarre et sinistre impressionna si vivement la jeune imagination de Tony, qu’il oublia mame Toinon, et Joseph, le valet de chambre, et le lieu où il se trouvait. Il alla fermer la porte au verrou, plaça le coffret et le flambeau sur une table, prit un siège et se mit à lire avec une curiosité ardente le manuscrit du marquis, lequel avait ce simple titre : Mon secret.
III
Le secret du marquis de Vilers
Le manuscrit du marquis, écrit d’une grosse écriture fort lisible, commençait ainsi :
« J’ai trente ans. Il y en a quatre que ceci se passait. J’avais donc alors vingt-six ans.
Nous étions quatre amis, officiers au régiment de Flandre, lors du siège de la petite ville impériale de Fraülen, sur le Danube.
Le premier se nommait Gaston de Lavenay, le second Albert de Maurevailles, le troisième Marc de Lacy.
J’étais le quatrième.
Le siège traînait en longueur et le maréchal de Belle-Isle, qui en avait commandé les premières opérations, s’était retiré au bout de huit jours, laissant simplement devant la place trois régiments d’infanterie, un escadron de Royal-Cravate et deux batteries de campagne.
Le maréchal avait sans doute un vaste plan d’opérations dans lequel il entrait de ne prendre Fraülen qu’à la dernière extrémité, c’est-à-dire à la fin de la campagne. Fraülen était pour lui comme un point sans importance, sur lequel il forçait les Impériaux à concentrer toute leur attention.
Le mois de novembre arrivait et la saison devenait rigoureuse. Un jour, le commandant de la citadelle de Fraülen écrivit au marquis de Langevin, notre mestre-de-camp, qui commandait l’armée de siège, une lettre ainsi conçue :
« Monsieur le marquis,
« Voici le jour de la Toussaint, qui sera suivi du jour des Morts, et bientôt arriveront les fêtes de Noël et du nouvel an. Je vous viens faire une proposition : c’est d’établir une trêve entre nous pour tous les dimanches et jours de fête. Vos officiers pourront venir danser dans le faubourg de Fraülen, qui, vous le savez, renferme les plus belles maisons de la ville, et les miens les iront visiter dans la partie de votre camp que vous désignerez. Ce sera pour nos deux armées un moyen de tuer le temps.
« En attendant l’honneur de votre réponse, je suis, monsieur le marquis, votre très humble serviteur.
« Major Bergheim. »
Le marquis répondit :
« Monsieur le major,
« J’accepte votre proposition et j’invite vos officiers à dîner pour le jour de la Toussaint dans la première enceinte de nos retranchements, entre nos ouvrages avancés et la portée de vos canons.
« Je vais faire élever en cet endroit une tente convenable pour vous y recevoir et je suis, en attendant cet honneur, monsieur le major,
« Votre très obéissant,
« Marquis de Langevin. »
Or le jour de la Toussaint, les officiers français et les officiers autrichiens, profitant des conventions arrêtées, se rencontrèrent hors de la ville et firent assaut de courtoisie.
Notre mestre-de-camp, le marquis de Langevin, dont la fortune personnelle était considérable, donna aux assiégés un dîner splendide, et les dames de la ville furent invitées à venir danser sous une tente illuminée par des feux de Bengale et des lanternes vénitiennes.
Le lendemain, jour des Morts, on ne dansa pas dans Fraülen ; mais nous fûmes invités à une messe en musique et nous dînâmes chez le major.
Le dimanche suivant, un magnat hongrois, fabuleusement riche, nous donna une fête splendide dans sa maison de campagne, située au-delà du Danube et par conséquent sous la protection du canon des forts.
C’est à cette fête qu’a commencé pour moi la série d’événements étranges et terribles qui pourraient bien, au premier jour, avoir ma mort pour conclusion.
Je l’ai dit, nous étions quatre amis, quatre frères d’armes, servant dans le même régiment, nous tutoyant, n’ayant pas de secrets les uns pour les autres et faisant bourse commune.
On nous appelait les quatre Hommes Rouges ; et voici pourquoi :
Nous gardions un jour, avec une vingtaine d’hommes, une redoute.
Pendant deux heures, barricadés dans le bastion, nous supportâmes un feu meurtrier, et nos vingt hommes tombèrent un à un.
Quoique blessé lui-même, Marc de Lacy résolut avec nous de continuer la lutte. On décida qu’il chargerait les mousquets, tandis que nous ferions feu. Pendant une heure encore, à nous quatre, nous soutînmes ainsi le siège, et une compagnie tout entière d’Impériaux joncha de ses morts les alentours du bastion.
– Messieurs, nous cria Marc tout à coup, nous n’avons plus que vingt-cinq cartouches ; je vous engage à les ménager.
– Vive le roi ! répondîmes-nous, bien déterminés à ne tomber que morts au pouvoir des Impériaux.
Heureusement pour nous, un de ces épais brouillards qui sont fréquents sur les bords du Danube, s’éleva tout à coup en même temps que la nuit arrivait, et nous déroba à la fois la vue de la ville et celle du camp.
Alors le feu cessa.
– Il était temps, messieurs, nous dit Marc ; vous avez brûlé vos vingt-cinq cartouches.
Nous passâmes une partie de la nuit couchés à plat ventre derrière un rempart de cadavres et dans l’impossibilité de sortir du bastion, car l’ennemi avait établi un cordon de Soldats autour de nous.
De temps à autre, une balle sifflait au-dessus de nos têtes ; à un certain moment, un obus vint éclater au milieu du bastion.
– Allons, mes amis, dit Maurevailles, au point du jour nous serons morts. Dès que le brouillard sera dissipé, on nous livrera un dernier assaut, et comme nous n’avons plus de cartouches !...
– Nous serons morts ou sauvés, répondis-je.
– Ah ! par exemple, répondit Marc en riant, tu es bien bon de conserver de l’espoir.
– Qui sait ?
– À moins que tu ne veuilles te rendre ?
– Vous êtes fous !
– Alors, fais tes préparatifs de voyage pour l’autre monde.
– Messieurs, répondis-je froidement, cet obus, qui vient d’éclater et qui a failli me tuer, a illuminé le bastion l’espace d’une seconde.
– Eh bien ?
– À sa clarté, je vous ai vus pêle-mêle avec nos cadavres et couverts de leur sang.
– Où veux-tu en venir ?
– Attendez ! Les uhlans hongrois ont des tuniques et des manteaux rouges ?
– Oui.
– Parfaitement, nous sommes sauvés.
La nuit était sombre et le brouillard épais ; mais j’avais sur moi une mèche soufrée, comme on en porte dans les tranchées ou dans les mines ; je battis le briquet et j’allumai la mèche.
– Malheureux ! me cria Maurevailles, ta mèche est un point de mire, la place va nous envoyer un boulet.
– Ah ! dame, je ne dis pas le contraire. Il y a des cas où il faut y voir.
La clarté de la mèche soufrée pénétrait bien un peu le brouillard, mais Maurevailles s’était trompé ; elle ne pouvait arriver jusqu’à la place. Seulement les Impériaux, qui entouraient le bastion, l’aperçurent et en cinq minutes nous entendîmes cinquante balles pleuvoir autour de nous.
Mais nous avions mis à profit ces cinq minutes.
Dans le sang de nos soldats qui couvrait le sol de la redoute, chacun de nous avait roulé son manteau, puis s’était drapé dans ce manteau rougi.
Après quoi nous nous étions recouchés à plat ventre.
– Tenons conseil, dis-je alors.
– Voyons, me répondit-on.
– Il y a, autour du bastion, à cinquante pas de distance, un cordon d’Impériaux ; mais il laisse passer les patrouilles des uhlans hongrois. Or vos manteaux sont maintenant aussi rouges que les leurs et comme on ne voit pas à cinquante pas de distance par le brouillard qu’il fait, on ne saura d’où nous venons. Partons.
Si aventureux que fût mon plan, il réussit.
Nous nous glissâmes hors du pavillon et nous nous mîmes à marcher résolument deux par deux.
– Qui vive ! cria une sentinelle.
– Patrouille ! répondis-je en hongrois, et nous fîmes trente pas en avant. Un pontonnier, qui travaillait dans une tranchée, souleva sa lanterne, et sa clarté se projeta un instant sur nos vêtements rouges. Les rangs des Impériaux s’ouvrirent... et nous passâmes. On nous avait pris pour des uhlans hongrois.
Dix minutes après, nous arrivâmes au camp français où on n’espérait plus nous revoir, et depuis lors, le surnom d’Hommes Rouges nous est resté.
Or, ce fut à la fête, dont je parlais plus haut et que le riche magnat hongrois nous donna dans sa maison de campagne, que commença pour moi cette série d’événements que je vais retracer.
Une jeune fille attira tout d’abord notre attention à tous les quatre, tant elle était belle dans son riche et pittoresque costume de hongroise des montagnes.
– Palsembleu ! m’écriai-je, je serais capable de lui conquérir un royaume si elle voulait m’aimer.
– Et moi aussi, dit Maurevailles.
– Et moi donc ? exclama Gaston de Lavenay.
– Bon ! fit Marc de Lacy, vous m’oubliez, messieurs. J’en suis, morbleu ! moi aussi...
Nous avions échangé ces quatre exclamations dans un petit pavillon isolé, où nous étions demeurés seuls un moment, après avoir vu passer la belle Hongroise au bras de son père, qui était un autre magnat excessivement riche.
Nous nous regardâmes tous quatre et, pour la première fois, nous éprouvâmes un singulier malaise, et nos regards se croisèrent comme des lames d’épée.
– Ah çà ! messieurs, dit Gaston de Lavenay, je crois, Dieu me pardonne ! que nous allons devenir rivaux ?
– C’est bien possible, murmurai-je.
– Tu l’aimerais ?
– J’en suis déjà fou.
– Et toi, Maurevailles ?
– Moi, je l’adore.
– Et toi, Lacy ?
– Je te la disputerais l’épée à la main.
– Vous êtes insensés ! répondit Lavenay. Et je vous propose, moi, de la tirer au sort.
– Au fait ! dit Maurevailles, c’est une idée.
– Et je l’approuve, dit Marc de Lacy à son tour.
Comme eux, et sans réfléchir, j’inclinai la tête.
– Ah ! messieurs, reprit Lavenay, j’ai une autre proposition à vous soumettre avant d’interroger le sort.
– Parle vite.
– Nous allons faire un serment, continua d’une voix grave notre ami, un serment solennel et terrible, – tel que des gens comme nous peuvent en prêter un, – un serment d’amitié, d’amour, mais de mort aussi.
– Lequel ? demanda Maurevailles.
– Eh bien, reprit Lavenay, jurons d’aider de tout notre pouvoir, de servir par tous les moyens possibles l’heureux d’entre nous à qui le sort aura donné celle que nous aimons tous les quatre.
– Soit, répondîmes-nous.
– Et il est bien convenu que celui qui manquerait à ce serment et qui ne se résignerait pas à la volonté exprimée par le destin...
– Celui-là, dit Maurevailles, sera tenu de se battre avec les trois autres ! »
IV
Où le marquis de Vilers se trouve être une ancienne connaissance de la belle Haydée
Tony, de plus en plus intrigué, continua à lire :
« Nous fîmes le serment convenu et nous jetâmes nos quatre noms dans un chapeau.
Le sort allait décider...
Mais une difficulté se présenta.
Qui donc allait plonger la main dans cette urne improvisée ? Quel était celui d’entre nous qui en retirerait le nom de l’élu du destin ?
– Messieurs, dis-je à mon tour, il y a un moyen de nous mettre tous d’accord. Nous allons prier la belle Hongroise de plonger sa jolie main dans le tricorne.
– Ah ! quelle drôle d’idée ! Mais comment obtenir ?...
– Soyez tranquille, je m’en charge.
– Bon ! et après ?
– Après ? Je suis d’avis que nous brûlions les trois noms demeurés au fond du chapeau sans les lire.
– Et le quatrième ?
– Si vous le voulez bien, le quatrième papier ne sera point déroulé tout de suite, et son contenu demeurera un mystère pour tous.
– Jusqu’à quand ?
– Jusqu’à ce que nous ayons réalisé le plan que je médite.
– Voyons ! firent-ils tous trois.
Je posai sur une table le tricorne de Maurevailles qui contenait les quatre papiers, puis je jetai un regard autour de nous pour m’assurer que nous étions toujours seuls.
– Messieurs, repris-je alors, laissez-moi vous dire que nous ne savons absolument rien de notre belle inconnue, si ce n’est qu’elle est la fille de ce vieux magnat qui lui donne le bras.
– Qu’importe ? fit Lavenay.
– J’aimerais assez, puisque nous allons la tirer au sort, que chacun de nous concourût à sa conquête avant que le sort se fût prononcé.
– Mais, dit le baron, tu oublies que nous avons fait le serment d’aider le vainqueur.
– Je le sais...
– Voyons, explique-toi...
– Eh bien, je suis persuadé que nous déploierions bien plus de zèle isolément, si chacun de nous avait l’espoir que son nom fût contenu dans le quatrième bulletin.
– Au fait, dit Marc de Lacy, c’est une bonne idée.
– Ah ! vous trouvez ?
– C’est également mon avis, ajouta Maurevailles.
– Eh bien, arrêtons un plan.
– Soit !
– Je vais prendre quelques renseignements à travers le bal, faites-en autant.
– Et puis ?
– Quand nous saurons où demeure la belle Hongroise, nous aviserons aux moyens, soit de nous introduire chez elle, soit de l’enlever.
– Je penche pour ce dernier parti, dit Gaston de Lavenay.
– Et moi aussi, répliquèrent Maurevailles et Marc de Lacy.
Nous laissâmes le tricorne de Maurevailles sur la table où je l’avais placé, et nous rentrâmes dans le bal, où chacun de nous prit une direction différente.
Moi, j’allai passer mon bras sous celui d’un jeune et charmant officier autrichien, aide de camp du major Bergheim, le commandant de Fraülen.
Le lieutenant Hinch, tel était son nom, s’était pris pour moi, dès le premier jour de trêve, d’une grande sympathie, que je lui rendais, du reste.
– Mon cher lieutenant, lui dis-je en lui montrant la belle Hongroise qui valsait en ce moment au milieu d’un groupe d’admirateurs enthousiastes, quelle est cette jeune fille ?
Il me regarda en souriant.
– Ah ! je vous y prends, vous aussi ! me dit-il.
– Que voulez-vous dire ?
– Que vous êtes amoureux.
– Passionnément.
– Vous avez cela de commun avec les cinquante ou soixante officiers de l’armée impériale qui sont ici ce soir.
– Oh ! mais vous aussi, sans doute ?
– Oh ! non, dit le lieutenant, et cela tient à ce que j’ai laissé à Vienne une blonde fiancée que j’aime...
– Eh bien, tant mieux !
– Pourquoi ?
– Je craignais que nous ne fussions rivaux.
– Oh ! mon cher, répondit le lieutenant, je crois que ni vous ni personne ne réussirez jamais auprès d’elle.
– Bah ! fis-je avec la fatuité d’un officier de vingt-six ans. Comment se nomme-t-elle, votre Hongroise ?
– Haydée, comtesse Mingréli.
– Le nom est joli.
– C’est la fille de ce vieux comte Mingréli qui est appuyé là-bas, à cette colonne, et regarde danser.
– Je l’ai déjà vu. Ainsi vous dites que Haydée...
– Passe pour avoir un amour mystérieux.
– Diable !
– On ne sait pas quel est celui qu’elle aime, mais on sait bien qu’elle a refusé la main des plus riches et des plus nobles seigneurs de l’empire.
– Est-ce qu’elle habite Fraülen ?
– Non ; elle vient même assez rarement ici et ne quitte guère le manoir de son père, situé sur les bords du Danube. Ah ! continua le lieutenant en riant, si vous voulez en faire le siège et tenter d’enlever la comtesse, vous ne serez pas le premier qui en aura eu l’idée.
– Vraiment !
– Un magnat des environs, après avoir demandé sa main et avoir été refusé, a fait un siège en règle du château.
– Et il a été repoussé ?
– Le vieux comte Mingréli lui a envoyé, à cent pas de distance, du haut d’une tour, une balle dans le front ! Si le cœur vous en dit...
– Mais, mon cher, m’écriai-je, tout ce que vous me dites là, loin de me décourager, irrite ma passion naissante.
– C’est assez l’ordinaire.
– Est-ce que vous ne pourriez pas me présenter ?...
– Au comte ?
– Non, à sa fille.
– Oh ! très volontiers. Vous serez bien accueilli, car elle me sait un gré infini de ne point mourir d’amour pour elle, comme tout le monde. Tenez, justement la valse finit, venez...
Le lieutenant m’entraîna vers le milieu du grand salon.
La belle Hongroise remerciait alors son danseur, qui n’était autre que le magnat, maître de la maison, et elle s’apprêtait à rejoindre son père, lorsque nous l’abordâmes.
En Hongrie, une fille unique hérite des titres de son père et les porte même du vivant de ce dernier.
C’est ainsi que la fille du comte Mingréli était comtesse.
Elle accueillit le lieutenant Hinch avec un charmant sourire.
– Comtesse, lui dit-il, permettez-moi de vous présenter M. le marquis de Vilers, un ennemi que j’aime de tout mon cœur.
Elle reporta sur moi ce regard et ce sourire dont elle avait salué le jeune lieutenant.
– J’ai ouï parler de vous, monsieur, me dit-elle.
– En vérité, comtesse ?
– D’abord, me dit-elle, vous êtes un des Gentilshommes rouges, comme on vous nomme depuis votre belle défense de la redoute ?
– Oui, comtesse.
– Ensuite, je vous ai connu à Paris.
– À Paris ? fis-je avec étonnement.
Le lieutenant Hinch, en galant homme qu’il était, s’était déjà mis à l’écart pour nous laisser causer.
– Chut ! me dit tout bas Haydée ; je vous conterai cela plus tard... à moins que vous ne vouliez me faire danser.
– Je vous le demande à genoux, répondis-je ébloui de sa beauté et prêtant l’oreille à sa voix qui était mélodieuse comme un chant slave.
– Parlez-vous le hongrois ? me demanda-t-elle, car elle m’avait adressé la parole en français, et, comme tous les Slaves, elle parlait cette langue aussi purement qu’une Parisienne élevée à Versailles.
– Un peu, répondis-je.
– Vous devez être une exception dans votre armée ?
– À peu près.
– C’est comme ici les Autrichiens ; il y en a fort peu qui parlent le hongrois.
– Ah !
– Et si nous nous servons de cette langue, nous courons le risque de n’être entendus de personne.
Les préludes d’une danse nationale, que, à Paris et à Versailles, nous avons nommée la hongroise, se firent entendre alors.
Haydée plaça dans ma main sa main gantée et je l’entraînai dans le tourbillon.
– Comtesse, lui dis-je alors, vous êtes donc allée à Paris ?
– L’hiver dernier.
– Pourtant nous étions déjà en guerre ?
– Oui, mais mon père avait un sauf-conduit du maréchal de Belle-Isle, votre général.
– Ah ! c’est différent ; cependant...
– Je sais ce que vous allez me dire, interrompit-elle en souriant.
– Peut-être...
– Vous allez me dire : Moi aussi, j’étais à Paris et à Versailles l’hiver dernier, et il est impossible que des gens comme nous ne se soient point rencontrés.
– En effet..., vous êtes si belle, que, après vous avoir vue une seule fois, on ne saurait plus vous oublier.
– Flatteur !
Elle prononça ce mot sans irritation, d’une voix plutôt émue que railleuse, et je me demandai si c’était bien là cette femme qui, disait-on, était insensible à tous les hommages.
– Oui, reprit-elle, j’étais à Paris, et je vous ai vu.
– Oh ! c’est impossible !...
– Regardez bien mes cheveux blonds.
Je tressaillis.
– C’est tout ce que vous avez vu de moi...
– Ah ! m’écriai-je, je me souviens... c’était vous ?
Pour vous expliquer ces paroles que nous avions si rapidement échangées, il est nécessaire que je raconte une aventure qui m’était advenue l’hiver précédent.
Un soir de décembre, je me rendais au premier bal de l’Opéra, et mes porteurs longeaient la rue Saint-Denis. Arrivé à la hauteur de la rue aux Ours, j’entendis tout à coup des cris, des supplications et tout le tapage, en un mot, d’une rixe nocturne.
Plusieurs voleurs avaient entouré une chaise à porteurs dans laquelle une jeune femme se débattait et appelait au secours.
Les voleurs lui disaient :
– Donnez votre argent, vos pierreries, vos bijoux, madame, et il ne vous sera fait aucun mal.
La jeune femme était masquée, ce qui était une preuve qu’elle se rendait au bal de l’Opéra.
À la première attaque, les porteurs de la dame s’étaient enfuis.
Je sortis de ma chaise et je fondis, l’épée haute, sur les bandits en criant :
– Je suis le marquis de Vilers, et j’ai rossé le guet trop souvent pour n’avoir point bon marché de drôles tels que vous.
Je tuai l’un des voleurs ; les autres prirent la fuite. Alors j’offris ma chaise à la jeune femme, qui l’accepta, et je marchai à ses côtés jusqu’à l’Opéra.
Là, elle me remercia chaudement, mais elle n’ôta point son masque, et je la perdis de vue dans le bal.
Toute la nuit, je la cherchai. Ses cheveux blonds avaient fait sur moi quelque impression.
Mes recherches furent vaines...
Elle avait disparu, – et je l’oubliai.
– Ainsi, murmurai-je en regardant la comtesse avec extase, c’était vous ?
– C’était moi, me répondit-elle. Vous voyez que nous sommes de vieilles connaissances.
Il me sembla alors que sa voix trahissait une légère émotion, et il me passa par l’esprit et par le cœur un ardent espoir.
– Qui sait ? me dis-je, si je ne suis pas cet homme qu’elle aime et dont nul ne sait le nom ?...
Mais, en ce moment, j’aperçus devant moi la figure railleuse de Gaston de Lavenay qui m’observait attentivement, et je sentis mon sang se glacer...
Je me souvenais du serment odieux que j’avais fait !
V
Où Tony apprend à quoi peut servir la valse
La jeune Hongroise n’avait remarqué, disait ensuite le manuscrit, ni les regards de mes amis braqués sur nous, ni le trouble que m’avait fait éprouver cette espèce de surveillance.
La danse finissait.
– Voulez-vous que je vous présente à mon père ? me demanda la comtesse.
– Je vous en serai reconnaissant, répondis-je.
Elle continua à s’appuyer sur mon bras et me conduisit jusqu’à cette colonne contre laquelle le magnat était demeuré appuyé depuis que sa fille dansait.
– Mon père, lui dit-elle, je vous présente M. le marquis de Vilers.
Le magnat me salua avec la courtoisie d’un homme bien né, mais il n’y eut rien dans son geste, son regard ou sa voix qui pût me laisser croire que mon nom eût été déjà prononcé devant lui.
– Il paraît, pensai-je, que la belle comtesse n’a pas jugé convenable de lui parler du petit service que je lui ai rendu à Paris.
Puis, comme le magnat ne m’adressait que quelques paroles insignifiantes et semblait désirer que sa fille demeurât avec lui, je pris congé :
– Comtesse, dis-je en me retirant, m’accorderez-vous, cette nuit, l’honneur de vous faire valser ?
– Avec plaisir, me répondit-elle, en m’enveloppant de ce sourire qui m’avait déjà enivré. Venez me chercher quand on valsera.
Elle prit alors à sa ceinture le petit bouquet que chaque danseuse, en Allemagne, a coutume de confier à son danseur, et elle me le donna en ajoutant :
– Vous me le rapporterez.
Je m’éloignai et voulus me perdre dans la foule, mais Gaston de Laveney me frappa sur l’épaule.
– Hé ! hé ! me dit-il, tu fais un peu trop tes affaires personnelles, marquis, il me semble...
– Moi ? pas du tout.
– Te voilà présenté..., tu nous présenteras, j’imagine.
– Parbleu ! dit Maurevailles qui s’approchait avec Marc de Lacy.
Marc ajouta :
– Cela va de soi. Tu dois nous présenter l’un après l’autre.
– Soit, répondis-je.
– Nous avons eu nos renseignements, nous aussi, dit Gaston de Lavenay.
– Ah !
– La belle a un amour au cœur...
Je tressaillis.
– Elle aime, nous a-t-on dit, un petit cousin à elle...
Ces mots me firent éprouver un éblouissement, et le sang fouetta mes tempes avec violence.
– Êtes-vous sûrs de cela ?
– On dit tant de choses !
– Mais qu’importe ! dit Gaston de Lavenay, il faudra bien qu’elle se résigne à aimer celui de nous qui...
– Moi, interrompit Maurevailles, je vais vous donner un autre renseignement.
– Voyons ?
– La belle Hongroise habite un château en aval du Danube, sur la rive gauche, et à la frontière de l’Empire.
– Je sais cela.
– Attendez..., son père est un chasseur passionné, et il lui arrive de s’absenter deux ou trois jours de suite.
– Pour chasser ?
– Oui.
– Hé ! dit Marc de Lacy, cette indication est précieuse. Le père absent, on enlèvera plus aisément la fille.
– Comment ! messieurs, fis-je avec aigreur, vous comptez donner suite à votre plaisanterie ?
– Plaît-il ? fit Gaston.
– Est-ce que tu te moques de nous ? exclama Maurevailles.
– Non, mais...
– Ah ! messieurs, dit Marc de Lacy, notre ami le marquis est plus roué qu’il n’en a l’air.
– Mais... je te jure...
– Il a avancé ses petites affaires et il voudrait maintenant nous distancer.
– Ma foi ! dit Gaston, il me vient une idée.
– Voyons ?
– Tu vas la prier de tirer elle-même du chapeau de Maurevailles le nom du vainqueur.
– Mais il faudra donc lui expliquer...
– Absolument rien. Tu lui diras que nous avons fait une gageure, que cette gageure est provisoirement un mystère.
J’étais au supplice.
Cependant je n’osai refuser.
En ce moment le prélude d’une valse se fit entendre.
La comtesse m’avait promis de valser avec moi.
– Messieurs, dis-je en grimaçant un sourire, je vais continuer à avancer mes affaires.
Et je les quittai brusquement.
La comtesse Haydée m’attendait, debout, auprès de son père, qui n’avait point quitté sa place.
J’allai m’incliner devant elle. Elle prit ma main en souriant.
– Allons, me dit-elle.
Je lui fis faire deux tours de valse sans pouvoir murmurer une seule parole, tant j’étais ému ; mais elle me dit :
– J’ai tenu à valser avec vous, parce que je veux vous parler, marquis.
Je sentis, à ces mots, tout mon sang affluer au cœur.
Elle continua :
– Au point du jour, la trêve du dimanche finira, et il vous faudra regagner le camp français.
– Hélas ! balbutiai-je, et dimanche prochain est bien loin.
– Pourtant, reprit-elle, il faut que je cause avec vous.
Sa voix trahissait une émotion contenue.
– ... Que je cause avec vous, poursuivit-elle, longuement, pendant plus d’une heure.
– Je suis à vos ordres, comtesse.
Ma voix tremblait plus que la sienne.
– Et, dit-elle encore, il faut que nous soyons seuls.
Je tressaillis et je songeai à mes trois amis.
– Je vais quitter le bal dans une heure, continua-t-elle.
– Et puis ?
– En sortant du faubourg, vous vous dirigerez vers le Danube.
– Bien.
– Vous verrez une petite maison blanche, isolée de toute autre habitation.
– Je la connais.
– Cette maison est inhabitée. Vous irez vous asseoir sur le seuil de la porte et vous attendrez !
À mesure que la comtesse parlait, mon cœur battait avec violence.
– Ah ! soupira la jeune fille au moment où la valse finissait, je n’ai, hélas ! foi qu’en vous...
Et comme je lui demandais l’explication de ces étranges paroles :
– Ne m’interrogez pas, dit-elle ; dans une heure vous saurez tout.
J’allais la reconduire auprès de son père et sortir du bal, mais, en ce moment, je vis Maurevailles, Lacy et Lavenay qui s’avançaient vers nous.
Maurevailles avait à la main son tricorne qui renfermait nos quatre noms.
– Présentez-nous donc ! fit-il.
Je devins fort pâle ; mais je parvins néanmoins à me dominer, et, souriant à la jeune fille, je lui dis :
– Permettez-moi, comtesse, de vous présenter mes trois amis les hommes rouges.
Elle les salua avec une grâce charmante.
– Madame, lui dit alors Maurevailles, nous avons fait un pari, mes amis et moi.
– En vérité, fit-elle souriante.
– Nous avons une expédition à entreprendre. Il faut que l’un de nous se dévoue, me hâtai-je d’ajouter.
– Ah ! mon Dieu ! dit-elle. Mais vous êtes en pleine trêve, messieurs ?
– Il ne s’agit point de guerre, madame.
– C’est différent, en ce cas.
– Et nous avons mis nos quatre noms dans un chapeau.
– Eh bien ?
– Nous cherchons une main innocente pour remplir le rôle du destin ; il était impossible d’en trouver une plus pure et plus belle, murmurai-je.
Elle eut un frais éclat de rire.
– Ah ! comme vous voudrez ! dit-elle.
Et elle mit sa main blanche dans le chapeau de Maurevailles.
Une violente émotion s’empara sans doute de mes trois rivaux, car je les vis pâlir.
Gaston de Lavenay, surtout, devint livide.
VI
Où Tony voit le marquis aller à un rendez-vous
Quant à moi, lut encore le commis à mame Toinon, j’éprouvai, pendant que la comtesse plongeait sa jolie main dans le chapeau de Maurevailles, un supplice qu’il me serait impossible de décrire.
La jeune fille, souriante et calme, retira sa main et nous montra un des quatre rouleaux de papier.
– Voici le nom du gagnant, dit-elle.
Et elle s’apprêtait à dérouler le papier ; mais Gaston de Lavenay l’arrêta d’un geste.
– Pas encore ! murmura-t-il.
La jeune fille le regarda avec étonnement.
– C’est pour la suite du pari, dit Marc de Lacy.
– Comtesse, ajouta Maurevailles, veuillez garder un moment ce billet.
Il s’approcha d’une cheminée et jeta les trois autres noms dans le feu.
Puis il revint vers nous.
– M’expliquerez-vous cette énigme ? demanda la belle Hongroise en se tournant vers moi.
Mais Maurevailles prit encore la parole et dit :
– Comtesse, nous nous sommes fixé un but tous les quatre.
– Ah !
– Ce but doit être la récompense de celui dont le nom se trouve roulé entre vos jolis doigts.
– Eh bien ?
– Mais chacun de nous doit le poursuivre.
– Je ne comprends pas, dit naïvement la jeune fille.
– C’est peut-être une énigme, ajouta Gaston de Lavenay, qui avait fini par sourire.
– Et cette énigme ?
– Nous devons concourir à la déchiffrer tous les quatre.
– Je comprends de moins en moins.
– Eh bien, dit Maurevailles, voulez-vous nous donner huit jours pour vous l’expliquer !
– Oh ! de grand cœur...
– Et, en attendant, gardez ce billet sans l’ouvrir.
– Par sainte Haydée, ma patronne, je le jure, répondit la jeune fille.
Une Hongroise mourrait plutôt que de trahir son serment.
Nos trois amis s’inclinèrent, laissant le billet aux mains de la comtesse Haydée, et je demeurai seul avec elle une minute encore.
– Qu’est-ce que cette nébuleuse plaisanterie ?
– Je ne sais...
– Comment ! fit-elle.
– Ou plutôt, ajoutai-je me remettant tout à fait de mon trouble, je ne puis vous l’expliquer aujourd’hui.
– C’est juste, me dit-elle ; comme vos amis, vous êtes lié par un serment sans doute ?
– Oui, comtesse.
Elle me sourit.
– Soit, dit-elle, gardez votre secret, mais n’oubliez pas que je vous attends dans une heure. Adieu.
Elle me tendit le bout de ses doigts à la façon orientale et me quitta pour rejoindre son père.
Quant à moi, je voulais me perdre dans la foule et m’esquiver ; mais Gaston de Lavenay me rejoignit.
Il passa son bras sous le mien.
– J’ai à te parler, marquis, me dit-il.
– Que veux-tu ?
– Nous avons recueilli un nouveau renseignement.
– Sur qui ?
– Sur elle, parbleu !
– Voyons ?
– Elle va chaque dimanche, au matin, avant le jour, entendre la messe dans une petite chapelle située au milieu des bois. C’est un vœu qu’elle a fait.
– Ah ! fis-je avec une indifférence affectée.
– Un seul serviteur l’accompagne.
– Eh bien ?
– Tu comprends que le moment est propice.
– Pourquoi ?
– Mais pour l’enlever.
– C’est juste, balbutiai-je.
– Ah çà ! me dit Gaston, mais tu es idiot, mon cher, depuis une heure.
– Tu trouves ?
– Tu es amoureux fou, stupide.
– Toi aussi.
– D’accord ; mais je n’oublie pas nos conventions, tandis que toi...
– Je ne parais pas m’en souvenir, veux-tu dire ?
– Précisément.
Je fis un violent effort sur moi-même et je répondis :
– Pardonne-moi, mais je viens d’éprouver une violente contrariété et j’ai l’esprit à tout autre chose qu’à nos amours.
– Qu’as-tu donc ?
– J’ai aperçu dans le bal un officier autrichien que j’ai connu à Paris avant la guerre et je désire le trouver.
– Une querelle ?
– Peut-être...
– Mais, c’est jour de trêve...
– Oh ! pas pour des affaires particulières... j’ai mes raisons.
– Veux-tu que je t’accompagne ?
– C’est inutile. Au revoir...
Et grâce à ce prétexte, je me débarrassai de Gaston, m’élançai au plus épais de la foule et parvins à gagner la porte. Dix minutes après, j’étais assis sur le seuil extérieur de la petite maison isolée au bord du Danube, que la comtesse Haydée m’avait assignée comme lieu de rendez-vous.
J’attendis environ une heure dans la plus vive anxiété.
Pourquoi la jeune Hongroise m’avait-elle donné rendez-vous ? Pourquoi avait-elle besoin de me voir et n’avait-elle foi qu’en moi ?
À l’émotion que de telles pensées devaient faire naître dans mon cœur, joignez le souvenir de ce serment infâme que j’avais prêté et de cette loterie étrange à laquelle j’avais consenti.
Depuis une heure, mes amis m’étaient devenus odieux.
Il me semblait que ces trois hommes formaient entre elle et moi une barrière infranchissable.
Toutes ces réflexions tumultueuses torturaient mon esprit, lorsque je vis se mouvoir dans l’éloignement une forme humaine.
La nuit était assez sombre, et je ne pus distinguer tout d’abord à qui j’avais affaire.
Cependant j’entendis un pas léger résonner sur le sol glacé et bientôt je pus me convaincre que la personne qui venait à moi était une femme.
Cette femme était enveloppée dans une mante épaisse qui lui cachait entièrement le visage.
Je crus que c’était la comtesse elle-même et j’allai vers elle.
Mais une voix qui m’était inconnue me dit, en mauvais français :
– Qui êtes-vous ?
– Je suis le marquis de Vilers.
– C’est bien, reprit la voix, on vous attend.
– Où ?
– Suivez-moi. Elle n’a pu venir ici.
La femme inconnue me prit alors par la main et me fît remonter les bords du Danube vers la ville, où nous pénétrâmes par une ruelle tortueuse et sombre.
– Où me conduisez-vous ? demandai-je.
– Venez toujours, répondit la femme encapuchonnée.
Nous cheminâmes ainsi de ruelle en ruelle pendant un quart d’heure environ.
Puis, la femme s’arrêta.
J’essayai alors de m’orienter, et je cherchai à savoir où je me trouvais. J’étais sur le seuil d’une porte bâtarde, sous les murs d’une maison noire et de sinistre apparence.
Un moment je crus à un guet-apens.
Mais je n’étais pas homme à reculer et me contentai de porter sous mon manteau la main à la garde de mon épée.
La femme souleva un marteau qui rendit à l’intérieur un bruit sourd ; une minute s’écoula, puis la porte s’ouvrit.
– Venez, répéta l’inconnue.
J’avais devant moi un corridor ténébreux.
La femme encapuchonnée me prit par la main et m’entraîna. Je fis en ce moment une réflexion bizarre.
Peut-être un rival malheureux avait-il entendu la comtesse Haydée lorsqu’elle m’assignait un rendez-vous, et, ivre de jalousie, me tendait-il un piège ?
Mais je serais allé au bout du monde et je n’en continuai pas moins à marcher.
Tout à coup, à l’extrémité du corridor, nous atteignîmes une porte.
La femme encapuchonnée poussa cette porte, et, lorsque celle-ci fut ouverte, je demeurai, ébloui.
VII
Où Tony est initié à une sombre histoire d’amour
Je me trouvai, disait encore le marquis de Vilers dans ce manuscrit si palpitant, à l’entrée d’un joli boudoir comme nos marquises de Versailles savent en avoir.
C’était un boudoir à la française avec des meubles de Boule, des sièges en bois doré, recouverts de tapisseries des Gobelins ; les murs étaient tendus d’une étoffe de soie d’un gris tendre à grands ramages.
Çà et là, j’aperçus des tableaux, des bronzes, des statuettes d’un goût parfait.
Je n’étais plus chez une Hongroise, j’étais chez une femme de qualité de Versailles.
Ce boudoir était vide cependant.
– Entrez, me dit la femme encapuchonnée, et attendez.
Je fis quelques pas dans cette pièce que deux flambeaux à trois bougies éclairaient, et je m’assis sur un canapé auprès de la cheminée, où flambait un grand feu.
– Si je suis tombé dans un piège, pensai-je, il faut convenir que celui qui m’y attire mène galamment les choses.
Mais à peine avais-je fait cette réflexion, qu’une portière s’écarta dans le fond du boudoir.
Je me levai précipitamment, et un cri de surprise et de joie m’échappa.
La belle Hongroise pénétrait dans le boudoir et vint à moi.
– Pardonnez-moi, me dit-elle, de ne m’être point trouvée moi-même au rendez-vous que je vous ai donné. Ce n’est point ma faute, en vérité ; c’est celle des circonstances. J’ai craint que nous ne fussions surpris... et j’ai préféré ce lieu.
– Qu’importe ! lui répondis-je, puisque j’ai le bonheur de vous voir.
Elle eut un sourire triste et me demanda :
– Par où êtes-vous venu ?
– Par... là... fis-je en me retournant vers le mur, et en reconnaissant avec surprise que ce mur n’avait aucun indice de porte.
Elle tira tout à fait la portière qu’elle avait soulevée pour entrer.
– C’est mon boudoir, me dit-elle ; il dépend de la maison de ville que nous possédons à Fraülen, mais au lieu d’y pénétrer par cette porte, vous y êtes venu par une autre, que moi seule et la femme qui vous a amené connaissons.
– Mon Dieu, ajouta-t-elle avec tristesse, savez-vous que si on vous surprenait ici, vous seriez perdu ?
J’eus un fier sourire de dédain.
– Et moi aussi peut-être, ajouta-t-elle en courbant le front.
Alors seulement je frissonnai et jetai un regard inquiet autour de nous. La comtesse Haydée vint s’asseoir auprès de moi, prit ma main et me dit :
– Monsieur le marquis, laissez-moi vous répéter que vous êtes le seul homme en qui j’aie foi.
– Oh ! répondis-je, permettez-moi donc alors d’être le plus fier des hommes.
– J’ai osé venir à vous, me dit-elle, car vous êtes brave et loyal et me l’avez déjà prouvé.
– Comtesse...
– Ah ! poursuivit-elle, tous ceux qui me voient jeune, belle, couverte de pierreries, adorée de tous, s’imaginent que je suis la plus heureuse des femmes. D’autres encore prétendent, en me voyant refuser tous ceux qui aspirent à ma main, que je suis une jeune fille sans cœur. Hélas ! les uns et les autres se trompent. Vous seul saurez le secret de ma mystérieuse existence.
La jeune fille parlait avec une émotion grave, pleine de dignité. Je pris sa main et la portai respectueusement à mes lèvres.
– Madame, lui dis-je, quelque terrible que puisse être le secret que vous allez me confier...
– Oh ! dit-elle en m’interrompant, je sais qu’il sera gardé.
– Parlez donc, madame, je vous écoute...