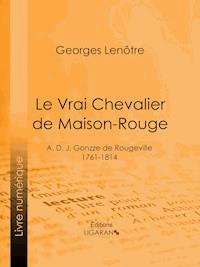
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Französisch
Extrait : "Alexandre Dumas n'a peut-être rien écrit de comparable, sous le point de vue du pittoresque et de l'intérêt dramatique, aux premiers chapitres du Chevalier de Maison-Rouge. C'est une nuit de printemps de 1793. Paris est gardé par le peuple ; les patrouilles circulent dans les rues ; l'une d'elles rencontre une jeune femme — seule, marchant vite, tremblant d'être vue — et l'arrête."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 320
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alexandre Dumas n’a peut-être rien écrit de comparable, sous le point de vue du pittoresque et de l’intérêt dramatique, aux premiers chapitres du Chevalier de Maison-Rouge.
C’est une nuit de printemps de 1793. Paris est gardé par le peuple ; les patrouilles circulent dans les rues ; l’une d’elles rencontre une jeune femme – seule, marchant vite, tremblant d’être vue – et l’arrête. L’inconnue ne répond pas aux questions que lui posent les gardes nationaux ; elle ne peut montrer sa carte de sûreté… c’est une suspecte. Tandis qu’on l’entraîne vers le poste voisin, un jeune municipal, élégant et de bonne mine, s’approche et demande la cause du tumulte.
La pauvre femme devine en lui un sauveur.
– Oh ! Monsieur, lui dit-elle tout bas, si je vais à la section, je suis perdue !
L’officier est un patriote ardent, connu dans son quartier pour un irréprochable démocrate ; mais il a vingt-cinq ans, le cœur tendre et l’esprit chevaleresque. Il se fait le champion de l’inconnue, se porte garant de son civisme, pousse la patrouille dans la boutique d’un marchand de vins – argument sans réplique. – Puis, offrant son bras à la jeune femme, il lui propose de la protéger jusqu’à sa demeure.
Elle accepte, car elle a eu grand-peur : et les voilà tous deux marchant par les rues désertes : ils traversent toute la ville ; lui, sensible, galant, presque amoureux déjà ; elle, discrète, réservée, mystérieuse.
Quand ils sont ainsi parvenus aux confins du faubourg Saint-Victor, l’inconnue s’arrête :
– Monsieur, dit-elle, nous allons nous séparer pour ne plus nous revoir. J’habite à quelques pas d’ici et je puis regagner ma maison sans crainte de mauvaise rencontre. Vous m’avez sauvé la vie ; mais un immense intérêt est attaché à ce que personne ne sache qui je suis, et je dois vous demander une dernière faveur : vous allez fermer les yeux, et, quoi qu’il vous arrive, me promettre de ne pas les ouvrir avant que je sois éloignée.
Le municipal obéit ; tout à coup il sent les lèvres de la jeune femme se poser sur les siennes et lui glisser, dans un baiser, l’anneau d’or qu’elle a détaché de son doigt. Il peut à peine retenir un cri de surprise et de plaisir ; mais il reste fidèle à sa promesse…
Lorsque, quelques instants après, il rouvre les yeux, la rue est déserte : la jeune femme a disparu.
Ce froid et rapide scénario ne donne, comme l’on pense, qu’un bien pâle aperçu du récit dramatique et coloré d’Alexandre Dumas : il a en outre le tort grave de résumer une histoire que tout le monde connaît, car qui n’a lu le Chevalier de Maison-Rouge ? Mais, comme le roman de l’illustre conteur est à la fois le prétexte et la raison d’être de cette étude historique, il nous faut bien en retracer les grandes lignes et en remémorer aux lecteurs les principaux incidents.
Maurice Lindey – c’est le héros de l’aventure que nous venons de rappeler – à force de ruses et de recherches, parvient à connaître le nom de celle à laquelle il n’a cessé de rêver : elle s’appelle Geneviève Dixmer. Il réussit à pénétrer chez elle ; bientôt il devient le familier de la maison.
Oh ! le singulier ménage que ces Dixmer ! Le mari, un riche teinturier, très occupé de ses affaires et fort peu de la politique, vit retiré au fond de ses ateliers, passant ses journées avec ses ouvriers et ses nuits dans son laboratoire, négligeant quelque peu sa jeune femme, à qui Maurice vient maintenant rendre visite chaque jour. Dixmer est d’ailleurs peu gênant : il ne se montre guère et vit assez mystérieusement. Non point que la Terreur qui pèse sur la France l’impressionne en aucune façon : il s’en soucie bien, ma foi ! mais il emploie des marchandises de contrebande et il est très jaloux de ses secrets de fabrication. Il a pour associé un certain Morand, personnage étrange, savant chimiste, l’esprit toujours perdu dans quelque formule, les mains toujours teintes de pourpre ou de cobalt.
Ce Morand inquiète l’amoureux Maurice ; il a grand air sous ses impénétrables lunettes bleues ; il est instruit, travailleur, causeur agréable ; malgré l’indifférence qu’il affecte, on devine, à d’insaisissables indices, que son influence est grande dans le ménage Dixmer. Geneviève l’aimerait-elle ? Ce soupçon traverse si douloureusement le cœur de Maurice qu’il prend la résolution de fuir la maison Dixmer ; il saisit un prétexte et ne revient pas.
Le mari, que la présence de Maurice ne semblait pas offusquer, s’étonne de son absence. Il interroge Geneviève ; elle rougit, elle hésite, elle balbutie ; elle avoue enfin, en femme honnête, qu’il vaut mieux pour son repos que le jeune municipal ne reparaisse plus ; elle se sent prête à l’aimer, elle a peur de lui et d’elle-même. Alors Dixmer se révèle. Dissimulant la rage jalouse qui l’étouffe, il rappelle à sa femme le but que Morand et lui-même poursuivent…
– Geneviève, dit-il, nous sommes dans l’époque des grands dévouements : j’ai donné à la reine, notre bienfaitrice, non seulement mon bras, non seulement ma tête, mais encore ma félicité. Je ferai plus que de lui donner ma vie, je risquerai mon honneur… mais je vous connais, Geneviève, vous êtes un digne et noble cœur. Je suis sûr de vous…
– Hélas ! gémit la pauvre femme, qui peut être sûr des autres, quand nul n’est sûr de soi… !
– Il le faut… vous m’entendez ; il faut que ce jeune homme revienne ici comme par le passé ; il est indispensable que cette maison soit la sienne ; c’est à vous de savoir l’y rappeler et l’y retenir par tous les moyens.
Et voilà comment Maurice Lindey reprit à la table des Dixmer la place qu’un mouvement de dépit amoureux lui avait fait abandonner.
Certain jour, Dixmer s’étant absenté pour affaires, Morand dînait en compagnie de Geneviève et de Maurice ; en homme que les évènements n’intéressent que par leur côté philosophique, il met la conversation sur la reine que Lindey voit souvent au Temple où ses fonctions l’appellent :
– Est-elle bien changée, demande-t-il ; que dit-elle ? comment supporte-t-elle sa détention ?
– La pauvre femme, soupire Geneviève, je voudrais bien la voir !
– La voir ! rien n’est plus facile, reprend Maurice, heureux de satisfaire un caprice de celle qu’il aime ; venez me rendre visite jeudi au Temple ; j’y commande la garde pour vingt-quatre heures, je vous placerai sur le passage de la prisonnière au moment de sa promenade. Morand nous servira de chaperon.
Mais Morand ne se décide pas ; il a trop d’occupations ; ce serait une journée perdue. Maurice, dans l’espoir de passer quelques heures avec Geneviève, de traverser Paris à son bras, insiste, supplie, lève toutes les objections, si bien qu’au jour dit tous trois se dirigent vers le Temple où le jeune municipal va prendre son service.
En chemin une bouquetière présente au couple amoureux une gerbe d’œillets que le jeune officier attache à la ceinture de sa compagne. Elle est émue ; lui est radieux. Morand les suit d’un air ennuyé et distrait. On arrive au Temple. Lorsque les femmes Capet descendent au jardin, Marie-Antoinette, étonnée, s’arrête devant la jolie visiteuse, et, jetant un regard aux œillets, elle ne peut s’empêcher, avec un gros soupir, de murmurer : « Oh ! les belles fleurs ! » Geneviève détache son bouquet et l’offre à la prisonnière. Mais Simon, le savetier que la Révolution a donné comme précepteur au Dauphin, Simon fait bonne garde : il a des soupçons et des soupçons vite justifiés. Le bouquet contenait un billet ; les visiteurs ne sont venus que dans le but de faire évader la Reine : Morand n’est autre que le chevalier de Maison-Rouge, l’insaisissable conspirateur, le fidèle royaliste sur lequel la police, malgré ses efforts, n’est jamais parvenue à mettre la main : Geneviève et Dixmer sont ses complices. Maurice Lindey a donné aveuglément dans le piège.
On sait avec quelle verve, quelles ressources d’invention Dumas conduit cette intrigue. La mystérieuse figure de Morand, ce chevalier de Maison-Rouge, qui aime la Reine d’un amour respectueux et muet, et qui s’est voué à sa délivrance ; le stoïcisme de Dixmer, qui, très épris de la pudique et chaste Geneviève, la force à retenir le patriote dont la présence est nécessaire au complot, tout cela est conté… comme l’auteur des Mousquetaires savait conter. Et ces divers éléments se combinent jusqu’à ce que, la Reine morte, Maison-Rouge se poignarde au pied de la guillotine. Maurice et Geneviève, condamnés à leur tour, montent ensemble sur l’échafaud et meurent en échangeant un dernier serment d’amour.
Tel est ce roman célèbre ; et tous ceux qui l’ont lu se sont, sans nul doute, en fermant le livre, posés cette question : qu’y a-t-il de vrai dans tout cela ?
Ce qui fait à la fois le charme et le défaut des romans historiques, c’est qu’ils mettent en scène des personnages authentiques, et qu’ils les font agir d’une façon purement fantaisiste, de sorte qu’on ne sait plus quelle est la part de l’imagination et quelle est celle de l’histoire. Personne n’ignore, par exemple, qu’en 1793 plusieurs tentatives furent faites pour arracher Marie-Antoinette à sa prison ; on connaît moins les noms de ceux qui avaient conçu un si audacieux projet, et telle est la popularité du roman de Dumas que pour bien des gens les aventures du Chevalier de Maison-Rouge synthétisent tous les dévouements qui s’étaient donnés pour but le salut de la reine.
Il n’en est rien ; Maison-Rouge n’est pas un personnage d’imagination : nous n’avons pas la prétention de faire ici une révélation inédite ; il suffit d’ouvrir un dictionnaire biographique au nom de Rougeville pour reconnaître que, sous le pseudonyme transparent dont il a revêtu son héros, Dumas a raconté, en les amplifiant, les exploits d’un homme qui a bel et bien existé. Ces courtes notices, tout incomplètes et erronées qu’elles soient, vous apprendront même que celui qui eut l’invraisemblable audace de pénétrer à travers mille dangers jusqu’à la reine prisonnière, ne laissa pas sa tête dans l’aventure. Échappé par miracle aux policiers du Comité de Sûreté générale il vécut jusqu’en 1814.
Voilà qui commence à piquer la curiosité. Comment ? à une époque où l’on condamne à mort les simples suspects, où l’on entasse dans les prisons des gens soupçonnés seulement d’avoir « médit » des assignats, où les plus riches financiers, les plus puissants seigneurs, les hommes politiques les plus influents ne parviennent pas à se soustraire à l’échafaud, un conspirateur, un aristocrate avéré, un noble se jette dans la mêlée, parvient à se faire ouvrir les portes d’une prison d’État, complote, s’expose, dupe les fonctionnaires, corrompt les geôliers, fait montre de ses sentiments royalistes, va, vient, circule, réunit des complices, se glisse dans le cachot de la reine et réussit, en fin de compte, à disparaître en temps opportun, à se terrer si habilement qu’il sort sain et sauf de la tourmente où tant d’innocents ont laissé la vie ?… Il y a là une invraisemblance telle que le romancier lui-même n’a pas cru pouvoir la faire accepter, et qu’il a préféré, pour n’être point accusé d’écrire un conte à dormir debout, sacrifier son héros en le faisant se suicider pour sortir d’une situation inextricable.
Eh bien ! le précepte du vieux Boileau est ici applicable : pour si invraisemblable que la chose paraisse, elle n’en est pas moins absolument vraie. Rougeville, qui fut de tous les royalistes celui qui peut-être se compromit le plus, survécut à la Terreur. C’est même cette période de son existence, de 1794 à 1814, qui nous semble présenter le plus d’intérêt.
D’abord, elle était restée jusqu’à présent absolument mystérieuse ; hâtons-nous de dire que nous ne sommes parvenus qu’à soulever le voile à demi nous marchions sur un terrain si inconnu, si plein de surprises, resté forcément si inexploré, que nous avons laissé dans l’ombre, faute de lumière suffisante, bien des points qu’il eût été utile d’éclairer.
L’histoire ressemble à des décors d’opéra, représentant des palais solidement construits, aux robustes assises, aux perspectives nobles, et donnant dans toutes leurs parties l’illusion de la vérité. Si l’on voit le décor à l’envers, on s’aperçoit que tout est carton et toile peinte, que le granit et le marbre ne sont que simulés, et que le moindre portant, mis de travers, suffirait à détruire le trompe-l’œil. L’histoire, telle qu’on l’a écrite trop longtemps, est semblable, disons-nous, à ces décorations de théâtre, vues de la salle. Tout s’y présente dans un ordre parfait, tout y est logique et bien à sa place, tout y paraît solide et réel… à condition qu’on ne pénètre pas dans les coulisses, c’est-à-dire qu’on n’entreprenne point d’étudier les faits dans les documents authentiques entassés par monceaux dans les archives, car alors on découvre que ce monument n’est qu’en façade et qu’il ne tient debout qu’à grand renfort de ficelles et de chevilles.
Nous connaissons, – à peu près – les effets ; mais, dans la plupart des cas, nous ignorons les causes si des gens comme de Batz, Frotté, Pellier, Cadoudal, Pichegru et d’autres dont nous verrons les silhouettes apparaître en ce récit, avaient pu ou voulu écrire sincèrement, loyalement, sans réticence et sans pose, ce qu’ils savaient et tout ce qu’ils savaient, on peut considérer comme certain que leurs dépositions modifieraient absolument l’histoire officielle qui n’est faite que de ce qu’on connaît – peu de chose – et naturellement pas de ce qu’on ignore – presque tout !
Il se produit, pour les évènements contemporains, que nous content chaque jour les gazettes, un phénomène singulier : les faits naissent quotidiennement, démesurément grossis d’abord ; on soupçonne des dessous ténébreux, on flaire de gigantesques intrigues, on promet des révélations écrasantes ; puis, au fur et à mesure de l’éloignement, il se produit une sorte de tassement, la perspective fait son office, les choses prennent une certaine forme avec laquelle on se familiarise, qu’on admet peu à peu, les uns par intérêt, les autres par lassitude, par besoin de nouveauté, et les faits finissent par être définitivement classés dans la mémoire de tous, sous un aspect si incomplet qu’il diffère tout à fait de la vérité. L’histoire les recueille en cet état et les expose dans son froid musée. Je ne désespère pas qu’un beau jour, si l’on parvient à lire toutes les pièces authentiques, à recueillir tous les vieux papiers qui dorment dans la poussière des greniers de province, à tout compulser, fouiller, classer, on prouvera que ce musée n’est qu’une galerie de trucages et que tout est à refaire.
Mais peut-être va-t-on penser que, dans ce modeste livre, nous avons si grosse ambition. Il n’en est rien et ces réflexions ne nous sont inspirées que par le dépit de nous être heurté, tout le long de notre travail, à l’inconnu et au mystérieux. Nous espérions, en l’entreprenant, tracer le tableau d’une époque : nous n’avons réussi à écrire que l’histoire d’un homme. Il est vrai que cet homme s’est, pendant toute sa vie, trouvé en lutte avec les policiers de la Convention, du Directoire, du Consulat, de l’Empire ; son existence a été si mouvementée, si périlleuse, si remplie d’intrigues, qu’un illustre romancier en a fait le sujet d’un de ses contes les plus attachants. Et, si nous n’avons pas la prétention d’égaler en intérêt le roman dont cet homme est le héros, nous croyons cependant qu’on aura plaisir à connaître les aventures – sinon complètes, du moins vraies – auxquelles il fut mêlé.
Le marquis de Rougeville n’était ni marquis, ni noble : son nom même de Rougeville était usurpé.
On se figure généralement que, sous l’ancien régime, un titre et une particule impliquaient forcément la noblesse ; rien de plus faux : alors, comme aujourd’hui, bon nombre de bourgeois, par une sorte de travers assez inexplicable, ajoutaient à leur nom patronymique celui d’une terre ou d’un village, et jouaient au gentilhomme.
De nos jours on parvient ainsi à faire illusion. On est devenu tellement indifférent en France à tout ce qui se rapporte à la généalogie, les révolutions successives ont à ce point transfiguré l’ancienne société, les différentes monarchies qui se sont succédé depuis 1804 ont tant distribué de lettres de noblesse, que l’on ne saurait attacher grande importance au plus ou moins d’authenticité d’un titre. Dès qu’on a des chevaux, un hôtel, qu’on mène un certain train de vie, on se fait comte ou marquis ; le monde n’est point difficile et vous accepte pour tel sur l’étiquette. Autrefois il n’en était pas ainsi : un comte ou un marquis de contrebande ne trompait personne ; certaines prérogatives étant attachées aux titres authentiques – prérogatives parfaitement justifiées à l’égard de familles qui depuis huit siècles servaient la France en guerroyant pour elle à leurs dépens, – il était d’une importance extrême de ne laisser aucun intrus se glisser dans cette classe privilégiée et profiter injustement des avantages dont elle jouissait. Les généalogistes de la Cour étaient les juges de ces droits nobiliaires ; ils étudiaient avec soin les titulatures possédaient le secret de toutes les familles et décidaient des présentations, sorte de brevet accordé par le roi aux gens de haute noblesse. Telle était la règle et elle était inflexible. On prétend que, sous le règne de Louis XV, qui vit la fin de ces anciennes et respectables coutumes, il n’existait pas en France plus de quatre-vingt-quatorze familles dont la noblesse remontât au-delà de 1399. Toutes les autres ne comptaient que des anoblis pour services rendus à la Couronne. Mais le roi, en accordant par faveur ou par reconnaissance des lettres de noblesse, ne pouvait cependant créer à volonté des duchés, des marquisats ou des comtés héréditaires ; les ordonnances, rigoureusement suivies en cette matière, prescrivaient certaines conditions territoriales et féodales, inhérentes à la nature d’un domaine, difficiles à réunir et très indépendantes de la volonté royale impuissante à y rien changer. On ne pouvait, par exemple, créer un marquis héréditaire, à moins qu’il ne fût en possession d’un domaine substitué réunissant trois baronnies et six châtellenies mouvantes de la Tour du Louvre et tenues du roi à un seul hommage.
… Nous voilà loin, on va le voir, du marquis de Rougeville et, si ce préambule a paru fastidieux au lecteur, nous l’avons cru néanmoins indispensable, en ce qu’il va nous aider à saisir, dès l’abord, un côté du caractère de l’étrange personnage dont l’histoire fait le sujet de ce livre.
Il était fils d’un cultivateur enrichi, intéressé à la Ferme des eaux-de-vie et des grains de la province d’Artois. Ce traitant s’appelait-il Gousse ou Gonsse ? Ce point est douteux : c’est néanmoins cette dernière orthographe, adoptée par Rougeville lui-même, que nous accepterons.
Gonsse avait un parfum des plus roturiers ; Gonsse pouvait faire assez bonne figure, à condition de l’écrire Gonzze, comme ne manquait pas de le faire Rougeville, ce qui lui permettait de donner à son nom patronymique un pittoresque aspect espagnol : Gonzza de Gonzzala. Au surplus Gonzze peut être la véritable forme, et l’origine espagnole semble assez plausible, l’Artois ayant été pendant longtemps sous la domination de la maison d’Espagne.
Le père de notre héros avait donc amassé une fortune dans les spéculations de denrées ; jointe aux propriétés territoriales que lui avaient laissées ses ancêtres, cette fortune formait un patrimoine considérable. Rougeville ne manquait jamais de qualifier ses ascendants des titres pompeux des Seigneurs et vicomtes de Wetzamarles, de Marles, de Rougeville, barons de Mingoval, d’Athies, d’Humécourt et de Saint-Laurent… La vérité est que les Gonzze, établis depuis plus de deux siècles en Artois, possédaient une terre à Mingoval, commune aujourd’hui comprise dans le canton d’Aubigny, à vingt kilomètres de Saint-Pol. De père en fils, ils faisaient valoir cette propriété qui s’était augmentée successivement de plusieurs fermes sises à Athies, près d’Arras, ou aux environs de Montreuil, sur le territoire des paroisses de Marles et de Us-de-Marles. Rougeville est le nom d’un moulin situé aux portes de Valenciennes.
Ceux qui aiment à rechercher dans les aïeux d’un personnage historique certains indices d’atavisme, pourront trouver dans la généalogie de notre marquis une succession de faits dénotant à la fois une race d’une vigueur physique peu commune et d’une puissance vitale vraiment extraordinaire. Son grand-père, Pierre-Marie-Joseph Gonsse, né à Mingoval, en 1684, vécut cent ans, sans aucune infirmité ; son bisaïeul, né en 1653, n’avait jamais connu la maladie ou la décrépitude. À l’âge de cent neuf ans, il faisait encore ses quatre repas par jour, marchait sans bâton, montait à cheval et mourut par accident en 1762. Il avait épousé, le 15 juin 1681, Marie-Albertine Sauthy et en avait eu quinze enfants ! Quant à son trisaïeul il était mort à quatre-vingt-dix ans dans sa ferme de Mingoval qu’il faisait valoir depuis les premières années du règne de Louis XIV.
Comment Rougeville descendant d’une si belle lignée de robustes campagnards se trouva-t-il entiché de noblesse à un degré tel qu’on pourrait par moment le croire atteint de la folie des grandeurs ? C’est là un point impossible à élucider et la chose est regrettable, car cette étrange marotte fut la boussole de toute son existence. Il y eut là un résultat de l’éducation reçue, une durable impression d’enfance excusable chez un jeune homme né de condition roturière et élevé, grâce à la fortune de ses parents, comme pouvait l’être le fils d’un gentilhomme destiné à une vie oisive et brillante.
Son père, spéculant, comme on l’a vu, sur les grains et les eaux-de-vie présentés au marché d’Arras, avait quitté sa terre natale de Mingoval pour venir habiter la ville. Devenu riche assez rapidement, il acheta un vaste terrain à Saint-Laurent, paroisse très voisine d’Arras, et y fit bâtir, vers 1775, un château où il comptait passer paisiblement sa vieillesse. Il s’y installa avec ses trois enfants, auxquels, dit-on, un jeune oratorien, de grand savoir et de haute intelligence, servait de précepteur ; cet homme s’appelait Joseph Lebon.
Le château de Saint-Laurent, s’il faut en juger par une annonce émanée de l’étude du citoyen Arnouts, notaire à Arras, rue Guillaume-Tell, ci-devant des Récollets, devait être le type des confortables gentilhommières, telles qu’on les entendait avant la Révolution.
À cette époque où les communications étaient malaisées, où, par suite, on sortait peu, on aimait à grouper autour de soi toutes les nécessités et les agréments de l’existence. Le père du marquis de Rougeville, en construisant le château de Saint-Laurent, l’avait aménagé de façon à y vivre largement, en propriétaire opulent, qui veut avoir sous la main sa ferme, son potager, une basse-cour bien garnie, une chasse giboyeuse et des étangs poissonneux. L’habitation élevait au haut d’une double terrasse sa belle façade de pierre à l’italienne ; elle contenait au rez-de-chaussée deux vestibules, une salle à manger, un grand salon de réception et un salon de compagnie, des cuisines, des dégagements, des offices et quelques chambres d’amis. Un bel escalier à rampes de cuivre et de fer doré conduisait au premier étage où se trouvaient plusieurs appartements de maître, lambrissés de boiseries sculptées.
À droite de la cour d’honneur se massaient les logements du fermier, du jardinier, du concierge, les remises, les écuries, le poulailler, la laiterie, dominés par un haut pigeonnier très peuplé. Au bas de la terrasse s’étendait un beau parterre de fleurs et d’arbustes, décoré de statues et de vases, et accoté de deux boulingrins touffus. Plus loin se trouvaient un espalier et une treille, le verger, le réservoir à poissons, la carpière, et le grand potager qu’une longue avenue d’ormes de Hollande et une haie de charmille séparaient d’un petit-bois de haute futaie, dont les ombrages bordaient deux longues pièces d’eau séparées par une digue plantée de tilleuls. Un kiosque chinois reflétait dans l’eau son dôme élégant, décoré à l’intérieur d’une fresque représentant le sacrifice de Confucius. Quatre-vingt-dix mesures de prairies et de terres de labour complétaient la propriété.
C’est là que Rougeville passa son enfance. Il ne nous a pas été possible de réunir sur ses jeunes années des renseignements positifs. Mais le peu que nous en savons nous permet de reconstituer, sans trop de fantaisie, les premières impressions de cette singulière nature.
Nous le voyons, dès l’enfance, rêvant de gloire, d’honneur, de combats… Élevé dans un château, fils d’un homme que sa fortune rendait l’égal de bien des seigneurs, il devait, dans sa morgue de petit provincial, s’imaginer qu’il ferait aisément à la Cour aussi bonne figure qu’à Saint-Laurent. La Cour ! ces mots évoquaient en son esprit une sorte de paradis accessible aux seuls élus, où la vie se passait en fêtes, en intrigues galantes, où les femmes étaient toutes jolies, où les hommes étaient tous braves, élégants et amoureux.
Il y avait alors un jeune prince dont on parlait beaucoup à Arras. C’était le comte d’Artois. Chaque année la chronique locale faisait espérer aux Artésiens que le frère du Roi viendrait bientôt visiter la province dont il portait le nom. En attendant l’auguste visiteur – qui ne se dérangea point, du reste – on ne tarissait pas sur son luxe, ses aventures, ses jockeys, ses duels ; on racontait qu’il ne voyageait jamais à moins de cent chevaux par poste, qu’il perdait en une nuit des monceaux d’or, qu’il dansait sur la corde raide aussi habilement qu’un acrobate de profession. Jusqu’au fond de la province ses excentricités d’élégance éblouissaient ; il possédait, disait-on, trois cent soixante-cinq paires de souliers et trois cent soixante-cinq boucles de pierreries, afin d’en changer chaque jour de l’année. Il envoyait à Londres des courriers spéciaux pour consulter des experts sur un coup de dé douteux ; il jouait la comédie devant les reines…
Ah ! ce fut une bien singulière époque, celle qui précéda immédiatement la Révolution ; on eût dit que le vieux monde était pris du désir de vivre vite, comprenant qu’il ne vivrait plus longtemps, et il s’échevela en une sarabande folle, s’éprit des aventures, rêva des sensations inconnues : jamais bouillonnement semblable n’agita une nation ; la fièvre gagnait jusqu’aux provinces les plus calmes et les plus guindées, une fièvre d’indépendance, de scepticisme et d’inédit.
Rougeville, moins qu’un autre, ne devait pas échapper à la contagion. Mais comment prendrait-il sa part à ce festival monstre où s’entraînait la société ? Comment devait-il conquérir sa place dans les rangs de ces jeunes seigneurs batailleurs et charmants, parmi lesquels l’appelaient ses goûts et son désir d’aventures, mais d’où l’excluait sa naissance ? Les évènements allaient lui en fournir l’occasion.
On a dit, et tous les dictionnaires biographiques l’ont répété, que Rougeville s’était engagé dans les gendarmes de la garde du Roi, en 1775, et que, passé l’année suivante en Amérique, il y avait servi, de 1776 à 1783, en qualité d’aide de camp des généraux Lee et Washington. Or, en 1775, Rougeville avait un peu plus de treize ans ; en supposant même qu’un gendarme de cet âge ne semble pas une anomalie on peut aisément croire que Washington ne prit pas comme officier d’ordonnance un gamin de quinze ans. Les historiens auraient-ils donc, dès ce premier pas, été dupes d’une confusion ? Confusion volontairement établie peut-être par Rougeville lui-même, qui, toute sa vie, semble n’avoir eu qu’un but : s’assurer de brillants états de service et se targuer de titres souvent imaginaires pour s’imposer à l’admiration de la postérité. Celui qui fut gendarme en 1775 nous semble avoir été son frère aîné, de plusieurs années plus âgé que lui, portant comme lui le prénom de Joseph, et qui, passé plus tard au service de l’empereur d’Autriche, périt en 1789 à Hungarische-Brood, en Moravie, des suites d’une chute de cheval.
Ce qui est vrai, néanmoins, c’est que la guerre d’Amérique allait permettre à Rougeville de se lancer dans la vie aventureuse qu’il rêvait et de se mêler enfin à ces brillants seigneurs de la Cour, de conquérir un grade qui, sa fortune aidant, ferait de lui leur égal, de tenter, en un mot, son trou dans la vie.
Nous n’avons pas à raconter ici par suite de quels évènements les Colons de l’Amérique du Nord se révoltèrent contre la dure autorité de l’Angleterre qui les pressurait. Nous n’en retiendrons que ce qui a un rapport direct avec notre sujet. Les hostilités commencèrent en 1769 ; la province de Massachusetts se déclara la première en insurrection ; toutes les autres suivirent cet exemple, chassèrent les employés anglais et élurent des députés à un Congrès général. Le 4 juin 1776, le Congrès publia sa déclaration d’indépendance ; entre autres doctrines on y remarquait les principes suivants : « Tous les hommes ont été créés égaux ; ils ont été doués par le Créateur de certains droits inaliénables ; pour s’assurer la jouissance de ces droits, les hommes ont établi parmi eux des gouvernements dont la juste autorité émane du consentement des gouvernés ; toutes les fois qu’une forme de gouvernement quelconque devient destructive des fins pour lesquelles elle a été établie, le peuple a le droit de la changer et de l’abolir. »
On pense quel enthousiasme cette déclaration, fille de la philosophie française, excita parmi l’ardente génération d’alors : la nation demanda à grands cris la guerre contre l’Angleterre ; la jeune noblesse, imbue des idées philosophiques et désireuse de secouer la honte de la guerre de Sept ans voulait rassembler des volontaires, équiper des vaisseaux et partir en masse pour l’Amérique. Le gouvernement tâchait de ramener le sang-froid, et il y serait parvenu peut-être si trois envoyés américains n’étaient venus à Paris pour solliciter les secours de la France. Ces trois hommes étaient Franklin, Arthur Lee et Silas Deane.
Il n’est pas utile d’apprendre aux Français de notre époque comment Paris reçoit les étrangers auxquels il veut faire fête. L’inoubliable spectacle que nous avons vu lors du récent voyage de l’escadre russe n’est pas un fait unique dans notre histoire ; il s’était déjà présenté, il y a cent vingt ans, et précisément à l’occasion de ce voyage de Franklin. Ce fut le même enthousiasme, le même délire, les mêmes acclamations. La foule se pressait sur le passage de l’illustre savant ; on s’écrasait autour de sa voiture ; et les Parisiens, frondeurs de père en fils, y mettaient d’autant plus d’entrain que le gouvernement restait froid. Recevoir officiellement les ambassadeurs américains, c’était rompre avec l’Angleterre ; aussi le ministre Vergennes ne les vit-il qu’en secret.
Tout à coup l’on apprit qu’un jeune officier, lassé de l’inexécution des promesses d’avancement dont le bernait le ministre, avait fait armer secrètement un navire : abandonnant sa femme et son enfant, il s’était embarqué avec cinquante autres officiers pour aller rejoindre Washington. Un de ses amis, tenu au courant du projet, crut devoir en avertir la famille ; vite on dépêcha courrier sur courrier vers Bordeaux, d’où l’on croyait que le départ devait s’effectuer ; mais le vaisseau était déjà en pleine mer lorsque les ordres de l’arrêter arrivèrent. Ce jeune officier se nommait La Fayette.
Rougeville était-il au nombre de ses compagnons ? C’est peu probable. La chose se passait au mois de mars 1777, et La Fayette n’aurait pas consenti, sans doute, à associer à son escapade un jeune homme de quinze ans, qui lui était parfaitement inconnu et qui ne pouvait, d’ailleurs, être en possession d’aucun grade dans l’armée.
Mais ce ne fut que partie remise ; l’exemple était donné ; chaque mois voyait partir un certain nombre d’enthousiastes pressés de se battre pour la cause de l’Indépendance américaine ; les évènements ne marchaient pas alors aussi rapidement qu’aujourd’hui ; l’Amérique était à cinquante jours de nos côtes : la Correspondance secrète qui nous tient, pour ainsi dire jour par jour, au courant des lents incidents de cette guerre, signale, de temps à autre, un nouveau départ de volontaires.
Pendant cinq ans ils s’embarquèrent ainsi par petits groupes ; et, à la date du 18 février 1782, la Correspondance note encore : « Il partira, dans le mois prochain, un bel assortiment de jeunes gens de toutes conditions pour l’armée de Rochambeau ; nos jeunes seigneurs veulent tous faire les petits La Fayette. » Le 30 novembre suivant, l’Angleterre, renonçant à lutter contre les provinces révoltées et contre l’armée de quinze mille hommes que la France entretenait en Amérique, reconnaissait l’indépendance des treize États, et deux mois plus tard la paix était signée.
Il n’est donc pas possible, ignorant à quelle date s’embarqua Rougeville, de démêler le rôle qui lui fut assigné dans cette campagne. Ceux qui étaient partis des premiers assistèrent à bien des batailles, connurent bien des revers, eurent aussi la joie de nombreuses victoires ; mais était-il de ceux-là ? Étant donné son jeune âge, c’est douteux. Il ne prit probablement part qu’à la fin de l’expédition – il avait alors vingt ans – et c’est en imagination qu’il aura été l’aide de camp de Lee et de Washington, blessé, couvert de gloire, et doté d’une rente par le Congrès, toutes choses qu’il croyait fermement à force de les avoir répétées.
Il ne paraît pas, d’ailleurs, avoir tiré grand profit de cette première campagne : quand il rentra en France il regagna d’abord Saint-Laurent où il pensait sans doute que sa réputation l’aurait précédé. Chose étrange, son vénérable père, homme estimé de tous, avait, pendant l’absence de Rougeville, été pris de la marotte nobilière de son fils. Cette indication nous est fournie par un témoin encore vivant – il est vrai qu’il est de bronze, – l’une des cloches de l’église de Blangy dont le châtelain de Saint-Laurent fut le parrain. Sa filleule porte gravée sur ses flancs l’inscription que voici :
« L’an 1781, je fus nommée Laurentine-Josèphe par le Sr François-Joseph Gousse, Sgr de Wetz-à-Marles, Marles en partie, Rougeville, Saint-Laurent, baron d’Athies et autres lieux ; et par Dlle Marie-Rose-Françoise Huret, épouse du Sr Martin-François-Hilaire Deladerrière, bourgeois de la ville d’Arras, mes parrains et marraines. »
Il paraît résulter de cette ronflante succession de titres qu’avec la fortune était venu aux Gonzze le désir de s’anoblir ; ils le faisaient en ajoutant à leur nom celui de toutes leurs terres, et leurs concitoyens leur passaient ce petit travers, puisque l’on admettait qu’ils arborassent ce panache dans les actes qui, sans être officiels, admettaient cependant, comme le baptême d’une cloche, une certaine publicité.
Telle était donc la situation de la famille Gonzze quelques années avant la Révolution.
Rougeville quitta bientôt Saint-Laurent qu’il jugeait une scène trop étroite pour le rôle qu’il se croyait appelé à jouer. Il vint à Paris. À l’entendre, il n’y réussit pas trop mal. Voici un bref résumé de ses états de service, tracé par lui-même, quelques années plus tard :
D’abord officier dans la légion de Soubise ;
Gendarme de la garde du roi ;
Réformé avec le brevet de capitaine de cavalerie ;
Ensuite lieutenant-colonel de cavalerie, en Amérique ;
Puis écuyer de Monsieur, fils de France, frère du roi ;
Colonel de cavalerie, breveté de sa Majesté ;
Chevalier de l’ordre royal et militaire de Saint-Louis ;
Chevalier de l’ordre de Cincinnatus.
Avec des indications aussi précises, rien ne semblait plus facile que de reconstituer la vie de notre héros depuis son entrée dans l’armée jusqu’à la Révolution du 10 août. Les dossiers conservés aux archives du ministère de la Guerre devraient nous servir à broder de quelques détails ce canevas si net, et nous étions assurés d’y faire une ample récolte de renseignements précieux sur la façon dont Rougeville s’était comporté dans ses différents grades.
Eh bien ! ce Rougeville qui, nous l’avons vu, ne s’appelait pas Rougeville, ce marquis qui n’était pas noble, ne fut ni officier, ni gendarme de la garde, ni capitaine, ni lieutenant-colonel, ni écuyer de Monsieur, ni colonel de cavalerie, ni rien. Son nom n’existe pas dans les contrôles. S’il servit, ce qui est douteux, ce fut sous un pseudonyme. D’ailleurs il avait certainement oublié son acte de naissance lorsqu’il se vantait d’avoir atteint, avant la guerre d’Amérique, le grade de capitaine de cavalerie. Né en 1761, il ne pouvait, en 1776, – voire même en 1780, – avoir obtenu les deux épaulettes.
Il ne figure pas davantage dans les annuaires de l’armée ; l’Almanach royal ne le mentionne point comme faisant partie de la maison de Monsieur, frère du roi ; enfin les répertoires de l’ordre militaire de Saint-Louis, publiés par MM. A. Mazas et Théodore Anne, fort complets en ce qui concerne les promotions du règne de Louis XVI, ne font mention d’aucun Gonzze ni d’aucun Rougeville. En supposant – ce qui est possible, étant données la difficulté et la minutie de semblables recherches – que son nom nous ait échappé dans l’une de ces listes, il n’en reste pas moins acquis qu’on ne le trouve nulle part au dépôt des dossiers de la Guerre, et l’on peut en conclure que Rougeville n’a jamais porté l’épée.
Mais alors un problème se pose : comment le verrons-nous bientôt, tenant à la cour une sorte de rang, se glissant dans l’entourage de la famille royale ? Comment expliquera-t-on qu’il ne soit désigné, en 1793, que sous le nom du Chevalier de Saint-Louis, et que la reine elle-même lui donne ce titre ? Cela reste mystère, et nous en sommes réduits aux suppositions en ce qui concerne son existence pendant les années qui précédèrent la Révolution.
Il est possible qu’il parvint à obtenir un emploi très subalterne dans les services de la maison du comte de Provence ; nous avons quelque indice qu’il y remplit les fonctions de fourrier des écuries. Grâce à son aplomb, à sa fortune, à son esprit d’intrigue, il aura pu se lier avec quelques gendarmes du roi, ou quelque modeste officier de la garde de Monsieur ; grâce à ces relations, il se sera fait admettre dans cette petite phalange de défenseurs qui se groupèrent, dans les dernières années de la monarchie, autour de la famille royale ; sans doute acceptait-on, vu le péril urgent, tous les dévouements, d’où qu’ils vinssent. D’ailleurs Rougeville – il le prouva – n’était pas un homme à négliger : courageux, sans scrupules, habile, intrigant, coureur d’aventures, on pouvait l’utiliser à la seule condition de flatter sa vanité. Ce fut là, peut-être, tout le secret du rôle qu’il parvint à jouer.





























