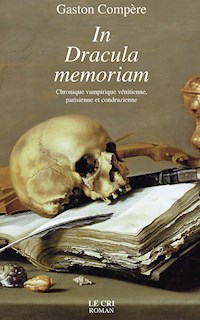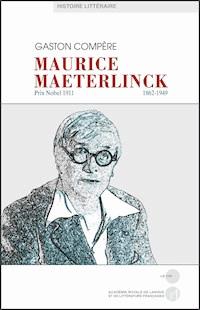
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Le Cri
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Französisch
Un essai littéraire sur l'une des figures de la littérature belge francophoneL’admiration, la vénération même de Gaston Compère pour Maurice Maeterlinck est un prodige en soi. À première vue, il ne devrait pas y avoir de rapport entre l’écriture économe, familière du silence de l’aîné et la faconde baroque de son disciple. Leur connivence ne se situe pas là, mais dans le pouvoir de percer à jour les mystères, d’explorer les confins du réel, de passer les miroirs. L’un et l’autre ont été imprégnés par les sortilèges du romantisme allemand, ils savent traverser les apparences, nous entraîner dans une autre dimension. Compère a relevé cela très tôt dans l’œuvre de Maeterlinck, au point de n’avoir de cesse, tout jeune, de le rencontrer et d’enfourcher sa motocyclette pour solliciter un entretien avec son idole dans le Midi de la France. Cette rencontre est l’un des fleurons de ce livre très différent de la thèse que Compère a par ailleurs consacrée au seul prix Nobel de littérature belge.Ce livre-ci n’est pas moins savant, mais libéré des contraintes de l’académisme, il est un véritable essai au sens le plus noble du terme, un exercice d’admiration lucide, passionnée, d’une rare pénétration.Riche de documentation, Gaston Compère nous offre une formidable référence biographique sur l'auteur récompensé par le Prix Nobel de littératureA PROPOS DE L'AUTEUR Gaston Compère, né dans le Condroz en 1929, docteur en philosophie et lettres, est un des grands écrivains d’expression française. Il a reçu en 1989 le Grand prix de Littérature de la francophonie. Outre ses romans (notamment chez Belfond), il a publié une biographie très remarquée de Maurice Maeterlinck (La Manufacture, 1989) et de nombreuses pièces de théâtre. Il est aussi poète et traducteur (Le Livre d’Heures de R. M. Rilke, Le Cri, 1989).EXTRAIT On peut tout comprendre des hommes engagés dans des événements qu’ils dominent ou qui les dépassent. Rien d’humain qui ne soit susceptible d’être compris. Maeterlinck l’a souvent souligné, et avec raison. Tel critique se voit invité d’écrire une monographie de Jacques Brel. Il ne connaît pas spécialement le chanteur. Il ne le goûte pas particulièrement. Il accepte. Pour diverses raisons, qui vont de l’argent à gagner au fait que tout homme, parce que homme, est digne d’intérêt. Il suffit de se sentir une vocation d’historien. L’historien, comme le souligne Fontenelle, « spectateur de toutes choses, indifférent et appliqué ». Maeterlinck, on ne peut guère dire qu’il ait éveillé de ces gens à sang froid pour qui, à la limite, tous les sujets se valent. Ni son œuvre. Ni son œuvre surtout. Les avis sont aussi variés que possible.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 406
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
MAURICE MAETERLINCK
DANS LA MÊME COLLECTION
Albert Ayguesparse,Selon toute vraisemblance
Nouvelles, 2004
Marie-Thérèse Bodart,Léon Tolstoï
Biographie, 2011
Valérie Catelain,Julien Green
Essai, 2005
Jacques Cels,Entretiens avec Charles Bertin,2012
Jacques De Decker,Le Dossier Hubert Nyssen,2012
Marie Delcourt,L’Autre regard,
Chroniques du journalLe Soir, 2004
Sophie Deroisin,Le Prince de Ligne
Biographie, 2006
Daniel Droixhe,Le Cri du public
Essai, 2003
Daniel Droixhe,L’Esprit des journaux
Histoire, 2010
Daniel Droixhe,Lettres de Liège,Histoire, 2012
Louis Dubrau,Profils perdus
Nouvelles inédites, 2004
André Goosse,Façons belges de parler
Essai, 2011
Paul Gorceix, Roger Bodart,Maeterlinck en partie double
Essai, 2011
Paul Gorceix,Maeterlinck, l’arpenteur de l’invisible
Essai, 2005
Luc Hommel,Marguerite d’York
Biographie, 2003
Marcel Lobet,Cœurs mis à nu
Histoire littéraire, 2004
Roland Mortier,Juliette de Robersart
Biographie, 2003
Jean Tordeur,La Table d’écriture, prises de parole
Discours, 2009
Raymond Trousson,Rousseau par ceux qui l’ont vu
Essai, 2004
Guy Vaes,111 Films
Chroniques de cinéma, 2007
Charles Van Lerberghe,N’êtes-vous pas patineuse ?
Correspondance, 2004
Jean Weisgerber,Faulkner et Dostoïevski,essai, 2012
Paul Willems,Lettres à Jacques Ferrand 1946 - 1994
Correspondance, 2005
Paul Willems,Le Vase de Delft
Nouvelles, 2004
GASTON COMPÈRE
MAURICE MAETERLINCK
Biographie
www.lecri.be [email protected]
La version numérique a été réalisée en partenariat avec le CNL
(Centre National du Livre - FR)
ISBN 978-2-8710-6769-6
© Le Cri édition
Avenue Léopold Wiener, 18
B-1170 Bruxelles
Tous droits de reproduction, par quelque procédé que ce soit, d’adaptation ou de traduction, réservés pour tous pays.
À Georges et Denyse Thinès,
pour saluer les connivences de l’amitié.
AVANT-PROPOS
Dans son pays d’origine, et plus particulièrement, j’imagine, si le pays est petit, arrange bien des choses la mort d’un écrivain connu aux quatre coins de la planète. Le mort est évidemment en paix, du moins on le suppose. En paix aussi, enfin, les confrères, et particulièrement ceux qui jouissent de la notoriété. D’un de ceux-ci je tiens ce mot qui en dit long : «La mort, il sait enfin ce que c’est. » Bien sûr, en 1949, Maeterlinck, à quatre-vingt-sept ans, ne bouchait plus guère d’horizons. On le vénérait, comme on vénère une relique. Mais enfin, qu’il fût absent pour de bon, était pour beaucoup un soulagement — et, en particulier, pour la plupart de ceux qui, en Belgique, se voulaient la plume ambitieuse. Maeterlinck faisait encore de l’ombre, et l’on sait que l’ombre donne un teint peu recommandé à ceux qui veulent briller. L’écrivain belge a facilement un teint d’endive — légume national — et il en souffre. Un académicien (belge) de l’époque, plus célèbre parmi ses étudiants, dont j’étais, par ses cravates que par ses œuvres, nous fit cet aveu : « En 1911, l’Académie française lui ouvre ses portes. Il n’a même pas à faire les visites d’usage. Il lui suffit de prendre la nationalité française. Et il ne la prend pas ! Comprenez-vous cela ? Faut-il qu’il soit flamand ! » On connaît sans doute ce mot d’un général qui, la guerre terminée, déclara : « On va pouvoir enfin faire de belles manœuvres ! » Réactions un peu semblables parmi la gent littéraire. On allait pouvoir s’offrir de belles oraisons funèbres. Et on se ferait un devoir de les publier. Des articles où l’on pourrait sans danger exalter le dithyrambe. Ceci. Cela. La lumière du grand homme vous retombe sur la tête, vous fait une auréole, n’est-ce pas que je suis bien ? L’Institut national de radiodiffusion pouvait se permettre d’éditer une brochure-programme. Pour quinze francs. Quinze francs, une bagatelle. Même à l’époque pour le bourgeois. À votre porte-monnaie, bonnes gens qui vous dites cultivées. Non, il n’était pas dit que les instances officielles n’œuvraient pas pour ce grand homme détestable qui voyait plus loin que son nez belge. Les bourgeois aiment se dire cultivés. (La culture vous camoufle en même temps qu’elle vous fait socialement briller.) J’en connais personnellement un si grand nombre qu’il m’arriverait de trouver la chose décourageante si je n’avais le don de lui trouver un de ces comiques amers qui vous revigorent. Il faut bien reconnaître que l’instruction obligatoire a eu comme conséquence malheureuse de faire braire des ânes aux mille coins du « paysage culturel ». Sur les ondes, la bêtise devient terrifiante. Les bourgeois gantois de la jeunesse de Maeterlinck se trouvaient assez de lustre dans leur fortune. Ils étaient souvent incultes. Ils ne s’en vantaient pas. Ils l’étaient : massivement. « Gand, note Maeterlinck, était hermétiquement fermée à toute littérature… On ne vous en voulait pas, on ne vous houspillait pas; mais on vous traitait avec une dédaigneuse bienveillance, comme d’inoffensifs minus habentes, dont les années assagiraient la monomanie. » Ces gens ne sont pas de tout repos. Il en reste, et plus qu’on ne croit. Mais il en est qui se veulent un peu de cette érudition qui attire l’attention. La Bruyère ferait merveille dans ces milieux qu’il me faut parfois fréquenter par obligation. Ceci, tenez, dont je fus plusieurs fois le témoin. Le concours Reine Élisabeth donne, paraît-il, à la Belgique, un lustre incomparable partout où la bonne musique se voit honorée. Je préfère, pour mon repos, ne porter aucun jugement sur le public de ces concerts. Il m’est souvent arrivé de voir, à l’entracte, des auditeurs tirer de leur poche un « mini-transistor » et, dans une solitude relative, écouter l’opinion du type incertain qui se voit convié, sur les ondes, à donner son opinion. Il parle, il se tait, le « mini-transistor » disparaît dans la poche, on peut enfin, dans le groupe où l’on se glisse faire preuve de compétence — de soi-disant compétence, on l’entend bien. Le snobisme, tout vain qu’il est, conforte qui s’y adonne. La société dite cultivée est gangrenée par ces gens. Quant à ceux à qui vont leurs suffrages, les artistes en tous genres, on pourrait les classer en catégories que ne renierait pas Linné. Je m’y risquerai ailleurs. Pour l’instant, je les vois se grouper en émoussés et en pointus, en plats discoureurs et en jargonneurs râpeux. Pour ceux qui ont le bonheur d’avoir l’œil critique et l’âme indépendante, ces gens mettent bien en valeur les personnes qui ont du moins le talent du don et du travail. On le devine, ils sont rares. On peut comprendre que ce fut une chance pour Maeterlinck de ne pas avoir connu ces espèces de fantoches bavards pendant plus d’un quart de siècle et, par après, d’avoir eu la chance de les éviter. Il reste qu’après sa mort, ce sont ces gens qui, le plus souvent, vont (comment faire autrement dans les milieux officiels ?) « glorifier » son œuvre et, ce qu’on ne peut pas ne pas concevoir, cela de son œuvre qui s’offre comme le plus académique, le moins novateur, donc le plus rassurant pour le repos intellectuel et le sommeil satisfait. C’est tout juste si tel critique bien-pensant ne regrette pas que, loin de s’étouffer dans sa propre chaleur, Serres chaudes se rafraîchisse à un air nouveau en touchant Éluard et Mauriac. Que dirait-il actuellement ? Dans l’état où sont les choses pour l’instant, on peut affirmer que Maeterlinck se soit abusé sur la valeur réelle de ses ouvrages. On le lui pardonne volontiers pour la raison qu’il était conscient de l’incertitude des jugements et que rien n’est plus sûr que toute œuvre d’art est, comme il a été dit, une flèche lancée dans le noir. Mais on pardonne moins aux critiques. Maeterlinck est un des écrivains sur qui on a le plus écrit, sur qui on s’est le plus trompé : trompé avec une espèce de détermination péremptoire. Avant sa mort surtout, on le conçoit. Le siècle s’étant déroulé « comme, me disait Queneau, une limace orageuse », on distingue mieux, forcément, ce qui dans cette œuvre a d’importance. Tout est peut-être dit, c’est possible. Ce n’est pas sûr. Le montreraient bien les analyses de Christian Lutaud, encore qu’elles ne manquent pas, parfois, d’un comique irrésistible. Elles montrent pourtant que l’œuvre de Maeterlinck a plus de ressources et de densité qu’on ne pourrait le croire. Toutefois, impossible, me semble-t-il, d’écrire toute une œuvre d’invention sur Maeterlinck. Peut-être me fera-t-on l’amitié d’entendre, par-ci, par-là, un son quelque peu différent de ceux qui furent émis et qui s’assemblent en une espèce de rhapsodie confuse. Qu’on ne m’en veuille pas de répéter ce qui a été dit cent fois : je ne puis pas y échapper. Tout de même il m’est loisible d’espérer que je pourrai le faire dans une autre atmosphère que celle d’innombrables critiques stupéfiés par une gloire à ce point universelle. Et puis quoi ? Ne puis-je pas rappeler cette phrase de Pascal : « Qu’on ne me dise pas que je n’ai rien dit de nouveau, la disposition des matières est nouvelle. »
J’ai parlé de gloire universelle. Il est vrai, ce genre de gloire, Maeterlinck l’a connue, et a su la gérer. Cela a été dit et redit — résumons : avant quarante ans, la création; après quarante ans, l’administration. Le temps de la création vraiment originale, en fin de compte, est court. Il s’est passé, dans la vie de Maeterlinck, quelque chose d’extraordinaire, dont on peut sans doute donner les circonstances, mais qui est irréductible à toute explication évidente. Il fut un temps où sa parole a été, par moments, inouïe, et son œuvre absolument nouvelle, tout imparfaite qu’elle pouvait et peut encore parfois apparaître. Je pourrais rappeler ces lignes du Trésor des humbles : « Si vous me demandez […] : “Qu’ai-je fait d’immortel aujourd’hui ?” est-ce toujours du côté des choses que l’on peut compter, peser et mesurer sans erreur, qu’il vous faut chercher tout d’abord ? Il est possible que vous répandiez des larmes extraordinaires, que vous remplissiez un cœur de certitudes inouïes, que vous rendiez la vie éternelle à une âme sans que personne s’en aperçoive, sans que vous-même le sachiez. […] Quelque chose de divin a eu lieu. » Hellens, tout critique qu’il peut être, et critique assez aigre, reconnaît que Maeterlinck est un écrivain né. « Telle sera ma conclusion dernière, et la plus nette », écrit-il. C’est indiscutable. Mais il se fait que cet écrivain est entré, à un moment de sa vie, dans un territoire inconnu. Et il a eu la chance — il y a mis aussi de l’habileté — à y être suivi. Les circonstances l’ont aidé, c’est certain. Son premier théâtre, il n’y en avait point de comparable dans toute la littérature française. Ce fut la jeunesse de l’époque qui l’accueillit, particulièrement après la parution de l’étourdissant article de Mirbeau. Il reste que, même sans cet accueil, on pourrait lui donner les adjectifs du texte que je viens de tirer du Trésor des humbles : extraordinaire, inouï; il reste qu’il joua le pari de l’éternité sans en avoir été conscient. Mais plus extraordinaires et plus inouïs encore sont certains vers de l’époque. Alors même qu’entre 1886 et 1889, certains poètes, français ou belges, des plus connus donnaient des vers que j’ai la charité de ne pas transcrire, ces vers « divins », c’est la plume du Maeterlinck le plus étrange qui soit qui les traçait, et maintenant, à les lire, pour peu qu’on tienne compte de l’époque qui les a vus naître, cela semble tenir du miracle :
« Attention ! l’ombre des grands voiliers passe sur les dalhias des forêts sous-marines !
Et je suis un instant à l’ombre des baleines qui s’en vont vers le pôle ! »
Dans l’Anthologie de la nouvelle poésie française parue chez Kra en 1924, on peut lire : « Les jeunes poètes ont sans doute raison de déclarer que ses Serres chaudes feront plus pour la gloire de Maeterlinck que tous ses autres volumes. » Sans doute. On pourrait aussi bien retracer la phrase en remplaçant « les jeunes poètes » par « les jeunes dramaturges » et « ses Serres chaudes » par « son premier théâtre ». Et ce pour la raison toute simple que rien de pareil n’était jamais apparu, du moins dans l’espace où le français se parlait. Ces phrases ont, je le reconnais, dirigé ma pensée. Il est bien inutile de s’attacher aux ouvrages de Maeterlinck dont on ne parle plus — ou, dans le meilleur des cas, dont on ne parle plus guère. Le temps va, les goûts changent, certains ouvrages, mystérieusement, se mettent à briller d’un bel éclat, d’autres, à l’époque, plus fêtés et plus lus, sont tombés dans un oubli dont les spécialistes ne viennent pas à bout. Dans l’état actuel des choses, on constate qu’il y eut un Maeterlinck génial (sans qu’il en eût conscience), puis un Maeterlinck peu différent des bons écrivains de son temps. Après un Maeterlinck inquiétant et prophétique, un Maeterlinck rassurant et distingué, qui aurait pu faire partie des grandes institutions officielles s’il en avait eu le goût. Ce n’est pas le poète de Serres chaudes que l’Académie française aurait voulu voir affublé d’une épée postiche et d’un habit épinard. Mais l’écrivain qui manie, comme l’écrit Roland Mortier, « la belle prose nombreuse et rythmée des essais », celui dont Hellens dit : « Les vrais inspirateurs de Maeterlinck ne sont ni Verlaine, ni Villiers, ni Mallarmé; ce sont les grands prosateurs français : Bossuet, Chateaubriand. » Cocteau assure que Maeterlinck était habité par un ange. Mais l’ange le quitta tôt, et non sans hésiter. Le Maeterlinck tombé (dixit Cocteau) « comme un aérolithe de quelque ciel en pleine crise féminine de l’esthétique », ce « mâle », cet époux dévoré par l’épouse, ce fut lui que l’ange emplit de presciences inouïes et de chuchotements pathétiques. L’ange parti, il resta un mâle supérieur, mais ce mâle cachait bien des faiblesses, et sa supériorité tout autant. Il avait écrit ce que personne n’avait même eu l’idée d’écrire; il dut se contenter d’être un littérateur parmi d’autres, et à leur image — avec, cela va de soi, sa petite musique personnelle. Si le Maeterlinck « angélique » avait eu son public, forcément restreint, le second, qui exposait à sa manière une philosophie aussi vieille que le monde et donnait des pièces dont rassurait l’optimisme sentimental, le second s’acquit une gloire démesurée dont on peut voir une concrétisation, par exemple, dans la présence, aux U.S.A., d’un oiseau bleu en image sur la vaisselle et les cartes à jouer, les boîtes de friandises et le linge. Même, a-t-il été rapporté, les élégantes aimaient savoir qu’un oiseau bleu nichait sur leur chapeau.
Le temps passe, et se dessinent les véritables perspectives. « Le flou, le mièvre » que Hellens discerne dans ses premiers écrits sont tout à fait illusoires. Ni flou, ni mièvrerie : une autre vision, et sans doute bien plus près de la réalité que celle dévoilée par un langage que commande la rhétorique, même imprégnée de poésie diffuse. Vraiment, ce fut quand Maeterlinck décida d’écrire en « beau français » qu’il perdit ce qui le rendait unique. C’est, faut-il le dire aussi, que le beau français est l’instrument d’une autre pensée. On ne s’est pas fait faute de parler du Maeterlinck flamand, incarnant les caractéristiques de sa race. S’il commença par signer « Mooris Maeterlinck », on nous le dit, à la fin de sa vie, après plus de quarante ans vécus dans le sud de la France, aimant affirmer son aspect d’homme du Nord. Le Flamand est dit travailleur : Maeterlinck, incontestablement, le fut; mystique : le temps, pour Maeterlinck, que l’ange acceptât d’habiter en lui; réaliste : Maeterlinck pense, il observe, il n’accueille chez lui, à l’époque dite d’épanouissement et d’équilibre, que les sportifs et les hommes de sciences. C’est le mystique qui dure, celui-là qu’il devait railler en termes qui firent scandale — le mystique, ou plutôt l’artiste qui, par la réflexion, et s’aidant d’intuitions admirables, trouva dans ce mysticisme les sujets à traiter et les procédés pour les écrire, cet artiste qui, comme Ruysbroek, « joint l’ignorance d’un enfant à la science de quelqu’un qui est revenu de la mort ».
UNE HISTOIRE D’AMOUR
On peut tout comprendre des hommes engagés dans des événements qu’ils dominent ou qui les dépassent. Rien d’humain qui ne soit susceptible d’être compris. Maeterlinck l’a souvent souligné, et avec raison. Tel critique se voit invité d’écrire une monographie de Jacques Brel. Il ne connaît pas spécialement le chanteur. Il ne le goûte pas particulièrement. Il accepte. Pour diverses raisons, qui vont de l’argent à gagner au fait que tout homme, parce que homme, est digne d’intérêt. Il suffit de se sentir une vocation d’historien. L’historien, comme le souligne Fontenelle, « spectateur de toutes choses, indifférent et appliqué ». Maeterlinck, on ne peut guère dire qu’il ait éveillé de ces gens à sang froid pour qui, à la limite, tous les sujets se valent. Ni son œuvre. Ni son œuvre surtout. Les avis sont aussi variés que possible. Et, chose assez curieuse, il y entre autant dire toujours de la passion. Disons plutôt qu’il y entrait : le temps apaise les passions. Les thuriféraires pullulaient. Les adversaires ne ménageaient pas leurs mots. Maeterlinck note quelque part, dans Bulles bleues que « ces policiers de la vie littéraire que sont les journalistes lui en ont fait voir bien d’autres ». Il arrivait même que s’étale la bêtise la plus crasse. On découvrait là tout un paysage bien humain, que l’on trouve déjà brossé chez Pascal. Parlant des passionnés, celui-ci n’écrit-il pas : « Encore qu’ils ne fassent pas dans leur esprit ce raisonnement formel; je l’aime, donc c’est le plus habile homme du monde; je le hais, donc c’est un homme de néant; ils le font en quelque sorte dans leur cœur. Et c’est parce que l’on peut appeler ces sortes d’égarements des sophismes et des illusions du cœur, qui consistent à transposer nos passions dans les objets de nos passions, et à juger qu’ils sont ce que nous voulons ou désirons qu’ils soient. » Mais, naturellement, il était des critiques qui, avec finesse, et souvent avec sympathie (il n’était personne à ne point reconnaître en Maeterlinck un écrivain de classe) s’essayaient à juger avec autant d’équité que possible une œuvre, dans ses débuts, si insolite. Il faut reconnaître qu’ils n’étaient pas nombreux.
Que l’on m’excuse d’intervenir ici personnellement. Mais comment ne pas intervenir ? Une histoire d’amour demande généralement deux partenaires. Ici ? L’œuvre de Maeterlinck, et moi qui la lisais. Peu après avoir écrit, dans les orages silencieux de mes études musicales, une thèse de doctorat consacrée au théâtre de Maeterlinck, il me vint à l’esprit, certaines circonstances m’y aidant, d’aller interroger au sujet de mon littérateur des littérateurs de renom. À ma surprise, il me fut relativement facile de les approcher, et je puis encore maintenant m’étonner de leur amabilité envers quelqu’un qui leur arrivait je ne sais d’où et ne se présentait pas comme journaliste. Je rapporte au plus court les opinions de trois d’entre eux pour souligner la vivacité de trois jugements différents. Cocteau : « Maeterlinck ? Admirable ! Un feu de brume ! » Sartre : « Exécrable. Un sophiste gras. » Queneau : « Savez-vous qu’il a été l’homme le plus détesté de ses confrères ? — Pour sa nationalité ? — Pensez-vous. Pour ses droits d’auteur. (Rire.) Songez qu’il faut du génie pour se faire tant d’argent avec du prêchi-prêcha. — Tout de même… — Oui, oui, tout de même… Nous nous comprenons, n’est-ce pas ? » On se comprenait. Nous étions prêts à tout pardonner pour un sourire de Mélisande.
Ce que je voudrais dire ici est que ce travail, sans doute, se trouve être la dernière manifestation de cet amour que j’ai mentionné, ce très ancien amour. Je salue ici, en l’écrivant, une jeunesse qu’il a rendue plus supportable et ces rêves qui donnaient, si je puis dire, de l’élasticité aux lignes implacables du contrepoint musical. Je ne sais si on me devinera : la liberté en musique ne semble exister que pour permettre la naissance d’un « discours » qui s’impose comme nécessaire, et comme l’écrit Sartre dans La Nausée, « tranche comme une faux la fade intimité du monde ». Rien qui n’enivre comme ces noces paradoxales de la liberté et de la nécessité. Mais il arrive que la jeunesse, même volontiers exigeante et quelque peu jacobine, demande à souffler et à se sentir une liberté même illusoire. Le Trésor des humbles m’ouvrit des espaces. Ses contradictions m’enchantaient, cette espèce d’impudeur tranquille qui, dans la même langue enchantée, faisait à son auteur soutenir les points de vue qui s’estompaient l’un l’autre, des vérités qui s’excluaient sans cesser d’être vérités parce qu’il s’était mis dans la situation de quelqu’un qui peut se permettre cette politique, la réalité du monde, à ses yeux, dépassant, et de loin, ce que nos intuitions les plus profondes nous permettent d’en deviner. À vrai dire, ce devait être la musique de la langue qui enchantait mon oreille musicienne. Et, à tout prendre, les idées du Trésor des humbles étaient d’un vague tel qu’elles n’étaient pas loin de ne signifier rien à l’image des sons dont use la musique. Mais quelle différence essentielle cependant entre une rêverie de Maeterlinck et, par exemple, ce trio à cordes de Webern dont je me délectais à l’époque !
Entre autres obligations professionnelles, mon père s’occupait de la bibliothèque communale. Un budget, modeste, lui était alloué chaque année pour l’achat de livres dont les amateurs étaient plus nombreux qu’on ne pourrait le croire de gens de la campagne. Mais il recevait, également, d’office, de je ne sais où, des livres dont, on le devine, il était curieux, le paquet arrivé, de connaître les titres. C’est ainsi que je connus les chefs-d’œuvre de Jean-Jacques Proumen, Marius Renard et autres génies de l’époque. Jamais un Maeterlinck ne lui parvint par cette voie. Je suppose que l’office des bibliothèques le trouvait trop ardu pour une population rurale : cette supposition, on le devine, est la plus innocente. Par bonheur, un oncle, que l’on ne voyait que trop rarement, avait laissé dans la bibliothèque personnelle de mon père cinq ouvrages de Maeterlinck. Quatre d’entre eux allaient sans fin alimenter mes rêveries d’adolescent : Deux contes, Serres chaudes, La Princesse Maleine, Le Trésor des humbles. (Il m’est difficile, maintenant même, de prendre du recul devant ces œuvres encore magiques.) Le cinquième, L’Oiseau bleu, sans qu’à l’époque j’aie pu analyser le phénomène, je le rejetais avec une énergie morose, dont j’eus honte tout un temps.
Sorti d’un collège moins oppressant que celui de Sainte-Barbe, dont il semble bien que le jeune Maurice n’eût qu’à souffrir, puis bientôt de la guerre, je pus prendre connaissance, lentement, de l’œuvre de Maeterlinck. Je travaillais à l’époque sous l’autorité de pères jésuites plutôt bienveillants : ils trouvaient certainement que la misère de ces jours noirs était bien suffisante pour nos âmes d’adolescents. La bibliothèque de la Faculté ne me refusa pas l’œuvre théâtrale de Maeterlinck. Je fus comme enivré par le premier théâtre, étrangement déçu par le second. Je trouvais la chose si singulière que je proposai au père Stinglhamber qui surveillait mes travaux d’écrire un petit essai à ce sujet. Il refusa. Je dus m’attacher à décrire la philosophie de Leconte de Lisle. Tout est prétexte à enthousiasme aux jeunes gens. Leconte de Lisle — maintenant mal perçu, par parenthèse — me fascina. Et Schopenhauer, que requérait mon étude, Schopenhauer, dans le grondement des avions, le fracas des bombardements et la faim obsessionnelle, parlait avec une voix que je percevais comme définitive. Les événements firent que, devant me cacher de l’ennemi, je dus me réfugier à la campagne. Mélisande et Alladine m’accompagnèrent dans mes promenades en compagnie de Qaïn et de Rui Diaz. Et le Hjamlar spectral de Maleine suivait comme son ombre cet autre Hialmar qui allait s’« asseoir parmi les Dieux, dans le soleil ». L’année terrible passa. J’en sortis indemne. Je revins à la charge auprès du père Stinglhamber : il me fit travailler Baudelaire. Toutefois il me donna son assentiment pour que j’écrive à l’évêque et en obtienne la permission de lire les essais de Maeterlinck. L’heureuse époque ! Ce fut plutôt froid que je lus ces essais. Moi qui plus de quinze ans avais dû donner un coup de main à mon père, apiculteur zélé, pour surveiller les ruches et en extraire le miel, je trouvai exécrable La Vie des abeilles : je n’avais eu qu’à me plaindre de ces insectes infatigables. Enfin je pus m’occuper de mon Maeterlinck à l’université de Liège : un mémoire sur les procédés dramatiques dans le premier théâtre, puis une thèse sur le théâtre en son entier. Si je rapporte tout ceci, ce n’est que pour éclairer cet ouvrage. Le Maeterlinck de l’époque symboliste fut le seul écrivain pour qui je me sois senti un amour déraisonnable. J’aimerais qu’on en perçoive l’écho. Un écho très assourdi, comme il se doit.
Ceci peut-être aussi se doit d’être rapporté. Quand j’appris par le journal que Maeterlinck était rentré des États-Unis et qu’ « Orlamonde abritait à nouveau sa rêverie » (je me souviens clairement de cette phrase de journaliste « inspiré »), je n’eus de cesse d’obtenir un rendez-vous de sa part. Je lui écrivis. Et tout un temps je me berçai de ces phrases où le jeune Maeterlinck, avec une placidité anxieuse, parle de dialogues d’âme à âme à travers les épaisseurs du temps et de l’espace. Ma lettre, puis une seconde, restèrent sans réponse. Alors je partis. Bach, sur l’écriture de qui je travaillais depuis des mois, Bach était parti écouter Buxtehude. À pied. J’avais à ma disposition une moto épaisse et sonore. À Nice, je téléphonai, très ému. On me répondit, aimablement. On apprécia que je ne fusse pas journaliste; que je fusse Belge et attaché à l’œuvre fut non moins apprécié. Il y eut quelques instants de silence, et l’on peut se douter que je m’en référai dans l’instant au premier chapitre du Trésor des humbles. Mais je soupçonne la personne qui me répondait — un homme — de s’enquérir auprès de l’écrivain du sort qu’il me réservait. Il me fut donné rendez-vous à Nice, dans un établissement dont j’ai oublié le nom, mais d’où la mer s’apercevait à travers des palmiers vigoureux. J’y fus à l’heure fixée. Il faisait très chaud. La mer charriait ce souffle épais et ardent dont parle Camus. Trop chaud sans doute. Une voiture finit par s’arrêter devant le café. Un homme encore jeune en descendit, parla à un serveur qui, de table en table, s’enquit de ma présence. Quand il m’eut trouvé, je pus prendre langue avec cet homme vêtu de sombre qui attendait à quelques mètres de la voiture. Il me demanda de l’excuser de son retard. Le « Maître », qui avait dû se rendre à un rendez-vous, y avait été retenu. Il se trouvait fatigué, la journée était trop torride, venez demain, il vous recevra à dix heures. Et la voiture repartit sans que j’eusse eu la possibilité d’y apercevoir l’écrivain.
Le lendemain, je fus introduit auprès de Maeterlinck dans une pièce sombre. Il m’invita à sortir, eut une phrase, qui me parut harmonieuse, pour me dire la beauté de la journée. Il me fit asseoir sur une terrasse d’où s’apercevait une mer en tout semblable à celle que Valéry avait pu apercevoir de son cimetière. Il s’assit à son tour et nous fit servir des rafraîchissements. Il eut ce mot absurde : « Ici, l’eau a la fraîcheur des anges. » Je soupçonne qu’il se payait, oh, très gentiment, ma tête — une tête enfiévrée. C’était, à mon souvenir, un grand vieillard un peu voûté, à qui la vieillesse avait, sous des cheveux blancs, accusé l’ossature de la tête. On connaît l’amour de Maeterlinck pour l’adjectif étrange. Je dirai que ses yeux, qui ne me regardaient que rarement, étaient d’un bleu étrange. Il parla peu, d’une voix assourdie. Je n’ai guère le don de la parole. Il s’établissait entre nous de ces silences sur lesquels mon esprit pouvait extravaguer. Mais je doute qu’à l’instar du mien, son esprit ait battu la campagne du subconscient. Il n’eut pour ma personne d’autre curiosité que celle que commande la civilité, et je mesure ici à quel point les tempéraments peuvent différer quand je pense à Cocteau qui, lui, poussa la curiosité jusqu’à l’indiscrétion, une indiscrétion, au reste, amicale et même un rien goguenarde. Maeterlinck ne me parla pas de lui. Je tentai en vain de mettre la conversation sur La Princesse Maleine : il haussa les épaules. Je me tus. Il ne se soucia que de la Belgique. Et comme, à l’époque, plus ou moins coincé par mon état et par les circonstances, je n’avais guère quitté la vallée mosane et mon Condroz natal, il m’interrogea longuement sur Liège et, particulièrement, sur Namur, dont il semblait bien se souvenir. Ce fut lui qui, après Baudelaire, m’affirma, mais de vive voix, que Rops était un artiste exceptionnel. Il eut à son sujet une image qui me parut plutôt bizarre : un temple livré aux termites. L’entretien, au fond, n’eut rien de bien intéressant, et je n’entendis derrière lui aucune de ces voix qui nous parlent d’ailleurs. Peut-être, au fond, l’intérêt le plus évident fut celui des silences. Pour moi du moins. L’heure était belle, et je pouvais rêver. Foule de textes me traversaient la tête. C’était comme si on me passait sur le visage un linge humide quand il s’agissait de textes de jeunesse, un linge sec quand il était question d’autres qui ont suivi. Et à le voir, à contre-jour, comme rêver en regardant la ligne d’horizon, il me revint à la mémoire ce texte célèbre du Trésor des humbles, qu’à l’époque je connaissais par cœur : « Il m’est arrivé de croire qu’un vieillard assis dans son fauteuil, attendant simplement sous la lampe, écoutant sans le savoir toutes les lois éternelles qui règnent autour de sa maison, interprétant sans le comprendre ce qu’il y a dans le silence des portes et des fenêtres et dans la petite voix de la lumière, subissant la présence de son âme et de sa destinée, inclinant un peu la tête, sans se douter que toutes les puissances de ce monde interviennent et veillent dans la chambre comme des servantes attentives, ignorant que le soleil lui-même soutient au-dessus de l’abîme la petite table sur laquelle il s’accoude, et qu’il n’y a pas un astre du ciel ni une force de l’âme qui soient indifférents au mouvement d’une paupière qui tombe ou d’une pensée qui s’élève, — il m’est arrivé de croire que ce vieillard immobile vivait, en réalité, d’une vie plus profonde, plus humaine et plus générale que l’amant qui étrangle sa maîtresse, le capitaine qui remporte une victoire ou “l’époux qui venge son honneur”. » Toute la durée de cette entrevue que je ne puis guère qualifier et dont je ne suis pas certain de recréer l’ambiance, la mémoire étant, pour moi du moins, une faculté à quoi je ne puis pas me fier, toute la durée de cette entrevue, tout comme d’ailleurs au long de ce voyage, j’eus l’âme hantée par la musique de la Suite lyrique de Berg, que je venais de découvrir, avant mon départ, chez un ami, maître en sonorités nouvelles. Cette permanence douce et obsessionnelle d’une musique qui se donnait comme par lambeaux, n’était pas, même dans ces circonstances, sans me distraire, et il me fallut souvent m’imposer un effort pour ne pas faire à mon hôte l’injure de ne point l’entendre quand il lui arrivait d’ouvrir la bouche. Par ailleurs, je ne pouvais pas m’empêcher d’imaginer que cette rencontre pouvait faire naître une œuvre théâtrale exemplaire pour la défense et l’illustration des procédés dramatiques du jeune Maeterlinck — procédés poussés à l’extrême puisque le statisme en avait été intégral et le « personnage sublime » immobile. Les silences devinrent pesants. Il me fallut prendre congé. Je touchai une main brûlante. C’est alors qu’il s’enquit de mon avenir. Je n’étais pas fixé. Professeur sans doute. « Ne parlez pas de ce que j’ai écrit avec trop de sévérité », me dit-il en souriant faiblement. Je me récriai, comme bien l’on pense, mais d’une voix « étrangement » étouffée. « Même sincères et attentifs, il nous arrive d’écrire des choses indignes. » Je pensai : indignes de notre âme. Il eut un soupir. Et avec un faible sourire : « L’ennui est que nous ignorons où les trouver dans ce que nous avons pu écrire. » J’aurais aimé un peu plaisanter pour alléger la tristesse qui m’était lentement venue et tempérer l’obstination de ce fichu Berg qui commençait à m’excéder. Mais les écrits de Maeterlinck, on ne peut guère dire que l’humour s’y fasse jour. Et je ne le connaissais pas assez pour savoir s’il était recommandé d’en faire usage. Je me tus. Je sais que la jeunesse est imaginative, et j’étais tellement imbibé de la littérature maeterlinckienne de l’autre siècle qu’il me vint à l’esprit que, derrière ces paroles difficilement, semblait-il, échangées, se tenait un autre dialogue, évidemment plus profond et plus universel, et, je m’en souviens très bien, paradoxalement muet, entendez : sans paroles — quelque chose comme une musique inouïe, qu’étouffait d’ailleurs en moi celle de Berg. C’était manifestement là un moment bizarre et rare, dont la complexité mystérieuse allait me marquer. Maeterlinck me serra encore la main, et je m’en fus.
Je garde en moi quelques secrets. Ils ne me font pas vivre. Ils ont maintenant comme une fonction décorative. En quelque sorte ils se sont fait allégories. On peut les livrer sans crainte de se sentir appauvri. Sans doute, hic et nunc, m’est-il permis de rapporter ce souvenir. J’aimerais qu’il en montât une buée qui humidifiât le restant de ce livre et le rendît, au moins par là, différent de ces terribles études (auxquelles j’ai d’ailleurs sacrifié) de gens qui se penchent sur une œuvre comme des médecins légistes sur un cadavre. La critique d’après-guerre est terrible dans cette lumière nouvelle : Maeterlinck, l’œuvre de Maeterlinck livrée parfois aux jargonneurs ! Mais puis-je leur préférer ces critiques plus âgés qui ne semblent s’intéresser à l’œuvre que pour en être des panégyristes souvent imbéciles ou des Zoïle, qui ne le sont pas moins ? Je crois, pour ma part, pouvoir soutenir que l’œuvre d’un auteur disparu est, généralement, de la chair vive et que l’anime une âme ravie de se savoir réveillée. Je me souviens d’avoir, à l’époque, et dans cette atmosphère quelque peu hystérique que l’on peut deviner, démonté, sous le contrôle d’un professeur qui ne connaissait Maeterlinck que de nom, démonté, dis-je, les structures sonores de tableaux entiers du Pelléas de Debussy, d’en nommer les accords et d’en montrer les enchaînements et les ruptures. Mais quoi ? ce faisant étais-je entré d’un iota dans l’âme de cette musique et par elle dans celle des personnages ? Réduire le texte à l’objet pur, et, par-dessus, jargonner à son propos, cela excède ma patience. J’espère, je veux espérer que le lecteur ne m’en voudra pas d’employer certains procédés que le spécialiste enragé peut tenir pour méprisables. Le lecteur ? Je l’imagine cultivé et amical, aussi éloigné que possible de ces analystes qui trouvent dans leur baragouin cette sensation d’être ce qu’ils ne sont pas et ne seront jamais. Certes, on n’ignore pas qu’il est bien plus facile de jargonner que d’employer la langue de La Bruyère ou de Voltaire. Que l’on parle à propos de telle ou telle pièce de chronotope dialogique ne peut que faire sourire celui que plus rien d’humain n’étonne. Mais il reste de la rage. Je m’abandonnerais volontiers à une de ces explosions verbales où excellait Céline, et je vous jure qu’il est, ici, de ces fulminations céliniennes qui s’imposeraient avec une autorité qu’il me plairait de qualifier de hurlante. Mais comment m’y résoudre ? Maeterlinck a beau avoir entassé ouvrage sur ouvrage, il est un homme de silence.
Ce lecteur que j’espère, comme je l’ai écrit, cultivé et amical, je n’imagine pas qu’il ait de Maeterlinck et de son œuvre une connaissance approfondie. Que les connaisseurs me pardonnent : ils trouveront dans ces pages bien des choses qui, depuis longtemps peut-être, ne leur sont pas ignorées. S’ils me lisent, qu’ils prennent patience. Peut-être trouveront-ils par-ci, par-là, une indication dont ils n’ont pas connaissance, une opinion qui ne les avait jamais touchés. Je voudrais du moins que les autres lecteurs trouvent dans l’ouvrage assez d’eau pour étancher leur soif, et que cette eau soit fraîche et désaltérante. Il est bon de rappeler ces lignes bien connues de Racine : « La principale règle est de plaire et de toucher. Toutes les autres ne sont faites que pour parvenir à cette première. » Il est bien des manières de plaire et de toucher, et sans bassesse, même quand il s’agit d’un essai, comme celui-ci, sans prétention aucune. Qu’on me pardonne donc certains artifices, au demeurant très simples, et qui n’ont d’autre dessein que de nous rendre Maeterlinck plus proche et en quelque sorte plus vivant.
BIOGRAPHIE
Maeterlinck, comme on l’apprendra dans ce chapitre, plus de vingt ans eut comme compagne l’actrice Georgette Leblanc. Celle-ci laisse des Mémoires bien connus de ceux que le destin de l’écrivain ne laisse pas indifférents. On peut y lire ces lignes : « Un jour de grande chaleur, tous deux à genoux sous les pins, nous observions une fourmilière. Maurice taquinait les fourmis avec une baguette. Soudain j’interrogeai malgré moi : “Pourquoi, lorsque tu me cites dans Le Trésor des humbles, as-tu mis chaque fois : ‘Un vieux philosophe disait…’, ou bien ‘Un vieil ami’, ou encore ‘Je ne sais plus quel sage’, ou simplement des guillemets ?” Il releva la tête étonné. “Mais te nommer serait ridicule, voyons ! Tu es au théâtre… une chanteuse… on ne me croirait pas… ce serait ridicule !…” » Dans ses Mémoires, Georgette Leblanc ne parle de Maeterlinck que pour parler d’elle : point d’historienne plus suspecte. « On raisonne sur ce qu’ont dit les historiens, écrit Fontenelle; mais ces historiens n’ont-ils été ni passionnés, ni crédules, ni mal instruits, ni négligents ? » Voilà bien des erreurs à éviter, et quel historien peut se vanter de les avoir évitées toutes ?
On sait par ailleurs qu’il n’est rien de plus suspect que l’autobiographie. Cependant on ne peut nier que celui qui a rédigé la sienne soit le seul à savoir certaines choses, qui n’ont jamais été dites ni écrites; on ne peut nier qu’il soit le seul, pour autant que sa mémoire est bonne, à savoir dans quel climat et avec quelle sensibilité furent par lui reçus certains événements. Dommage que dans cet ouvrage je ne puisse pas me montrer romancier : il y aurait matière à des analyses dont, peut-être, Proust lui-même se serait montré satisfait. Mais quoi ? ne m’est-il pas loisible de faire parler un Maeterlinck qui eût assez de mémoire et de conscience pour ne rien dire de sa vie qui ne puisse se vérifier dans ses textes ou dans les témoignages passés au crible de la plus exigeante critique ? Le procédé me semble défendable, et même souhaitable pour assurer l’agrément de l’exposé. Je rêve que, cette matinée d’Orlamonde où j’eus le privilège de rencontrer l’écrivain, il m’eût dit : « Voilà : le 29 août 1862, la ville de Gand comptait un citoyen de plus… » J’aurais aimé que l’homme qui me parlait ne fût pas ce vieillard éprouvé par l’âge, mais celui-là, en lui, dont ne s’ouvrait pas la bouche, ce « sage » dont il avait tant parlé sans jamais vraiment dire qui il était au juste — en l’occurrence, ici, l’historien rêvé par Fontenelle, mais dont les certitudes se donnent en souriant et se chargent de compassion.
Il me serait agréable de rapporter l’existence de l’écrivain par sa bouche, en employant ce procédé dont il fit usage dans Le Trésor des humbles en commençant à écrire le onzième chapitre, consacré à la « bonté invisible ».
*
Voilà, « me dit ce sage que j’avais rencontré par hasard au bord de l’océan qu’on entendait à peine », le 29 août 1862, la ville de Gand comptait un citoyen de plus. Excusez-moi, je vous dirai les choses comme elles sont, sans avoir recours à cette prose dont j’ai fait tant emploi et qu’on a dite « nombreuse et rythmée », sans aussi, autant qu’il m’est possible, faire appel à ces images qui ont tant enchanté mes rêveries et mes textes, et dont je me suis quelque peu lassé. Quelque peu : un euphémisme. Si vous êtes au courant de ma production, vous avez pu vous en rendre compte. Me voilà donc sur la planète Terre. En 1890, je constatais : « Il ne m’est jamais rien arrivé de plus étonnant que ma naissance. » Mais ce 29 août, je n’en étais pas encore à ressentir « ce qu’il y a d’étonnant dans le fait seul de vivre ». Je vivais. J’étais né au numéro 6 de la rue du Poivre, un hôtel de style Empire, pas très loin de la cathédrale Saint-Bavon, moins loin encore du cloître des Dominicains. J’eus droit à quatre prénoms : Maurice, Polydore, Marie, Bernard. On assurait, dans la famille, que mon nom était celui d’une très vieille famille flamande dont on pouvait trouver les traces au quatorzième siècle. Ceci est sans grande importance, quoiqu’il soit parfois consolant de connaître un peu ces « invisibles qui dirigent notre vie ». La famille n’était pas gantoise mais renaisienne. Au quatorzième siècle, justement, un bailli de Renaix du nom de Maeterlinck se rendit célèbre en sauvant la ville de la famine. Sa récompense fut d’être promu chevalier, d’avoir droit à des armoiries et à une devise : « Quand Dieu voudra. »
Il me faudrait vous parler de Gand. Je ne m’en sens guère le désir. Je sais que la ville s’est, depuis le début du siècle, considérablement transformée. Ainsi a disparu le Grand Béguinage que j’ai connu à proximité de ma maison natale. Mais m’est, à vrai dire, passé le goût pour elle, que j’ai connu longtemps dans ma jeunesse. Encore que… Mais laissons. Oh, j’en revois bien le centre médiéval, qui ne doit guère avoir changé. Mais pour le reste, je suis autant dire certain de la voie qu’elle a prise : celle de l’anonymat. Celle d’un relatif bien-être aussi. Dans ma jeunesse, les faubourgs étaient d’une sordidité telle qu’on ne les fréquentait jamais, nous, les mijnheren, les messieurs — les gros, comme disent les Wallons. Y grouillait un prolétariat qui survivait à grand-peine. Rien d’étonnant à ce que Gand devînt le bastion du socialisme flamand. Comme, jadis, celui des libertés communales. Vous devinez bien à quoi s’attachait avant tout l’humeur des mijnheren : à la mangeaille. Je puis vous assurer que manger, et manger beaucoup, était un devoir de classe. Toutes les occasions étaient bonnes pour ripailler. Je vous dirai pourtant qu’on ne se gavait pas sans cette grâce épanouie et haute en couleur qu’ont révélée au monde les pinceaux de nos meilleurs peintres. Je reconnais ici que c’est de ces gens que je tiens mon amour de la bonne table. Savez-vous ce que j’ai écrit sur la cuisine belge ? Qu’elle « est un heureux prolongement de la cuisine française. On y retrouve toutes les bonnes recettes classées et longtemps éprouvées de la vieille cuisine parisienne et provinciale, auxquelles s’ajoute parfois je ne sais quel goût de terroir qui en accentue et en améliore la saveur… » On ripaillait donc, on était fou de bordeaux, de cigares coûteux, et de femmes secrètes. Secrètes, entendons-nous. La société, et jusqu’à l’Église, en supportaient l’existence si elles pratiquaient la discrétion qu’il fallait. Les liaisons ouatées, les épouses fermaient les yeux dessus. Pas de drames. Ces femmes sortaient du menu peuple — petites mains, modistes, couturières —, petites femmes proprettes que ces messieurs entretenaient pour deux fois rien, qu’ils visitaient le soir venu et ne sortaient jamais sauf, de temps à autre, à Bruxelles. Petits adultères bourgeois et bourgeoisement vécus. Ces femmes, les mijnheren leur donnaient le nom de… je traduis : petites ailes. Ces petites ailes prenaient vite de l’embonpoint et n’en étaient que plus appréciées. L’embonpoint vous classait socialement. Mon père les fréquenta. Moi aussi, je le reconnais. Je ne leur dois aucun souvenir attristé. Je vous dirai ici, par parenthèse, que j’eus toujours avec les femmes les rapports les plus libres. J’ai de la timidité. J’en ai toujours souffert. La première fois que je rencontrai Georgette Leblanc, elle remarque justement que mon regard fuit, que la main que je lui tends est timide, et que la timidité hache mon récit. Mais avec ces femmes nécessaires à mon équilibre physique, point de ce genre de timidité dont, à vrai dire, je ne me suis jamais entièrement défait. Je me souviens avec amusement que mon père fit un brin de cour à ma maîtresse et, s’en étant aperçu, se retira de la façon la plus délicate. Et vous vous doutez bien que Georgette, dans ses Mémoires, ne pouvait pas ne pas aborder ce sujet. Tout de même, elle y mit de la discrétion, ce qui peut étonner. En tout elle était excessive, elle l’avoue, elle en tire gloire. Tout de même, sur ce plan, elle a dû se sentir mal à l’aise, prise qu’elle était entre le fait de faire savoir que j’étais d’humeur disons gaillarde et celui de révéler qu’elle n’avait pas assez de séduction et de puissance pour me retenir. En fin de compte, je lui suis reconnaissant de n’avoir rien exagéré. Elle écrit pourtant que, sans abuser de ma liberté, j’en usai, dit-elle, comme un enfant gâté. Tout cela est sans importance, mais d’un grand agrément pour la mémoire : je ne garde en moi que les souvenirs heureux — ces bulles bleues, comme je les appelle, dont vous savez qu’elles ont fait le titre de mon dernier livre.
J’en reviens à Gand. C’est nécessaire, et l’est extrêmement pour me comprendre. Souvenez-vous, je l’ai écrit : la vie d’un enfant se nourrit de ce qui l’environne et le submerge. Elle est formée des reflets de ce qu’elle voit, des échos de ce qu’elle entend. Ils deviennent sa substance. Entendez cela. C’est capital. Ils deviennent sa substance. Ma substance est gantoise. J’ai écrit aussi que les souvenirs d’âge mûr ne méritent que rarement d’être recueillis. Souffrez que j’insiste sur mes souvenirs d’enfance. Rien ne surviendra dans ma vie qui ne se relie à sa façon, et sans grand mystère d’ailleurs, à cette période heureuse.
Mon père… Polydore, c’est là un de ces noms qui maintenant font sourire. Ce nom suit le mien sur ma carte d’identité — un peu comme il me suit, lui, tout disparu qu’il est, dans l’existence. Je lui ai dû ma force, et cette timidité bizarre que je vous ai mentionnée. Dans Bulles bleues, je lui consacre tout un chapitre. C’est bien le moins que je pouvais faire pour, dans les limites de mon pouvoir, assurer son souvenir. Il était juste, bon, et montrait de l’aménité. Mais sa timidité le poussait aux actes d’autorité. Comme on disait en ce temps-là, il avait trop de sang et trop de santé. Dans ses Souvenirs, Georgette écrit : « L’homme (je veux dire la plupart des hommes) avec ses conquêtes faciles, son égoïsme, son amour-propre, sa vigueur physique, sa certitude d’être le maître, n’a rien au-dessus de lui, rien devant quoi baisser la tête s’il ne garde le sens des responsabilités que sa force lui confère. » C’est là parler de façon trop abrupte. Je dois évidemment me sentir visé. Tout de même ces lignes m’évoquent mon père d’une façon assez frappante. C’était un oisif toujours occupé. Je ne parle pas de ces marches qu’il s’imposait pour « faire tomber le sang », non. Mais je le vois encore s’occuper du jardin, du verger, du rucher. Dans la maison, il aimait s’adonner au bricolage. À date fixe, il partait lui-même recueillir l’argent des loyers, celui des fermages. Son plus sûr souci fut celui d’user de cet argent en placements. Il en fit de téméraires. Il y en eut un de catastrophique : des valeurs russes. Il les brûla à la campagne, dans le calorifère. Ce jour-là fut sans doute le plus sombre de son existence. Ma mère, bien que consternée, le regardait en souriant malgré tout. « Que voulez-vous ? disait-elle. Je ne peux rien dire, il n’écoute que les conseils de ses banquiers. »