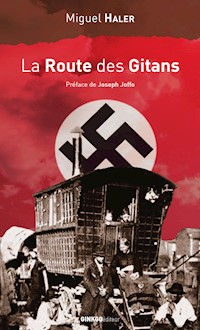Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ginkgo éditeur
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Französisch
La Grande guerre comme on l’a appelée, fut l’immense boucherie que l’on sait, véritable suicide de l’Europe dont l’Europe se souvient et qu’elle marque par de nombreuses commémorations encore un siècle après.
À cette occasion paraissent de nombreux livres, essais, réflexions, ouvrages historiques de fond, mais aussi les récits, de nombreux récits, écrits au fond des tranchées, ou plus tard, parfois bien plus tard, hors de la boue, de la saleté et de la fureur des batailles. Récits de morceaux de vie, de vies partagées, parfois souriantes, souvent souffrantes ; exemples quotidiens d’un quotidien de guerre, d’appel au clairon, d’attentes, de marches, de souvenirs terribles de sang, de corps démembrés ou brûlés, de copains disparus ; mais aussi de retour à l’arrière, de repos, de retrouvailles des êtres chers, d’oubli relatif du feu en redoutant les prochains combats, car la vie et le besoin de bonheur sont les plus forts.
EXTRAIT
À la pause de quatre heures, Isidore me regarda d’un air grave et, en me tendant un verre de vin, il prononça, sous sa moustache grise :
« Mon bon Joseph, cet automne nous n’irons pas chasser le sanglier ensemble ! Cette fois, c’est le Boche que tu chasseras ! »
Pris par l’émotion, je lui rétorquai juste : « Oui mon oncle, ça se précise. »
Depuis plusieurs semaines, les journaux parlaient d’un conflit européen imminent… Il se profilait à court terme. Maintenant on y était, le cap était franchi, j’étais bon pour rempiler et reprendre mon uniforme bleu et rouge de fantassin…
En fin d’après-midi, sur la place du village, le garde-champêtre annonçait dans un roulement de tambour « la mobilisation générale ». Devant la mairie, des affiches à l’effigie de la République, posées depuis peu, appelaient à la même chose.
CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE
Miguel Haler se glisse dans la peau de son grand-père pour nous livrer un récit plein d'émotion et de poésie. Comme à son habitude les phrases et les mots sont simples et forts. -
RCF
C’est un récit vivant et sensible, le lecteur se sent proche du narrateur. -
Chez Mark et Marcel
À PROPOS DE L'AUTEUR
Miguel Haler est écrivain et artiste. C’est dans le grenier de la maison familiale, au fond d’un coffre fermé depuis bien longtemps et oublié, que Miguel et les siens ont découvert, il y a quelques années, cinq carnets manuscrits. Ils avaient été rédigés par le grand père paternel, pendant les années de guerre, sur le front, et précieusement gardés en mémoire des années sombres et pour les générations futures. Ces carnets rassemblent les souvenirs, mieux encore les témoignages pris sur le vif d’un Poilu issu d’une famille d’Alsaciens originaires de Willer-sur-Thur, qui, après la défaite de 1870, pour rester française et par convictions politiques républicaines, s’était établi dans le mince pays de Belfort.
Miguel ne réécrit pas mais accompagne ce qui est déjà écrit, (Miguel a mené une véritable recherche historique), se glissant ainsi dans la peau et l’esprit de celui qui combat et souffre.
Moi, Joseph l’Alsacien est devenu ainsi, non pas un roman, ni même un récit romancé, mais la chronique journalière, remaniée et enrichie, humaine et humaniste, de celui qui, au soir de sa vie, était appelé affectueusement « Pépé piquant ».
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 351
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
À mes petites-filles Léa et Éloïne, ceci est l’histoire authentique de votre arrière-arrière-grand-père.
La guerre, un massacre de gens qui ne se connaissent pas au profit de gens qui se connaissent mais ne se massacrent pas.
Paul Valéry
Préambule
11 novembre 2012
Mon cher cousin,
C’est avec une certaine émotion, que je viens d’extirper des mystères du temps, ce paquet de lettres et de carnets, que notre grand-père Joseph a laissé dans un coffret, à l’intérieur du grenier de notre maison familiale de Morasen-Valloire, que j’occupe depuis dix ans déjà… Il y avait passé les dernières années de sa vie avec notre grand-mère Marguerite.
Comme tu es romancier et désireux de connaître le parcours de nos ancêtres, je te joins tout ça dans ce paquet recommandé.
Je pense que tu as matière à écrire un bon livre sur son parcours pendant la « Grande Guerre ».
Affectueusement, ta cousine.
Réponse une semaine plus tard :
Ma chère Maguy,
Ah, le pépé ! Ses lettres et ses carnets de guerre sont un témoignage inestimable. Grâce à eux et à ce qu’il nous a raconté lui-même lorsque nous étions enfants, j’ai, comme tu dis, de la matière…
En plus de son livret militaire qui m’indique les différentes affectations et régiments où il a été incorporé entre 1914 et 1918, avec le Journal de Marche et Opérations : JMO, Patrick Jouffret, généalogiste passionné que j’ai lancé sur le dossier de notre “pépé” et Bernard Labarbe, historien du 57e RI, je peux reconstituer son parcours, jour après jour, avec son état d’esprit et ses réflexions un peu abruptes mais tellement vraies sur le conflit, je crois le revoir avec sa gouaille d’autrefois…
Je me mets au travail demain pour que mon livre-témoignage soit prêt pour le centième anniversaire de la déclaration de cette horrible boucherie.
Affectueusement, ton cousin.
L’âme emplie d’émotion, j’ouvre le premier carnet. Il accueille mon regard, avec ses feuilles jaunies par le temps, d’une belle écriture, penchée, lisse, à l’encre violette, comme on a appris à la styliser dans les écoles de la République du début du vingtième siècle avec une plume Sergent-Major.
Je plonge dans le passé de cet homme, mon grand-père…
Soudain, mon cœur bat la chamade : des images enfouies par le temps resurgissent à ma mémoire… Je suis un enfant, je marche avec lui dans un sous-bois. Nous parcourons tous les deux ces forêts d’automne de la Valloire vers Moras où il a pris sa retraite. Je trottine à côté de sa grande et maigre silhouette. Il accompagne son pas d’une canne. Je grignote mon goûter fait d’un quignon de pain et de quelques carreaux de chocolat. Lorsque j’ai fini ma barre chocolatée, comme je n’ai plus faim, je jette le reste de mon pain sur le sol jonché de feuilles jaunies. Mon grand-père, qui a vu mon geste, me prend par la main, il se baisse pour être à ma hauteur et, en me regardant dans les yeux, avec bienveillance, il me dit :
« Mon petit-fils, il ne faut jamais jeter le pain !
– Pourquoi, Pépé ? le questionné-je, étonné.
– C’est une denrée noble qui se respecte. D’abord, elle a permis de nourrir l’humanité pendant des millénaires, mais pour que tu comprennes, je vais te raconter une histoire : il y a longtemps, au début de la Grande Guerre, j’étais un jeune soldat insouciant. Avant de monter au front, on avait donné, à tous, deux boules de pain. La première était bien fraîche, tendre avec une croute craquante ; la seconde me semblait dure et déjà presque rassie. Sans me soucier de l’avenir, je la balançai dans un buisson avant de partir en me disant : elle sera bonne pour les oiseaux ! Quinze jours plus tard, en revenant du combat, comme nous n’avions presque rien mangé depuis notre départ, j’étais tellement affamé, qu’en repassant devant le buisson où j’avais jeté ma boule de pain, je suis allé fouiller pour la rechercher… Elle était toute sale, picorée par les oiseaux, rongée par les rats, mais j’avais tellement faim que je l’ai dévorée avec plaisir…
C’est pour ça qu’il faut respecter la nourriture et ne jamais jeter le pain. Si aujourd’hui c’est l’abondance pour nous, demain nous pouvons très bien crier famine ! Dans beaucoup de pays pauvres, des enfants n’ont rien à se mettre sous la dent, ou si peu… »
Cette leçon resta à jamais gravée dans mon âme. Depuis, je ne jette plus de pain.
Enfin, après réflexion, au hasard, je parcours tous les carnets…
Certains passages sont gribouillés à la va-vite au crayon de bois : ils sont à peine lisibles. J’imagine qu’il les a griffonnés dans le feu de l’action, juste après une bataille. D’autres sont mis en page, ponctués, écrits à l’encre violette. Là, je me dis : « Il a pris son temps, il y a de la pensée. Les phrases sont bien construites, alignées, ce n’est plus un style télégraphique. Je suppose qu’il a rédigé ces feuillets sur l’arrière en ayant la concentration de les réfléchir, de les poser. »
Quoi qu’il en soit, je suis très ému devant ce recueil de textes.
Par moments, il y a comme des blancs, des trous dans la chronologie d’un paragraphe à l’autre… Conseillé par M. Bernard Labarbe, historien de la Grande Guerre, je consulte le journal des marches et opérations (JMO), véritable journal de bord au jour le jour du régiment, en ligne sur le site Mémoire des Hommes du ministère de la défense.1
Travail de fourmi, ô combien intéressant, quand je pense à cet homme dont j’ai les gènes et à toute sa génération qui a connu cette affreuse période.
Humblement, je mets mon savoir de conteur-romancier à leur service pour raconter leur histoire de simples Poilus.
Je commence mon boulot de rédaction en essayant de rester au plus juste par rapport aux écrits en m’aidant du JMO.
Ceci est donc l’histoire authentique d’un Poilu issu d’une famille d’Alsaciens originaires de Willer-sur-Thur, qui, après la défaite de 1870, pour rester française, par convictions politiques républicaines, s’établit sur le mince pays de Belfort. Cette portion de terre était alors le dernier bout, resté accroché à la France, de cette belle province perdue, et qu’on appelait toujours « Département du Haut-Rhin Français ».
Afin de ne pas éveiller des susceptibilités, même lointaines, tous les noms des principaux protagonistes de ce récit ont été changés.
Je remercie tout particulièrement :
Pierre et Nadette Berthier, Patrick Jouffret, Bernard Labarbe (conseiller militaire et historien du 57e RI pendant la Grande Guerre au sein duquel Joseph a combattu), Yann Le Floch, Daniel Prouteau, Dominique Vignoboul, ainsi que mes cousins Gabriel Lacroix et Maguy Laville qui ont bien voulu me confier leurs archives et collections photographiques.
Une page du carnet de Joseph. Collection Laville-Haler-Lacroix
1. http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/article.php?laref=1]
Livret n°1 : 1914
Déclaration de la guerre. Commission Médicale. 42e RI. Préparation au combat.
Chapitre 1Début des carnets (1914)…
Tout a commencé pour moi ce fameux jour au début du mois d’août 1914. J’étais revenu prématurément de mon service militaire pour raison médicale. Comme je n’avais pas encore obtenu d’embauche sérieuse dans mon métier de serrurier-ajusteur sur Belfort, j’aidais mon oncle Isidore dans sa ferme au pied des Vosges. Il faisait chaud, nous transpirions tous sous nos chapeaux de paille mais comme les oiseaux chantaient dans les fourrés, c’était bucolique, ça nous encourageait. Nous étions toute la famille affairée avec nos faux, en ce beau jour de soleil. Dans un ballet lent et cadencé, à mi-colline, à la moitié du champ, nous coupions nos gerbes de blé. La moisson avait débuté depuis peu, c’est alors que le tocsin de l’église du village, située quatre kilomètres en contrebas, sonna.
Recru par le travail harassant et déjà bien fatigué par la journée qui avait commencé au matin, à cinq heures, personne ne dit mot… Tout le monde savait.
À la pause de quatre heures, Isidore me regarda d’un air grave et, en me tendant un verre de vin, il prononça, sous sa moustache grise :
« Mon bon Joseph, cet automne nous n’irons pas chasser le sanglier ensemble ! Cette fois, c’est le Boche que tu chasseras ! »
Pris par l’émotion, je lui rétorquai juste : « Oui mon oncle, ça se précise. »
Depuis plusieurs semaines, les journaux parlaient d’un conflit européen imminent… Il se profilait à court terme. Maintenant on y était, le cap était franchi, j’étais bon pour rempiler et reprendre mon uniforme bleu et rouge de fantassin…
En fin d’après-midi, sur la place du village, le garde-champêtre annonçait dans un roulement de tambour « la mobilisation générale ». Devant la mairie, des affiches à l’effigie de la République, posées depuis peu, appelaient à la même chose.
Le soir, devant la soupe paysanne, sur la lourde table de chêne brut, on se retrouva tous avec ma tante et mes cousines. Nous fîmes tout le repas sans nous parler. Le sujet qui nous paralysait était si bouleversant que personne n’osa s’aventurer à l’évoquer… L’Alsace allemande n’était qu’à quelques dizaines de kilomètres. Les conséquences pour tous seraient graves. Après le dessert, mon oncle attrapa, sur la crédence, sa grosse pipe en terre qu’il bourra avec un geste habituel que je sentis plus fébrile qu’à l’ordinaire. Il se plaça dans son fauteuil paysan devant la cheminée, en m’intimant de le rejoindre avec ma pipe.
Tandis que le bois craquait entre les chenets, léché par les flammes, ma tante nous servit la goutte de mirabelle. Avec un air empreint de gravité, Isidore me regardant dans les yeux, méditatif, me demanda après avoir tiré une bouffée de fumée :
« Mon bon Joseph, que comptes-tu faire ?
– C’est simple, mon oncle, redescendre au plus vite au Valdoie, embrasser ma mère, mon père, mon frère et mes sœurs, ensuite prendre des renseignements pour rejoindre mon unité.
– J’ai l’impression que ça va barder ! Les Allemands nous ont attaqués. Cette fois-ci, je souhaite que nous soyons moins pitoyables qu’en 70…
– Mon oncle, les Boches sont un peuple de militaires, ils ont l’esprit guerrier. Mais nous avons de quoi les arrêter ! Certains de nos généraux sont bons et déterminés !
– Je l’espère, mon garçon. Puis, me regardant dans les yeux à nouveau : Surtout n’oublie pas que nous sommes Alsaciens de souche, nous autres ! Tu as vu le jour au Valdoie, mais tes parents et ta famille viennent de Willer-sur-Thur, berceau de tes ancêtres. Ton grand-père Valentin, né en 1833, a dit fièrement au colonel Prussien, venu lui rendre visite dans sa boutique de barbier, après la défaite de ce fanfaron Napoléon III : “Je suis républicain, Herr Colonel, et avant tout, Français ! Aucun de mes fils ne portera l’uniforme allemand !”
– Ça, c’est envoyé, mon cher oncle !
– Ton grand-père était un personnage hors du commun ! Quelques jours plus tard avec ton père Alphonse, nos sœurs et moi, nous avons suivi nos parents en laissant notre belle maison et la boutique de barbier de Valentin qui nous faisait tous vivre. Clandestinement, nous avons traversé les Vosges par des sentiers incertains, la nuit, pour parvenir autour de Belfort et nous établir… N’oublie jamais ça, mon bon Joseph. Aujourd’hui je suis trop vieux pour porter les armes, mais toi, avec ta vigueur et ta jeunesse, fais de ton mieux !… Si nous pouvions reconquérir la terre de nos ancêtres !…
– Oui, mon oncle. »
Je connaissais l’histoire de mon cabochard grand-père Valentin et de toute notre famille depuis mon enfance. Elle m’avait été racontée maintes fois par mon père, mes tantes et tous ceux qui l’avaient vécue. Mais, mon oncle Isidore avait dit ça avec tant d’amertume et de détermination, que je n’avais pas osé le couper dans son discours.
§§§§§
Chapitre 2Retour au Valdoie
Le lendemain avant l’aube, je me levai. Après un rapide coup d’eau jeté sur la figure, je m’habillai en hâte. Dans la grande pièce commune, je pris un bon déjeuner paysan avec une soupe au lard et une bonne tranche de pain bis beurrée. Ma tante m’avait copieusement garni ma musette d’un solide casse-croûte avec du pain, du fromage de Munster, du saucisson, des fruits de saison et un litre d’eau et de vin pour m’accompagner dans les vingt-quatre kilomètres qui me séparaient de mon village du Valdoie.
Aidé de mon bâton de marche, je partis d’un bon pas sur le sentier forestier qui traversait les champs et les bois pour couper presque en ligne droite jusqu’aux environs de Belfort.
Derrière moi, la belle ligne bleue des Vosges dessinait ses contours imprécis et flous, exhibant ses touffes de sapins noirs. Elle semblait loin, mais lorsque, à ma première halte, je la regardai, je me dis que, de l’autre côté, déjà c’était les préparatifs au combat qui devaient s’activer. Peut-être même des charges avaient-elles commencé… Malgré la hargne que j’éprouvais contre le peuple allemand si belliqueux, et une certaine envie d’en découdre, ceci ne me réjouissait guère. D’abord, la guerre je ne la connaissais pas, même si, au service militaire, pendant mes classes, j’avais été mis en condition, préparé à combattre. Même si, j’avais fait de longues marches pour m’aguerrir, même si, j’avais manié des armes sophistiquées, avant d’être exempté pour raisons médicales, je n’avais jamais été au feu. Ceci était un univers que je ne pouvais calculer et qui m’effrayait autant qu’il m’excitait. Pour éviter de me morfondre et ne pas me mettre de pression inutile, je me forçais à chasser ces idées bourrées d’inquiétude. Je voulais profiter de cette belle journée d’été et surtout de liberté. Je n’avais que vingt-deux ans. J’étais encore naïf des choses de la vie. Je ne connaissais pas bien le monde des hommes avec leurs contradictions, leurs problèmes et leurs envies. Comme tous les jeunes de mon âge, je rêvais à une vie simple. Dans quelque temps, je ferai comme mes parents et mes ancêtres : je rencontrerai une jeune fille de ma condition, simple et bonne, pour l’épouser, fonder une famille et avoir des enfants qui continueront la lignée de notre nom… Quelques unes d’entre elles, au Valdoie, me plaisaient. Mais, de ce côté-là, je n’étais pas trop pressé de mettre le doigt dans l’engrenage. Je laissais faire le destin. Hélas ! Celui-ci, avec la guerre déclarée, bouchait de nuages sombres autant qu’inquiétants cette perspective heureuse.
Enfin, je continuais mon chemin, coupant à travers champs où je faisais quelques signes amicaux aux agriculteurs et à leur famille, qui moissonnaient, eux aussi en grande vitesse, et pour cause… À mi-parcours, je me laissais aller à une plus longue halte dans la fraîcheur d’un sous-bois pour souffler un brin et avaler, à la hâte, mon casse-croûte bien garni…
En reprenant ma marche, au tournant du sentier, j’eus la joie simple de découvrir, entre les mousses et les lichens, toute une poussée de cèpes et de girolles. Je les ramassai et en garnis ma musette. Ceci m’égaya l’esprit. C’est avec le bonheur facile des plaisirs bucoliques que l’on apprécie mieux la vie. Enfin, en ce qui me concernait, c’était important. Je me remémorais, au fil de ma marche, toutes les belles promenades que nous faisions avec mon père et mon oncle Isidore, fusil en bandoulière, à traquer le lièvre ou le marcassin, tout en cueillant des champignons au passage dans les bois touffus et denses de notre belle région. Tout ceci allait m’être, pour quelque temps, défendu avec ce conflit qui prenait forme. Je gardais l’espoir que cela ne durerait pas trop longtemps.
Ah ! Ça y est, tandis que le soleil décline doucement du côté Ouest en éblouissant quelque peu ma vue, j’atteins la dernière colline avant le grand fossé qui me plonge sur Belfort et ses environs.
Un tantinet fatigué, cœur battant, j’arrive au sommet et, pour reprendre mon souffle, je m’assieds sur une large pierre et je laisse divaguer mon âme en contemplant le paysage.
La grosse agglomération m’apparaît avec ses immeubles, ses églises avec leur clocher au relief pointu, dans le soir… De loin en loin, je distingue tous les petits villages qui s’agglutinent autour comme des poussins nouveau-nés vers leur mère poule. J’aperçois même mon bourg avec notre petite rivière au nom charmant de la Savoureuse, qui serpente dans le soir, reflétant sa clarté limpide dans son lit sinueux. C’est ici que j’ai passé toute mon enfance et ma jeunesse, c’est là que j’ai mes amis, mes souvenirs d’école. Le dimanche, à la grand-messe, c’est avec envie que je regarde toutes les jeunes filles de mon âge en ébauchant des rêves de tendresse avec certaines… Après l’office, sur la place, j’essaie, en faisant violence à ma timidité, d’en aborder une ou deux sans trop rougir. Mais les parents, toujours aux aguets et en alerte, répriment souvent, l’œil sévère, sans façon, mes velléités de discussions… Enfin, c’est ainsi. Je ne me fais pas trop de bile. Je sais qu’un jour, il y en aura sûrement une qui me sourira plus que les autres, voudra me connaître davantage, acceptera mes paroles et peut-être consentira à des rendez-vous secrets. C’est arrivé à plusieurs de mes conscrits de la classe 12 qui, eux, sont déjà fiancés et, pour certains, pères de famille. Mais, pour le moment une autre préoccupation bien plus angoissante et pressante m’habite l’esprit, tandis que je descends la dernière ravine pour atteindre les premières rues pavées du faubourg. Lorsque j’arrive dans l’agglomération, j’ai l’impression que tout a changé depuis mon départ. Ça grouille de militaires en armes qui courent dans tous les sens.
Ça y est, je suis à côté de l’église, je bifurque vers le cimetière où, très ému, je dépose sur la tombe de ma sœur Alphonsine, un bouquet de fleurs sauvages glanées le long de mon parcours de retour.
§§§§§
Chapitre 3Je retrouve ma maison familiale
Enfin, je longe la Savoureuse en regardant, dans les derniers rayons du couchant si, dans son lit clair, quelques truites ne se faufilent pas entre les herbes et les cailloux verts.
Je frappe à la porte de notre maison située juste à côté de la rivière… Ma sœur Lucie m’ouvre du haut de ses belles années de jolie jeune fille. Elle enlace ses deux bras autour de mon cou, se hissant sur la pointe des pieds. Elle me colle sur les joues plusieurs gros baisers affectueux, humides, en me criant : « Mon Joseph ! Mon Joseph ! » Puis c’est au tour de mon petit frère Jules. Enfin, mon père arrive. Ils me prodiguent leur affection, je leur déballe mes champignons et, assis devant la large table familiale, nous commençons à causer avec, dans les mains, une bonne chope de bière.
Pour ne pas tout de suite attaquer sur le sujet sensible, je leur parle tout d’abord de la ferme, là-haut, donnant des nouvelles de mon oncle, de sa femme et de leurs filles :
« La moisson a commencé, la récolte sera abondante, le blé est de bonne qualité. »
Mais la réponse de mon père, qui est un pessimistené, est sans appel :
« Si les Boches ne nous la réquisitionnent pas d’ici quelque temps ! Les hostilités ont déjà commencé. Sur le journal, il est écrit qu’ils avancent ! On est enfoncé sur notre frontière et celle de la Belgique ! Ils sont déjà sur notre territoire, c’est un scandale ! Belfort est une ville de garnison bien trop près de la ligne de front ! Nous sommes en état de siège. Les autorités de l’armée française contrôlent tous les habitants… Il a été décrété que « les bouches inutiles »2 seront évacuées sur l’arrière par trains spéciaux… Si je ne travaillais pas dans une usine qui fournit des pièces pour l’artillerie, nous aurions dû partir ! Quelle misère, mon fils, cette guerre… Certaines maisons du village sont réquisitionnées pour loger des officiers qui arrivent pour les batailles.
– Au fait, mon Joseph, réplique ma sœur, les gendarmes sont venus hier soir pour te remettre ton ordre de mobilisation. Regarde, le document est sur la commode !
– Tu leur as dit quoi, exactement, quand ils ne m’ont pas trouvé ?
– Que tu étais là-haut, chez l’oncle Isidore ! Ils ont répondu qu’ils iraient te chercher si tu ne te présentais pas ici.
– Oui, bon, nous verrons… »
J’attrape l’ordre sur le meuble, le parcours rapidement.
« C’est clair, je leur explique dans un raclement de gorge : je dois rejoindre mon unité de combat au plus vite ! Rendez-vous à ma caserne d’affectation.
– Tu nous quittes déjà, réplique mon frère en s’attristant.
– Non ! La guerre m’attendra un peu. J’ai l’intention de profiter de vous avant de partir. Surtout que je ne sais pas quand je reviendrai, ni si je reviendrai !
– ‘Parle pas de malheur, ronchonne mon père.
– Je dois me renseigner pour mon départ, préparer mon sac. En attendant, égayons cette dernière soirée ensemble ! Lucie, comment as-tu l’idée d’accommoder ma cueillette ?
– Comme tu l’aimes, mon Joseph ! En mitonnant sur notre fourneau une grosse omelette, bien baveuse, je sais que c’est ton goût.
– Splendide !
– Nous ouvrirons aussi une bonne bouteille de vin du Jura et je sortirai les saucisses et un jambon qui pendent dans la cave, reprend mon père, c’est pas tous les jours qu’on a son aîné qui va défendre le drapeau ! Reconquérir notre chère belle province perdue ! Même si l’heure est grave, il faut marquer le coup.
– Pour le dessert, ça sera la tarte aux airelles que j’ai préparée, tranche Lucie qui déjà grattait les girolles, munie d’un couteau pointu.
– Quand tu seras là-bas, en face des Boches, si on te tire des balles dessus, mon Joseph, cache-toi bien, hein ! C’est bien d’être courageux, mais fais-en pas plus qu’il ne faut ! J’ai un grand frère et j’y tiens !
– Ne t’inquiète pas Jules, j’ai appris à me dissimuler, c’est dans mon instruction militaire », je conclus en riant.
Entre-temps, ma sœur Marie et ma mère arrivent du lavoir les bras chargés de corbeilles pleines de linge. C’est une nouvelle effusion avec des embrassades. Je serre sur mon cœur ma chère mère et ma sœur cadette. Ça me fait chaud à l’âme d’avoir une famille si aimante.
Nous passons une soirée très agréable dans la grande pièce, où, sur notre table de chêne, nous dégustons le repas préparé par ma chère Lucie. Papa sort trois bouteilles de vin. Il voulait vraiment que l’on n’oublie pas cette réunion familiale. Bien que nos conversations fussent axées sur des sujets futiles, pour ne pas aggraver notre humeur, je sentais, dans le brillant de l’œil de mon père, un pressentiment mauvais. Depuis la mort de notre chère Alphonsine, il était aigri, sensible, un peu plus ronchon que d’habitude, même s’il évitait de le montrer. Maman aussi avait de la peine, mais elle me souriait pour ne pas ternir cette journée.
Ma sœur Marie, déjà grande, et d’un naturel assez refermé, ne me disait rien, mais je sentais dans son attitude, une forme de mélancolie.
Enfin, à la lueur de la lampe à pétrole, pour la tarte aux airelles de Lucie, mon père sortit un pétillant vin de Champagne qui acheva de mettre dans nos cœurs du vague à l’âme. Ensuite, assis confortablement dans nos fauteuils respectifs, tout en fumant une bonne pipe avec mon père, tandis que Marie nous servait un marc de derrière les fagots, nous discutâmes encore. Pour ne pas les affoler, je leur expliquai qu’avec les nouveaux armements que nos ingénieurs avaient conçus, les Allemands avaient du souci à se faire.
« Ah, grommelle, en guise de conclusion, mon père, dont j’avais ravivé un certain patriotisme : si l’armée française pouvait reconquérir la belle province perdue de nos ancêtres ! Je vous ferais visiter le village où je suis né. Avec votre mère, nous n’y sommes jamais retournés et ça fait plus de quarante ans ! »
Exténué par cette journée de marche et les agapes de nos retrouvailles, sur le coup de minuit, je grimpai les escaliers de bois qui craquaient sous mes pas, en me rappelant les souvenirs d’une enfance joyeuse. J’accédai à ma chambre au premier étage. Lucie m’avait mis des draps frais. Je me déshabillai en hâte et me jetai aussitôt sur le grand lit de bois. Le sommeil m’emporta sur l’instant et je rejoignis la frontière de mes rêves sans difficulté.
§§§§§
Chapitre 4Préparatifs
Le lendemain matin, après le déjeuner, j’investis les rues de mon village en effervescence et grouillantes de soldats. Les gens allaient et venaient avec nervosité. Je me présente directement à la gendarmerie de Belfort, juste à côté du Valdoie.
Le préposé du bureau, qui me connaissait, me lance avec son accent franc-comtois très appuyé :
« Ah, Glandard, c’est-y enfin qu’on te voit, on t’a cherché de partout !
– J’étais à la moisson chez mon oncle !
– Ah, reprend-il en riant, maintenant, tu risques de faire une bien drôle de moisson, mon gars ! Tu vas moissonner le Boche ! Ça va te changer de danse, hein ! Fais-leur pas de cadeau à ces cochons-là !… Mais, euh, ton dossier n’est pas complet, je vois que tu as eu des problèmes de santé pendant ton service militaire, alors tu dois te rendre au plus vite à la caserne de Belfort au 42e RI, bureau 18, ils ont des informations que je n’ai pas. Ils t’aiguilleront pour ton avenir militaire !
– Merci bien, Monsieur, au revoir. »
Un quart d’heure plus tard, je pénétrais dans cette caserne que je connaissais bien pour y avoir fait mes classes. Je me dirigeai tout de suite vers le bâtiment en question pour en savoir plus sur mon cas. À l’intérieur de la cour, il régnait une animation extraordinaire. Les soldats allaient dans tous les sens, c’était déjà l’effervescence du combat qui se préparait à quelques dizaines de kilomètres de là, sur la frontière…
Je franchis la porte du bureau indiqué et me présente.
« Glandard Joseph, matricule 708, né au Valdoie le 15 avril 1892…
– Ah, oui, me fait l’officier d’un air revêche, vous venez pour la mobilisation, mais vous avez un dossier médical, n’est-ce pas ? Vous n’avez pas fait le service militaire dans sa durée légale pour raison de “maladie”…
– Oui, mais maintenant je vais bien, je suis en pleine forme…
– Ce n’est pas à vous d’en décider, mais au conseil militaire de santé… Je consulte les éléments que j’ai en ma possession… Il feuillette mon dossier puis me dit : “végétations adénoïdes et pleurite du sommet droit”, c’est bien ça ?
– Peut-être, je ne suis pas médecin…
– Bien. Dans ce cas, il vous faut aller à Besançon, passer à nouveau devant la commission médicale qui statuera sur votre sort !
– D’accord, dis-je, je dois m’y rendre en train, mon lieutenant ?…
– Évidemment, en vélo ça serait un peu long, je vous fais délivrer un billet tout de suite…
– C’est en troisième classe ? lui demandé-je.
– Mon soldat, vous croyez pas que la République va vous payer le carrosse ! Si vous étiez officier encore, mais simple trouffion !
– Merci bien, mon lieutenant. Au revoir.
– Salut, Glandard, et bonne chance ! »
Je ne voulais plus trop avoir affaire à ce genre d’officier qui, parce qu’il avait une fonction, se donnait des airs d’une inouïe suffisance. Je quittais la caserne en vitesse pour rejoindre la gare par les petites rues adjacentes, où grouillait une activité inhabituelle. De nombreux « évacués de force » ainsi que des jeunes hommes, comme moi, appelés à rejoindre leur unité de combat, se précipitaient pour demander des renseignements au sujet des trains. Certains, que je connaissais pour les avoir déjà rencontrés, me faisaient, furtivement, des petits signes amicaux.
Heureusement, face à ces heures graves et un peu précipitées, les agents de la Compagnie des chemins de fer de l’Est avaient affiché, sur de grands tableaux, pour faciliter le départ des « bouches inutiles » et des appelés au front, les principales lignes avec les horaires et les correspondances qui allaient avec… De l’autre côté de la salle des pas perdus, sur les voies, dans de fracassants bruits de wagons et de halètements des locomotives, j’apercevais par intermittence, des convois qui s’enfuyaient vers l’orient, du côté de la frontière, à quelques dizaines de kilomètres, vers Dannemarie où probablement, les échauffourées avaient commencé. Certains trains, sur de larges wagons à plateau, étaient remplis de canons et de matériel de guerre. D’autres, qui ne comptaient que des voitures de voyageurs, étaient bourrés de militaires en uniforme qui semblaient armés de pied en cape… Ils gesticulaient aux fenêtres, avaient déjà leur képi et exhibaient le haut de leur fusil, en criant joyeusement, à la foule qui les acclamait sur le quai, des chants de gloire ponctués de cris guerriers et vengeurs.
Tandis que je regardais passer ces trains, grisé moi aussi par l’ambiance et l’idée d’en découdre, au son du tintamarre patriotique de circonstance, je sentis une lourde poigne me tapoter l’épaule et une voix me lancer amicalement :
« Jojo, toi aussi t’es de la partie ? »
En me retournant, je reconnus tout de suite mon vieux copain d’école, Théodore Zighler. Nous étions conscrits, tous les deux de la classe 12. Nous avions fait nos classes ensemble. Avant de tomber tous les deux malades, nous faisions notre service militaire dans le fameux régiment d’infanterie du 42e RI de Belfort.
« Mon Totor ! lui répliqué-je, très enthousiaste de le revoir. Je dois me rendre à la commission médicale de Besançon pour passer des examens afin de savoir si je peux être incorporé pour la guerre !
– Moi aussi, tu te souviens, j’avais eu des problèmes de santé, on me demande la même chose ! On voyagera ensemble, me fait-il, à deux ce sera plus drôle, on s’ennuiera moins. J’ai déjà pris les horaires. Le mieux pour nous, c’est le train de nuit. Il est un peu lent, il s’arrête à toutes les gares, mais il est direct et nous arriverons au petit matin à Besançon…
Pris par son enthousiasme, je me laissai aller face aux évènements. Je ne lui fis pas d’objection et acceptai sa proposition. Finalement, j’étais heureux de l’avoir retrouvé, et, savoir que nous allions peut-être combattre côte-à-côte, me donnait de l’espoir.
« Mon Jojo, maintenant que, pour nous deux, la question du voyage est réglée, je te propose de nous enfiler sous la cravate, ce midi, une bonne choucroute à la brasserie du père Muchler. C’est à deux pas d’ici, c’est pas coûteux et ça sera toujours ça que les Allemands n’auront pas », conclut-il en riant.
Sa face rougeaude de bon gaillard, haut sur pattes, mais déjà un peu gras, blond, frisé, le visage rond, sa petite bedondaine de bon vivant et son allégresse à la bonne chair, me mirent de bonne humeur. J’acceptai son invitation et, grisé moi aussi, nous déambulâmes dans les rues de Belfort, sans nous presser, comme des badauds qui flânent, en direction du restaurant.
L’estaminet est bourré de jeunes hommes, comme nous, qui veulent prendre un moment de convivialité avant de s’en aller au front. Quelques vieux binoclards déjà attablés devant leurs mets, en costume strict, lisent les journaux et gazettes tout en sirotant leur vin blanc. On peut lire en gros caractères sur leurs feuilles de chou ouvertes, les gros titres qui parlent du conflit. Un brouhaha mêlé de verres qui s’entrechoquent, de fourchettes qui s’activent, et de voix qui résonnent, emplit la grande pièce, tandis qu’une bonne odeur de cuisine nous attise les papilles gustatives.
Je salive déjà et mon estomac est en émoi rien que d’imaginer ce que je vais manger.
Les serveurs se pressent dans de rapides va-et-vient entre la cuisine et la salle. L’un d’eux, crayon à la main vient nous prendre la commande en vitesse.
« Alors, Glandard, me fait mon conscrit, que penses-tu de cette guerre qui commence ?
– Mon Totor, pour le moment, je n’en pense rien du tout. Nous n’avons pas eu de conflit sur le territoire depuis quarante-quatre ans. C’était déjà contre les Boches, et quelle déculottée nous avons prise ! Depuis, beaucoup de choses ont changé : les armements, les mentalités, les inventions avec leurs performances, surtout dans l’artillerie… Les fusils d’assaut ont évolué…
– Ah, pour sûr, nos grands-pères, avec leur Chassepot à un coup, peu précis, fumant et qui s’encrassait pour un rien… Et leurs généraux qui jouaient au billard pendant la bataille au lieu de s’impliquer !… Une vraie déroute pour l’armée française !
– Il n’y a qu’à Belfort, mon Totor, que nos Pioupious ont résisté. C’est pour ça qu’on a la statue de notre lion.
– Ouais, essayons d’en être dignes ! Mais moi, Glandard, je vais te faire une confidence, je suis patriote, c’est sûr, si le drapeau est en danger, je réponds présent ! Mais entre nous, les Allemands, moi, je les connais pas… Et ils ne m’ont rien fait. De leur côté, ça doit être un ramassis de braves gars comme nous, qu’on a enrégimentés au son du clairon, sans qu’ils le veuillent, en leur bourrant le bourrichon à coups de slogans haineux contre nous autres, Français… Du style qu’on était des sales vaches, pour qu’ils marchent dans leurs régiments et qu’ils nous tirent dessus ! À la rigueur, nous qui sommes des Alsaciens de souche, on peut leur en vouloir, ils nous ont piqué notre pays, mais les autres, hein ? Les Marseillais, les Bordelais, pour eux, c’est pas pareil !
– Zighler, je suis d’accord avec toi sur l’essentiel. De l’autre côté de la frontière, ce sont des pauvres types comme nous, pétants de jeunesse, que nous allons combattre. C’est vrai !… Mais si nous pouvions, tout de même reprendre notre belle province, je n’en serais pas fâché. Hier soir, mon père m’a encore parlé de son village natal. Il avait les larmes aux yeux.
– Ouais, Jojo, quand faut y aller, faut y aller ! conclut-il, car la choucroute venait d’arriver sur la table et les chopes de bière aussi. Dégustons ce mets savoureux, à la caserne, sur les champs de bataille, on ne sait pas ce qu’on mangera !… Trinquons à notre victoire !
– Oui, trinquons ! »
Nous fîmes tinter nos verres et, pris par l’ambiance, nous dévorâmes presque sans mot dire, notre copieuse assiette.
Au dessert, Zighler, grisé par ce repas et les nombreux verres de bière et de vin que nous avions engloutis, me dit :
« Regarde, Glandard, c’est du fromage de Munster que nous mangeons maintenant !… C’est qui, qui l’a inventé, mis au point, ce frometogomme ?… Munster, c’est un village allemand aujourd’hui !
– La choucroute de Strasbourg, surenchéris-je, hein !
– Oui, vengeons nos pères ! Rendons nos belles provinces à la patrie !… Vive la France ! »
C’est ainsi que nous sortîmes, un peu éméchés, de la brasserie pour déambuler dans les rues en sifflant des airs patriotiques, avant de nous quitter pour préparer nos affaires pour le voyage.
En me serrant la main, il conclut complètement enthousiaste :
« On va les plier vite fait… En quelques mois, ça sera fini. Nous fêterons Noël et la victoire dans nos familles !
– Espérons-le, mon Totor, mais avant tout, nous devons avoir l’avis favorable de la commission médicale…
– Je suis en pleine forme, y’a pas de raison…
– Moi aussi. »
À pied, je fis les quelques kilomètres qui me séparaient de ma commune. Dans les rues et les avenues, je sentais poindre une fébrilité et une activité inhabituelle dans le comportement des gens. Certains semblaient faire des provisions. Une espèce de nervosité mêlée d’inquiétude, que je n’arrivais pas à définir, animait la population. Au loin, dans la vallée, je percevais toujours les bruits des trains de guerre qui partaient vers l’Est à vitesse réduite.
Enfin, je toque chez moi. Ma chère Lucie m’accueille en me sautant au cou, Marie et Maman arrivent juste après. Je discerne dans leurs regards une joie teintée d’amertume.
« Mon Joseph, me dit ma petite sœur en m’embrassant, je vais t’aider à préparer ta valise. Si tu le veux, bien sûr !
– Évidemment, Lucie, mais je n’ai pas grand-chose à prendre, je ne pars que pour deux ou trois jours… Je dois affronter la commission médicale et je reviens. Je ne vais pas encore à la guerre, vois-tu…
– Pour le voyage tu auras besoin de manger et boire à l’aller et au retour. Je m’en occupe !
– Merci, ma chère sœur ! »
§§§§§
Chapitre 5En route pour la commission médicale
Le soir, j’embrasse Maman et Marie et, avec mon père, Lucie et Jules, nous prenons la direction de la gare de Belfort. Mon sac de victuailles est plein à craquer. Ma chère sœur me l’a bourré de saucisson, fromages, pain frais et chopine de bière. J’en avais pour trois jours…
Dans la salle des pas perdus de Belfort, l’animation est dense. Ça grouillait de gens qui, par force fuyaient la guerre et de jeunes hommes comme moi qui, le paquetage fait, patientaient devant les horaires, en faisant les cents pas avec leur famille. Devant la sortie, des cabriolets à cheval venaient déposer en hâte des voyageurs en partance, pour la plupart des paysans des villages lointains. Ils arrivaient, eux aussi, pour laisser leur fils ou un parent au train.
Parmi tous ces jeunes gens, j’en reconnus plusieurs. Certains avaient participé comme moi au dernier concours de tir à la carabine. Je serrais des mains à droite et à gauche, discutant avec l’un ou l’autre, sous les yeux admiratifs de mon cher Jules et surtout de Lucie qui avait une tendresse très particulière pour son grand frère comme elle m’appelait.
« Glandard, on va pouvoir s’exercer dans de nouvelles sortes de concours, hein ? Avec les Boches en ligne de mire, faudra viser juste !
– Je crois que ça sera beaucoup plus compliqué que nos joutes départementales, je réplique en riant à Henri Lanval, qui, comme moi avait été finaliste du dernier tournoi régional. »
Les becs de gaz répandaient cette odeur nauséabonde si particulière, diffusant leur lumière du bout de l’avenue jusqu’à l’intérieur de la station et même sur les quais. On pouvait distinguer les manœuvres des lourdes locomotives qui soufflaient leur vapeur par tous les tuyaux en amenant les wagons pour les convois en partance.
Enfin, je vois débouler Totor, accompagné de son père, par la grande porte vitrée de la station. On se serra la main et, pour mettre un peu de gaieté dans la séparation avec nos familles, il commença à raconter aux miens nos blagues et nos espiègleries de chambrée dans la caserne pendant nos classes… Mais, mon père, avec son pessimisme de rigueur et qui avait toujours un pressentiment mauvais sur notre avenir, lui lança laconiquement : « Théodore, si vous êtes enrôlés, cette fois, je crois que vous n’aurez pas le temps de faire trop de conneries ! » Cette réplique tomba comme une sentence sur notre petit groupe et, pendant une minute, nous nous regardâmes sans mot dire, un peu inquiets et graves.
Enfin, un chef de service muni d’un porte-voix annonça que le train en partance pour Besançon et Dijon allait se ranger devant le quai numéro deux… Lentement et avec tout notre barda, nous prîmes cette direction ensemble en passant sur les traverses.
La lourde locomotive noire toute suintante de fumée, avec son bruit de ferraille et de pistons, arriva lentement devant le quai, en plaçant son train. Dans un bruit de tampons et de crissements de freins, tout le convoi s’arrêta. Nous cherchâmes, en queue, les voitures de troisième classe. C’était encore, en ce temps-là, de longs wagons de bois sur un châssis métallique avec un marchepied unique qui filait de chaque côté sur toute la longueur. En troisième classe, nous n’avions pas encore de couloir qui reliait les compartiments entre eux, ni de cabinets d’aisance. Pour se rendre aux toilettes, il fallait se dépêcher pendant l’arrêt dans une gare… Les trajets étaient très longs ; les Français prenaient leur temps et leurs précautions, pour se déplacer d’un lieu à un autre.
Nous installâmes nos effets dans notre compartiment. Je calai ma valise dans le filet et mon sac de victuailles, qui allait bientôt servir, à ma place devant la fenêtre. Totor à mes côtés, nous descendîmes papoter encore un peu avec les nôtres… Son père, épicier à Belfort, lui donnait des consignes et mises en garde, tandis que moi, je serrais une dernière fois, avec une tendresse toute particulière, les miens en les rassurant pour leur expliquer que je ne partais pas encore à la guerre mais seulement à la commission médicale qui devait d’abord entériner son accord…
« Elle va le donner, répliqua mon père.
– De toute façon, je serai là dans quelques jours, tout au plus !… Vous aurez bien le temps de pleurer d’ici là si je pars vraiment au front ! »
Le chef de service cria à nouveau dans son porte-voix pour annoncer le départ prochain de notre convoi. Mon père glissa un peu d’argent dans ma poche en me disant : « Ça pourra toujours te servir. »
Les portières claquent, le chef de gare s’avance vers la motrice, il siffle un grand coup en actionnant une espèce de sémaphore.
J’entends la locomotive faire un long « Tchouf ! », puis un autre plus rapproché, et ainsi de suite… Notre convoi s’ébranle dans l’obscurité. Je regarde les miens par la fenêtre. Ils sont sur le quai. Ils s’éloignent imperceptiblement de ma vue. Le bruit de vitesse, de crissements de roues sur les rails et de vibrations des wagons s’accentue. Je vois disparaître les dernières lumières de Belfort. Après dix minutes, nous sommes dans le noir complet de la rase campagne. Seuls, les halètements saccadés, ponctués des coups de sifflets de la motrice qui nous emporte dans la nuit et vers cet avenir incertain, me tiennent en haleine. Je ferme la fenêtre.
Nous n’étions que quatre dans le compartiment. D’autres jeunes comme Totor et moi qui allaient rejoindre leur unité de combat et exposer leur simple existence aux balles, aux canons, aux bouches à feu des ennemis. Personne n’avait encore conscience de tout ce qui allait se découvrir. Cette descente dans l’horreur programmée, qui attendait chaque soldat dans un bref délai, nul ni pensait ni ne voulait la voir. Notre jeunesse encore insouciante prenait le dessus. Nous engageâmes entre nous une conversation joyeuse et décousue en parlant de notre beau pays de Belfort, des travaux des champs qui se feraient sans nous, car nos compagnons étaient tous deux fils de paysans. Aussi, et bien sûr, nous causâmes des filles et de leur beauté. Ça nous taraudait l’esprit, mais nous évitions, pour ne pas gâcher le voyage, d’évoquer le conflit et toute la puissance qu’il avait engagée. La discussion continua un bon moment puis l’un des fils de paysan proposa de trinquer à notre avenir. Il avait tout ce qu’il fallait dans sa musette. Comme Totor et moi avions faim, je lui dis que le mieux, et vu l’heure tardive, était tout bonnement de casser la croûte ensemble. Tandis que les gares s’égrenaient les unes après les autres, avec leur arrêt et leurs voyageurs, qui montaient et descendaient, nous, les appelés, conscrits de la République, à la lueur de la petite lanterne plafonnière, nous partagions notre pain, notre saucisson, notre fromage et le reste, en arrosant le tout d’un bon vin blanc râpeux, pour passer le temps de façon agréable et surtout, de ne pas trop penser à ce qui attendait chaque soldat.
La ville de Besançon arriva de façon impromptue, dans les pâleurs du petit matin frissonnant. Pris par l’ambiance joyeuse et les agapes improvisées, nous avions réussi à tenir sans nous soucier de rien.
Dans la gare, plein de jeunes hommes comme nous, descendaient pour rejoindre leur régiment. Nous quittâmes nos compagnons d’une nuit qui, eux, devaient atteindre leur casernement du côté de Tours.