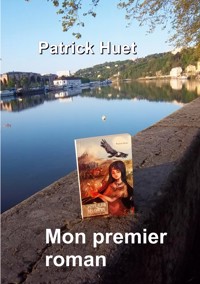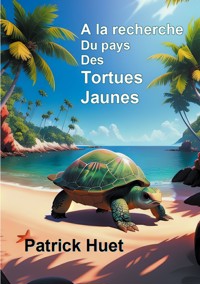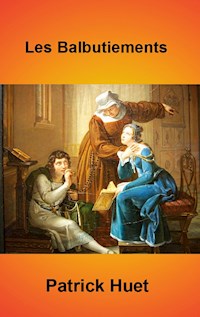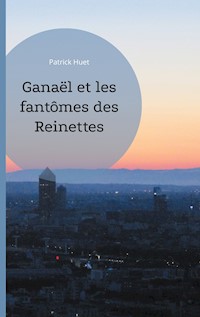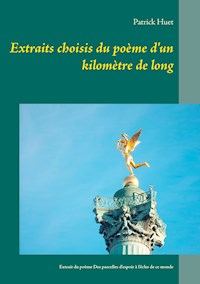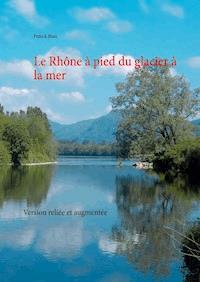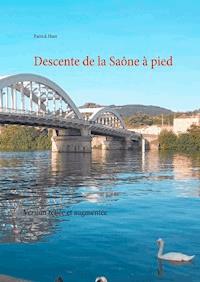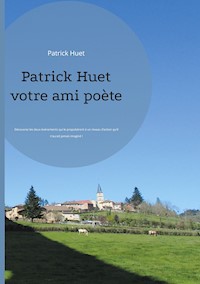
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Französisch
Patrick Huet est connu pour ses performances incroyables réalisées dans le domaine littéraire, notamment un poème d'un kilomètre de long. sur le thème des droits de l'Homme. Dans cet ouvrage, il vous dévoile ce qui l'a conduit sur les chemins de l'écriture. Comment il fut à la fois son propre élève et son propre maître pour progresser dans chaque domaine qu'il voulait aborder : le roman, la poésie, le conte, les conférences... Ses activités se plongèrent avec délice aussi bien dans la création de poèmes insolites que dans l'exploration des bords de fleuve (de la source à la mer). Mais rien de tout ceci n'aurait accédé à une telle envergure sans les découvertes fondamentales qui marquèrent une période spécifique de son existence. Découvrez à votre tour ces deux événements qui le propulsèrent à un niveau d'action qu'il n'aurait jamais imaginé !
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 106
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
SOMMAIRE
Prologue. Vous êtes bien chez votre ami poète
Ce qui m’a conduit à l’écriture
Les grandes dates
Les points de rupture et de grandes évolutions.
Ce qui m’a conduit à l’interprétation de contes
Ce qui m’a conduit aux conférences
La création de poèmes géants
Les Fêtes à thème
La création du Fleuve-trotteur, et de l’aventurier des bords de fleuves.
Remerciements
Annexe 1 – Liste des ouvrages
Annexe 2 – Liste des conférences
Annexe 3 – Photos de Patrick Huet
I – Prologue. Vous êtes bien chez votre ami poète.
« Bonjour, vous êtes bien chez votre ami poète ! »
Telle est la phrase de politesse qui accueille l’interlocuteur quand il se connecte au répondeur de mon téléphone fixe ou à la boîte vocale de mon téléphone mobile.
Cette formulation ne date pas de ces dernières années. J’en ai eu l’idée en 1997, quelque temps après avoir lancé une activité nouvelle à l’époque, celle de poète public (j’aurais l’occasion de développer ce point un peu plus loin, au chapitre suivant intitulé « Ce qui m’a conduit à l’écriture »).
Cependant, cette formulation ne concernait pas que les poèmes que je composais pour d’autres personnes, elle recouvrait un concept bien plus vaste, une façon de concevoir la vie dans ce qu’elle offre de plus merveilleux, la volonté d’affronter la dureté des aléas en gardant la tête haute et de continuer à percevoir la beauté des jours même quand la fureur se déchaîne autour de soi.
En effet, quand les événements fracassent les rêves, savoir saisir les reflets fugaces des éclairs qui foudroient, et leur accorder la magnificence du rubis, permet de maintenir en son coeur le jardin de la candeur, et d’y voir renaître, une fois la tempête apaisée, la fleur des beaux jours dont le parfum efface à tout jamais l’incendie des temps brutaux.
La poésie ne se résume pas seulement à l’écriture de poèmes, c’est d’abord une conception de la vie, une vision toujours renouvelée du monde réel et du monde imaginaire. C’est continuer de créer son propre univers intérieur en dépit des agressions et des oppressions qui voudraient nous obliger à l’abdiquer, et surtout… colorer le monde extérieur de cette fragrance qui palpite en nos regards.
II – Ce qui m’a conduit à l’écriture.
Ma principale activité, ma profession de base, celle qui sous-tend mes autres initiatives (privées ou professionnelles), c’est l’écriture.
Écrivain de métier et par vocation.
Mais d’où vient cette passion pour l’écriture ?
D’aussi loin que je me souvienne, je n’ai jamais appris à écrire… ni à lire… pas à l’école tout du moins.
Ce dont je me rappelle, c’est que le premier jour de mon entrée officielle à l’école (en classe préparatoire, abrégée en C. P.), on m’isola dans une salle, on me remit papier et stylo. Quelqu’un, un enseignant, je suppose, me lut un texte que je devais transcrire sur le papier (une dictée), puis on me fit lire un passage écrit et l’on me présenta un feuillet sur lequel je devais effectuer des opérations.
Conclusion des maîtres et maîtresses au vu des résultats, je savais lire, écrire, compter, sans jamais avoir été à l’école. On me fit donc sauter deux classes.
Comment ai-je appris à lire et à écrire ? Je l’ignore totalement. Peut-être que ma grand-mère qui me gardait durant mes premières années me les enseigna. Je n’en ai aucun souvenir.
Note sur la scolarité dès trois ans, en France.
Cette obligation récente de la scolarité dès l’âge de trois ans me paraît une absurdité sans nom. Bénéficier de l’attention de sa grand-mère (ou de son grand-père), c’est une chance merveilleuse pour un enfant. L’en priver en l’envoyant, à trois ans, de force à l’école (sur ordre de la loi) c’est l’empêcher d’acquérir la formation de base de la vie. (Peut-être est-ce voulu d’ailleurs.) Car rien ne remplace cela. D’autant que le grand-parent est à l’écoute constante de son petit-fils ou de sa petite-fille et désireux de lui apporter toutes les connaissances dont il est détenteur.
Une maîtresse de maternelle, si attentionnée soit-elle, sera toujours partagée entre quinze ou vingt petits êtres. De plus, elle n’enseignera que ce qui est inscrit au programme (lequel programme dépend largement pour ne pas dire totalement des idéologies et des modes de pensées en vigueur dans les hautes sphères).
Ainsi donc, alors qu’une maîtresse sera forcément obligée de s’occuper de quinze ou vingt enfants, une grand-mère accordera toute son attention à cet unique enfant qu’elle garde, répondra rapidement à ses questions et à ses inquiétudes (lorsqu’il en manifeste) et, ce qui est primordial, lui apprendra ce qu’elle sait de la vie (attribut fondamental des familles). Cette transmission de savoirs est indispensable pour la formation des jeunes êtres, elle ne dépend pas d’un horaire (ou d’un plan gouvernemental), elle s’effectue avec le coeur et à l’impromptu des interrogations de l’enfant à un moment ou un autre de la journée.
J’ai adoré ces jours passés auprès de ma grand-mère où je pouvais jouer à mon aise, en rampant sur le sol, en soufflant sur les petites araignées, ces moments où je la regardais travailler en babillant, et d’autres fois où je me vois traçant de longs chiffres à huit ou dix zéros que je m’émerveillais d’additionner.
Pour moi, il serait dommage qu’un autre enfant ne puisse pas être favorisé par autant d’attention que j’ai bénéficié auprès de ma grand-mère, et qu’il se trouve contraint, dès l’âge de trois ans, de se clôturer dans des classes au schéma comportemental préétabli par le gouvernement, ou bien sous le faisceau du regard accusateur d’un psychiatre, trop prompt à administrer des médicaments aux plus vivants d’entre les élèves (qualifiés dramatiquement d’être d’hyperactifs, alors qu’ils sont simplement débordants de vitalité) et les étiqueter comme présentant des « troubles » pour justifier leur décision.
Tandis qu’une grand-mère (ayant déjà élevé ses propres enfants) sera plus susceptible de comprendre son petit-fils ou sa petite-fille sans chercher à lui imputer un titre de maladie mentale.
On néglige l’importance incroyable des grands-parents dans la construction d’un enfant.
Cette mise au point faite (au sujet de l’école obligatoire à 3 ans) c’est très certainement grâce à ma grand-mère que j’écrivais et que je lisais couramment alors que les autres petits garçons de mon âge peinaient à tracer leur prénom sur une feuille durant leurs classes de maternelle.
Très vite, je m’intéressai à la lecture. Tout petit, c’étaient des romans pour enfants (tels que ceux de la série des « Oui-oui ») qui me passionnaient. Des bandes dessinées ? Durant mes premières années, elles étaient absentes de mon univers, de même qu’en primaire. J’en remercie les adultes autour de moi. Sans leur prévenance, je me serais laissé glisser vers l’attrait du moindre effort et n’aurais jamais développé cette facilité de lecture qui fut mienne.
Fort de cette expérience, je recommande aux parents d’éloigner les bandes dessinées de leur enfant jusqu’à l’âge de neuf ou dix ans. Et d’inviter les enseignants à les bannir des classes les plus jeunes, pour ne les réserver – au maximum – qu’aux CM2. C’est-à-dire à un âge où ils auront acquis une telle aisance dans la lecture que celle-ci ne leur demandera aucun effort, et sera pour eux aussi instinctive et naturelle que le fait de respirer.
La faculté de lire est semblable à celle des muscles de la main qui tient un stylo. Lorsque quelqu’un s’y est exercé longuement, la sensation d’effort disparaît. Car le muscle s’est adapté et on en maîtrise si bien la fonction qu’il n’est plus nécessaire d’y penser. Le rédacteur se concentre sur le message qu’il souhaite communiquer, ses doigts agissent automatiquement.
Un enfant qui presse la touche d’un clavier (réel ou virtuel) d’ordinateur, de tablette ou de smartphone, et qui n’a appris que cela, ne sait pas écrire. Pourquoi ? Parce qu'il ne sait pas reproduire physiquement les lettres, il sait juste appuyer sur quelque chose (ce qui ne demande aucune formation). Voyez-vous, quand il presse l’image d’un caractère (un « a », un « h », etc.), on lui fournit cette image. Sans cette image, il est livré à lui-même s’il n’a jamais appris à la tracer. Donc, apprendre prétendument à écrire par le biais d’un ordinateur ou d'une tablette est un non-sens. Le seul résultat, c’est qu’il ne sait pas écrire. Parce qu’il ne sait même, de mémoire, reproduire un simple caractère. Il a besoin de l’image de la machine pour appuyer dessus, ce qui ne requiert aucune connaissance.
Mais quand il s’est exercé à « reproduire de mémoire » les lettres, puis à les assembler à sa guise pour construire des mots et ensuite des phrases, alors ce n’est pas une difficulté, cela devient instinctif. Apprendre à écrire exige des mois d’effort. Une fois adulte, on ne se souvient plus de cet entraînement, car c’est un acquis si basique qu’il en devient automatique et qu'on n'y prête plus attention.
C’est exactement le même phénomène pour la lecture.
S’il s’est contenté durant ses premières années à regarder les dessins et les phrases ultra-courtes des bulles de BD, c’est la capacité de lecture de paragraphes entiers (ne parlons même pas de pages) qui lui fera défaut et qui lui sera vite pénible. Et pour cause, il n’aura jamais passé l’étape de s’exercer si longuement que cela devient naturel (comme pour n’importe quelle activité d’ailleurs). Tandis que s’il lit vraiment (des histoires de son âge, bien sûr), cette faculté s'inscrit en ses gènes de façon automatique.
B. D. et vidéos.
Les bandes dessinées sont absolument fascinantes. Les couleurs, les dessins, la mise en scène relèvent d’un véritablement d’un art spécifique. Je les apprécie énormément à titre personnel. Il n’en demeure pas moins que les remettre trop tôt entre les mains d’un enfant n’est pas une bonne idée. Il est nécessaire qu’il soit d’abord à l’aise avec la lecture, que cela lui soit si familier que le fait de lire plusieurs paragraphes d’affilée ne lui requiert aucun effort. Une fois cette maîtrise assimilée, on peut alors le laisser découvrir peu à peu les B.D.
Lui en donner avant cette étape fondamentale lui ôtera l’envie d’entreprendre l’effort mental que constitue pour un jeune enfant l’apprentissage de la lecture. La loi du moindre effort fait qu’il se contentera d’absorber passivement les images.
La situation est identique pour les écrans actuels et la visualisation en chaîne de vidéos. Un enfant habitué à ingérer passivement des vidéos qui « racontent » quelque chose abdiquera toute envie de créer l’effort suffisant pour décrypter une ligne ou un paragraphe de texte. Il ne s’agit pas d’une question de « modernité » ou d’autres termes ronflants, mais de donner à l’enfant les bases nécessaires à son entrée dans la vie. On ne le laisse pas se débrouiller seul dans un monde dont il ne sait rien. Les adultes ont la responsabilité de lui apprendre les éléments fondamentaux de la société et de la civilisation, et de l’amener à se former pour être capable par la suite de prendre sa vie en main. Même si cette formation est difficile au début.
Exactement comme on lui demande à partir de l'âge de neuf ou dix mois, qu’il fasse l’effort de se tenir debout sur ses jambes pour se déplacer à la verticale et non en rampant. Ne vous y trompez pas, il s’agit vraiment d’une formation. Elle est dure. Des mois durant, on l’incite à pousser ses jambes en avant, inlassablement, jusqu’à ce qu’il puisse le faire seul. Et même là, il va encore tomber, jusqu’à ce qu’au bout de deux ou trois ans, ce mouvement sur deux jambes soit si naturel qu’il ne trébuche plus et qu’il soit capable de descendre les escaliers sans y penser. Alors, à ce moment-là, il saura marcher. En revanche, si, pour des raisons de « modernité », on le loge dans un exosquelette qui se meut par des manettes ou par des ondes cervicales, alors certes, il pourra faire déplacer son corps (grâce à une machine électronique), mais il ne saura jamais marcher. Autrement dit, c’est un handicapé physique.
Aucun parent ne voudrait que son enfant soit incapable de se mouvoir par lui-même. Au contraire, ils le font s’exercer à marcher. Et si plus tard, il décide de se munir d’un exosquelette, ce sera son affaire personnelle, qui n’oblitérera pas sa compétence. Il saura toujours marcher. Car cet acquis ne s’effacera pas.
La situation est identique pour les écrans et l’avalanche de vidéos auxquels sont confrontés les enfants d’aujourd’hui. On laisse s’atrophier leur faculté de lecture en les abandonnant devant un appareil. Car une vidéo sera toujours plus attractive qu’une page de texte. Il n’y a là aucun effort à fournir.