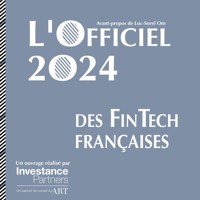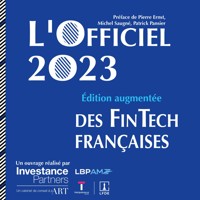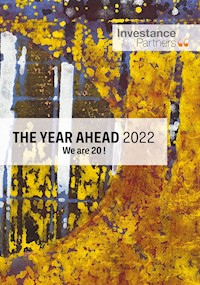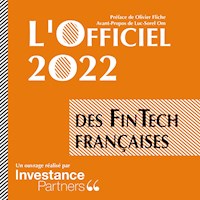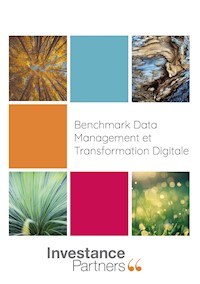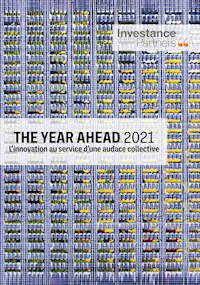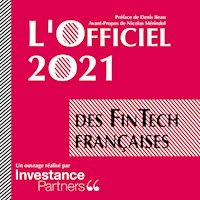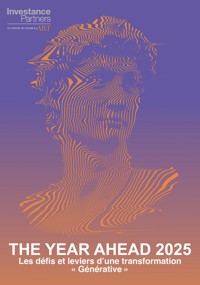
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Publishroom
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Französisch
« L’IA bouleverse la donne. Mais faut-il craindre de rester à la traîne ou redouter d’aller trop vite ? Dans cette édition 2025 de Year Ahead, Investance Partners explore comment l’intelligence artificielle transforme les métiers de la banque et de la finance, et bien au-delà. Synergies prometteuses, pièges à éviter, mais aussi solutions face aux défis climatiques, humains et géopolitiques : ce numéro décrypte les opportunités et les risques d’une révolution technologique incontournable. Une lecture essentielle pour éclairer les décisions stratégiques de demain, entre audace et vigilance ».
Sans doute l’avez-vous détecté : ce sympathique résumé est l’œuvre d’un célèbre agent conversationnel. Mais nous sommes bien gardés de tout lui dire. L’IA comme invitée d’honneur de notre revue prospective, voilà qui relevait de l’évidence ; mais pouvions-nous raisonnablement nous concentrer sur elle seule ?
Ce nouveau Year Ahead vous livre ses analyses sur les sujets à anticiper en matière de finance, de RSE, ou encore de ressources humaines, mais également d’écologie et de souveraineté des données. Nous avons mobilisé nos experts, et fait appel à des invités de marque. Au cœur de ces regards croisés, rappelant l’économie à son statut de science humaine des plus passionnantes et complexes, se cristallise une conviction essentielle : si le tournant technologique s’accélère indéniablement, c’est bien nous, professionnels, humains, collectifs, qui tenons les rênes. Soyons prêts !
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 277
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Couverture
Mentions légales
Créé en 2001, Investance Partners est un cabinet de conseil en management, spécialisé dans la transformation et la Performance des organisations, la Gestion du Risque, la mise en Conformité Réglementaire, le Data Management et la RSE.
Les équipes d’Investance Partners sont supportées par une organisation interne Innovante et Agile et par deux pôles de recherche : « Investance Le LAB » et le « LAB ESG ». Elles disposent d’expertises approfondies du secteur financier, adaptent régulièrement et par anticipation les propositions de valeur, en y intégrant les apports de l’innovation comme accélérateur de mise en œuvre, et services du cabinet.
10% du chiffre d’affaires est réinvesti chaque année en Recherche et Développement pour permettre la création d’offres de services augmentées et innovantes.
Contacter Investance Partners :
Investance Partners, 31 rue Saint Augustin, 75002 Paris
www.investance-partners.com
Les droits d’exploitation perçus sur les ventes de « Year Ahead 2025 » seront reversés en intégralité à la Fondation La Vie au Grand Air/Priorité Enfance. Acteur national de la protection de l’enfance depuis 1927, la Fondation vient en aide à des enfants et des parents confrontés à des difficultés familiales. Dans le respect de l’autorité parentale et en lien avec les services publics, elle les aide à restaurer ce que la vie a pu abîmer. Sa mission est de leur donner des outils et des repères pour surmonter leurs difficultés.
Equipe de rédaction :
Responsable éditorial : Luc-Sorel OM
Comité de rédaction : Luc Sorel OM, Stéphane BENKEMOUN et Aurore MEILENDER
Publishroom Factory
www.publishroom.com
ISBN : 978-2-38625-745-2
Le Code de la propriété intellectuelle interdit les copies ou reproductions destinées à une utilisation collective. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite par quelque procédé que ce soit, sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit, est illicite et constitue une contrefaçon, aux termes des articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
Préface par Jérôme GRIVET, Directeur général délégué de Crédit Agricole S.A.
Jérôme GRIVET
Directeur général délégué de Crédit Agricole S.A., en charge du pôle Pilotage et des fonctions de contrôle depuis septembre 2022. Il est membre du Comité exécutif de Crédit Agricole S.A. Jérôme Grivet débute sa carrière dans l’Administration. Il est notamment Conseiller pour les Affaires Européennes du Premier Ministre, M. Alain Juppé, avant de rejoindre le Crédit Lyonnais en 1998, en tant que Responsable de la Direction Financière et du Contrôle de Gestion de la banque commerciale en France. En 2001, il est nommé Directeur de la Stratégie du Crédit Lyonnais. Il occupe ensuite les mêmes fonctions au sein de Crédit Agricole S.A. En charge des Finances, du Secrétariat Général et de la Stratégie de Calyon en 2004, il en devient Directeur général délégué en 2007. Fin 2010, Jérôme Grivet devient Directeur général de Crédit Agricole Assurances et Directeur général de Predica. En mai 2015, Jérôme Grivet devient Directeur général adjoint de Crédit Agricole S.A., en charge du pôle Finances Groupe. En septembre 2021, il prend la responsabilité du pôle Pilotage. Inspecteur des Finances, ancien élève de l’ENA, Jérôme Grivet est diplômé de l’ESSEC et de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris.
L’irruption de l’IA générative et la rapidité sans égale de son adoption créent une effervescence dont on ne saurait s’abstraire. Elle nous oblige à nous interroger sur nos modes de fonctionnement et notre capacité d’évolution. Sur le temps long, notre histoire est celle d’un Groupe plus que centenaire, né du rassemblement d’une poignée d’agriculteurs dans le Jura à la fin du XIXe siècle et devenu en 2025 la 10e banque mondiale. Plus de 120 ans, donc, de transformation, d’adaptation, dans une dynamique permanente d’amplification de notre modèle. Certes, les exigences du présent marquent une accélération inédite qui nous interdit de considérer que les succès passés sont la garantie des réussites futures, sur la base de recettes inchangées. Mais j’y vois le témoignage éclatant de notre capacité collective à nous ré-inventer et ce, parce que nous savons faire évoluer nos recettes, dans une remarquable fidélité à nos racines.
Un ADN de croissance
L’histoire du Crédit Agricole est en effet une histoire de croissance, et de croissance rentable. Depuis son berceau historique du financement de l’agriculture, le Crédit Agricole a, étape par étape, de proche en proche, étendu son champ de compétence pour lever progressivement les restrictions qui s’imposait à lui. Dans un second temps, il a créé ex nihilo des métiers nouveaux, dont l’assurance, et développé la gestion d’actifs, le crédit-bail et l’affacturage. Ce faisant, il a étendu sa palette de produits et services utiles à ses clients, lui permettant de conquérir des parts de marché et des positions de premier plan.
Le Groupe a ensuite démontré sa capacité à prendre des virages, parfois inattendus pour un groupe mutualiste : l’acquisition de la Banque Indosuez en 1996, la cotation de son organe central, devenant Crédit Agricole S.A., en 2001, avant le lancement d’une offre publique sur le Crédit Lyonnais fin 2002, et la constitution par acquisitions successives de la 6e banque de proximité en Italie. En parallèle, il a réfuté la vision communément admise dans les années 2000 à 2010 que le digital condamnait irrémédiablement l’agence bancaire. La vie du Groupe s’est ainsi tissée dans l’accompagnement des évolutions sociétales de la période, jusqu’aux moments de ruptures qu’ont été l’arrivée d’Internet, de la banque en ligne et de la digitalisation d’une manière générale.
Des défis toujours nouveaux
Les crises - économiques, politiques, maintenant climatiques -, ont jalonné la période. Nos changements de taille, de métiers, de rayonnement géographique, ont exigé des transformations en profondeur de nos organisations : fusions donnant naissance aux 39 Caisses régionales d’aujourd’hui, rassemblement de moyens dans les domaines de la technologie et de la donnée, investissements lourds, chantiers d’efficacité, etc. Au cours des 10 dernières années, l’entrée en fonction de la BCE comme régulateur et superviseur bancaire en Europe est venue cristalliser de nouveaux défis. Son approche à la fois intrusive et holistique questionne et contraint nos organisations, avec une seule réponse possible en la matière : faire d’une contrainte une opportunité.
Du point de vue de la technologie, les banques en général ont eu cette capacité historique d’adopter, en l’adaptant, l’évolution qui s’est faite en dehors de leur périmètre. Les innovations de rupture ne sont pas forcément imaginées au des des banques, mais ces dernières savent les intégrer. A cet égard, notre culture du partenariat est un atout solide : nous l’avons fait avec LinkedIn, en lançant une plateforme unique pour promouvoir l’apprentissage constant de nos collaborateurs et nous avons aussi mis en place des partenariats technologiques. Ainsi, nous pouvons envisager la réponse aux attentes évolutives et parfois contradictoires de nos clients : personnalisation, transparence, respect de la vie privée…
Un de nos enjeux aujourd’hui est de libérer nos capacités créatives tout en inscrivant notre dynamique d’innovation dans un environnement sécurisé et conforme à nos exigences propres envers notre clientèle et au cadre réglementaire qui s’applique au secteur bancaire. Nous avons aussi à continuer de défendre notre modèle, celui de la banque universelle, qui a fait ses preuves en termes de répartition des risques, de capacité de résistance aux crises et surtout d’utilité sociétale. Confiant dans cet instinct vital qui nous pousse à la croissance, j’ai la conviction que nous saurons garder le cap ! ■
A nos lecteurs : Comment les organisations peuvent-elles mobiliser leurs acquis et surmonter les contraintes pour faire de la transformation générative un levier d’innovation et de performance durable ?
Luc-Sorel OM
Directeur général d’Investance Partners, un cabinet de conseil spécialisé dans les services financiers. Diplômé d’un titre d’Ingénieur Maître et d’un DEA en Stratégie et Économie de l’Université Paris 2 Assas, il a débuté sa carrière à la Banque CPR en 1998, avant de rejoindre la Caisse des Dépôts et Consignations en 2000. En 2002, il cofonde Investance Partners, où il est responsable du développement des offres de conseil et de l’innovation. Luc-Sorel Om est également impliqué dans des initiatives environnementales, notamment en tant qu’actionnaire de Team for the Planet, une entreprise à mission dédiée à la lutte contre le changement climatique.
Par le passé, beaucoup croyaient en la génération spontanée, c’est-à-dire en l’idée que la vie pouvait apparaître d’elle-même à partir de la matière inerte, sans cause extérieure. Jusqu’au XIXᵉ siècle, on pensait, par exemple, que les grenouilles se formaient spontanément dans la boue après la pluie. Il a fallu attendre les travaux de Pasteur, vers 1860, pour démontrer que toute forme de vie provient nécessairement d’une autre.
Aujourd’hui, alors que l’intelligence artificielle générative et la transformation numérique sont au cœur des stratégies d’innovation, une réflexion s’impose : les véritables transformations ne surgissent pas de nulle part. Elles reposent sur un socle de savoirs, d’expériences et d’écosystèmes préexistants.
De la plateformisation des industries à la mutation des modèles de travail, en passant par l’IA frugale et responsable, la transformation générative repose moins sur des ruptures brutales que sur la capacité à tirer parti de l’existant pour créer de nouvelles formes de valeur. Il serait illusoire d’attendre de l’IA des solutions miracles : les évolutions les plus durables sont celles qui s’inscrivent dans une continuité maîtrisée.
Néanmoins, le terme « génératif » s’est désormais largement imposé dans le débat public, porté notamment par les avancées en intelligence artificielle. Mais cette notion dépasse largement le seul cadre technologique : elle traduit une nouvelle approche de l’innovation, où l’on capitalise sur les acquis tout en ouvrant la voie à de nouvelles opportunités de différenciation et de croissance.
Toute transformation soulève cependant son lot de défis : technologiques, économiques, éthiques et environnementaux. L’essor de l’IA frugale et responsable témoigne d’une prise de conscience des limites du modèle hyper-centralisé et énergivore. De nouvelles approches émergent, s’appuyant sur des infrastructures plus légères, accessibles et durables. Par ailleurs, la compétition sino-américaine autour des modèles d’IA met en lumière l’enjeu stratégique de ces technologies, non seulement en matière d’innovation, mais aussi pour la souveraineté et la gouvernance des données.
Face à cette complexité croissante, une question essentielle se pose : comment piloter une transformation générative alignée avec une vision durable et responsable ? Loin d’être une simple course à la technologie, cette transformation exige une approche globale, où l’innovation s’articule avec les réalités humaines, sociétales et environnementales.
C’est cette réflexion que nous avons souhaité nourrir avec ce recueil de points de vue, à travers des contributions offrant un regard croisé sur les tendances et ruptures de demain. Nos clients, partenaires et startups y partagent leurs visions, leurs retours d’expérience et leurs pistes d’innovation, contribuant ainsi à une intelligence collective essentielle à la réussite de cette transformation.
Se réinventer est désormais une nécessité. En conjuguant héritage, innovation et responsabilité, nous avons l’opportunité de bâtir un avenir où la transformation générative devient un moteur de croissance, d’impact positif et de différenciation stratégique.
Bienvenue dans notre Year Ahead 2025. Nous espérons que sa lecture vous offrira un voyage prospectif au cœur des défis et opportunités de demain. ■
SOMMAIRE
1.Le nouvel élan tech dans la finance : L’IA générative ! Patrick PANSIER
2.Le bouleversement du monde des paiements lié à la digitalisation : du back-office au stratégique Hervé SITRUK
3.Avis d’expert : les défis et leviers d’une Transformation « Générative » Marc DE BEAUCORPS
4.Prénom : Intelligence, Nom : ARTIFICIELLE : un bon trimestre mais vous devriez pouvoir mieux faire en ce début 2025. Persévérez ! Jean-Christophe JANIN
5.Comment l’intelligence artificielle fait tomber des barrières dans la recherche, en l’occurrence dans les neurosciences ? Alexandra PRIEUX
6.Digitalisation bancaire : Europe vs États-Unis, quelles stratégies gagnantes ? Luc-Sorel OM
7.Maximiser la sécurité des SSI : stratégies pour limiter les risques opérationnels des paiements dans les banques Clément DEROSEREUIL
8.L’Intelligence Artificielle : un levier dans la détection de la fraude aux paiements Fabienne ASSI & Emmanuelle WEISBERG
9.Les enjeux de la facturation électronique associés au Request to Pay Henri VALADE & Emmanuelle WEISBERG
10.Conformité des adresses structurées Jean-Claude MUNHOZ
11.Entre futur prometteur et réalités du présent dans la Fintech Luc-Sorel OM
12.La Consolidation et la Plateformisation dans la Gestion d’Actifs - Vers une Nouvelle Ère d’Économies d’Échelle et d’Efficience Sophie BAUMEYER
13.La révolution des Modèles de Langage : une compétition Sino-Américaine Luc-Sorel OM
14.Biodiversité, j’écris ton nom Philippe GRANDCOLAS
15.La révolution générative dans la vidéo : vers un numérique performant et durable Erwan HUHARDEAUX
16.Transformation générative : comment la placer au cœur des stratégies ESG ? Erwan LE MENE
17.Les normes ESG et les défis de transformation du modèle de gestion des risques Abdelaziz ENASRI & Franck SEBBAN
18.La RSE comme levier d’innovation pour des paiements responsables Julie PAUMERIE & Emmanuelle WEISBERG
19.La protection des données personnelles face à l’essor de l’IA : transparence et éthique au cœur des défis Lina ZEID
20.Quelle place pour les scientifiques dans la genèse des normes européennes de la finance durable ? Julie PAUMERIE
21.L’IA porteuse d’innovation dans les métiers RH Néomie MVUAZI LEMFU & Tania DUFANAL LAINE
22.La CSRD comme levier stratégique pour une transition générative Baptiste COUTEAU-PICHON
23.Savons-nous mesurer l’impact global de l’IA ? François BOIRAL
24.Le capital naturel : peut-on attribuer une valeur au vivant ? Julie PAUMERIE
25.L’IA au service de la gestion des risques climatiques : une réponse urgente et nécessaire Luc-Sorel OM
26.Transformer l’investissement responsable : l’apport de l’Intelligence Artificielle générative Mendy SALBOT
27.L’intelligence artificielle frugale et responsable : un nouveau paradigme Luc-Sorel OM
28.How AI Model Risk Management can help protect personal data in AI Jos GHEERARDYN
29.L’IA entre régulation et compétitivité : un défi stratégique pour l’Europe Luc-Sorel OM
30.L’Intelligence Artificielle dans le monde : Course à la régulation ou bataille d’influence ? Stéphanie GUEU-VIGUIER
31.Vers une régulation harmonisée des cryptoactifs dans l’Union européenne : MiCA et Regulation EU Luc-Sorel OM
32.Vers une gouvernance intégrée : L’indispensable convergence de l’IA et de la conformité Luc-Sorel OM
33.Réglementation cybersécurité, un voyage vers l’excellence Nicolas MATTIOCCO
34.Résilience opérationnelle Pierre-Yves MAUROIS
35.Pourquoi le secteur bancaire européen doit envisager une transition vers des solutions souveraines Luc-Sorel OM
36.RegTech : La technologie au service de la Conformité Thomas NIAUX
37.Télétravail et présentiel : bâtir un modèle hybride épanouissant et performant Luc-Sorel OM
38.IA et banques : passer des pilotes isolés à une industrialisation à grande échelle Raphaël ZERBIB & Stéphane BENKEMOUN
39.L’intelligence artificielle au service du management 5.0 Cathye MOUKOKO
I. Innover pour transformer l’expérience client et l’efficacité opérationnelle
1.Le nouvel élan tech dans la finance : L’IA générative ! Patrick PANSIER
2.Le bouleversement du monde des paiements lié à la digitalisation : du back-office au stratégique Hervé SITRUK
3.Avis d’expert : les défis et leviers d’une Transformation « Générative » Marc DE BEAUCORPS
4.Prénom : Intelligence, Nom : ARTIFICIELLE : un bon trimestre mais vous devriez pouvoir mieux faire en ce début 2025. Persévérez ! Jean-Christophe JANIN
5.Comment l’intelligence artificielle fait tomber des barrières dans la recherche, en l’occurrence dans les neurosciences ? Alexandra PRIEUX
6.Digitalisation bancaire : Europe vs États-Unis, quelles stratégies gagnantes ? Luc-Sorel OM
7.Maximiser la sécurité des SSI : stratégies pour limiter les risques opérationnels des paiements dans les banques Clément DEROSEREUIL
8.L’Intelligence Artificielle : un levier dans la détection de la fraude aux paiements Fabienne ASSI & Emmanuelle WEISBERG
9.Les enjeux de la facturation électronique associés au Request to Pay Henri VALADE & Emmanuelle WEISBERG
10.Conformité des adresses structurées Jean-Claude MUNHOZ
11.Entre futur prometteur et réalités du présent dans la Fintech Luc-Sorel OM
12.La Consolidation et la Plateformisation dans la Gestion d’Actifs - Vers une Nouvelle Ère d’Économies d’Échelle et d’Efficience Sophie BAUMEYER
13.La révolution des Modèles de Langage : une compétition Sino-Américaine Luc-Sorel OM
Le nouvel élan tech dans la finance : L’IA générative !
Patrick PANSIER
Il occupe actuellement le poste de Directeur Digital, Data et Innovation de LBP AM depuis 2021. Il est responsable de l’IT et du développement de la transformation digitale au sein de l’entreprise. En 2022, il a créé le Digital Lab, un espace dédié au prototypage de technologies pour répondre aux besoins métiers.
Avant de rejoindre LBP AM, Patrick Pansier a contribué à la modernisation des systèmes de gestion de portefeuilles des asset-managers du groupe Exane, Exane AM et Ellipsis AM. Depuis 2017, il anime des tables rondes à l’AM Tech day et au salon BigData. Il a également été jury de Fintech For Tomorrow en 2021 et 2022.
Dans le secteur de l’asset management, la technologie émerge comme un levier stratégique pour affiner les prises de décision et optimiser la gestion des actifs. Les directions des systèmes d’information (DSI), en constante quête d’innovation, se tournent vers les modèles de Large Language Models (LLM) pour révolutionner leurs processus. Ces technologies promettent non seulement une efficacité accrue mais aussi une création de valeur inédite, en permettant une analyse prédictive et une personnalisation sans précédent des services aux clients. Toutefois, l’intégration de ces outils avancés soulève des défis spécifiques : de la nécessité d’une infrastructure de calcul haute performance à la sécurisation des données sensibles, en passant par la formation des équipes à l’élaboration de prompts précis. Nous allons donc mettre en avant la manière dont les DSI dans l’asset management peuvent naviguer dans ce paysage complexe, en exploitant la puissance des LLM pour transformer l’information en insights stratégiques et les insights en avantages compétitifs durables.
Le Défi de la Capacité de Calcul pour les LLM
Dans le monde numérique d’aujourd’hui, les modèles de Large Language Models (LLM) représentent une avancée significative dans le domaine de l’intelligence artificielle. Cependant, leur intégration dans les systèmes d’information d’entreprise pose un défi majeur : la capacité de calcul. Les LLM nécessitent une puissance de traitement considérable pour analyser et générer du texte, ce qui peut mettre à rude épreuve les ressources informatiques existantes. Pour les directions des systèmes d’information, la question n’est pas seulement de savoir si elles ont suffisamment de capacité de calcul, mais aussi comment optimiser l’acquisition de cette puissance.
La première étape consiste à évaluer les besoins spécifiques en termes de charge de travail et de performance. Cela implique de comprendre la complexité des tâches que le LLM doit accomplir et le volume de données à traiter. Une fois ces besoins définis, les entreprises se trouvent face à un choix : construire ou louer. Construire signifie investir dans des infrastructures matérielles, telles que des serveurs GPU haut de gamme, capables de gérer les exigences des LLM. C’est une option coûteuse qui nécessite un engagement à long terme, mais elle offre un contrôle total sur les ressources et la sécurité.
L’alternative est de louer de la capacité de calcul via des services cloud. Des fournisseurs comme AWS, Google Cloud, OVH Cloud ou Microsoft Azure proposent des solutions évolutives qui permettent aux entreprises de payer uniquement pour la puissance de calcul utilisée. Cette flexibilité est attrayante, surtout pour les projets avec des besoins de calcul fluctuants. De plus, les services cloud sont souvent à la pointe de la technologie, offrant des fonctionnalités avancées et une maintenance gérée qui peuvent s’avérer bénéfiques pour les entreprises sans expertise technique approfondie. De plus cela permet d’éviter la gestion complexe de l’obsolescence des machines.
Cependant, la dépendance à l’égard des fournisseurs de cloud soulève des questions de sécurité et de confidentialité des données. Les entreprises doivent s’assurer que leurs partenaires cloud respectent les normes de sécurité les plus strictes et offrent des garanties solides en matière de protection des données. De plus, la gestion des coûts peut devenir complexe, car les modèles de tarification à la demande peuvent entraîner des dépenses imprévues si elles ne sont pas soigneusement surveillées.
En fin de compte, la décision entre construire et louer dépendra des objectifs stratégiques, des ressources financières et de la culture de l’entreprise. Une analyse approfondie des avantages et des inconvénients est essentielle pour prendre une décision éclairée qui alignera les capacités de calcul avec les ambitions de l’entreprise en matière d’intégration des LLM.
Création de Prompts Efficaces pour les LLM
La création de prompts efficaces est essentielle pour guider les modèles de LLM vers des réponses précises et fiables. Un prompt bien conçu doit être clair, spécifique et structuré de manière à minimiser les ambiguïtés qui pourraient conduire le modèle à générer des réponses erronées ou non pertinentes.
Les prompts doivent être formulés avec une clarté absolue. Par exemple, au lieu de demander “Quelles sont les conséquences ?”, il est préférable de spécifier “Quelles sont les conséquences économiques de l’inflation sur le marché immobilier ?”. Cette précision aide le LLM à comprendre le contexte et à se concentrer sur la fourniture d’informations pertinentes.
Il convient d’inclure des détails contextuels dans le prompt peut également réduire les erreurs. Si le but est d’obtenir des informations sur une technologie spécifique, le prompt pourrait inclure une brève description de cette technologie ou son domaine d’application. Par exemple, “Dans le contexte des réseaux mobiles, comment la 5G améliore-t-elle la connectivité ?” fournit un cadre clair pour la réponse.
Il est également utile d’inclure des instructions explicites sur le type de réponse attendue. Si l’on cherche une explication détaillée, le prompt pourrait commencer par “Expliquez en détail comment…”. Pour une liste, on pourrait utiliser “Listez les étapes de…”. Ces instructions aident à façonner le format et la profondeur de la réponse.
Les prompts ne doivent pas reposer sur des suppositions non vérifiées ou des informations implicites. Ils doivent être basés sur des faits ou poser des questions ouvertes qui permettent au LLM de fournir des réponses fondées sur des données vérifiables.
Enfin, il est important de tester les prompts et d’ajuster leur formulation en fonction des réponses obtenues. Un processus itératif de feedback permet d’affiner les prompts pour qu’ils deviennent de plus en plus efficaces.
En suivant ces principes, les entreprises peuvent réduire significativement les risques d’erreurs dans les réponses des LLM, améliorant ainsi la fiabilité et la valeur des informations générées.
Engagement des Collaborateurs pour l’Innovation avec les LLM
L’adoption réussie des modèles de LLM dans une entreprise dépend fortement de l’engagement des collaborateurs à tous les niveaux. Pour découvrir les cas d’utilisation les plus pertinents, il est crucial de créer un environnement où les idées peuvent être librement partagées et explorées.
Il est important de cultiver une culture d’innovation qui encourage les employés à penser de manière créative sur la façon dont les LLM peuvent être appliqués à leurs tâches quotidiennes. Cela peut être réalisé en organisant des ateliers de brainstorming et en offrant des récompenses pour les idées qui mènent à des améliorations significatives.
La formation est essentielle pour aider les employés à comprendre le potentiel des LLM. Des sessions éducatives sur les capacités des LLM et des exemples de cas d’utilisation réussis peuvent inspirer les collaborateurs à réfléchir à de nouvelles applications dans leur propre travail.
Des plateformes de collaboration en ligne peuvent être mises en place pour permettre aux employés de différentes divisions de partager des idées et de travailler ensemble sur des projets impliquant des LLM. Cela favorise une approche interdisciplinaire qui peut révéler des opportunités inattendues.
Des projets pilotes peuvent être lancés pour tester les idées les plus prometteuses. Cela permet non seulement de valider l’utilité des LLM dans des scénarios réels, mais aussi de montrer aux employés l’impact direct de leur contribution.
Un système de feedback continu où les employés peuvent rapporter leurs expériences et les résultats obtenus avec les LLM est essentiel. Cela aide à ajuster les stratégies et à améliorer constamment les processus d’intégration des LLM.
En engageant activement les collaborateurs dans le processus d’innovation, les entreprises peuvent non seulement identifier les meilleurs cas d’utilisation des LLM, mais aussi assurer une adoption plus large et plus efficace de ces technologies.
Une entreprise de technologie a mis en place un programme de formation interne pour familiariser ses employés avec les LLM. En organisant des ateliers et des séminaires, elle a permis à ses collaborateurs de mieux comprendre comment intégrer les LLM dans leurs tâches quotidiennes, ce qui a conduit à une augmentation de l’efficacité opérationnelle et à la création de nouvelles solutions pour les clients.
Une société de services financiers a organisé des hackathons centrés sur l’utilisation des LLM pour résoudre des problèmes spécifiques du secteur. Ces événements ont non seulement engagé les employés dans des activités de Team-building, mais ont également généré des idées innovantes qui ont été intégrées dans les produits de l’entreprise.
Sécurité des Données dans l’utilisation des LLM
La sécurité des données est un aspect fondamental de l’utilisation des modèles de LLM. Avec l’augmentation des cyberattaques et des exigences réglementaires strictes, les entreprises doivent adopter des stratégies robustes pour protéger les informations sensibles.
Le chiffrement est la première ligne de défense pour sécuriser les données utilisées par les LLM. Les données en transit et au repos doivent être cryptées à l’aide de protocoles modernes tels que TLS (Transport Layer Security) et AES (Advanced Encryption Standard). Cela garantit que même en cas d’interception, les données restent inintelligibles pour les acteurs non autorisés.
La mise en place d’une gestion des accès basée sur les rôles est essentielle pour contrôler qui peut interagir avec les LLM et les données. L’authentification multifactorielle et les politiques de mot de passe strictes aident à prévenir les accès non autorisés.
Cette gestion des accès est primordiale également pour maitriser la portée du LLM sur les données de l’entreprise, sachant que le LLM aura accès à toutes les données accessibles par l’utilisateur. Et au fil des ans, la gestion des droits sur les documents, avec des héritages sur les systèmes de gestion documentaires, les exceptions accordées, et les changements de directions métiers et réorganisations de service, complexifie la gestion des données, et le LLM ira puiser de l’information là ou l’utilisateur n’aura pas conscience d’avoir un accès autorisé.
En mettant en œuvre ces mesures, les entreprises peuvent s’assurer que les données alimentant les LLM sont protégées contre les menaces externes et internes, tout en respectant les obligations légales et éthiques.
Risques de Fuite de Données et Démocratisation des LLM
La démocratisation des modèles de LLM augmente le risque de fuite de données pour les entreprises. À mesure que l’accès aux LLM devient plus répandu, le potentiel de divulgation accidentelle ou malveillante d’informations confidentielles s’accroît. Les employés peuvent, sans le savoir, fournir des données sensibles aux LLM, qui pourraient être exposées si les plateformes ne sont pas suffisamment sécurisées.
Pour prévenir ces fuites, les entreprises doivent mettre en œuvre des mesures proactives, telles que des politiques de gouvernance des données claires, qui définissent quelles informations peuvent être partagées avec les LLM. De plus, des systèmes de détection des pertes de données (DLP) doivent être en place pour surveiller et bloquer la transmission de données sensibles.
Il est également essentiel de former les utilisateurs sur les risques associés à l’utilisation des LLM. Ils doivent être conscients des types de données qui ne doivent jamais être entrés dans les systèmes LLM et des protocoles à suivre en cas de suspicion de fuite de données.
Lorsque les entreprises s’associent avec des fournisseurs de LLM, elles doivent s’assurer que ces partenaires appliquent des normes de sécurité rigoureuses et que les accords incluent des clauses de protection des données. Cela inclut la vérification des certifications de sécurité et des audits réguliers des pratiques de sécurité des fournisseurs.
Développer une Expertise en LLM en Interne ou l’Externaliser
Lorsqu’il s’agit d’intégrer les modèles de LLM dans leurs processus, les entreprises sont confrontées à un choix stratégique : développer une expertise en interne ou externaliser cette compétence. Chaque option présente des avantages et des inconvénients qu’il est important de peser soigneusement.
Le développement d’une expertise en LLM en interne offre un contrôle complet sur les projets et une personnalisation poussée des solutions. Cela permet une intégration plus étroite avec les systèmes existants et une adaptation rapide aux besoins spécifiques de l’entreprise. Cependant, cela nécessite un investissement initial important en termes de recrutement de talents spécialisés, de formation et de matériel informatique. De plus, cela implique une responsabilité continue pour la maintenance et l’évolution des compétences et des technologies.
L’externalisation à des plateformes spécialisées peut être une solution plus économique, surtout pour les entreprises qui n’ont pas les ressources pour développer une expertise interne. Les plateformes d’externalisation offrent l’accès à une gamme de LLM différents et gèrent toutes les étapes, de la préparation des données jusqu’à la génération des prompts. Elles bénéficient souvent d’une expertise collective et d’une mise à jour continue des modèles. Néanmoins, l’externalisation peut réduire le niveau de contrôle sur les solutions et soulever des questions de sécurité et de confidentialité des données.
Une approche hybride peut également être envisagée, où certaines capacités sont développées en interne tandis que d’autres sont externalisées. Cela permet de bénéficier de la flexibilité et de l’expertise des fournisseurs externes tout en conservant un certain degré de personnalisation et de contrôle.
En fin de compte, la décision dépendra des objectifs à long terme de l’entreprise, de sa culture, de ses ressources disponibles et de sa stratégie en matière de données et de technologie. Une analyse approfondie des besoins et des capacités actuelles aidera à déterminer la meilleure voie à suivre pour l’intégration des LLM. ■
Le bouleversement du monde des paiements lié à la digitalisation : du back-office au stratégique
Hervé SITRUK, Président fondateur de France Payments Forum
Expert spécialisé dans les systèmes de paiements en France et en Europe. Sur le plan européen, il a réalisé de nombreuses études sur les systèmes de paiement en Europe, et a fait adopter en 1995 le scénario de passage à l’euro. En France, il a été conseil auprès des Pouvoirs publics, chargé de plusieurs rapports publics, mené de nombreux travaux interbancaires, et notamment réorganisé la monétique française, et relancé le passage à la carte à puce. Il a enfin accompagné de nombreuses banques dans leurs stratégies en matière de paiement. Il préside désormais FRANCE PAYMENTS FORUM, une association qu’il a créé en 2012, spécialisée sur les paiements en France et en Europe.
Le monde des paiements vit depuis une quinzaine d’années un bouleversement technologique majeur dont les effets sont désormais perceptibles dans la vie de tous les jours. Ce bouleversement est dû à la digitalisation et aux multiples valeurs ajoutées mais aussi aux ruptures que celle-ci autorise.
Du côté des acteurs, trois grandes évolutions sont à noter :
1. Des acteurs non bancaires s’introduisent dans la relation entre le teneur de comptes et le client, offrant de nombreuses innovations, portées initialement par des Fintechs, mais aussi désormais par les Big Techs (via les XPay) et, les schemes cartes internationaux (ICS) et in fine, offertes par les banques elles-mêmes.
2. Des acteurs déjà présents sur une facette des paiements tendent à l’universalité, et à s’étendre dans toutes les formes du paiement : c’est le cas notamment des ICS qui s’étendent bien au-delà de la carte, jusqu’aux cryptopaiements et aux paiements internationaux ; mais c’est aussi le cas des banques centrales, qui se mettent en capacité d’offrir une forme numérique de la monnaie. Celle-ci pourrait être une Monnaie numérique (MNBC) de détail, qui serait émise en complément de la monnaie fiduciaire mais avec des fonctionnalités allant au-delà des paiements de face à face, jusqu’aux paiements à distance, et une MNBC de gros, notamment pour le règlement des transactions sur actifs numériques.
3. De nouveaux acteurs apparaissent autour de nouvelles formes de paiements, avec les monnaies électroniques au début des années 2000, et plus récemment, avec les cryptoactifs et les stablecoins, via les technologies DLT, … Et des acteurs plus traditionnels s’engagent dans ce mouvement, et créent de nouveaux supports numériques, via la tokenisation des actifs, y compris des dépôts bancaires.
Du côté de la sécurité, la tâche est devenue immense avec l’instantanéité, la mobilité, l’intelligence artificielle, et demain le quantique. La lutte contre la fraude impose d’analyser la chaîne de paiement de bout en bout, en y incluant tous les acteurs qui y participent, y compris les opérateurs de télécommunications, pour rechercher la responsabilité de chacun. Mais elle impose aussi de renforcer l’identification et l’authentification de tous les acteurs, notamment avec une identité numérique, de protéger les identifiants via leur tokenisation, et parallèlement d’assurer l’intégrité et la non-répudiation des transactions de paiement, ce pouvant aller jusqu’à leur chiffrement, et leur signature électronique. Ces évolutions occuperont à l’évidence la prochaine décennie.
Quant au modèle économique, il a explosé dans trois directions : (a) par les montants facturés, pour les transactions de paiement, en augmentation rapide, notamment via les Schèmes internationaux et les Big Techs ; (b) par la capture de la donnée de paiement, qui devient la nouvelle source majeure de revenus ; (c) par le développement de nombreux produits et services, adjacents aux paiements, et l’intégration industrielle verticale et horizontale.
Toutes ces évolutions vers le tout numérique ont des impacts stratégiques majeurs :
- D’abord sur la souveraineté dans le numérique et les paiements, le numérique offrant la possibilité de déplacer les centres de décision, de stockage et de traitement, et permettant aux grands acteurs technologiques d’entrer sur les paiements et de capter les données : ce sujet de la Souveraineté numérique sera sans conteste celui de l’année 2025.
- Ensuite sur la fragmentation du marché des paiements avec un double mouvement : d’une part la tentative de lever les barrières technologiques aux paiements au sein de l’Union européenne ainsi qu’à l’international, mais aussi en utilisant les paiements au plan politique à l’international, notamment à l’encontre de certains Etats, jugés peu recommandables. Ce deuxième mouvement conduit à une nouvelle fragmentation des paiements internationaux avec l’apparition de zones de paiement concurrentes ;