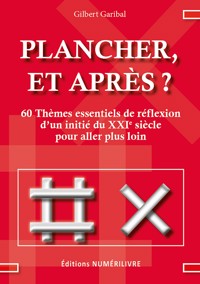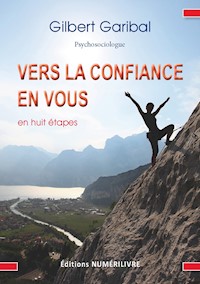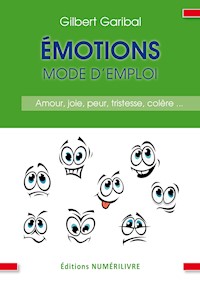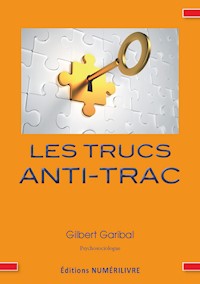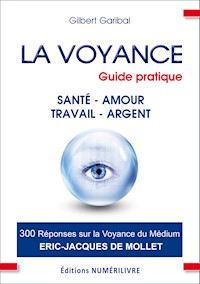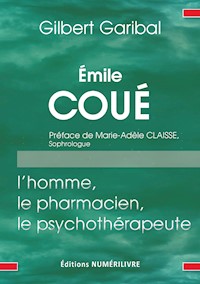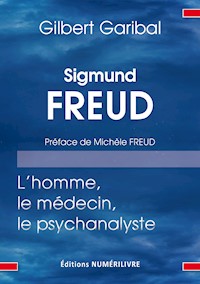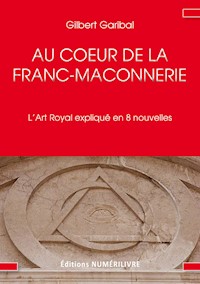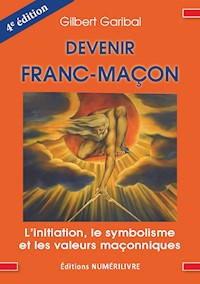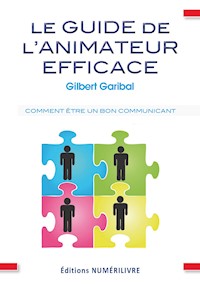Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Numérilivre
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
La deuxième guerre mondiale. Six ans pour les armées, de 1939 à 1945. Quatorze ans pour les civils. De l’avènement du nazisme en 1933, au Tour de France cycliste en 1947, symbole de la liesse populaire retrouvée.
C’est précisément toute l’enfance de l’auteur, ombrée par la croix gammée, à Boulogne-Billancourt.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Gilbert Garibal, maçon depuis plus de trente-cinq ans, sait de quoi il parle. Passé d’un système à l’autre pour terminer son parcours et auteur maçonnique chevronné, il présente dans ce nouveau livre une analyse avant tout sociologique. Elle aboutit à la conclusion d’une réforme nécessaire de la présente organisation obédientielle et juridictionnelle, pour sa survie même. L’Art Royal est une source vive dont on ne doit ni retenir ni polluer son libre courant. Empêchée ici, elle réapparaît là !
Gilbert Garibal, franc-maçon depuis plus de trente-cinq ans est docteur en philosophie, formé à la psychanalyse, et psychosociologue. Après une carrière commerciale puis l’exercice de la direction des ressources humaines en entreprise, il s’est investi dans la relation d’aide. Il se consacre aujourd’hui à l’observation des faits de société et à l’écriture. Auteur de nombreux articles et livres, il a publié chez Numérilivre-Editions des Bords de Seine, entre autres, « Devenir franc-maçon », « Plancher et après ? », « Comprendre et vivre les Hauts-Grades maçonniques » (Tome 1 et 2)
Approfondir l’Art Royal et
Le Rite Ecossais Ancien et Accepté.
Marie-Hélène Gonnin, psychologue de formation psychanalytique. Elle accompagne les dirigeants d’entreprise à comprendre leurs comportements et à les adapter aux meilleurs choix. Elle aide Joseph à élucider les énigmes que posent, à la psychanalyse, la Franc-maçonnerie.
Jacques Fontaine est un Frère impliqué dans le mouvement maçonnique depuis plus de quarante ans. Il intervient comme conférencier. Il a publié de nombreux articles et ouvrages sur l’Ordre. Dans cet ouvrage, poussé par la curiosité, il n’a de cesse de questionner Juliette sur la vérité maçonnique.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 429
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Cet ouvrage est réservé strictement pour votre usage personnel.
Tous droits de reproductions, de traduction et d’adaptation sont réservés pour tous pays sous quelques formes que ce soit.
Copyright Numérilivre ©
Édition numérique 2013
EAN : 9782366320244
Éditions NUMÉRILIVRE
Pour toute commande de livres papier,
Veuillez adresser votre règlement à NUMERILIVRE
50 avenue Molière, 78 360 MONTESSON
ou paiement par carte bancaire sur le site www.numerilivre.fr
Prix de vente livre papier : 16 euros TTC
Pour toute commande de livres numérisés,
Veuillez vous connecter sur le site de NUMERILIVRE
www.numerilivre.fr
Prix de vente numérique : 10 euros TTC
à Mireille
Maria-Corinne
Loïc
Romain
Brice
Lauriane
à Maurice
Jacqueline
Jean-Pierre
Michel
Bernard
Philippe
Valérie
— Comment je les lui coupe ?
— Courrrrt ! ! !
L’adjectif, lancé par la voix vibrante et rocailleuse de mon père – accent quercynois oblige – éclate dans mon dos comme un pétard. Un long frisson m’électrise de la tête aux pieds ! Juché par le coiffeur sur son haut tabouret et affublé d’un peignoir blanc sans manches, bien trop grand pour un enfant de six ans, je risque un œil dans l’immense glace devant moi : j’ai l’air d’un bonhomme de neige en train de fondre ! Je vois aussi mon père assis dans mon dos, le regard rivé à ma nuque. Trois autres clients lisent un journal, indifférents au désastre capillaire qui se prépare.
L’homme de l’art, prompt à l’injonction paternelle, a déjà saisi d’une main de longs ciseaux sur son comptoir, de l’autre un peigne aux larges dents. Les deux plongent sans vergogne dans la soie de ma longue chevelure blonde et bouclée. Un doigt sans-gêne, puis un deuxième, écartent mon col de chemise, écartent encore, pour y glisser une serviette éponge, une peur soudaine me griffe le ventre... Non, il ne va quand même pas oser ce bourreau !
Courrrt ! C’est le seul mot que mon père a dit. Et un mot, un seul, peut changer le sens, le cours d’une vie. Ma mère qui porte un soin jaloux à mes cheveux, m’a toujours coiffé jusqu’à présent comme une fille. Elle regrettera longtemps d’avoir demandé ce jour-là à son mari, de m’emmener chez le coiffeur, pour un léger « rafraîchissement » !
Ca y est, au gré des cliquetis métalliques, les mèches tuyautées commencent à gicler de ma tête baissée, rebondissent sur mon épaule, s’étirent en torsades, s’arrêtent un instant sur le tablier sous mes yeux, sur mes genoux recouverts, puis tombent en chute libre et roulent sur le carrelage blanc, tels des copeaux, couleur de miel. Le coiffeur, négligemment, les repoussent du pied !
A l’instant où, la dernière boucle décimée, mon tortionnaire me fait pivoter avec la chaise tournante et me relève le menton pour évaluer sa besogne en cours, une lueur jouissive allume son regard. D’une pichenette sur l’épaule, il me renvoie dans l’autre sens face au grand miroir et, ultime torture, je sens maintenant la pression d’un métal qui me glace la nuque. Je devine une tondeuse, elle glisse goulûment sur ma peau. La bête mécanique remonte vers l’occiput, redescend, zigzague autour de mes oreilles, escalade une tempe, et la seconde. J’ai la tête qui tourne, je me sens dénudé, j’ai froid. L’application à pleines mains d’un gel me secoue la tête et accentue mon vertige. Puis l’aller et retour d’une courte brosse dans mon cou pour glaner les poils épars, m’indique la fin du carnage. Ca y est la pelouse est tondue ! Prestement, mon tortionnaire me délivre de ma pèlerine blanche qu’il fait fièrement virevolter et claquer comme une muleta de toréador ! Une pluie de paillettes d’or plane une seconde dans la lumière, puis tombe sur le carrelage blanc.
— Alors, qu’est-ce que t’en dis, p’tit ? !
Je suis sonné, muet, penaud. Pour tout dire, horrifié. Le miroir me renvoie les yeux noirs écarquillés d’un blondinet au cou dégagé, et encadré de deux oreilles en liberté, que je n’ai jamais vues si grandes. Une vague raie centrale, sépare les courts cheveux plaqués et gominés qui me restent sur le sommet du crâne. En se levant, mon père affiche une satisfaction souriante, moi une mine déconfite et angoissée. Je sens une colère monter contre lui ! Que va dire, que va faire Maman devant cette tête ruinée... Désastre... catastrophe... malheur... ces mots, courants dans son vocabulaire, me martèlent les oreilles, les tempes. Une pensée de mort m’envahit. Ce coiffeur a commis l’irréparable, il a tué mes cheveux ! Une petite fille est entrée chez lui, c’est un petit garçon qui en sort. Tendu et tondu !
— Et hop ! Te v’là un homme maintenant ! claironne ce tondeur de chien, content de lui, en me soulevant de mon perchoir, pour me poser à terre.
Etourdi, nauséeux, après les va-et-vient de son tabouret tournant, j’ai l’impression de descendre d’un manège ! Pendant que mon père passe à la caisse, ce que je trouve honteux pour un tel travail, les trois clients abandonnent leur lecture et lèvent le nez. Ils me dévisagent, l’air goguenard. L’un d’eux, un jeune blanc-bec avec un duvet pour moustache, siffle d’admiration. Les yeux baissés sur mon tablier rose, je les regarde en coin, je les fusille de tout mon silence. Pauvres types ! Je saisis la main paternelle. Je voudrais disparaître, fondre, que le sol nous absorbe. Je sens la honte rougir mes joues, en quittant la boutique de ce virtuose du sécateur !
Mon poing droit serre une longue boucle blonde enroulée, que j’ai chopée en douce, au passage, sur la blouse blanche. En souvenir !
Je suis né à Boulogne-Billancourt, au printemps 1933. L’année de l’invention de l’horloge parlante, de la gaine « Scandale », de la Loterie nationale, et – coup de tonnerre dans un ciel serein – de l’avènement du terrible nazisme. Une onde de choc qui résonnera pendant toute mon enfance !
Je m’appelle Gilbert. J’ai un frère, Maurice, mon aîné de huit ans. Notre mère, modiste amateur, confectionne des chapeaux de dames en appartement, chez nous, avenue Victor Hugo. Pour elle et quelques voisines. Au premier étage d’une ancienne maison particulière. Notre père, gardien de la paix, est affecté au commissariat du 16ème arrondissement, à Paris. Bitos pour Maman Rose, képi pour Papa Henri ! Combien de fois au cours de nos jeux, mon frère et moi, avons-nous scandé derrière leur dos, ce slogan malicieux ? ! Coïncidence depuis cette époque heureuse de l’insouciance enfantine, les coiffures et couvre-chefs de toutes sortes, accrochent toujours mon regard.
A force d’entendre notre histoire, répétée et joyeusement commentée par mes parents lors des repas familiaux, j’ai gardé la curieuse impression d’avoir vécu en spectateur ma propre naissance. Puis mon évolution auprès des miens ! Souvent, j’en revois passer les images sonores devant mes yeux. Très présentes. A la maternité, avec la joyeuse annonce de la sage-femme qui lui pose sur la poitrine une boule noiraude, ridée et criarde, c’est une maman déçue qui apprend son accouchement d’un deuxième garçon ! Réaction et suprême cadeau de bienvenue pour moi : l’indifférence parentale ! Je reste quarante huit heures boudé, ignoré, sans identité, tant ma mère, qui attendait une fille – déjà prénommée Madeleine dans sa tête – est déçue. Mon père, par mimétisme docile, observe le même silence. Quant à mon frère, son jeune âge lui interdit l’entrée de la chambre. Un barrage opportun qui conforte sa soudaine mais compréhensible jalousie ! Donc, pas de bras pour m’accueillir, me prendre, me serrer, pour me cajoler. Que ceux des infirmières pour les soins d’usage. A peine quittées les eaux maternelles, je continue d’être ainsi en suspension, en attente ! Que peut-il bien se passer dans l’inconscient d’un nouveau-né... qui ne se sent pas désiré, aimé, reconnu ? ! Bref, ca commence mal !
Puis, petit miracle, cette maman qui voulait à peine regarder le berceau, mon berceau, près de son lit, est séduite par un prénom dans le feuilleton de l’Echo de la mode. Le héros s’appelle Gilbert. Tiens, pourquoi pas Gilbert ? C’est mon père qui, sans commentaires et avec un air détaché, va me déclarer au bureau de l’état civil de la mairie du Vème arrondissement. En énonçant à l’employé un deuxième prénom : le sien. Histoire de marquer, qui sait, un brin d’autorité ! Gilbert, Henri GARIBAL. L’ensemble ne sonne pas si mal. Il faudra bien que mes parents s’y fassent, que je m’y fasse. Et les autres aussi !
Quoi de plus normal après cet accueil raté, je refuse le sein et le lait maternels. Fera l’affaire le lait de vache en biberons. Puis il faut bien trouver un terrain d’entente avec le nouveau venu. Jour après jour, ma mère me regarde enfin, me saisit et me berce, mon père se fait une raison et m’approche. Mon frère, poussé par la curiosité, me découvre. Je passe ainsi de mains en mains, avec quelque retard sinon réticence têtue, au sortir de la maternité et le foyer rejoint.
Mon univers visuel, olfactif, sonore, se précise. Les yeux de Maman sont d’un velours noir profond, scintillant, qui me fascine. Ceux de Papa, tout au contraire, d’un bleu de mer transparent qui m’inquiète. Et ses joues ne manquent pas de piquant ! Le point rougeoyant et chaud du fin rouleau blanc sans cesse vissé à sa bouche me fait détourner le visage, quand il se penche sur moi. Je vais devoir m’accoutumer à la cigarette, cette inconséquence paternelle, en forme de volutes d’une fumée âcre et bleutée, expirés à jet continu et qui imprègnent la peau, les habits, l’appartement. Comme il me faudra m’habituer au contraste de ces voix, stridente de ma mère, rauque de mon père, provoquant mes sursauts. Et ne plus craindre ces aboiements furieux jaillissant par à-coups du poste de radio. C’est le ton habituel, guttural, menaçant, d’un certain Adolf Hitler : il fait aussitôt taire mes parents, qui écoutent sans comprendre. Et se regardent, l’œil soucieux. Je découvre ainsi les variantes de la parole. J’aurai besoin de temps pour saisir le sens des sobriquets dont la fratrie a été affublée par notre géniteur content de lui. Et qui reviennent avec un humour cinglant : « Trop tôt venu ! » pour l’aîné, « Sans toi on ferait ! » pour le cadet. Des mots cruels d’un homme qui, fils de modestes cultivateurs et aîné d’une fratrie conséquente, ne voulant pas d’enfant, le dit à sa façon. Des mots-sentences derrière l’ironie, des mots violents en vérité – davantage pour moi que pour mon frère ! – qui martèlent mon cerveau et s’y impriment. Ils ne sont pour l’instant que d’agaçantes onomatopées à mes oreilles. Mais j’ai bien compris que, dans la tête paternelle, si mon frère est accepté, moi je dérange !
Premiers contacts physiques, premiers sentiments de curiosité et de méfiance mêlés, premières « impressions » sur la carte perforée originelle de mon limonaire mental. Ainsi commencent à s’égrainer les notes d’une petite musique imposée, répétitive, avec ses pauses et ses reprises. Un air de famille, au vrai sens du terme, que je n’oublierai jamais. J’ai horreur de mon berceau. Déposé des heures durant au fond de cette caisse capitonnée – dont les parois m’empêchent d’explorer notre lieu de vie-je m’époumone jour et nuit à émettre un lancinant désaccord. Je dispose au moins d’une forme de pouvoir oral pour me venger : priver les autres de sommeil ! Une façon de les tyranniser à petit feu. Pour qu’ils s’intéressent à moi ! Les bébés de mon temps, enveloppés de langes blancs de la taille aux pieds, pareils à de gros tubes de dentifrice, ne peuvent trahir leur sexe. Une aubaine psychologique pour ma mère qui, de ce sac étanche, ne voit dépasser qu’une tête, dont la blondeur s’affirme au fil des semaines, des mois : celle de la fille, de « sa » fille désirée par dessus tout ! Et dans son esprit, à l’insu de la famille et des amis, par petites touches, Gilbert devient... Madeleine !
Au quotidien, certes rien ne change pour moi, sinon les accessoires à ma portée. La première peluche de mon frère était un ours : il traîne encore dans sa chambre, le poil usé jusqu’à la trame, une oreille et une patte en moins. Pour ma part, mon « doudou » est une petite poupée de tissu vert pâle, une « Bécassine », dont je m’applique à mâchouiller la coiffe avant que mes mains ne s’enhardissent et cherchent à dépiauter sa robe, puis étirer ses chaussettes rayées blanc et rouge. Dès que mes jambes sont enfin libérées de leur prison de laine, je me mets à ramper et je reçois là, sur le parquet, un cadeau encore plus beau : un gros catalogue en couleurs de vêtements féminins, que je peux retourner, corner, froisser, déchirer à loisir, image après image, chaque jour un peu plus. Un mystère, ces visages de femmes toutes souriantes, ces photos de robes, de chapeaux, de souliers multicolores, dont je fais des boules, des chiffons, des miettes !
Un bonheur, cette matière lisse qui obéit à mes doigts ! C’est pour en attraper un grand morceau que je me redresse, un dimanche après-midi. Je l’aperçois à quelques mètres de moi, je suis debout, j’avance une jambe, l’autre, je recommence, chancelle, tombe, je me relève, progresse encore et je m’agrippe à cette immense feuille, à ma hauteur. Mon père, assis sur le canapé de la salle à manger est surpris que son journal lui échappe des mains si brusquement ! Il me voit soudain devant lui à la place de sa lecture, je suis tout étonné aussi, avec un lambeau de papier dans ma menotte. Hourrah ! Je marche ! A onze mois ! J’ai droit à un vigoureux baiser paternel ! Ma mère accourt, me soulève, m’embrasse à son tour, joyeuse. Un menton de satin après une joue rêche. Je préfère !
Lorsque je change la bobine du film de mes petites années, sous-titré par la famille, pour celle de mes premiers vrais souvenirs personnels, passé cinq ans, défilent aussitôt sur mon écran mental, des scènes en noir et blanc pimentées de tâches de couleurs. Comme pour éclairer une période grave où flotte le pressentiment d’une guerre en gestation. Attendue, menaçante, inévitable. Guerre, ce mot claque souvent comme un coup de fouet à la maison, jusqu’à ce jour de septembre 1939, alors que l’automne commence à roussir les arbres de l’avenue, j’entends que, oui çà y est, la France a déclaré la guerre à l’Allemagne, le pays voisin ! D’autres mots suivent alors, bizarres, inquiétants, échangés entre locataires dans l’immeuble : armée, soldats, fusils, mitrailleuses, boches, tanks, ligne Maginot... C’est le nom d’un ministre, à ce qu’il paraît. J’entends que nos militaires sont massés dans les provinces d’Alsace et de Lorraine, le long de la frontière qui nous sépare de cet ennemi désigné, pour l’empêcher d’entrer chez nous. Des fortifications pour abriter les troupes, des lacs artificiels, des blocs de ferrailles, pour empêcher les tanks de passer, c’est çà la ligne Maginot. Oui, j’en entends des choses dans l’escalier ! Et je ne comprends pas tout, même si paraît-il, je suis en avance pour mon âge.
Conjuration maternelle contre le conflit en marche ? Le jour de mes six ans, j’étrenne une blouse du plus beau rose, choisie au « Prisunic ». J’ai droit aussi à des socquettes et des pantoufles à pompons assorties ! Mes cheveux tombant maintenant en cascades sur mes épaules, ma mère ose me planter sur le sommet du crâne, un gros ruban noué. Rose, bien entendu ! Comme son prénom.
— Ouh ! l’œuf de Pâques, ouh ! l’œuf de Pâques, scande mon frère !
C’est dans ce travestissement qu’un soir – pas à Pâques mais la veille de Noël, précisément – j’échappe à la vigilance maternelle, descends les escaliers et me retrouve sur le trottoir, sans manteau. Pour aller me planter devant la vitrine de jouets du quartier, dans laquelle s’agite depuis plusieurs jours un ours en peluche mécanique qui me subjugue. Boulevard Jean Jaurès, à cinq cent mètres de la maison, avec trois rues à traverser ! Heureusement, un voisin me reconnaît, me prend dans ses bras et me ramène à l’appartement. Etonné, je retrouve ma mère en sanglots, blanche comme un linge. Elle a cru à un enlèvement, et me presse de questions. Ma fascination pour l’ours en peluche lui échappe tout à fait ! D’autant, que l’enlèvement en 1932, du fils du célèbre aviateur américain Charles Lindbergh, est encore, sept ans après, dans tous les esprits. Enlevé et assassiné, c’en est trop pour Maman. Et sa réaction est bien compréhensible !
Je suis encore déguisé en œuf de Pâques, en tablier rose avec un nœud de même couleur dans les cheveux, quand, son jour de congé venu, mon père, missionné, me conduit chez le coiffeur voisin... J’y entre travesti en fille, et quelques coups de tondeuse plus tard, j’en ressors effectivement avec une tête de garçonnet. Je m’appelle bien Gilbert !
Entre « court » et « pas trop court », comme l’avait recommandé ma mère, il y a une grande différence ! Que Papa n’a pas saisie. Révoltée, noyée de larmes et au bord de la syncope, lorsqu’elle découvre ma tête dévastée par cette coupe virile, elle aura beaucoup de mal à pardonner un tel sacrilège à son mari. Lequel, en vérité, une fois l’orage maternel passé, est plutôt fier d’avoir ainsi récupéré un fils, en train de lui échapper ! Le sobriquet « Sans toi on ferait ! » s’est enfin transformé dans son regard pétillant de malice en cet accueil, que tout mon être réclame : « Sois le bienvenu, MON enfant ! ». Il n’est d’ailleurs, même pas besoin de mots, pour formuler et ressentir l’amour parental. L’œil voit, mais aussi écoute, parle, demande, refuse. Puis encore accepte et donne ! Avec cette particularité, de pouvoir saisir, immédiatement, le visage devant soi. Lequel est conçu par la nature pour cette réciprocité. Coiffure comprise !
Chapeau gris tourterelle ou cloche lie de vin de ma mère, béret marron ou casquette en tweed vert de mon frère, feutre gris clair à bords baissés ou képi bleu marine de mon père. La ronde de ces six couvre-chefs interchangeables sur mes trois têtes familières, rythme mon quotidien. Autant les coiffures familiales me plaisent, m’amusent parfois, autant celle du représentant de la Loi me dérange toujours. Je l’ai décidé très tôt, je n’aime pas être un fils de flic ! Comme sa joue piquante, comme sa cigarette allumée, la visière de son haut képi devient un obstacle de plus entre nous, quand il rentre du travail et se courbe vers moi pour m’embrasser ! Je commence à remarquer que mon enfance se déroule sous le signe des « couvre-chefs ». Elle est rythmée, même, par leur alternance...
Je le constate depuis que je vais à l’école : tous mes petits copains ont un père vêtu d’un habit de ville « normal », anonyme, quand il vient les attendre à la sortie ! Ce n’est pas le cas du mien, subordonné à l’uniforme de gardien de la paix ! Une tenue bien trop voyante, à mon goût ! Non seulement ce cylindre bleu marine haut perché lui donne un air lugubre, mais sa tunique cloutée de boutons nickelés le fait quasiment clignoter à distance ! Jusqu’à la boucle de son ceinturon de cuir qui brille, à hauteur de mes yeux. Et comment ne pas remarquer, pendus de chaque côté, à gauche, ce long bâton blanc, outil du policier de voie publique, et à droite, un mystérieux étui de cuir noir boursouflé à rabat. J’ai entendu ma mère chuchoter à mon frère qu’il contenait une « arme à feu », surtout à ne jamais toucher, donc à ne jamais approcher ! J’ai compris la nécessité de ne pas évoquer cette « chose dangereuse » et cachée à la maison. D’ailleurs, preuve que cet équipement lui déplaît, dès qu’il rentre, l’agent de police quitte très vite l’uniforme et ses accessoires, les enferment à clef au fond de son armoire personnelle, dans le « cabinet de débarras ». Pour réapparaître « en civil » dans la salle à manger. Pantalon de flanelle ou de toile et chemise ouverte en font aussitôt un autre homme, un « monsieur tout le monde », détendu et jovial. Voilà comment je voudrais voir mon père à la sortie de l’école. Dommage que ses horaires l’empêchent de venir me chercher !
Je savais lire et presque écrire avant d’entrer en classe, mais c’est là, parmi les élèves, que j’ai vite appris à mentir. En répondant à l’inévitable question :
— Qu’est-ce qu’il fait ton père ?
— Il est gardien de la paix.
Fils de flic ! Je ne comprends pas pourquoi l’agent de police, le flic, est mal aimé du public, alors qu’il exerce une fonction indispensable dans la ville ! Les quolibets et plaisanteries répétés de mes camarades, à l’annonce du métier paternel, d’abord m’ont blessés. Puis une honte diffuse m’a fait conclure à l’obligation d’inventer à mon père un autre statut. L’idée m’est venue, en pensant à l’un de ses collègues policier motocycliste. J’ai déjà pu constater le prestige de cet homme dans le quartier, par rapport au simple flic, toujours brocardé, lui. Une coutume bien française. Il faut dire que notre voisin « motard », casqué et botté, a fière allure quand il enfourche sa machine – une « René Bonnet » – et démarre en trombe ! C’est décidé, j’ai trouvé la parade :
— Parfaitement les copains, mon père est policier, et même qu’il est motard !
Du coup, c’est le silence étonné, intéressé. Terminées les railleries. Les regards vers moi deviennent presque admiratifs, respectueux... Non, mais !
Je vais porter ce mensonge pendant toute ma scolarité primaire. Au fil du temps, mon père est vraiment devenu « un chevalier motorisé » dans mon imagination ! J’en suis alors très fier. Il n’en saura jamais rien, ni mon frère. Ma mère non plus d’ailleurs. Son mari est pourtant bien loin d’être le héros de la maison depuis son exploit : je crois qu’elle lui en veut toujours, plusieurs semaines après son offensive sur ma chevelure. Qui a abouti à un scalp !
Catholique fervente, maman a choisi pour notre instruction, l’école de la paroisse Sainte-Thérèse. A un bon kilomètre de la maison, presque au bout de la longue rue Galliéni, près de la Seine. C’est mon frère qui m’y emmène chaque matin, avec la consigne, le palier franchi, de me tenir la main pendant tout le trajet, jusqu’à la cour des petits, avant de rejoindre celle des grands. Je vis mal d’être ainsi tenu en laisse, sous le regard de mes camarades de classe, en pleine rue. Surtout depuis que je me sens un « vrai garçon », dans une culotte courte de mon frère retaillée à mes mesures, et les cheveux courts sous mon béret ! Mais Maurice, lui en culotte de golf et casquette, est très fier de sa responsabilité, qu’il assume de même au retour, en fin d’après-midi. Difficile avec lui, de stationner en route devant le magasin de jouets de l’avenue Jean Jaurès !
En 1939, qui dit « école libre », dit religion et prêtres en soutane. Dieu et Jésus-Christ que je confonds. Et une succession de rituels au quotidien : signes de croix, prières en entrant et sortant de classe, puis avant et après le repas à la cantine, lectures bibliques, chants, catéchisme. Puis, quand punition individuelle il y a, vingt « pater » et « ave » en prime, une suite de formules apprises par cœur, que je ne comprends pas toutes, à égrainer en silence sur mon chapelet. Une chaînette en fer blanc, une sorte de collier, assorti d’une petite médaille nickelée qui pend et trente perles oblongues de verre sombre, comme des grains de café, enfilées entre les maillons. Je les ai comptées.
Ma mère me répète de prendre grand soin de cet objet précieux.
— C’est un chapelet de famille ! Ton frère l’a eu pour sa communion ! Ne le perds pas surtout, fais y attention, mets le dans ta poche de culotte, sous ton mouchoir !
J’avoue que je pratique avec, davantage de moulinets que de prières, au piquet dans le couloir. Où m’envoie régulièrement l’abbé Roland, pour indiscipline ! Motifs répétés : lancer de béret en vol plané à la cantine, envoi d’objets par la fenêtre ou imitation d’animaux en classe. Que le jeune prêtre, encore naïf, cherche partout, sous nos pupitres ! Le petit chat est dans ma gorge ! Le turbulent et clown que je suis ne passe pas une journée sans chercher à faire rire ses camarades ! Une façon, sans doute, de me faire aimer, et respecter par les plus grands, à la gifle facile ! C’est souvent là, que j’imagine mes gags. Devant la porte de la classe dans le couloir, en faisant semblant de marmonner mon pensum face au mur. Sous la grosse pendule, dite « à chiffres romains ». C’est là aussi que le Père Bernard, le directeur de l’école, un grand maigre à grosses lunettes de myope, me remarque régulièrement, quand il rôde dans l’établissement. Le nez en avant et les mains dans le dos.
En ce milieu de matinée d’automne, il me surprend à regarder par la fenêtre, du premier étage où nous sommes, dans la cour des filles, juste en dessous. Elles sont en récréation à dix heures et nous, les garçons, à dix heures et demie. Ce décalage pour éviter toute « promiscuité », nous a-t-on dit, sans nous expliquer ce mot savant ! En tout cas, mes pitreries me donnent au moins l’avantage d’une distraction visuelle ! Ma spécialité, c’est le lancer de parachute : Je le fabrique avec un mouchoir et quatre ficelles nouées aux coins, lestées d’un bonhomme en plomb, trouvé dans les paquets de Saponite. La marque de lessive de ma mère. L’ennui, c’est que mon engin tombe le plus souvent, comme une pierre, directement derrière la haie. Pas dans la cour des filles, qui ne voient rien arriver. Autre inconvénient, la pile de mouchoirs diminue à la maison !
— C’est comme çà que tu récites tes prières sur ton chapelet, en regardant les filles ! Espèce de petit garnement !
Le Père Bernard me tire de mon exercice, et je regagne mon coin de mur. Je tente une défense :
— Je ne fais rien de mal, mon Père !
— Ne répond pas, s’il te plaît ! Le mal est partout, effronté que tu es ! Allez, suis-moi, j’ai à te parler...
Il me tire par la manche de ma blouse grise et m’entraîne au deuxième étage, dans son bureau. Je déteste son regard chafouin qui me transperce, derrière ses binocles en « cul de bouteille ». Il me pousse dans la pièce, j’entends le loquet de la porte qui se referme. Il s’assoit sur une chaise devant son bureau et me fait face. Je vois davantage un diable noir devant moi qu’un homme de Dieu !
— Tu sais que je t’aime beaucoup, mon petit garçon ! C’est pour ton bien que je t’ai grondé. Approche-toi de moi...
Je ne le reconnais plus, sa voix est devenue toute douce. Son sourire enjôleur, mécanique, découvre des dents jaunes qui s’avancent. Il va me mordre ! Que veut-il ? J’ai la bouche sèche, comme paralysée. Qu’est-ce que je fais là ? Je suis prisonnier...
— Pourquoi tu as peur, approche, je te dis, laisse-toi faire...
C’est lui qui s’approche, qui se penche, il me saisit la taille des deux mains, me soulève. Je voudrais crier... J’ai l’impression de me dédoubler d’un seul coup, d’être dans un rêve, hors de mon corps et dedans à la fois, impossible de bouger... Une voix intérieure pose des questions. Pourquoi me prend-t-il soudain sur ses genoux ? Pourquoi me demande-t-il de compter les boutons sur sa soutane, de les défaire ? Pourquoi presse-t-il sa main sur mes cuisses, sur mon ventre ?Il cherche à déboutonner ma culotte, je ne peux pas repousser ses doigts qui se crispent, il tire sur mon slip, il l’écarte entre les jambes... Son visage s’approche du mien, il transpire, je sens son haleine chaude... il veut m’embrasser, une force désespérée monte en moi, je me contracte et lance des coups de pieds dans son estomac... j’y prend appui pour me reculer, il desserre son étreinte, retire sa main, je me dégage enfin, lui griffe la joue... ses lunettes tombent... il les cherche, je marche dessus exprès... j’écrase les verres du talon, je bondis vers la porte, je soulève le loquet sur la pointe des pieds, j’ouvre la porte, je cours vers ma classe, je sens de l’air frais...
...La même angoisse, la même honte que chez le coiffeur... je descends les marches par deux, personne dans la classe, c’est la récréation... je fonce dans la cour des grands, je cherche mon frère, il joue aux billes... je lui saute dans les bras, en larmes. Avec des « pourquoi il m’a fait çà, pourquoi il m’a fait çà, pourquoi il m’a fait çà ? » répétés, répétés encore, qui le laisse sans réponse, interloqué, bouleversé. Je ne veux pas retourner dans ma classe, je veux qu’on parte tout de suite, qu’on s’enfuie de cette école, vite ! Le concierge ne nous voit pas sortir. Je serre la main de Maurice très fort, je le tire même, en rentrant à la maison. J’apprécie d’avoir un grand frère aujourd’hui, d’être protégé. On file sur le trottoir, au pas de course, en blouses, en silence, sous une pluie fine... Le long des immeubles, des boutiques, des cafés, du cimetière. Je me retourne sans arrêt, j’ai peur que nous suive le sinistre homme en noir, j’ai mal au ventre...
Double coup de sonnette de mon frère. Ma mère ouvre et nous voit rentrer, décomposés, trempés.
— Mon Dieu, vous à cette heure-ci, mais qu’est-ce qui vous arrive, vous êtes tout pâles ? !
Je ne peux pas parler, je ne veux pas surtout, il n’est pas question que je dise ces choses affreuses. Ni à ma mère, encore moins à mon père. Je vais vite dans ma chambre, je m’enferme, je me jette sur le lit. Avec ma blouse. Entre mes sanglots, j’entends mon frère qui se met à raconter l’évènement dans la salle à manger. Je devine les questions de ma mère. Puis la porte se ferme. Leur dialogue se transforme en murmure, en musique lointaine. Je revois ce visage aux pommettes rouges, ces yeux exorbités, cette bouche tordue qui veut m’embrasser, ces dents jaunes qui s’avancent, je sens cette haleine fétide, je mets ma tête sous l’oreiller. Je ne veux plus rien voir de ce monde. Je m’endors, épuisé. Tout habillé.
Ma chambre, c’est plutôt celle de Maurice. Nous dormons ensemble dans un cosy poussé contre le mur, et que l’on tire le soir. Le lendemain matin de cette sale aventure, mon frère me réveille en me secouant, en rouspétant. Mais qui y a t-il ? Pourquoi ces cris ? Qu’est-ce que tu as fait, mais touche, je suis tout mouillé ! C’est vrai, sa chemise de nuit est trempée, la mienne aussi, les draps avec, j’ai fait pipi au lit... Catastrophe ! Ma mère arrive, me crie dessus à son tour, comment je vais faire sécher le matelas par ce temps, et il est tout tâché maintenant, mais c’est pas possible, comment t’as fait ton compte ? ! Je suis mortifié, ce n’est pas de ma faute, les images du prêtre, ce sale type, reviennent sans arrêt. Personne ne comprend mon choc, mon désarroi... Je baigne dans l’urine autant que dans un immense sentiment d’injustice ! Et je devine que je suis l’acteur d’une « sale histoire », quelque chose d’important à raconter pour ma mère, du trouble, du clandestin, qui colle bien à l’ambiance feutrée du moment. Bref, on s’intéresse à moi, on parle de moi, ça c’est sûr ! Au fond, ce n’est pas tout à fait pour me déplaire...
Pas d’école aujourd’hui, nous a ordonné Maman ! Nous restons consignés à la maison. Gorgée de colère, l’air grave, l’œil sombre, elle se rend seule à Sainte-Thérèse, d’un pas nerveux, qui résonne dans l’escalier et le couloir de la maison. Ca va barder ! Silence dans l’appartement, toute la matinée. Nous n’osons pas nous parler. L’attente est longue. Elle revient de l’école vers midi, avec nos cartables qu’on avaient laissés, les joues rouges, visiblement très tendue. Mais elle ne nous dit pas un mot. Le directeur, je l’espère bien, a dû passer un très mauvais moment. Sale type ! Il vient de perdre deux élèves et ma mère, ses illusions sur les vertus de l’école libre ! Trois jours après, Maurice et moi entrons à l’école publique, toute proche, rue de Paris. Trois mois après la rentrée !
Curieusement, je me sens en faute. Avoir inondé le lit en plus, me rend très coupable, humilié, inférieur. Je suis meurtri aussi, le ventre noué, zébré par des mains fantômes. J’ai envie de vomir. Je voudrais me blottir contre Maman, mais depuis ma nouvelle coiffure, ma tête dénudée, son affection semble s’être envolée avec mes cheveux. Juste un baiser léger avant de partir à l’école, fini le câlin sur ses genoux après le dîner ! Je comprends qu’on ne devra jamais plus parler de cette odieuse agression. Papa est-il au courant ? A-t-il porté plainte au commissariat ? Mystère. Pas de scandale. Il faut faire disparaître « la chose ». Mais je sens bien qu’elle est inscrite en moi. Pour toujours !
Les jours passent, un évènement chasse l’autre. Janvier 1940 n’annonce rien de bon pour l’armée française. Sinon la défaite. Mes parents s’inquiètent pour Maurice qui va vers ses quinze ans. Ils décident de l’envoyer dans le Lot, au pays paternel. Il y sera à l’abri du conflit, pensent-ils. D’abord quelque temps gardien de vaches dans une ferme, il est accueilli ensuite en apprentissage, « nourri-logé », par le marchand de vins de la petite localité d’Assier. Un coup dur pour mon frère qui s’est éloigné soudain. Et pour moi, qui me retrouve sans mon protecteur ! A un hiver très froid, succède un printemps bien triste. Début mai, je découvre sur le journal, la photo de cet Adolf Hitler, qui vocifère dans le poste de radio. Des yeux exorbités, mèche en virgule sur le front, carré de moustache sous le nez, comme un timbre noir. Il est sinistre, ce guignol ! Voilà donc le chef des soldats ennemis. Je lis qu’ils sont entrés en France par la Belgique, dont la frontière n’est pas fortifiée. Notre ligne Maginot, trop courte, n’a servi à rien ! Et les troupes allemandes, sans résistance devant eux, sont en train d’envahir le pays. Elles avancent vers Paris, dit le gros titre de Paris-soir. C’est donc ça la guerre, des militaires qui s’installent dans le pays conquis et des civils qui s’enfuient sur les routes, poursuit l’article dans le journal !
Mon frère parti, allons-nous suivre ? Pas question, pour le moment du moins. Mon père, fonctionnaire de police, ne peut pas quitter son poste. Et ma mère ne veut pas quitter son mari. Comme indifférente à ce drame, elle persiste à tailler feutres, tissus et rubans, pour bricoler des chapeaux. Des robes aussi. Les voisines, tout excitées par les nouvelles, se succèdent dans l’appartement. Pour tirer l’aiguille avec ma mère. Enfermé dans ma chambre, je mordille mon crayon devant mes devoirs. Je reconnais chaque femme aux phrases échangées, quand la machine à coudre s’arrête de ronronner. Etats de santé respectifs... rumeurs du quartier... débâcle de l’armée française... où est-elle passée ?... exode des parisiens... les restrictions alimentaires qui commencent... et ces soldats allemands, qu’est-ce qu’ils vont nous faire ces barbares ?...
— Vous prendrez bien une tasse de thé ? !
— Oui, avec un nuage de lait, merci !
A travers la cloison, j’entends soudain ce changement de sujet, j’imagine ce cérémonial insolite, un brin précieux, presque hors du temps. Etrange rencontre du tragique et, me semble-t-il, de la frivolité. Par la fenêtre du premier étage, je regarde ces femmes s’éloigner dans la rue, avec leur bibi tout neuf sur la tête, ou à la main, que j’ai appris à distinguer. Cloche parme enrubannée, toque vert pomme à voilette, feutre caramel à plume et bords gansés, charlotte bleu ciel à dentelles, capeline blanche, turban noir à aigrette. Un festival d’élégance multicolore sous mes yeux ! Une façon insolente aussi, pour l’éternel féminin, de refuser les tourments qui s’annoncent...
Le matin, avant de partir à l’école, j’ai plaisir à détacher le feuillet quotidien de l’éphéméride accroché au mur de notre petite cuisine, pour voir apparaître la date et surtout le dessin humoristique du jour. Ce 14 juin 1940, je découvre un coiffeur appliqué qui repeint la devanture de sa boutique et le client rigolard qui passe lui dit : — Dites donc, monsieur le coiffeur, vous peignez toujours ! Un jeu de mots, que je ne trouve pas tout de suite. Il sera difficile à replacer auprès des copains !
Mon père travaille la nuit. Il alterne les gardes au commissariat de police et les rondes à pied avec un collègue, en ville. Il vient de rentrer, maussade, fatigué, pressé de dormir. Nous nous croisons à table. Lui, le visage penché sur son assiette de soupe. Ma mère, sa tartine plongée dans sa tasse de café au lait. Moi devant mon bol de Banania. Etonnant ce petit déjeuner, en même temps, repas du soir pour le paternel ! Ce qui me surprend le plus, c’est le rituel qui suit le potage, une vraie cérémonie : il déplie avec précaution le papier gommé qui entoure le camembert posé devant lui par Maman, le tâte de la lame du couteau, puis le découpe en deux puis en quatre quartiers. Il les mange enfin, lentement, l’un après l’autre, accompagnés chacun d’une longue gorgée de Postillon. Un camembert entier à sept heures du matin, et presque un demi-litre de vin, comment fait-il ? ! Je ne pars à l’école que sa dernière bouchée avalée, lorsqu’il relève la tête. Pour une bise coutumière du bout des lèvres. Je pense que c’est depuis ce temps là que je n’aime pas le fromage, quelque chose m’incommode. L’odeur, sans doute.
Je le devine à son air, aujourd’hui, notre père n’a pas le cœur à rire, avant d’aller se coucher. Il nous apprend que les soldats allemands sont entrés dans Paris à l’aube, sans obstacle, et ont déjà investi, entre autres, une partie du Bois de Boulogne, avec leurs tanks, camions et canons anti-aériens. Puis il lève vers nous des yeux couleur de mer en tempête, pour nous dire sa révolte : les autorités occupantes ont aussitôt exigé la soumission des forces de police, de douanes et de gendarmerie, avec leur désarmement immédiat.
Papa, gardien de la paix – une expression bien dérisoire en ce moment ! – a dû abandonner son revolver et ses chargeurs sur le bureau du Commissaire, en quittant le service de nuit. Que peut-il rester à garder maintenant dans cette France occupée ? Il est rentré à la maison avec un étui vide au ceinturon, à la fois désarmé et humilié. Un sanglot noie ses paroles dans sa gorge. Deux larmes serpentent sur ses joues bleuies par la barbe matinale. Il baisse à nouveau la tête. C’est la première fois que je vois mon père pleurer.
La police française est réarmée quelques semaines plus tard, sous contrôle de l’occupant, maintien de l’ordre oblige. Certain que mon père a récupéré son revolver, une chose, pourtant, m’intrigue. L’étui fixé à son ceinturon est « gonflé » comme auparavant, mais ne me paraît pas porter le poids d’une arme. Bizarre ! Un jeudi matin, profitant du sommeil paternel, et de l’absence de maman, partie au marché, je décide de « visiter » l’armoire paternelle, au fond du débarras, dans la pénombre. Là où l’agent de police range son uniforme et ses accessoires.
Je tremble un peu en montant sur le tabouret pour prendre la clé... que je sais posée sur le plafond de l’armoire ! Redescente, je retiens mon souffle, j’ouvre un battant de la porte, il grince une seconde, je me mords la lèvre... A droite, côté étagères, devant moi, j’ouvre d’une main le couvercle d’une grande boîte à cigares, je distingue tout de suite le revolver à crosse marron nervurée et les deux chargeurs chromés. Ils sont posés sur plusieurs petits cartons jaune pâle, pliés en deux. Je vois imprimé sur le premier : CARTE NATIONALE D’IDENTITE. Avec, à l’intérieur, un nom que je n’arrive pas à lire et une photo d’une inconnue collée en dessous. A gauche, côté penderie, je repère près de la tunique sur son cintre, le ceinturon et l’étui, suspendus à un crochet.
La manœuvre est délicate, il faut mes deux mains pour soulever doucement la patte du rabat, puis glisser pouce et index dans l’étui. Je suis en sueur, je sens un tissu mou, je tire, je tire encore et j’en sors une boule difforme qui s’ouvre et s’allonge soudain. A la lumière de la petite fenêtre, je le reconnais, c’est mon doudou, ma Bécassine, toute plissée et cabossée ! Dire que je l’ai cherchée partout pendant des semaines ! Je souris nerveusement, je suis tout attendri et inquiet, en la remettant dans l’étui. Je referme tout, je serre mes dents qui claquent, et je sors du débarras sur la pointe des pieds. Mon père dort toujours, j’entends sa respiration bruyante et régulière. Ouf !
Je suis content, bien sûr, de l’accompagner dans son travail par objet interposé. Je me sens même un peu policier ! Mais pourquoi, encore une interrogation, pourquoi il n’emporte plus son revolver dans son étui ? Lui qui était si malheureux d’en être privé, le mois dernier ? ! Chez nous, la TSF est une sorte de commode haute en bois clair, surmontée d’un phono qui n’a jamais marché. Elle est apposée contre le mur dans la salle à manger, près de la cheminée en marbre roux. Je n’ai pas le droit de toucher à la rangée de boutons en bakélite, mais je triche ! Lorsque le soir après le dîner, ma mère est dans sa chambre et mon frère dans la nôtre, j’ouvre le poste, toute lumière éteinte. En tournant la molette bordeaux, je déplace l’aiguille sur le cadran phosphorescent. Les stations défilent, ça grésille, j’entends baragouiner dans toutes les langues, jusqu’à ce que je trouve Radio-Paris. Magique !
Allongé sur le tapis, la tête collée contre le tissu toilé du grand haut-parleur rond, j’aime écouter en sourdine, la musique et les voix qui en sortent. Très vite monte des entrailles du poste une odeur de lampe chaude poussiéreuse, je suis à l’écoute du monde ! C’est ainsi, après une chanson de Rina Ketty, que j’entends un soir le speaker déclarer d’un ton solennel l’instauration d’un couvre-feu à Paris et en banlieue. Plus personne dans les rues après onze heures du soir ! Les services de police sont autorisés à tirer sur toute personne civile suspecte, qui ne répond pas à leurs sommations !
Je comprends soudain la désobéissance de mon père, si pacifique, aux ordres allemands. Ma Bécassine sera une arme bien inoffensive contre tout fuyard dans la nuit. Il n’aura même pas à dégainer ! Je comprends aussi le risque personnel auquel il s’expose. Un revolver au ceinturon d’un flic, c’est d’abord une marque d’autorité ! J’ai entendu plusieurs fois « le paternel » prononcer cette phrase au cours des repas de famille, avec son économie de mots habituelle. Un jour, je lui demanderai ce que c’est, une « marque d’autorité » !
Notre voisine de palier, Madame Galianov, dite « de Balmain », authentique comtesse russe, reconvertie coiffeuse à domicile, et grande bavarde, rivalise avec la concierge pour recueillir et colporter dans l’immeuble, les nouvelles du jour ! Ce jeudi matin, coup de sonnette, elle vient avertir ma mère. Entre deux portes, elle démarre ! Une de ses clientes lui a appris à l’instant qu’une unité de l’infanterie allemande, partie de la rue de Rivoli, a traversé il y a une heure à peine la place de la Concorde pour remonter les Champs Elysées. Jusqu’à l’Arc de Triomphe, musique en tête. Des soldats casqués, tout en vert, avec des bottes noires, qui marchent au pas de l’oie. Je ne sais pas ce que ça veut dire, « au pas de l’oie » ... Il faudra que je regarde marcher les oies, à la campagne !
J’écoute la conversation, plutôt le monologue de la coiffeuse, dans ma position favorite, assis sur le parquet de la salle à manger, où je feuillette un album de Bibi Fricotin. Je n’ose pas me montrer. Si elle me voit, çà va être encore pour se lamenter « sur ma tête toute rrrrrrasée », comme elle dit avec son accent russe. C’est elle qui tuyautais mes anglaises avec son fer à friser quand j’avais mes cheveux longs. Tout en disant un jour, que je ressemblais à la petite actrice américaine Shirley Temple, un autre jour que j’étais le portrait de la réclame du Bébé Cadum, que je pourrais faire du cinéma, qu’il fallait me présenter aux studios de Boulogne, qu’ils cherchaient des enfants comme moi pour les faire tourner dans des films, et blablabla, et blablabla ! Elle a longtemps monté la tête de ma mère avec ce long monologue ! C’est trop tard, mon père et le coiffeur ont réglé le problème !
Aujourd’hui, « Madame Bigoudi » parle de l’exode. Après la « débâcle » de l’armée française, son sujet récurrent qui la met en colère, c’est « l’exode » des civils, qu’elle développe aujourd’hui. Un mot curieux, l’exode. Il y a des milliers de gens qui fuient sur les routes, lance-t-elle de sa voix stridente, en automobile, s’ils trouvent de l’essence, mais aussi à vélo, à pied en poussant des charrettes et des voitures d’enfant. Depuis quelques jours, parisiens compris, ils partent des villes du nord vers le sud. Si j’ai bien saisi ce que notre voisine raconte, les allemands ont pris le pouvoir à Paris. Et la France va être séparée en deux. Avec en gros, une zone occupée au dessus de la Loire, et une zone libre. Sans allemands, sans doute. Mais comment sait-elle tout çà, la coiffeuse ? !
Les trains pour le sud sont pris d’assaut. Toujours d’après elle, il paraît que l’envahisseur envoie des avions, des chasseurs, qui mitraillent les colonnes de populations civiles. Pourquoi cette horreur gratuite, cette violence meurtrière, pourquoi tuer ces innocents ! Le flot de paroles de la voisine m’étourdit, son ton angoissé me serre les tempes, toutes ces scènes de guerre qu’elle décrit en détail, me nouent l’estomac, le ventre. Les dessins de mon illustré se brouillent devant mes yeux. J’ai envie de me boucher les oreilles, de ne plus l’entendre, qu’elle rentre chez elle ! Assez ! Mais qu’est-ce qu’elle nous dit, cette femme, elle est folle ? ! Enfin, une cliente arrive pour se faire coiffer, ma mère est sauvée. Elle n’a pas pu placer un mot, condamnée, debout dans l’entrée, à écouter l’intarissable comtesse !
Il faut que je m’habitue à vivre simultanément dans le monde visible sous mes yeux et un monde invisible, cet ailleurs de mort raconté sans fin dans les conversations ou que j’imagine, en écoutant la voix des ondes. Et qui me fait frissonner.
Après le dîner, avant que la nuit tombe et s’installe le couvre-feu, ma mère me laisse sortir une petite heure. Je retrouve quelques copains du quartier pour jouer au foot-ball dans l’avenue, devant la maison. Un ballon de caoutchouc un peu dégonflé et deux vieilles boîtes de conserves dans chaque camp pour figurer les buts, font de nous des gosses heureux. Nous goûtons l’illusion fugitive de posséder un terrain de jeu, un territoire, en pleine ville ! Le pavé est à nous ! La guerre ? Quelle guerre ? Pas une voiture le soir, ni sur la chaussée, ni en stationnement. Seule, la lente carriole du menuisier-charpentier tirée par deux chevaux blancs et qui rentre tous les soirs son matériel à l’atelier tout proche, interrompt notre partie un instant. L’artisan, joyeux complice qui marche aux côtés de ses bêtes fatiguées, ne manque pas de schooter dans le ballon en passant. Et nous reprenons vite notre jeu de crocs en jambe, entre les tas de crottin, cadeau fumant du soir ! 30 juin, 16 heures 30 pile, l’école nous lâche au soleil estival jusqu’au 15 septembre. « Vive les vacances, mettons les livres au feu et les profs au milieu ! » Avec mes nouveaux copains de classe et l’insouciance du jeune âge, nous chantons à tue-tête ce refrain, en traversant l’avenue de la Reine. L’irruption d’une patrouille allemande, en train de remonter l’avenue Victor Hugo vers le bois de Boulogne, nous stoppe net ! Devant nos yeux curieux, la preuve de la France occupée : un grand carré de soldats de vert vêtus, une centaine peut-être, calots plats à pattes boutonnées et courtes bottes noires, marchent au pas fusil à l’épaule, en martelant les pavés. Ils sont précédés, au ralenti, d’un motocycliste et de son passager dans un side-car avec mitrailleuse. Tous les deux, casqués et sanglés de cuir gris. Derrière le peloton, suivent trois autres soldats casqués, tenant chacun un chien berger, allemand lui aussi, en courte laisse. Je n’avais pas encore vu ces militaires annoncés. Ils ont l’air triste et méfiant. Comme les passants. A la maison, je trouve ma mère en fin d’essayage. Indifférente aux évènements ! Elle est en train d’ajuster une casquette bouffante en toile blanche, sur la tête d’une jolie jeune femme blonde aux yeux bleus verts. Je la connais, je l’ai déjà croisée. Dans le quartier, sans doute.
— Avec vos cheveux courts, elle vous va, mais alors, à ravir ! Regardez-vous dans la glace, Mademoiselle Esther...
Je suis derrière elle, comme mon père quand j’étais chez le coiffeur. Nos regards se télescopent une seconde, par miroir interposé. Elle me sourit d’une mimique protectrice, comme on le fait aux enfants. Je n’aime pas trop ! Je voudrais être grand soudain derrière cette glace. Un homme quoi, pour recevoir un sourire de femme, un vrai ! La demoiselle fixe sa casquette, je sens qu’elle pense à autre chose, elle prononce une phrase banale...
— C’est tout à fait ce que je voulais pour voyager, merci ! Vous avez pu...
— Oui, attendez un instant ! dit ma mère, en me regardant d’un air de reproche.
Ma parole, je dérange ! Je me suis assis derrière la cliente sur ma petite chaise, et je n’ai pas l’intention de bouger. Non, je ne veux pas aller dans ma chambre. Ma mère me regarde, soupire et quitte la pièce. Au nombre de pas, je sais qu’elle va dans le débarras. Mademoiselle Esther s’est décoiffée et tourne sa casquette blanche dans ses mains, machinalement. Elle pose des yeux distraits sur tous les objets de la salle à manger, sauf sur moi. J’entends un bruit de clé que je connais bien, une porte d’armoire qui s’ouvre, qui grince, qui se referme. Ma mère revient, une main couvrant l’autre, comme si elle tenait un oiseau qu’elle voudrait cacher ! Elle est bien obligée de les ouvrir. Ce n’est pas un canari, mais une carte jaune pâle, pliée en deux, qui apparaît. Mon cœur bondit...
— Tenez, mettez là tout de suite dans votre sac, Mademoiselle... lisez vous même... Jeannine Bourgeois, et souvenez-vous bien de votre nouveau prénom. Pareil pour votre nom de famille !
— Jeannine Bourgeois ! C’est vrai, ça ne fait pas juif du tout ! Oh ! merci du cœur à votre mari ! Je vous dois combien pour la casquette ?
— Vous n’y pensez pas, juste pour une couture ! Allez, sauvez-vous, j’espère que vous aurez un train pour Vierzon, attention à vous et bon voyage !
Je me lève. J’ai droit à un deuxième sourire, un vrai cette fois et comme Maman, à deux baisers de la jolie dame blonde, avant qu’elle ne disparaisse dans l’escalier. Il faudra que je cherche dans le dictionnaire de mon frère, le mot « juif ».
J’ai horreur du métro en fin d’après-midi. A chaque fois que je le prends avec ma mère, la même crainte m’envahit : pendant ce voyage souterrain dans des wagons toujours bondés, debout, j’ai peur d’être écrasé ! Du haut de mes sept ans, je ne vois pas bien haut ! La main dans celle de ma mère, à chaque station, je suis emporté et repoussé avec elle par une nouvelle vague montante, vers le fond du wagon. Le visage pressé contre un sac à main ou les boutons d’une veste ! Si ce n’est pas le ceinturon d’un boche ! Ce soir, je ne peux que m’agripper au manteau de maman. Elle porte deux valises, moi le petit panier en osier avec les provisions. Nous partons vers la gare d’Austerlitz prendre le train de nuit pour le Lot, le pays de mon père, où l’on va chaque année. En service de nuit, il n’a pas pu nous accompagner à la gare. Il nous rejoindra dans un mois, pour ses congés, s’il peut les prendre. Nouvelle décision familiale, mieux vaut finalement que nous quittions Paris, vu les circonstances. C’est l’exode donc, pour nous aussi. Il commence dans le métro, à l’heure d’affluence.
Au changement, à la station Jussieu, nouvelle bousculade dans le wagon. Elle m’éloigne de ma mère, je lâche la barre centrale, on me marche sur les pieds, je suis pris dans un étau, entre la hanche d’une dame très forte et la jambe bottée d’un grand militaire allemand. Je vois la visière de sa casquette verte galonnée au dessus de moi, je vais étouffer ! Soudain, deux mains me prennent le torse et me soulèvent au dessus de la foule pour me dégager, je suis dans les bras de l’officier qui me sourit. Il a compris ma détresse. Je vois ma mère crispée à côté de lui, elle n’a plus son chapeau. J’ai l’impression que tous les voyageurs me regardent. Méchamment. Je n’ai pas lâché mon panier, je domine le wagon, à la fois gêné et heureux de respirer à nouveau ! Gare d’Austerlitz, le géant me dépose sur le quai du métro, ma mère lui lance un timide « oh ! merci beaucoup », lui me gratifie d’un clin d’œil. Il dépose même les deux valises de ma mère sur le quai et remonte dans le wagon. Je suis muet, la gorge encore serrée, je reprends mon souffle. Pas tout à fait mauvais l’occupant, je me dis !