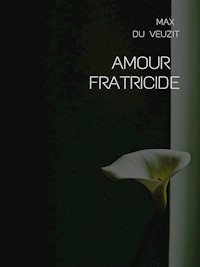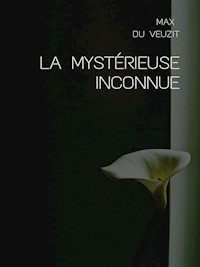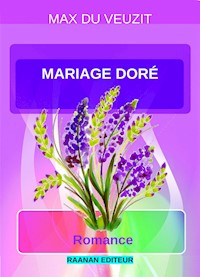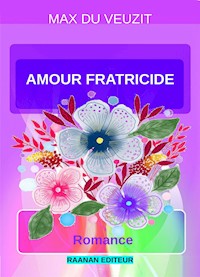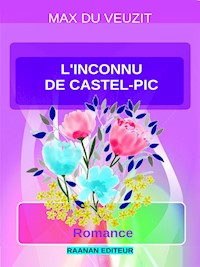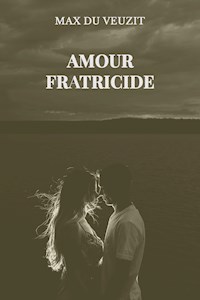
2,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Depuis de longues générations, les Guilo étaient pêcheurs, et Pierre, comme ses ancêtres, vivait péniblement du produit de sa pêche. C'était un honnête homme dans toute l'acception du mot, et, bon camarade, hardi marin, toujours prêt à voler au secours des malheureux en danger sur la grande eau traîtresse, - il était aimé de ses proches et estimé du tous ceux qui le connaissaient. Vingt-cinq ans auparavant, il avait épousé Catherine, une orpheline, aînée de sept enfants, qui ne lui avait apporté en dot que sa jeunesse et son courage. Ensemble, ils vivaient, sinon aisés, du moins heureux, et la naissance attendue d'un enfant, au début de leur union, avait semblé devoir couronner leur bonheur, Pourtant, quand Catherine avait mis au monde, le même jour, deux jolis petits garçons, robustes et bien constitués, une grande consternation avait régné dans la maison. C'était une opinion bien établie dans la famille et même dans Saint-Géran, que jamais on n'avait vu deux frères vivre ensemble sous le toit d'un Guilo.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 73
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Amour fratricide
Max du VeuzitPremière partieIIIIIIIVVVIVIIIXXDeuxième partieI - 1II - 1III - 1IV - 1V - 1Page de copyrightAmour fratricide
Max du Veuzit
Max du Veuzit est le nom de plume de Alphonsine Zéphirine Vavasseur, née au Petit-Quevilly le 29 octobre 1876 et morte à Bois-Colombes le 15 avril 1952. Elle est un écrivain de langue française, auteur de nombreux romans sentimentaux à grand succès.
Première partie
I
Le petit hameau de Saint-Géran, situé sur la baie de la Fresnaye, dans les Côtes-du-Nord, n’est habité que par quelques familles de pêcheurs.
C’est dans cette pauvre bourgade que se dressait, il y a une cinquantaine d’années, la chaumière de Pierre Guilo.
Depuis de longues générations, les Guilo étaient pêcheurs, et Pierre, comme ses ancêtres, vivait péniblement du produit de sa pêche.
C’était un honnête homme dans toute l’acception du mot, et, bon camarade, hardi marin, toujours prêt à voler au secours des malheureux en danger sur la grande eau traîtresse, – il était aimé de ses proches et estimé du tous ceux qui le connaissaient.
Vingt-cinq ans auparavant, il avait épousé Catherine, une orpheline, aînée de sept enfants, qui ne lui avait apporté en dot que sa jeunesse et son courage.
Ensemble, ils vivaient, sinon aisés, du moins heureux, et la naissance attendue d’un enfant, au début de leur union, avait semblé devoir couronner leur bonheur,
Pourtant, quand Catherine avait mis au monde, le même jour, deux jolis petits garçons, robustes et bien constitués, une grande consternation avait régné dans la maison.
C’était une opinion bien établie dans la famille et même dans Saint-Géran, que jamais on n’avait vu deux frères vivre ensemble sous le toit d’un Guilo.
En effet, les vieilles gens rappelaient que par un rapprochement fatal, chaque fois que l’épouse d’un Guilo avait donné le jour à un deuxième enfant mâle, toujours cette naissance avait été suivie de douloureux événements.
Rien, cependant, cette fois-ci, n’avait paru devoir confirmer cette tradition, et petit à petit, le pécheur et sa femme oublièrent la terreur qui les avait assaillit à la venue de leurs fils.
Les jumeaux portaient les noms d’Ervoan et d’Yau1.
Ils venaient d’atteindre leur vingt-troisième année, quand commence cette histoire.
Très grands tous les deux, très forts et très musclés, large d’épaules, les cheveux d’un blond roux, les yeux bleus et vifs, le front hardi, c’étaient deux beaux types de Bretons chez lesquels on retrouvait toutes les qualités physique de la race.
Quoiqu’ils se ressemblassent d’une façon frappante, leurs caractères étaient diamétralement opposés.
Ervoan était gai, vif et alerte. Il avait sans cesse le mot pour rire, et en toute circonstance, prenait le bon côté des choses.
Yan, au contraire, était sombre et taciturne. Tout jeune, il s’était fait remarquer par ses allures singulières, par ses longues rêvasseries, par son désir de solitude, et cette disposition à la mélancolie n’avait fait qu’augmenter avec l’âge.
Cette grande différence morale entre les deux frères n’avait pas arrêté leur mutuelle tendresse ; au contraire, chacun dans la contrée les citait comme étant le plus bel exemple d’amitié fraternelle.
Ervoan sacrifiait à son frère les divertissements bruyants qui l’attiraient, et Yan s’efforçait de rire et de s’amuser pour ne pas priver son « besson » d’une partie de plaisir où celui ci n’eût pas été sans lui.
La demeure des Guilo, située à droite de Saint-Géran, était presque en dehors du village. Élevée à mi-côte, c’était une vieille bâtisse au toit de chaume, aux murs effrités, dont la façade, tournée vers la mer, permettait aux habitants de contempler sans trêve l’immense étendue d’eau mouvante, aux reflets miroitants gris ou bleus, selon le temps ou les heures, au murmure indéfini, et qui, dans le lointain, se confondait avec l’azur du ciel.
Du seuil de la porte, on apercevait aussi, suivant le pied des blanches falaises, le long ruban sinueux des grèves sombres où les rochers et les écueils pointus dressaient leurs crêtes brunes que la mer en écumant couronnait de mousse.
Derrière l’habitation des Guilo, et séparée d’elle par une longue bande de terrain inculte, une petite masure s’abritait, frileusement, eu ton dit, sous l’épais feuillage de trois grands chênes pressés contre ses murs et qui semblaient vouloir l’écraser de leur force.
Une jeune fille occupait seule cette misérable bicoque. Annaïc2 Brunec était encore bien jeune, quand ses parents moururent.
Son père, un pêcheur comme Pierre Guilo, périt dans une tempête et sa mère en ressentit un si violent chagrin qu’elle ne lui survécut que peu de temps. L’enfant resta donc seule... ou presque seule, du moins. Une vieille cousine de son père la recueillit. La femme était très pauvre et sa charité envers l’orpheline avait l’intérêt pour but.
Elle se servit de la petite comme d’une servante, ne la nourrissant que de quelques croûtes de pain souvent dur, et lui demandant en revanche une somme de travail très importante pour une enfant si jeune. Annaïc poussa cependant comme poussent les fleurs des champs, sans qu’aucune main attentive l’eût soignée.
Quand la fillette eut sept ans, la vieille l’envoya sur les grèves, à marée basse, pour y ramasser des moules ou y pêcher des crabes.
Armée d’un crochet, Annaïc partait, les pieds nus, les jupes retroussées, la hotte sur le dos ou le panier au bras, explorer les rochers implantés dans le sable, depuis des siècles, dans un désordre pittoresque.
À ce rude labeur – car le métier de pêcheur de crabes est dur pour les jeunes enfants – les petites mains d’Annaïc s’étaient souvent meurtries et déchirées, et bien des fois aussi en voulant descendre dans le creux des roches pour y sonder les crevasses, ses pieds glissèrent sur la surface abrupte des pierres couvertes d’herbes gluantes.
C’est dans une de ccs circonstances qu’Annaïc rencontra les frères Guilo, alors âgés de douze ans.
En voulant harponner un crabe, la fillette, qui se trouvait debout sur un écueil, perdit l’équilibre et tomba si malencontreusement que sa tête porta sur la saillie aiguë d’une arête de roc. La douleur fut si vive qu’elle perdit connaissance.
La mer montait, et Annaïc aurait infailliblement péri, si sa bonne étoile – ou peut-être sa mère qui veillait sur elle du haut du ciel –n’eût justement amené les jumeaux vers cette partie des grèves.
Les deux frères, le pantalon retroussé jusqu’au dessus des genoux, cherchaient des coquillages.
Ervoan, toujours plus remuant, marchait en avant. Ce fut lui qui découvrit l’enfant étendue, inanimée, au fond d’une coulée profonde, entre deux rochers.
Descendre pour lui porter secours, la prendre dans ses bras, et, avec l’aide de son frère qu’il avait appelé, la mettre en lieu sûr, ce fut l’affaire de quelques minutes, et bientôt, les jeunes garçons eurent la joie de voir Annaïc ouvrir les yeux.
De cette dramatique rencontre, les trois enfants gardèrent toujours le souvenir.
Ervoan et Yan, heureux et fiers de l’important rôle qu’ils avaient joué ce jour-là, se plurent, par la suite, à protéger et à défendre la petite fille, qui, de son côté, n’oublia jamais qu’elle leur devait la vie.
Dans sa triste existence d’abandonnée, Annaïc n’avait jamais connu la tendresse.
Chez les gens qui l’entouraient, elle devinait plutôt un sentiment de pitié que de sympathie. On la plaignait, on ne lui eût point fait de mal, mais nul ne songeait à dépasser à son égard cette bienveillante indifférence : nul ne se disait que l’humble enfant craintive était bien seule et bien abandonnée, que son jeune cœur n’avait personne pour satisfaire ce besoin d’expansion qui est inné chez tous.
Personne... Seule...
Seule, surtout à l’âge où les caresses d’une mère sont aussi nécessaires que le pain quotidien !
Et toute petite, repliée sur elle-même sans une main amie tendue vers elle, sans une parole pour la réconforter, l’esseulée grandissait, effrayée et sauvage, dans cette absence de sympathie. Sa rencontre avec les frères Guilo fut donc pour elle tout un événement, et quand elle les eut revus plusieurs fois, elle chercha le plus possible à se rapprocher d’eux.
Elle les aima d’une tendresse de petite sœur – craintive et admirative à la fois – déversant sur eux tout le trop-plein de son cœur comprimé.
Étrange destinée qui la poussait vers eux pour leur malheur et pour le sien.
Les jumeaux rendirent à la fillette la vive amitié qu’ils lui avaient inspirée, et entre ces trois braves enfants un doux lien se forma, que les années ne firent que resserrer davantage, si bien que petit à petit, et presque à leur insu, un sentiment plus tendre se fit jour dans le cœur des deux frères : ils aimèrent d’amour la compagne de leurs jeux.
Mais ils l’aimèrent, chacun selon son tempérament.
Ervoan mit dans sa passion tout ce qu’il y avait de fort, de noble, de puissant en lui. Il aima en homme énergique qui ne voit pas seulement dans la femme l’être de grâce et de tentation : l’être faible à protéger et à défendre, dont la faiblesse même excite les désirs mais aussi celle qui doit être la vaillante et dévouée compagne de l’existence, la mère de nombreux enfants, la vraie force du foyer, celle dont on aime à presser la main dans les jours de malheur, parce qu’à son contact, on sent son énergie s’accroître de toute la sienne à elle.
L’amour d’Yan était tout différent.