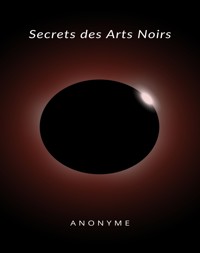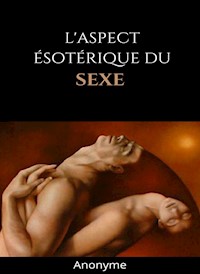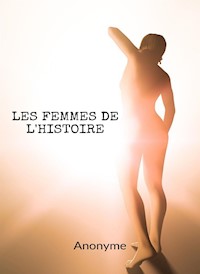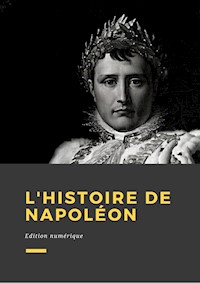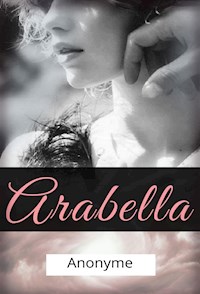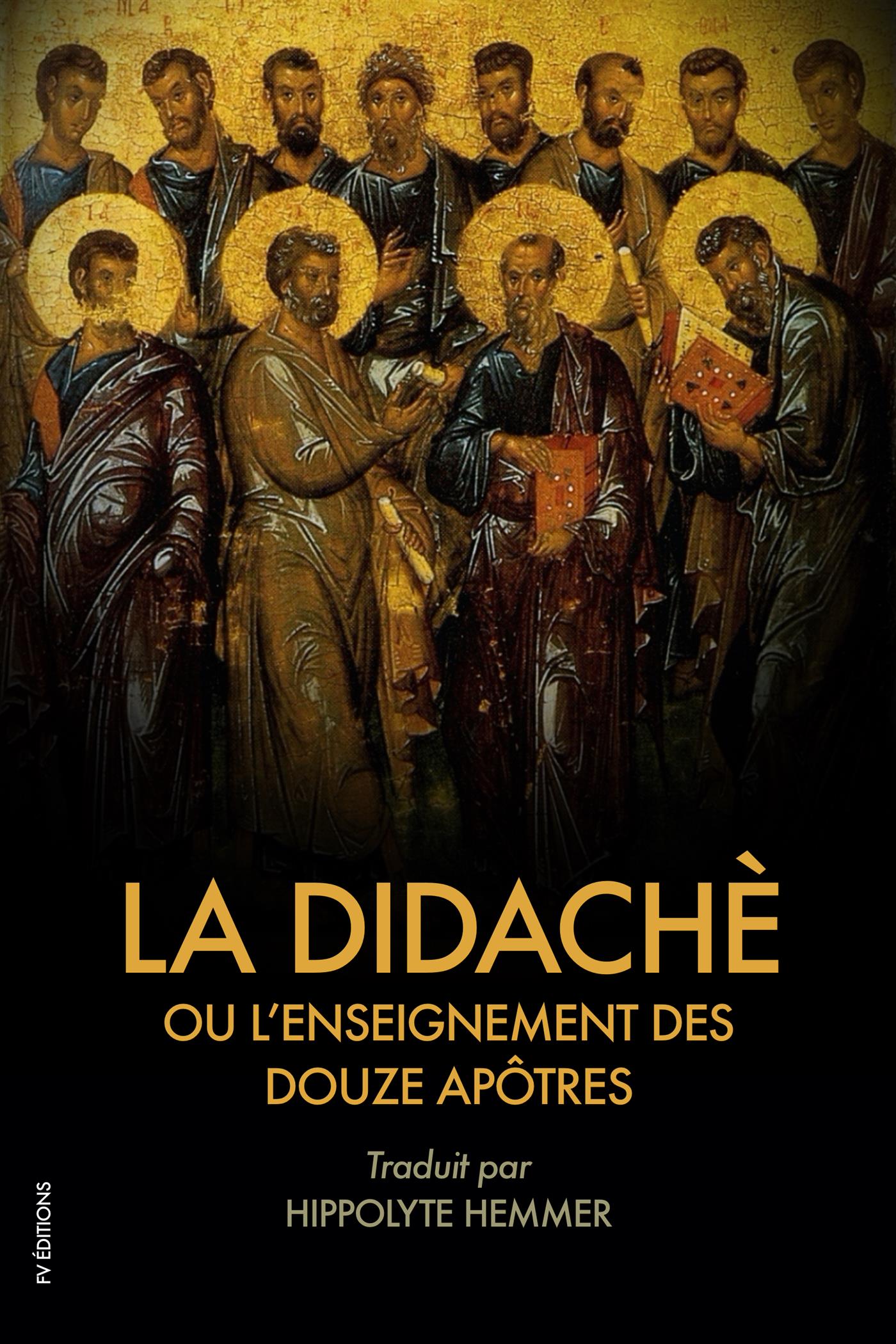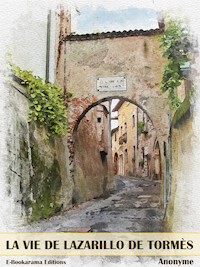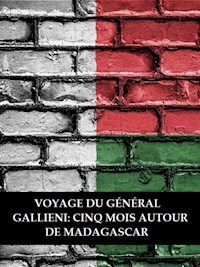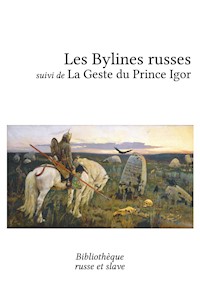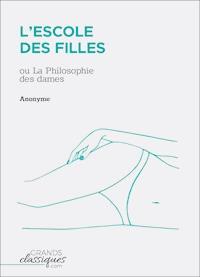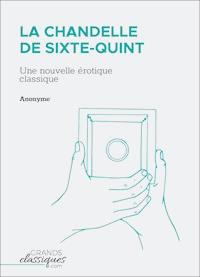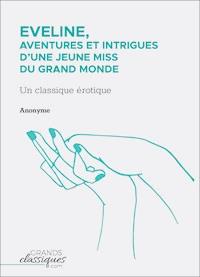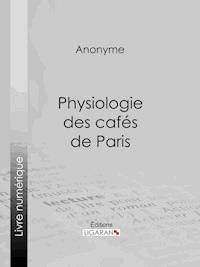149,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bruylant
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Annales du droit luxembourgeois
- Sprache: Französisch
Au sommaire de ce volume, on retrouve les contributions suivantes : Mes professeurs à la Faculté de droit et aux Sciences Po Paris, 1946-1947, par Georges Als Le droit de la grappe au Luxembourg par Nico Schaeffer La responsabilité des professionnels du droit par Alex Engel Retour sur la consolidation, cause d’extinction de l’usufruit par Hannes Westendorf Modalités de la réglementation des clauses d’indexation de prix au Luxembourg, en France, Belgique et Allemagne par Pascal Ancel, Bertrand Christmann, Xavier Dieux et Fabienne Kutscher-Puis Actualités du droit antidiscrimination par François Moyse Les évolutions récentes en matière d’assistance internationale en droit fiscal luxembourgeois par Jean-Pierre Winandy Droit des sociétés (2006-2012) par Franz Fayot et Cintia Martins Costa Cour de justice de l’Union européenne (2010) par Georges Friden et Jacques Thill La pratique luxembourgeoise en matière de droit international public (2009-2010) par Georges Friden et Patrick Kinsch
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 748
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Cette version numérique de l’ouvrage a été réalisée pour le Groupe De Boeck. Nous vous remercions de respecter la propriété littéraire et artistique. Le « photoco-pillage » menace l’avenir du livre.
Pour toute information sur notre fonds et les nouveautés dans votre domaine de spécialisation, consultez notre site web : www.bruylant.be
© Groupe De Boeck s.a., 2012 Éditions Bruylant Rue des Minimes, 39 • B-1000 Bruxelles
Tous droits réservés pour tous pays. Il est interdit, sauf accord préalable et écrit de l’éditeur, de reproduire (notamment par photocopie) partiellement ou totalement le présent ouvrage, de le stocker dans une banque de données ou de le communiquer au public, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit.
ISBN 978-2-8027-4034-6
Préface
Le 20e volume des Annales du Droit luxembourgeois couvre à nouveau une large panoplie de sujets juridiques.
L’article de M. Georges Als rappelle aux souvenirs de nos lecteurs des grands enseignants de la Faculté de Droit de Paris et de Sciences Po dans les annees de l’après-guerre, ainsi que l’organisation de cours spécifiques pour les étudiants luxembourgeois.
Me Nico Schaeffer consacre sa contribution à un sujet qui à notre connaissance est inedit dans les pages d’une revue juridique luxembourgeois : le droit de l’activite vinicole au Luxembourg.
M. Hannes Westendorf aborde un sujet de droit des biens, en traitant de la consolidation comme cause d’extinction de l’usufruit.
La contribution suivante, sous les plumes de MM. Pascal Ancel, Bertrand Christmann, Xavier Dieux et Fabienne Kutscher-Puis se penche sur les modalités de la réglementation des clauses d’indexation, en prenant une approche comparative entre les droits luxembourgeois, français, beige et allemand.
Me François Moyse fait un tour d’horizon des actualites en matiere de droit antidiscrimination.
Me Jean-Pierre Winandy analyse les évolutions récentes en matiere d’assistance intemationale en droit fiscal luxembourgeois.
Dans une contribution provenant de l’Association Henri Capitant (Journées Cambodge-Vietnam), Me Alex Engel analyse la question de la responsabilité des professionnels du droit au regard de la jurisprudence récente.
Suivent ensuite les traditionnelles chroniques consacrées respectivement au droit des sociétés (années 2006-2012, par MMes Franz Fayot et Cintia Martins Costa), à l’actualité de la Cour de Justice de l’Union européenne (2010), par MM. Georges Friden et Jacques Thill, et à la pratique luxembourgeoise en matière de droit international public (M. Georges Friden et Me Patrick Kinsch).
DeanSpielmann
Marc Thewes
Franz Fayot
Steve Jacoby
Alex Engel
Partie générale. Articles
Mes professeurs à la faculté de droit et aux sciences Po Paris, 1946-1947 (1)
par
Georges Als
Professeur honoraire à l’ULB Directeur honoraire du States
À deux ans seulement de la fin de la guerre Paris, fin 1946, souffrait encore de pénuries. L’hiver, on étudiait emmitouflé dans des couvertures. Périodiquement, un camionneur apportait des paquets de vivres aux étudiants luxembourgeois. À la Cité universitaire, la chambre que j’aurais voulue était réservée depuis longtemps, trop tard ! J’eus l’idée d’offrir une livre de café à la secrétaire, la chambre devint soudain disponible. Post hoc, ergo propter hoc.
Nous étions plusieurs à vouloir suivre l’exemple d’aînés qui, à l’époque, n’étaient pas encore illustres – Pierre Werner, Ernest Arendt… – et qui, avant-guerre, avaient réussi à mener de front deux sortes d’études, celles de droit à la Faculté, rue Soufflot, et de sciences politiques à l’ancienne École libre des sciences politiques, entre-temps nationalisée et baptisée « Institut d’études politiques », à la rue Saint-Guillaume. Le régime des deux écoles était fort différent, ainsi qu’on le lira ci-après. Mais ces souvenirs n’ont pu être reconstitués que grâce à des notes prises sur le vif, à l’époque, et qui en garantissent l’authenticité.
I. – Souvenirs de la Faculté de droit
A. – Premières impressions : le chahut
Les premiers cours ne furent qu’un vaste chahut. À l’ouverture, une tourbe d’au moins cinq cents « étudiants » (où étaient les autres, car 21.000 jeunes étaient inscrits à la Faculté de droit ?) était venue acclamer le professeur JulienLaferrière (1881-1958), titulaire du cours de droit constitutionnel. Dans l’amphithéâtre, ça criait, hurlait, sifflait, alors que de petits avions en papier planaient au-dessus de nos têtes. Des gars étaient montés en chaire pour haranguer la foule, quand le professeur entra solennellement, vêtu de sa toge. M. Laferrière saisit au col l’un des orateurs, le traîna jusqu’à la porte et lui flanqua un rude coup de pied, quittant ainsi la gravité qu’il avait observée en entrant. Entre-temps, l’huissier devait s’occuper d’autres garnements, tandis que redoublaient les hurlements, renforcés encore par des cors de chasse et des trompettes.
Julien Laferrière
D’un air résigné, le professeur attendit une accalmie pour prononcer : « Je vais vous faire le cours de droit constitutionnel ». Quelqu’un cria : « T’as raison », et le tapage reprit de plus belle. Des V2 en papier, allumés à la queue, planaient en brûlant, puis fonçaient sur le professeur en se consumant. Incroyable, inimaginable ! Des chœurs se formaient : « Remboursez, remboursez... », puis des « échos » répétaient le dernier mot de chaque phrase prononcée par le professeur. Cela continua pendant toute la première semaine, à ce qu’il paraît, car je n’avais plus le cœur de m’y rendre.
Gabriel Le Bras
Le professeur Gabriel Le Bras (1891-1970), spécialiste du droit romain fut, lui aussi, pris dans ces turbulences. Avant sa première leçon, un mauvais plaisant avait dessiné au tableau des caricatures du professeur et posé un sac de dame sur la chaire. M. Le Bras fit semblant de ne rien voir, mais le farceur l’interpellait sans cesse en posant des questions drôles. Faisant bonne mine au mauvais jeu, le prof répondait ou non, selon les questions. Enfin, exaspéré, il s’avança dans la salle : « Monsieur, vous m’interrompez tout le temps. Qu’est-ce qui vous prend ? Quel est votre nom ? » Le type vint à sa rencontre, et désignant la classe : « Ils sont amorphes. Ah oui, Monsieur, vous faites bien de vous fâcher. Je tâche de les réveiller en animant la discussion. Mais… voyez le résultat ». M. Le Bras fut désarmé. Il retourna à sa chaire en disant : « Oui, j’aime bien qu’on me pose des questions. Il faut que vous réfléchissiez sur ces problèmes ». Le farceur lança : « Voilà un type épatant », et continua de s’en moquer par ses questions insolentes ; on ne fit plus rien durant la leçon ; quand le professeur sortit, l’autre chahutait encore : « Au pouvoir ! Au pouvoir !... Guckuck ! ».
Le même garçon s’en prit aussi à M. Julliot de la Morandière qui, parlant des élèves en droit et de leur réputation, se posait la question : « Que font les élèves en droit quand ils arrivent à la Faculté ? » L’autre répondit : « Du chahut ! ». Julliot : « Oh ! ça ne nous intéresse guère ». Le farceur : « Évidemment, vous en avez l’habitude ». Peu après, le doyen arriva néanmoins à congédier le vaurien et sa bande.
Signalons encore cet avis affiché à la porte d’une salle de cours :
Les pilules Esmein contre l’insomnie sont en vente à la Faculté tous les mercredis de 10 à 12 heures.
J’aimais moins la Faculté que l’École, d’abord parce que la Fac était un vieux bâtiment moins confortable, mais surtout à cause de la lamentable mentalité des étudiants de première année en droit. Lorsqu’en économie politique il était question de la population et des moyens de la limiter, ou lorsqu’en droit civil le professeur traitait de l’union libre, de l’adultère, etc., il y avait toujours des « oh ! », des « ah ! », des claquements de langue ironiquement réprobateurs ou des applaudissements. Pénible !
B. – Mes professeurs de la Faculté de droit
Passons aux choses sérieuses. Voici des souvenirs qui, malheureusement, se limitent à quelques enseignements.
Léon Julliot de la Morandière
Le droit civil I (première partie) nous était enseigné par M. Léon Julliot de la Morandière (1885-1968), doyen de la Faculté, membre de l’Institut, président de la commission de réforme du Code civil. Juriste subtil, c’était un homme d’une intelligence remarquable, en même temps que d’une exquise amabilité. Y avait-il quelque part un congrès ou un banquet en quête d’orateur, c’est généralement lui qu’on y députait, car Julliot avait l’esprit et la politesse qu’il faut pour bien évoluer dans le monde. Il fut aussi le seul de nos professeurs à avoir un contact humain avec ses élèves, nous posant des questions ou faisant des bons mots. Il venait même nous parler après la leçon ! Surtout, il fut d’une extrême gentillesse pour nous autres, Luxembourgeois, et nous invitait à venir le trouver quand on aurait quelque question. C’est qu’il gardait un excellent souvenir de sa visite à Luxembourg en février 1947, à l’occasion de laquelle le Jeune barreau l’avait royalement reçu et offert de plantureux banquets.
Julliot était très aimé des élèves ; il avait l’art de contenir cet auditoire confus que sont des élèves de première année. Tandis qu’Esmein s’interrompait pour dire : « Taisez-vous là haut ! », Julliot, le plus aimablement du monde, se tournait vers les parleurs : « Ne plaidez pas encore ! ». Son cours était plus approfondi que celui de M. Rouast, raison pour laquelle il n’arrivait pas à le mener à terme. Il en était conscient, mais tenait avant tout à faire aimer le droit civil à ses élèves, ce qui n’est pas toujours une tâche facile. Ses opinions étaient celles d’un esprit sagement conservateur. Dans son introduction au droit, c’est avec une parfaite clarté qu’il nous exposait les points de vue socialistes, mais ses propres arguments tendaient à la préservation des éléments qu’il considérait comme essentiels parmi les conceptions classiques du Code.
Par contraste, en droit civil II, la salle restait à moitié vide. M. Esmein était un petit homme vieillot, à la physionomie pleureuse, récitant tout sur un même ton. Même s’il fut des fois original et amusant, le professeur était banal dans l’expression et manquait d’esprit, ce qui devait être à l’origine de l’affiche citée ci-dessus.
En droit romain II, c’était aussi le vide, mais la raison en devait tenir au caractère ardu de la matière plutôt qu’au maître. Car l’enseignement de M. Besnier était remarquable, on aurait dit un cours professé par un artiste. Besnier avait devant lui les notes de l’année précédente (que je possédais), et cependant il improvisait des phrases merveilleusement équilibrées. Sa diction était des plus pures, et de la langue française, déjà si légère, il faisait comme une musique de Mozart, flottant en l’air, sans effort. Je n’ai entendu d’élocution aussi cultivée et fine qu’à la Comédie-Française dans les comédies spirituelles de Musset. Avec cela, Besnier parlait très vite ; son cours était abstrait, concentré, dépouillé, à l’image des mathématiques. Aussi fallait-il une attention concentrée pour le suivre. J’aimais cette abstraction, et me rappelle que Leibniz appréciait ce côté du droit romain, car il écrit (en latin) :
« J’admire la méthode du Digeste, ou plutôt celle des auteurs dont sont extraites ses citations, et je n’ai jamais rien connu qui, fût-ce comme subtilité des arguments, fût-ce comme vigueur des raisonnements, eût davantage approché de la sagacité des mathématiciens. »
Mais l’intérêt réel du droit romain me semble consister à saisir ce que Iering, à la suite de Montesquieu, appelle « L’esprit du droit romain ». Besnier faisait admirablement ressortir cet aspect dans sa conclusion générale. Le droit naît de l’histoire. Par quels moyens, par quels détours ? C’est ce que nous montre d’une façon tout à fait unique le droit romain dont nous avons sous les yeux l’évolution millénaire. Le droit est le produit complexe de facteurs économiques, politiques, moraux, religieux, etc., n’agissant jamais seuls, mais dont l’un peut jouer un rôle prépondérant, des facteurs qui varient suivant les époques, et dont l’effet peut suivre la cause avec retard, comme dans le cas du christianisme. Le droit romain en fournit des légions d’exemples.
M. Besnier terminait son aperçu du droit romain des obligations par une passionnante conclusion sur la crise contemporaine du droit romain, ainsi que sur les causes de la ruine de l’empire romain.
Autre souvenir mémorable, mais d’un bien autre genre, celui du cours d’économie politique de seconde année donné par un vieux professeur délicieux. M. Henri Noyelle. C’était le type du « vrai » professeur, barbu, éloquent, truculent, sachant faire durer ses effets. On avait plaisir à l’écouter. Aussi son succès était-il à l’égal de ses qualités, avec une salle comble jusqu’aux marches accédant à la chaire.
Cours spéciaux pour les Luxembourgeois
Après Pâques, la Faculté organisa trois cours spéciaux pour les étudiants luxembourgeois. Ils portaient sur le droit civil (Solus), le droit public (Laferrière), et le droit pénal (Donnedieu de Vabres). Sans exception, ces cours furent de haute qualité.
Henry Solus
M. Julien Laferrière, se livrant à une analyse de la Constitution luxembourgeoise, réussit chemin faisant à nous fournir un aperçu précieux sur le droit constitutionnel.
En l’espace de deux semaines, M. Henry Solus (1892-1981) – futur pivot des Amitiés franco-luxembourgeoises de Paris – traça un tableau fort utile des principales différences entre les droits civils français et luxembourgeois.
Pour bien profiter de ces cours, il eût fallu travailler nuit et jour, tant était dense leur matière.
C. – Mes professeurs de Sciences Po
Quel contraste avec le chahut de la Faculté ! Aux Sciences Po, on aurait plutôt dit des offices religieux, ou des spectacles. Le professeur n’y était pas à sa chaire, mais sur une scène de théâtre. À 14 heures précises, il faisait son entrée, précédé d’un huissier. Toute conversation cessait et, d’un coup, les 500 étudiants peuplant l’amphithéâtre Émile Boutmy et son balcon se levaient et restaient debout jusqu’à ce que le maître eût dit : « Asseyez-vous ! ». La leçon commençait sur-le-champ et se poursuivait sans interruption jusqu’à 15 heures moins une. À ce moment, le professeur se levait, prononçait ses dernières paroles en se promenant de long en large ; sur le coup de l’heure, il quittait la salle. Pendant ces soixante minutes, il nous aura dit bien des choses.
L’histoire politique générale de 1610 à nos jours nous était enseignée par M. Pierre Renouvin (1893-1974), professeur à la Sorbonne et membre de l’Institut, âgé alors de 53 ans. C’était un homme grand et fort, invalide de la Première Guerre, manchot et ayant un pouce atrophié, mais il s’en tirait avec ses quatre doigts, réussissant même à écrire au tableau. Après son entrée, M. Renouvin arpentait d’abord la scène en promenant le regard sur son auditoire. L’on frémissait en contemplant cet homme imposant. Prenant place à la table, le professeur sortait ses lunettes de l’étui en le pressant entre son menton et l’épaule et commençait à parler. Chacune de ses leçons était l’exposé tripartite – causes, formes, résultats – d’un grand chapitre historique, tel que « La Réforme » ou « La Révolution française » ou « Les mouvements sociaux au XIXe siècle ». L’ensemble de ces leçons, pendant lesquelles il renvoyait constamment les élèves aux cours complémentaires de MM. Chevallier et Morazé, formait une admirable synthèse de l’histoire, dominée par un grand souci d’objectivité. Professeur aussi d’histoire diplomatique, Renouvin brossait des tableaux machiavéliques des relations internationales aux différentes époques. L’individu a beau tendre vers un idéal de moralité, en politique ne comptent que l’intérêt, la force et l’égoïsme, que cela s’appelle « équilibre européen » ou « poussée vers la mer chaude », ou « débouché économique », ou encore « unification nationale ». Dans le concert des nations percent surtout les bruits de la jungle. En voici un exemple : en 1815, l’Angleterre restitue aux Pays-Bas les Indes néerlandaises acquises durant l’occupation de la Hollande par Napoléon. Pourquoi ce geste ? Justice ? Ou pour être agréable aux Hollandais ? Mais non ! Il s’agissait de faire en sorte que le royaume des Pays-Bas eût assez de force pour constituer une barrière contre la France ; pour le surplus, se conciliant les Hollandais, l’Angleterre pensait exercer son contrôle sur les Indes néerlandaises. En politique, il faut ou bien être plus fort ou meilleur diplomate.
Pierre Renouvin
L’homme qui nous traçait cette fresque fut lui-même d’une certaine dureté. À témoin, ce propos brutal, et en somme inutile, qu’il nous tint lors de sa première leçon : « Il y a des élèves qui se plaignent, surtout durant les premiers mois, d’être surchargés de travail. Ceux qui sont de cet avis, eh bien ! ils n’ont qu’à s’en aller ! ».
Mais je retiendrai de son enseignement quelques grandes leçons, à commencer par le désir de rechercher les causes véritables des phénomènes historiques et de les juger dans leur rapport avec le milieu et la mentalité des hommes, ou encore par comparaison avec des cas analogues ; ensuite, la conviction que les causes de l’évolution historique sont complexes, enfin et surtout que l’idée aussi joue un rôle en histoire, et que la personnalité n’est pas qu’une marionnette, que même le hasard y a sa part.
Complémentaire du premier cours, l’Histoire des idées politiques avait pour auteur Jean-Jacques Chevallier (1900-1983), jeune homme de 46 ans – alors qu’on s’attendait à un monsieur barbu et ventru – qui arrivait en vélo à l’Institut, se faisait placer un petit pupitre sur la table afin de pouvoir parler debout. Tour à tour spirituel, poétique, solennel, amusant, Chevallier commençait par nous parler de cette « méditation intense et millénaire de l’esprit humain sur la provenance du pouvoir », ses formes et ses divisions, façon d’aborder enfin cette science merveilleuse qu’est – ô moment solennel ! – l’histoire des idées politiques !
Jean-Jacques Chevallier à la fin de sa vie.
Jean-Jacques Chevallier était aussi professeur de droit constitutionnel comparé à la Faculté de droit. C’était un homme de taille moyenne, musclé, au visage d’acier, à l’expression volontaire. Fervent sportif – qui allait jusqu’à emprunter des images aux règles sportives pour expliquer des idées politiques – il jouait encore au football, et faisait de l’alpinisme. Chevallier ne s’asseyait pas, mais lisait son cours, debout, en levant continuellement la tête pour regarder son auditoire. En effet, son cours épousait un style si parfait qu’il eût été dommage d’y changer un mot. Excellant à exposer clairement des notions complexes, il nous montrait en quoi consiste la démocratie et en quoi les régimes totalitaires ont pris son contre-pied. Analyse magistrale des auteurs politiques, où toujours l’analyste avait le souci de montrer l’homme derrière son œuvre, au besoin lançant un propos frivole pour dérider son auditoire.
Cette histoire allant de Machiavel à Hitler, curieux voyage en zigzags de Florence à Nuremberg, était notre cours le plus passionnant. Soucieux d’objectivité, Chevallier se bornait à exposer en se gardant de juger. Mais l’on sentait à travers les mots la foi politique qui l’animait. Plein d’enthousiasme quand il parlait de John Locke, ou de Montesquieu « dont le buste manque encore dans le hall des pas perdus de l’École », sa langue se chargeait de sous-entendus étymologiques et d’allusions historiques lorsqu’il évoquait Lénine et Staline, ce dernier encore en vie à l’époque. Alors, c’était un délice de l’écouter. D’autre part, il ne cachait pas son admiration pour la vieille Angleterre, pour sa sagesse politique et l’esprit civique de ses citoyens, et enfin pour son vieux lutteur Churchill.
Cette analyse profonde, des fois spirituelle, nous invitait à lire les grandes œuvres politiques, à commencer par Le Prince de Machiavel, puis les Mémoires de Louis XIV, les Lettres philosophiques de Voltaire, la conférence de Renan sur « Qu’est-ce qu’une Nation ? », enfin trois ouvrages de l’ère des tyrannies : Les principes du léninisme de Staline, La doctrine du fascisme de Mussolini et Mein Kampf de Hitler, et si possible encore d’autres écrits de poids, tels que La politique d’Aristote, l’Essai sur le gouvernement civil de Locke, L’esprit des lois de Montesquieu, La démocratie en Amérique de Tocqueville et les Réflexions sur la violence de Georges Sorel.
Son enseignement, expliquait Chevallier, était synchronisé avec nos deux autres cours historiques, afin de nous fournir une vue d’ensemble de tous les aspects de l’évolution humaine… trois enseignements fusionnant pour ne former plus qu’un gigantesque ensemble, symbole de la Sainte Trinité.
Mais le cadet de la trinité n’était pas à la hauteur, hélas, de ses aînés. Le cours de Charles Morazé (1913-2003) sur l’histoire économique n’était pas au diapason des deux premiers. Maître de conférences à la Sorbonne, Morazé savait émailler son cours d’anecdotes, mais manquait de clarté. Il parlait librement, sans notes, mais aussi sans plan, d’où par moments une impression de chaos ; son style oral manquait d’élégance. Le professeur se croyait brillant, parce qu’il savait faire de l’esprit en déformant les événements historiques jusqu’à les rendre amusants. Mais ses bons mots, souvent, étaient des caricatures. Ce qu’il nous disait n’était pas arrêté d’avance, comme chez Renouvin et Chevallier. Morazé improvisait la forme, et même parfois le contenu, employant des formules comme : « S’il nous reste du temps, nous pourrons parler de... », formules inconcevables chez Renouvin, qui disait ce qui devait être dit et rien de plus, car le temps était limité. Enfin pour Morazé, l’histoire semblait avoir pour principale vertu d’être une boîte à précédents où le financier, l’économiste, le politique puiseront de précieux conseils, alors qu’à mon sens elle est avant tout la connaissance du devenir des sociétés humaines. Je ne fus pas seul à penser que le cours de Morazé semblait fumeux.
M. Pierre George, le communiste de la maison, nous enseignait la géographie humaine. Être étique et d’apparence maladive, il étendait les bras raides des deux côtés de son pupitre comme un Gauredner, et parlait comme une cascade. Je n’en ai rien retenu.
Reste à dire un mot de l’homme le plus prestigieux de l’École, André Siegfried (1875-1959), « le plus grand voyageur de la maison », 71 ans. Son cours intitulé « Matières premières et échanges internationaux » ne révélait pas toute l’originalité de l’auteur, car il reposait essentiellement sur des statistiques. Même son style n’avait rien d’extraordinaire, en sorte qu’il était difficile de se faire une idée de ce qu’avait été cet André Siegfried aux conférences duquel tout Paris accourait. L’homme était comblé de tous les honneurs auxquels un intellectuel peut aspirer en ce pays. Par un côté, sa carrière ressemblait à celle qu’eut un siècle plus tôt Alexis de Tocqueville ; en effet, tout comme chez l’aîné, c’est un livre fameux sur les États-Unis qui lui ouvrit les portes de l’Académie des sciences morales et politiques. Quelques années après, il fut reçu sous la Coupole. Siegfried était en outre professeur au Collège de France et, grâce à son expérience de tous les peuples de la terre, sans être juriste, il avait été nommé juge international à La Haye.
André Siegfried
Quel curieux nom pour un Français : André Siegfried ! Son physique était celui d’un pur Germain : grand, élancé, dolichocéphale, avec des yeux d’un bleu transparent qu’on pouvait croire prêts de s’éteindre, mais qui parfois scintillaient d’intelligence ; enfin – incredibile dictu – il avait les cheveux coupés en Sommerschnitt. Ce qui ne l’empêchait pas d’être vêtu avec l’élégance d’un gentleman et d’avoir des façons aristocratiques ; le petit mouvement très simple de la main accompagné d’une légère inflexion du buste qu’il faisait pour répondre à nos applaudissements était étudié à la perfection. En commençant son cours, Siegfried sortait un face-à-main dont il se servait pour regarder ses notes, puis pour envisager l’auditoire. Sa tournure d’esprit l’apparentait aux Anglo-Saxons. L’esprit français lui faisait défaut, mais il savait faire de l’humour britannique, celui qu’on ne réalise que quelques instants plus tard. Son flegme britannique devait l’avoir servi dans ses pérégrinations ; sachant s’accommoder de toutes les situations, de tous les moyens de transport, il disait « adorer les vieux chars chinois sans aucun ressort dans lesquels on est horriblement cahoté ». Et enfin, il parlait beaucoup de lui-même et de ses aventures personnelles, ce qui est encore un tour d’esprit anglo-saxon peu goûté des Français, épris d’objectivité et d’idées générales. Un jour, parlant du canal de Panama, et décrivant la forme de la région, il ajoutait : « J’ai pu m’en rendre compte moi-même quand je faisais la traversée du lac de Gatun : un crocodile suivait le bateau de très près... », alors quelqu’un des nôtres de s’écrier : « Pas eu trop peur, non ? ».
André Siegfried était alors le plus grand voyageur de France. En dehors des deux pôles, il n’y avait peut-être pas de point du globe où il n’eût posé les pieds. Très jeune, il avait été en Amérique ; en 1900, il visita l’Australie et la Nouvelle-Zélande ; puis toute l’Asie avec le Japon ; à dos d’âne, il fit le voyage de Pékin à la Grande Muraille ; il connaissait l’Afrique, etc.
André Siegfried avait aussi des talents pratiques. Son père, Jules Siegfried, originaire d’Alsace, fut un habile négociant de coton au Havre ; il achetait son coton aux États-Unis, puis, pendant la guerre de Sécession, aux Indes. Il fut également parmi les fondateurs de l’École libre des sciences politiques. André Siegfried citait souvent son père : « Mon père, qui savait que le commerce moderne ne se fait pas sans connaissances spéciales... », « Mon père qui était un homme intelligent... ». C’est de lui qu’il tenait sa fortune et, sans doute, le précieux appui de nombreux amis aux Indes et aux États-Unis, sorte de tremplin pour ses premiers voyages. Malgré son âge avancé, André Siegfried était encore d’une grouillante activité. Il restait en contact avec les responsables de la politique et de l’économie. Il écrivait des articles et des livres ou répondait à un discours de réception à l’Académie française. Il faisait des conférences et des cours et savait fort bien servir le même plat à plusieurs sauces.
Il est une notion qui revenait dans ses discours et qu’il voulait voir adopter, celle de « civilisation occidentale » pour désigner l’ensemble de la race blanche : Europe – Amérique – Dominions. Il enseignait qu’en étudiant la géographie économique, on ne doit pas se contenter d’une étude statique indiquant la répartition des matières premières à un moment donné, mais il faut comparer les productions dans le temps et faire voir les transformations de l’équilibre économique mondial. Ensuite, il parlait des grandes routes de la planète, montrant à cette occasion qu’il en connaissait tous les recoins, ses villes, ses montagnes, ses régions, caps et détroits. Il nous disait que l’organisation, notamment des routes maritimes et aériennes, si compliquée aux points de vue technique et administratif, avait été l’œuvre exclusive de la race blanche et de la civilisation occidentale. Non point que les autres races lui fussent inférieures dans le domaine de l’intelligence, de l’art ou du sentiment religieux, mais elle fut seule à posséder ce talent d’organisation, vieil héritage romain, grâce auquel elle put, à un moment, dominer le monde.
Conférences de méthode
Ce tour de la maison des sciences po serait incomplet sans une allusion à l’une de ses spécificités : les conférences de méthode, sources de la clarté française. Lorsque plus tard, nous disait-on, vous aurez à faire une note ou un exposé pour un ministre ou autre chef, vous devrez savoir en peu de mots résumer l’essentiel d’un problème. Pas de bla-bla, mais de la substance. Pour cela, il faut un plan en trois parties : une introduction qui pose le problème, un développement qui l’analyse en deux, trois, ou quatre sections au maximum, enfin une conclusion qui tire la leçon, esquisse une solution. Tout cela ne doit pas dépasser le temps qui vous est alloué, que ce soient dix, vingt ou trente minutes, mais toujours la méthode sera la même.
On avait deux conférences de méthode par semaine, dont l’une consacrée à des disciplines juridiques et économiques de la Faculté (droit constitutionnel, éco po…) et l’autre à l’histoire politique générale, économique, et des idées politiques. Tous les élèves y participaient, par écrit ou, à tour de rôle, oralement. Cette rude discipline intellectuelle fut une contribution durable à notre formation.
(1) Les 4 premières illustrations de cet article sont reprises de l’ouvrage Nos maîtres de la Faculté de droit de Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence R. Pichon et R. Durand-Auzias, 1932, les illustrations étant l’œuvre de Madame Favrot-Houllevigue. Les autres illustrations ont été remises à l’auteur par la direction de l’Institut d’Études Politiques de Paris aux fins de publication.
Le droit de la grappe au Luxembourg
par
Nico Schaeffer
Docteur en droit Dipl. I.E.P. Paris Ancien bâtonnier
En entrée : les méandres de la grappe au vin et au verre
Des mets et des vins, des chefs de cuisine et des chefs de chais, on en discute, parle, radote, et même on jase. On les loue et les dénigre, à toute occasion mondaine, voire au bistrot et autour du zinc. Chaque gros plein de soupe veut briller, être le meilleur des connaisseurs, le critique suprême, reléguant aux oubliettes les Curnonsky et Courtine (La Reynière), Brillat-Savarin, Parker, Lichine, Sicheri, et même Charles Quittanson l’éminence grise des appellations contrôlées.
L’épreuve organoleptique retourne à la rengaine des goûts et des couleurs. À chacun sa préférence ! En matières gastronomiques et œnologiques, chez les palais les plus cultivés même des consensus ne se rencontrent qu’à l’à-peu-près. Des labeurs, dévouements et concentrations sont certes présupposés, mais sans le don inné, sans le savoir par l’entraînement et sans un acquis en perfection, nul chef des mets ou des chais, nul sommelier ne saurait réussir.
Je ne prétends nullement être un élu au sein de ces heureux initiés. Quoique de souche mosellane, quoique j’aie pu collaborer avec mes grands-parents, ma tante et mon oncle à des travaux au vignoble, je me suis résigné à cette tâche plus commode de l’historique des méandres législatifs sur la vigne et la culture du vin, avec une légère prétention de m’y connaître un peu mieux qu’avec la serpette à la main.
S’y connaître ne suffit plus ! Il me fallait recourir aux lumières de mon ancien avocat stagiaire Marc Mathekowitsch, promu administrateur général au ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, ainsi qu’à mes amis mosellans Robert Ley, directeur de l’Institut viti-vinicole de Remich (successeur de Raymond Weydert, qui siège à la Chambre des députés pour le vigneron et maintes autres bonnes intentions), Marc Kuhn, contrôleur des vins, Jerry Scheuer, secrétaire à la Marque nationale ainsi que leur jeune juriste Yves Kohn.
Je me suis aussi permis de chercher support auprès des vigneronnes et vignerons, œnologues en plein exercice. Pour éviter une publicité indirecte, je préfère ne pas les nommer, sans pourtant ne pas leur exprimer ma reconnaissance.
Mes remerciements vont encore à l’adresse du jeune avocat collaborateur Maître Steve Hoffmann de Oberdonven, celui qui jouit d’une vue directe sur les coteaux mosellans.
Cette contribution a comme origine une invitation de Maître Jérôme Chevrier, notaire à Paris, soutenu par Maître André Schwachtgen, notaire honoraire à Luxembourg, les deux étant membres fondateurs et anciens présidents de l’Institut des recherches et d’études notariales européen – IRENE, pour le colloque « Droit et vin » organisé avec l’université Montesquieu de Bordeaux, en juin 2010.
L’occasion fut propice avec des connaisseurs chevronnés en cette discipline : maître Éric Agostini, professeur à Montesquieu Bordeaux et avocat des grandes maisons viticoles, Jean-Marc Bahans, greffier du tribunal de commerce de Bordeaux, où des plus importants litiges entre éleveurs et producteurs remplissent le rôle, le professeur Philippe Dupichot de Panthéon-Assas Paris II un penseur sur la législation future du statut des vignerons et le professeur Denis Dubourdieu qui évolue du matin au soir dans l’Institut français de la vigne et du vin.
Le rapport luxembourgeois qui vous est présenté fut avantageusement remodelé grâce aux fructueuses, ne dirait-on pas mieux juteuses, discussions avec ces sommités.
J’ose espérer que vous, chers lecteurs, n’y trouverez aucun goût de liège, ni de bois, ni de tonneau.
Luxembourg, le 16 mars 2011.
Nico Schaeffer
I. – Aspects historiques
L’avancée romaine jusqu’à Trèves et ses alentours mosellans traînait des ceps dans les bagages. Un lien plus direct ne nous parvint pourtant pas de la Sicile ou de l’Avellin, héritiers des cépages grecs, mais de Burdigala (Bordeaux), du fondateur légendaire du château Ausone. Decimus Magnus Ausonius, grammairien, rhétoricien, avocat était natif de Bordeaux (vers 310). À cette époque, la ville de Trèves, à 35 kilomètres de Luxembourg, s’était muée en capitale de l’Empire romain d’Occident. Valentinien I, à peine accédé au trône impérial, nomma Ausone à sa cour, comme précepteur de son fils, le futur empereur Gratien. Ausone y résida une vingtaine d’années, grimpant les échelons du gouvernement jusqu’au rang de ministre de la Justice Quaestor sacri palatii.
Il nous gratifia du fameux poème Ausonii Mosella, un guide de randonnées le long du pays mosellan, qui engloberait de nos jours les régions de Trèves, Luxembourg, Sarrelouis, Thionville et Metz. La vigne n’y est pourtant citée qu’en marge d’une monumentale description de la rivière Moselle : « … où les vignes offrent cet autre spectacle pompeux suggérant la vue sur les dons de Bacchus, là où sur une longue traînée les crêtes de montagnes abruptes surplombent récifs et hauteurs ensoleillées, courbes et revers à travers les plantations de vignes dans cet amphithéâtre de la nature ».
Cette viticulture luxembourgeoise couvre actuellement 1.300 hectares le long de 42 kilomètres de la Moselle et de sa tributaire la Sûre, à partir du village de Schengen en aval jusqu’à Rosport.
Le nom de Schengen, se lit dans tous les aéroports, souvent dans l’ignorance que c’est aussi un haut lieu viticole, fameux pour ses vins de la gamme des pinots.
Le vignoble est majoritairement orienté vers le lever du soleil, bien servi en rosées matinales pour enrober les baies des grappes naissantes, ne manquant pas de brouillard, mais, hélas aussi, de gelées tardives, de tempêtes et de grêlons.
Depuis l’Antiquité jusqu’après la Première Guerre mondiale ce fut un vignoble bien pauvre en rendement et en qualité, exploité par des vignerons loin de l’opulence, sauf quelques grandes familles qui elles-mêmes ne manipulèrent guère la houe et la serpette.
Le Luxembourg étant associé à l’union douanière allemande, le Zollverein, jusqu’en 1918, les vins furent exportés en majorité dans les pays allemands pour y servir au coupage, principalement avec le « Sekt » mousseux. Des étendues non négligeables étaient aux mains de l’évêque-prince électeur de Trèves.
De par notre association privilégiée avec cette union douanière, un autre phénomène s’afficha. Il était dû aussi au fait géologique qu´une large étendue du vignoble est composée de calcaire conchylien – « Muschelkalk », qui avoisine en qualité le sol de la Champagne. Ainsi de grandes maisons ont établi des entreprises dépendantes au Luxembourg, dans les rues de Reims et d’Épernay. Elles fournissaient les vins de base et les coupaient sur place en cuvées avec des vins de chez nous. Le tout pour être exporté en Allemagne comme champagne, mais de provenance douanière de Luxembourg aux taux de faveur.
On se raconte que les champenois auraient coupé leur produit d’origine de vins de base provenant de nos coteaux de calcaire conchyliens, apparentés aux terres blanches de chez eux.
Des maisons alors en vogue en Allemagne, comme Kupferberg, importèrent largement nos vins secs pour leurs coupages.
La Champagne ne tirait pas seulement avantage des droits de douane mettant à leur profit le village de Kopstal, qui entretenait plus de 200 ouvriers pour couper les saulaies et ouvrières pour tresser des paniers en osier originaires du Weidendall. En exclusivité pour les grands producteurs de la Champagne ! D’anciennes photographies ornent par exemple les locaux de Mercier à Épernay, comme une seule autre qui est exposée au musée du vin à Ehnen.
La morale de ces deux considérations : des deux côtés de nos frontières, on avait déjà à cette époque besoin d’un plus petit que soi. Que l’on ne considère pas ceci comme une allusion aux banques françaises et allemandes établies dans ce même petit pays, depuis une bonne trentaine d’années.
La Première Guerre mondiale y mit fin. Par malheur, ces années furent en plus infectées par la plaie du phylloxéra – Reblaus – une première fois au début du siècle, et d’une façon plus dévastatrice vers 1924-1925. La viticulture était à bout de souffle. Il fallut la réorganiser du point de vue de sa structure, de la culture, de l’économie et de la distribution. Bien des petits vignerons durent fermer les chais, pour s’adonner à l’agriculture traditionnelle, ou même aller chercher un gagne-pain dans l’industrie sidérurgique.
Sans union douanière, le Grand-Duché aurait eu des difficultés de survie.
Le 28 septembre 1919, le peuple se prononça dans un référendum avec 60 133 voix pour une union économique avec la France et 22 242 voix pour la Belgique. L’accord fut conclu avec la Belgique en 1922. Il a survécu jusqu’à nos jours. La France s’en était distancée, préférant sans doute une annexion ?
Après les élections de 1919 fut créé un ministère de la Viticulture que dirigea, presque en permanence, le ministre Joseph Bech jusqu’en 1959, cumulant ce portefeuille avec celui de premier ministre respectivement de ministre des Affaires étrangères. Depuis lors, ce ministère continue de subsister en autonomie, étant couplé quand même avec celui de l’Agriculture.
Un fait marquant, l’amitié de Joseph Bech avec l’ingénieur Nicolas Kieffer, qui durant cette période est resté son conseiller exécutant. C’est lui qui fut nommé premier directeur de la Station viticole établie à Remich en 1925. La rumeur n’est pas contredite que ce fut lui qui préparait les lois, au ministre Bech de les faire adopter par la Chambre des députés et audit directeur de les faire exécuter.
Revenons à la période suivant la Première Guerre mondiale, celle où la sortie du Zollverein allemand et le départ de chez nous des producteurs de champagne de la Champagne priva le vin luxembourgeois de presque toutes ses possibilités de servir au coupage.
Il ne nous restait que le choix, ou bien de produire à bas prix du vin « ires des dieux » (« Gotteszorn ») et vendre à qui il plaisait d’acheter, ou bien de moderniser la culture, créer des crus de qualité et espérer trouver le client payant bien. L’union douanière avec la Belgique présentait le client espéré, surtout comme ses gastronomes, et ce pays n’en manque pas, ont trouvé que les blancs secs se mariaient à merveille avec les moules, les frites et les poissons du littoral.
II. – Le phylloxera
Ce coléoptère croquait, bouffait, rongeait toute écorce de vigne qu’il pouvait rencontrer. Des surfaces entières en furent victimes. L’établissement de la Station viticole survint à point, alors qu’il fallut instruire, éduquer et motiver les disciples apprentis vignerons.
La grande découverte venait d’être faite, à savoir d’enter la vigne naissante (le greffon), à quelques centimètres en haut de la racine, d’un bout minuscule d’un cep de vigne de provenance étrangère d’un bois bien plus acerbe et amer (le porte-greffe), puis de regreffer le cep d’origine. La bestiole dévastatrice, qui a l’habitude d’attaquer sa victime vinifère par le bas du sol, étonnamment délicate aux goûts, abandonna son ascension dès les premières morsures dans la sève du bois greffé et amer. Et le vignoble survécut !
Ce que d’aucuns ignorent : le stratagème fut appliqué au début au moyen de greffons importés de Hongrie, mais ils ne donnaient que des résultats moyennement satisfaisants. À la Californie de fournir l’ente salvatrice, plus amère, et donc plus rébarbative ! Réflexion amusante : les vignobles du Palo Alto ou de la Nappa Valley furent plantés de Riparia, de Chablis et de Chardonnay de provenance française, souvent bourguignonne. Ils ont quitté la France en douceur et nous sont revenus avec des bois plus amers, favorisant l’extermination des bestioles.
La pratique est continue jusqu’à nos jours. Les œnologues sont unanimes, la vigne, quelle que soit sa variété, n’a pas changé son goût originel. Citons Féret dans Bordeaux et ses vins (édition 1982, p. 70) : « … bien que certains botanistes aient prétendu que la qualité des vins ainsi obtenus serait inférieure à celle des vins produits par des cépages français, opinion dont le bien-fondé n’a, heureusement, jamais pu être mis en évidence ».
En ces années le vignoble de l’Europe de l’Ouest, du Rhin jusqu’à la Provence, du Portugal jusqu’en Italie, en passant par l’Espagne et le Bordelais a vécu ce que jamais toutes les tempêtes, toutes les grêles n’auraient pu faire lui souffrir. Les petits vignerons à l’abandon ne surent résister à l’appétit des grands acheteurs à vil prix. Les plus petits se recyclèrent en plantant des patates ou des betteraves.
La nouvelle Station viticole de Remich remonta le moral des jeunes de la serpette. Mais ce ne fut pas suffisant pour un vignoble dans lequel, à part quelques grandes familles, la majorité devait se contenter de quelques ares restés en culture.
Notre viticulture n’est pourtant pas épargnée par d’autres maladies de la vigne et d’insectes maléfiques. Nommons le mildiou, l’oïdium, l’esca causée par des champignons parasites et le ver de la grappe. Le cigarier n’a quand même pas entièrement disparu.
III. – La loi du 24 juillet 1909
En ces années où nous participions encore à l’union douanière allemande, la loi du 24 juillet 1909 « sur le régime des vins et boissons similaires » domine ce contexte historique. Elle ne manque pas de ressemblances avec les lois allemandes d’alors, mais est parsemée de références précises aux traditions françaises. À ne pas déconsidérer qu’en ces temps la production de vins rouges saint-laurent et meunier fut encore appréciable. Ce qui en advint par après, renseignez-vous auprès du phylloxéra ! Le saint-laurent et le pinot noir vinifié en rosé ou en noir revivent actuellement un regain de faveur.
En 1909, le vin est défini, de même que de l’autre côté de la Moselle, comme étant « la boisson obtenue par la fermentation alcoolique du jus de raisins frais ». Le coupage est permis, sauf pour les vins de dessert appelés « vins du Midi » ou « vins doux », qui ne peuvent être employés au coupage de vin blanc d’autres espèces. Voyez l’influence française !
La définition du sucrage par chaptalisation se limitait aux vins de raisins indigènes, où « il est permis d’ajouter au jus non fermenté ou aux vins qui en proviennent, et, dans le cas de la préparation de vin rouge, également au moût complet, une quantité limitée de sucre, dissous ou en eau pure, à l’effet de suppléer à un manque naturel de sucre ou d’alcool, ou de remédier à un excès d’acides, dans la mesure obtenue par la constitution du produit obtenu dans les bonnes années ». Tout sucrage, dont la pratique était limitée depuis les vendanges jusqu’au 31 décembre, devait être déclaré à l’autorité compétente.
L’intention de sucrer du moût complet, du jus de raisins ou du vin était à déclarer. Un avertissement de ne pas suivre les pratiques allemandes par l’adjonction au vin du moût non fermenté d’un unvergorener Traubenmost.
La mise en vente de vins sucrés sous une désignation qui vise à sa pureté ou à l’application de soins particuliers pendant la vendange était interdite.
Un passage de la loi revêt une importance capitale. Il perdure et s’oppose à la pratique française de la qualification des crus en fonction du lieu-dit de leur croissance : « … les désignations géographiques ne pourront être employées que pour caractériser la provenance ».
Cette loi de 1909 est déjà prémonitoire des règlements CE, CEE et UE en ce qu’elle admet des « coupages avec des produits d’origine différente ». Ceci fut réintroduit dans notre Europe, qui admet des coupages avec d’autres vins communautaires. Était-ce déjà une ouverture aux stratégies des Rémois et Sparnaciens pour venir marchander leurs champagnes français, chez nous, aux taux du Zollverein allemand ?
Cette loi portait pourtant l’interdiction d’indiquer uniquement que le vin émanait d’un propriétaire récoltant spécifiquement sans mentionner les cépages. Cette pratique des vins uniques Einheitsweine est donc abandonnée !
Le monde du XXIe siècle n’enseigne pas que des nouveautés ! Rappelez-vous cette idée saugrenue de fabriquer du vin rosé par le mélange du rouge et du blanc, faisant fi de la véritable vinification des rosés de tradition. La loi de 1909 : « Le mélange de vin blanc et de vin rouge ne peut, dans un but de lucre, être mis en circulation comme vin rosé, que sous une dénomination caractérisant le mélange ».
À propos des vins pétillants, la loi s’en tient à l’expression vins mousseux, se gardant de citer le « champagne », quoique, jusqu’en 1918, on eût pu le faire.
Des références aux cognacs d’origine luxembourgeoise ne manquent pas. Mais elles devaient aussi disparaître une dizaine d’années plus tard par la force du Traité de Versailles et des traités annexes. Pourtant, en 1909 : « L’eau-de-vie de consommation dont la teneur en alcool ne provient pas exclusivement du vin, ne doit pas, dans les relations d’affaires, être désignée comme cognac ». Et dans les relations non affairistes, le pouvait-on ? Étant donné la mentalité de mes concitoyens, je dirais que oui !
Le vin mousseux a droit à des restrictions spéciales, avec une vue sur la Champagne à peine cachée, mais pas avouée. Il « doit porter une désignation qui fasse connaître le pays où il a été tiré en bouteilles ». Si sa « teneur en acide carbonique provient partiellement ou totalement d’acide carbonique préparé d’avance, cette désignation devra faire connaître le mode de fabrication ». Ce ne fut pas uniquement une protection pour les pays de la Marne et de l’Aude, une incitation aux producteurs indigènes d’en faire autant ! Que les bonbonnes carbonifères fêtassent les noces ailleurs !
La loi de 1909 était l’œuvre du ministre d’État Paul Eyschen, reconnu pour avoir été le premier homme politique à s’occuper intensivement de la viticulture du pays. Il trône encore au Primerberg entre Stadtbredimus et Ehnen sur le monument qui lui est dédié.
La loi de 1909 resta presque intacte jusqu’à l’arrêté grand-ducal du 29 décembre 1960. Exception faite pour celui du 5 mai 1937 qui introduisit une protection de l’appellation d’origine « Cognac ». En 1935, la France venait de légiférer en profondeur sur les appellations contrôlées. On y lit : « Les appellations contrôlées “Cognac”, “Eau-de-vie des Charentes”, “Fine Champagne”, “Armagnac”, ainsi que les sous-appellations de la région délimitée de Cognac et Armagnac, sont réservées aux eaux-de-vie d’origine française, auxquelles la législation française reconnaît le droit à ces appellations ».
Le 29 décembre 1960, plusieurs dispositions datant de 1909 et de 1937 furent profondément modifiées.
Les boissons exclues de la circulation en 1909 ne pourront désormais plus être employées pour la fabrication de boissons contenant du vin et de vins mousseux.
IV. – Contrôles
Le XXe siècle nous donna, le 24 juillet 1909, la loi sur le régime des « vins et boissons similaires », qui, quelques fois modifiée, perdura jusqu’à la loi du 29 décembre 1960. Cette dernière y apporta des modifications profondes, qui s’imposaient par l’écoulement des années et l’entrée dans le marché commun.
En conséquence de cette loi, un arrêté grand-ducal introduisit le 14 novembre 1909 « l’organisation du contrôle des vins » avec la nomination d’un seul contrôleur des vins, une personne totalement autonome, placée sous l’autorité immédiate du ministère de la Viticulture. Il avait son siège dans la ville de Grevenmacher, qui est avec la ville de Remich l’autre haute localité de l’aire viticole. La nomination d’un second contrôleur était prévue, mais elle ne l’a jamais été faite, jusqu’à nos jours. Ce professionnel fait maintenant partie de l’Institut viti-vinicole.
Laissez-nous entrer dans le détail des textes pour dépeindre le peu de moyens d’un petit pays dont la viticulture était alors largement dominée par l’emprise de l’Allemagne, l’Alsace encore comprise, à des fins de coupage avec ses vins moins acidulés et les effervescents.
La mission du contrôleur est décrite comme suit : « La révision des locaux, livres, etc., et la dégustation des liquides se fera autant que possible contradictoirement avec le propriétaire ». Il procédera au moins trente fois par an à des prélèvements d’échantillons auprès de chaque récoltant ou producteur. « Ces échantillons devront être placés dans une bouteille neuve, en verre blanc, d’un litre de capacité, convenablement rincée avec le liquide lui-même dont l’échantillon sera prélevé. La bouteille sera bouchée soigneusement au moyen d’un bouchon neuf et scellée du sceau de service, de manière qu’il soit impossible de l’ouvrir sans briser ou endommager le scellé ». Les échantillons prélevés seront au nombre de trois, un pour le propriétaire, comme témoin d’une contre-expertise, un pour l’expert chimiste et le troisième pour le greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg. Le propriétaire aura droit à une indemnité, étant toutefois légiféré que ce dernier pourrait la refuser. L’expert chimiste exécutera son analyse « d’après les méthodes de “l’Office impérial d’hygiène de Berlin”-“Kaiserliches Gesundheitsamt in Berlin” ».
Par la création subséquente de la Station viticole de l’État, le contrôleur dut transférer son siège à Remich.
Les prérogatives du contrôleur sont dédoublées de celles d’un officier de police judiciaire, chef de la répression des fraudes. Il a été intégré dans l’organigramme de l’Institut viti-vinicole.
Qu’il nous soit permis de sauter les règlements intermédiaires, comme les deux du mois de mai 1937, pour nous arrêter à ce qui reste actuellement en vigueur.
Le 10 janvier 1947 déjà chaque envoi de vin, de mousseux et de jus de raisins à destination de l’étranger, et dépassant 20 litres, est sujet à un certificat de contrôle de l’Institut.
Le 14 juillet 1971 fut une journée propice pour la législation viti-vinicole luxembourgeoise. Un règlement, commenté plus amplement ailleurs dans cet exposé, établissait les dispositions particulières concernant les v.q.p.r.d. (vins de qualité produits dans une région déterminée) par transposition de la directive 817/70. Un règlement du même jour traitait du contrôle des vins, des moûts et des boissons similaires. Il s’agit d’un relevé chimique de ce qui est permis ou défendu, dont j’épargne la lecture aux non-spécialistes. Il est suivi d’un règlement encore plus technique à propos des méthodes d’analyse applicables au vin.
Depuis ce même jour, l’Institut viti-vinicole (à l’époque encore appelé Station viticole) est chargé du contrôle des opérations d’enrichissement, de désacidification et de l’édulcoration prescrites par la CEE. L’Institut est en conséquence chargé du contrôle : (i) des registres y afférents ainsi que (ii) de tous les vins de table et de la protection des v.q.p.r.d. commercialisés sur le territoire du Grand-Duché, comprenant donc les productions locales ainsi que toutes les importations.
Le 27 avril 2010, un règlement grand-ducal apporta des modifications à un autre texte du 14 juillet 1971 relatif à la détermination de la valeur de rendement d’un domaine agricole. Ici la viticulture n’est qu’indirectement touchée.
V. – La Station viticole
Une véritable révolution, en pleine crise du phylloxéra, fut la création, de la Station viticole, communément appelée aussi l’école de la vigne (Rebschule). Ses ambitions allaient vite au-delà d’une éducation systématique des jeunes vignerons au maniement des plants, greffons, vignobles et vinifications.
La loi du 23 juillet 1925 définissait cette Station, pour être « appelée à s’occuper de toutes les questions intéressant le domaine de la viticulture », étant composée d’un directeur (qui fut Nicolas Kieffer, déjà mentionné) et de deux chefs-ouvriers. « Quelques pépinières de plants déjà existantes furent rattachées à la Station. La fixation du prix de leur vente aux vignerons resta réservée à la discrétion du gouvernement ».
Pour l’amusement, on y constate la haute mission de portée nationale « …d’assurer l’exploitation des vignobles de démonstration appartenant à l’État ». Il est vrai, ces crus sont devenus tous d’une excellente qualité, faisant notre fierté à tous. En sont légitimement ravis les ministres, secrétaires d’État, conseillers du gouvernement (sans les adjoints), chefs des organes étatiques et autres hauts fonctionnaires : ils jouissaient d’un pactole en liquide aux fins d’assouvir leurs besoins privés de représentation.
La viticulture de la Moselle a tant de choses en commun avec celle de l’Alsace, et par extension avec celle du Haut-Rhin allemand. Les cépages sont, à peu d’exceptions près, les mêmes. Pourtant, les vins des cépages pinot et chardonnay sont d’origine bourguignonne, convoités par l’Alsace et conquis par le Bade-Wurtemberg. Ceci grâce au maître des chais du Kaiserstuhl, le Dr Ruland, complice du passage paisible du Rhin par le pinot gris. D’où ce cru reçut en Allemagne le nom de Ruländer. Les Alsaciens croyaient bien faire de baptiser le leur « tokay ». Jusqu’il y a plusieurs années, quand les viticulteurs hongrois, encore sous la férule soviétique, contestèrent ce nom comme étant exclusivement celui d’un cru hongrois.
Nos amis Alsaciens durent retourner à la dénomination de pinot gris. Ils avaient peut-être oublié de rappeler aux Magyars que les premiers ceps du furmint, leurs ancêtres les avaient volés lors de leurs invasions en Belgique, précisément le long du vignoble de la Meuse à Ans aux environs de Liège, au IXe siècle. Il n’y a plus de vignobles, le climat a rétréci les vignes de la Meuse à quelques lopins nostalgiques. Le furmint s’est établi depuis 895 autour du château de Tokay. D’aucuns prétendent que des Italiens auraient implanté le furmint en Hongrie.
Nous avons ceci de commun avec la viticulture alsacienne, qu’on chérit également des cépages communs, qui ne sont pas de Bourgogne : les riesling, sylvaner, auxerrois (peu fréquents en Alsace, disparus en Bourgogne), muscat ottonel, traminer, gewürztraminer. Ce sont des vins ayant des « cousins » notamment en Allemagne, en Italie du Nord et en Autriche.
Notre viticulture entra nécessairement en relation avec l’école de Colmar et la Rebschule de Geisenheim, se trouvant juste de face côté allemand. Le vigneron de notre Moselle étant au moins bilingue, les allées et venues tantôt d’un côté du Rhin et tantôt de l’autre lui étant certainement faciles, notre viticulture resta attachée aux enseignements techniques prodigués le long des deux rives.
Toutefois, après Compiègne et Versailles, la nouvelle Station viticole prit l’habitude d’envoyer plutôt ses disciples en stage à Colmar. Les savoirs du métier, c’est là que nos ancêtres les ont appris. Les manipulations essentielles, ils les ont pratiquées dans ces coteaux vinifiés d’au-dessous des Vosges.
VI. – L’Institut viti-vinicole
Depuis 1925 la Station vécut son essor, subissant plusieurs réorganisations, les dernières le 29 août 1976 et le 12 août 2003, et se mua en Institut viti-vinicole.
Son objet s’est élargi pour s’occuper à peu près de toutes les questions intéressant la viticulture et l’œnologie, y compris la participation dans les instances communautaires, ainsi que toutes autres missions fondamentales ou de représentation que le ministre lui confiera.
L’Institut s’est vu en outre confier « la lutte rationnelle contre les ennemis de la vigne du règne animal et végétal » ainsi que la surveillance et le contrôle de l’application de la loi. Y fut comprise la gestion d’un laboratoire d’analyses et de contrôles des vins ou produits similaires, donc un des lieux de la détection des fraudes.
L’organisation, la garantie et le contrôle du fonctionnement et de la gestion des marques nationales des vins, vins mousseux et crémants de Luxembourg, donc pratiquement tout ce qui, au niveau tant national qu’européen, est affaire des appellations d’origine contrôlées est passé sous la surveillance de l’Institut. S’y ajoutent toutes les importations de crus et breuvages non communautaires.
Nous avions constaté que la chétive Station viticole avait commencé avec trois personnes et quelques ouvriers. Le nouvel Institut s’est développé en une véritable administration centrale avec un directeur, un contrôleur des vins, des ingénieurs, assistants techniques viticoles, inspecteurs, commis techniques ou administratifs, ouvriers chefs, ouvriers et concierge. Les conseillers spéciaux et les chargés de cours ne sont pas compris dans cette énumération, ni les observateurs locaux.
Ces observateurs locaux ont été institués par un arrêté du 31 mars 1937, qui reconnaît la nécessité que « l’apparition de toute maladie dans la vigne tant du règne animal que végétal soit signalée immédiatement par les soins d’observateurs locaux, à la direction de la Station viticole ».
Une des conséquences de l’arrêté du 14 novembre 1909 est que chaque récoltant ou négociant est tenu de tenir un livre des caves. En vertu du règlement du 22 septembre 1978, toutes personnes ou tous groupements, à l’exception des détaillants, qui détiennent des produits vineux, sont obligés de tenir des registres additionnels, à savoir :
– des entrées et sorties ;
– de l’identification du vin ;
– des embouteillages.
La question s’est posée du genre de ces registres. On se trouve dans une époque où, de gauche ou de droite, de haut ou d’en bas, de la Commission de Bruxelles, de l’OCDE, des autorités nationales, des groupements des producteurs, les préceptes pour les soins comptables fusent à une allure vertigineuse. Les personnes employées dans la viticulture et sa distribution sont d’honnêtes producteurs ou négociants non imprégnés de la multitude de nouveautés comptables.
Dans un souci de ne pas leur imposer des normes qui se multiplient, l’Institut peut autoriser que ces registres soient tenus seulement en des « éléments appropriés à une comptabilité moderne ».
VII. – Les caves coopératives
Les années 1920 virent les retrouvailles des vignerons au sein de caves coopératives. Elles adoptèrent le régime sociétaire spécial des associations agricoles, avec une personnalité morale propre à elles.
Peu à peu, il en naquit six (Caves du Sud, Caves Coopératives de Wellenstein, Stadtbredimus, Greiveldange, Wormeldange et Grevenmacher), associant la presque totalité des vignerons qui avaient des problèmes pour cultiver, exploiter, vinifier et distribuer leurs produits. La demande était tarie, et pour les coupages en Allemagne, et pour les cuvées champenoises. Nos quelques centaines d’hectares devaient vivre en autonomie, avec pourtant un nouveau débouché vers la Belgique, le nouveau partenaire douanier.
Un racontar qui jouit de la réputation d’être vrai. Au Luxembourg, comme dans presque toutes les régions viticoles, subsistait la tradition de fouler le raisin fraîchement vendangé avec les pieds déchaussés.
Notre vignoble fait croître plusieurs cépages. De même produit-il, parmi ces différentes catégories, des vins qui varient en titrage et en acidité. Du temps où chaque vigneron travaillait ses propres récoltes, pas de problème pour les fouler au pied.
Le récoltant avait tout intérêt à ne pas mélanger les raisins de ses différents cépages, ni à ajouter ceux de piètre qualité aux meilleures provenances.
À l’avènement des caves coopératives, qui concentrèrent les arrivages à la cave commune, des récoltants moins respectueux du règlement, auraient pu en tirer profit pour faire fouler à pieds nus des récoltes de moindre qualité parmi des raisins à plus haute vocation. Pour contrecarrer une telle tricherie, les coopératives édictèrent que toutes grappes livrées à la cave centrale commune ne pouvaient l’être qu’en leur état d’origine, fraîchement délivrées du plant par la serpette ou le sécateur. Sans écrasement !
Les coopératives viticoles ne sont pas à confondre avec les sociétés coopératives du droit commercial commun. Elles sont des associations agricoles à destination viticole, qui pouvaient se constituer avec cinq membres au moins, et ne pouvaient comprendre qu’une minorité de non-viticulteurs.
Elles étaient soumises aux règles des lois successives des 27 mars 1900, 6 août 1921, 17 septembre 1945 et 25 août 1986.
Quant à l’objet :
– l’achat en commun de tous les objets destinés à l’exploitation ;
– l’acquisition de machines ou outils en vue d’une utilisation en commun ;
– la vente en commun de tous les produits ;
– l’exploitation en commun des terrains et l’organisation de toute entraide.
Quant à la forme et au contenu :
– l’association peut se constituer par acte notarié ou sous seing privé ;
– la personnalité juridique est acquise dès sa publication au journal officiel, le Mémorial ;
– les statuts désignent le siège, les membres et la composition du fonds social ainsi que les contributions de la part des adhérents ;
– les parts sont incessibles ;
– les noms et professions des membres du comité, des personnes ayant la signature sociale et de celles qui composaient le conseil de surveillance sont à déposer au secrétariat de la commune.
Ces six coopératives, en elles-mêmes bénéfiques parce qu’indispensables, survivaient parfois avec l’aide de subsides étatiques. Les ventes devaient souvent se faire aux cafetiers-restaurateurs, aux épiceries et aux particuliers. Leurs représentants commissionnés rivalisèrent, voire se bagarrèrent entre eux. En plus se heurtèrent-ils à des négociants d’autres tailles et aux importations étrangères, croissantes au fur et à mesure des immigrations.
Dans l’immédiat après-guerre les Italiens vinrent parfaire les rangs des ouvriers de la sidérurgie et du bâtiment. Leurs papilles ne surent se défaire du goût des rouges de chez eux. Ce ne furent pas des AOC–DOC classés. L’invasion des vins de qualité débuta bien plus tard avec l’entrée des fonctionnaires européens et des dirigeants de banques italiennes.
Nos coopératives traditionnelles ne surent tenir ni les pressions du marché internationalisé, ni l’emprise des super et hypermarchés.
Les immigrations s’accompagnaient également d’une multiplication de rosés de toutes régions, au point que tous nos vignerons se mirent à produire du pinot noir vinifié en rosé. Il y a des années ce fut encore une boisson rare. Aujourd’hui, elle est plus adaptée à notre palais qu’un hybride importé.
Les années 1965-1966 virent la naissance de Vinsmoselle, une société coopérative unique constituée sous le droit commun des sociétés commerciales. Elle mit pourtant bien des années pour fusionner toutes les six caves locales sous un même chapeau. C’en était fini, à peu près, des jalousies villageoises. Vinsmoselle domine même les grands récoltants-négociants privés au point de vue quantité surtout. Et avec des vins et crémants qui peuvent aisément rivaliser avec les crus des indépendants.
Vinsmoselle est parvenue à contrôler plus de 60 % de la production totale du vignoble.
VIII. – Rendement des vignobles
Mon exposé se concentre sur la loi du 21 janvier 1993, suivie du règlement du 15 septembre 1993, ainsi que de celle du 11 septembre 1997, celle-ci de nouveau suivie d’un règlement d’exécution.
Le 21 janvier 1993 (avec modification le 11 septembre 1997) le rendement maximum par vignoble est introduit, et le 15 septembre de la même année un règlement grand-ducal en détermine les modalités d’exécution. Nous sommes en des discussions communautaires tendant à la limitation des productions annuelles, imposant des stockages facultatifs, distillations obligatoires ou dénaturations du produit du raisin.
La Commission de la CEE, ayant établi le casier viticole, prend le chemin de la subsidiation des vignerons disposés à arracher leurs plants. Et en 2011, la Commission prêche la libéralisation des plantations.
Ce rendement maximum est fixé à l’hectare en production. Il constitue le rendement de base exprimé en quantités de raisins, de moûts ou de vin. On calcule pour chaque unité d’exploitation la quantité maximum de vin qui peut être produite pour une vendange déterminée. L’ancienne condition que la commercialisation ne pouvait se faire que sous la dénomination « Marque nationale – Appellation contrôlée », sans autre limitation, a été abrogée en 1997.