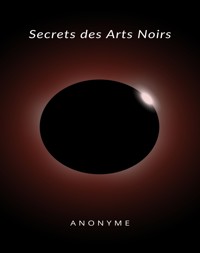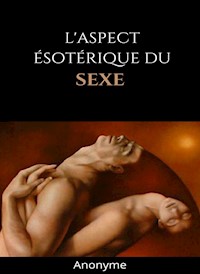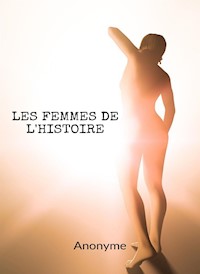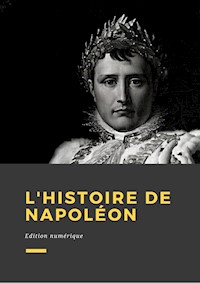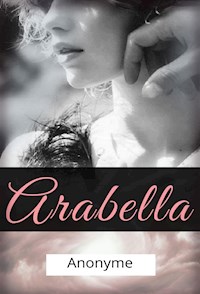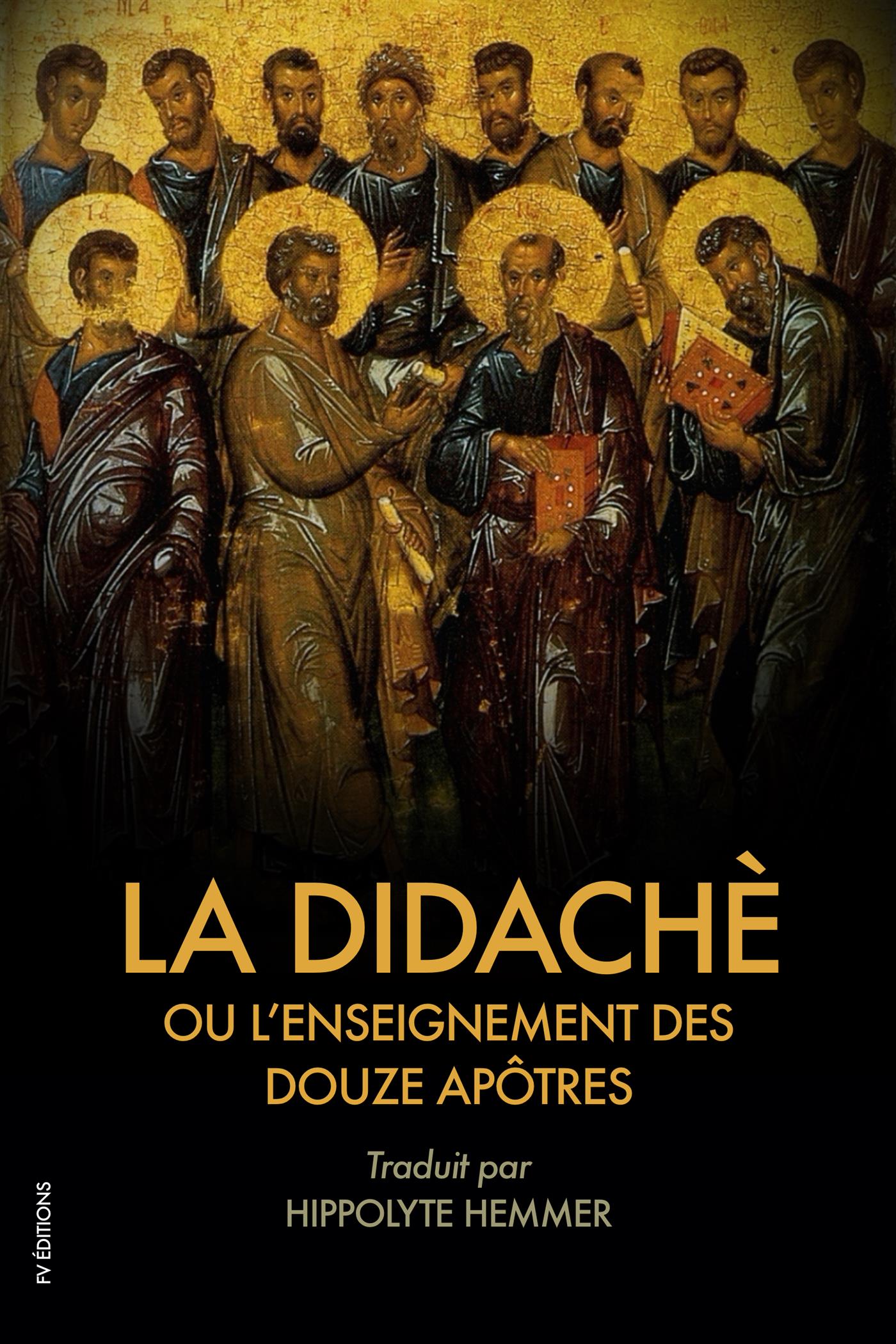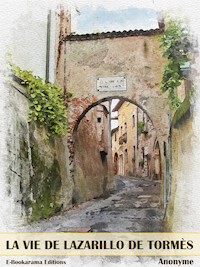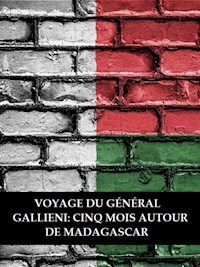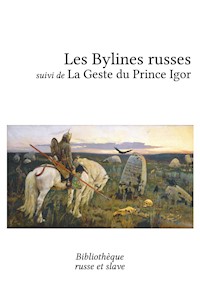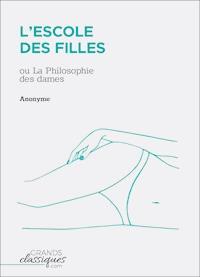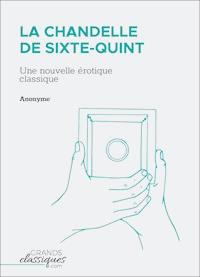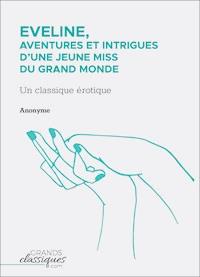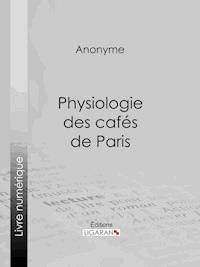84,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bruylant
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Annales du droit luxembourgeois
- Sprache: Französisch
Annales du droit luxembourgeois. Volume 23. 2013
Editions Bruylant, Bruxelles.
Revue de droit luxembourgeois paraissant tous les ans.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 508
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
REVUE FONDÉE EN 1991 PAR Marc THEWES et Dean SPIELMANN
COMITÉ DIRECTEUR
Marc THEWES
LL.M. (London School of Economics) Avocat à la Cour Chargé de cours à l’Université du Luxembourg
Dean SPIELMANN
LL.M.(Cantab.) Président de la Cour européenne des Droits de l’Homme
Franz FAYOT
D.E.A. (Paris I) Avocat à la Cour Chargé de cours associé à l’Université du Luxembourg
Steve JACOBY
LL.M. (Cantab.) Avocat à la Cour Chargé de cours à l’Université du Luxembourg
Alex ENGEL
D.E.A. (Nancy II) Avocat à la Cour Enseignant aux Cours complémentaires en droit luxembourgeois
COMITÉ SCIENTIFIQUE
Simone BEISSEL
Avocat à la Cour
Nicolas DECKER
Avocat à la Cour
Francis DELAPORTE
Vice-Président de la Cour administrative
Francis DELPÉRÉE
Professeur émérite de l’Université catholique de Louvain
Jacques DELVAUX
Docteur en droit
André ELVINGER
Avocat à la Cour
Marc ELVINGER
Avocat à la Cour
Georges FRIDEN
Ambassadeur, Représentant permanent adjoint du Grand-Duché de Luxembourg auprès de l’Union européenne
Jacques KAUFFMAN
Avocat à la Cour
Patrick KINSCH
Avocat à la Cour, Professeur invité à l’Université du Luxembourg
Jacques NEUEN
Docteur en droit
Jean-Paul NOESEN
Avocat à la Cour
Roger NOTHAR
Avocat à la Cour
André PRÜM
Doyen de la Faculté de droit, d’économie et de finance à l’Université du Luxembourg
Georges RAVARANI
Président de la Cour administrative
Alain STEICHEN
Avocat à la Cour, Professeur associé à l’Université du Luxembourg
André THILL
Président honoraire de l’Office des Assurances sociales
Albert WILDGEN
Avocat à la Cour
Georges WIVENES
Procureur général d’Etat adjoint
COMITÉ DE RÉDACTION
Francis DELAPORTE, Jacques DELVAUX, Franz FAYOT, Steve JACOBY, Jean-Paul NOESEN, Roger NOTHAR, Georges RAVARANI, Dean SPIELMANN, Marc THEWES
ANNALES DU DROIT LUXEMBOURGEOISRevue de droit luxembourgeois paraissant tous les ans
• La correspondance est à adresser à : Me Marc THEWES B.P. 55 L-2010 Luxembourg
La revue rend compte des ouvrages dont elle reçoit deux exemplaires. Sauf indication contraire, les articles publiés dans le présent volume sont à jour au 15 juillet 2014. Les mémoires d’université pour le Prix de la Fondation Bibliothèque du droit luxembourgeois 2012 sont à adresser en double exemplaire à la Fondation Bibliothèque du droit luxembourgeois à l’adresse ci-dessus.
Pour toute information sur notre fonds et les nouveautés dans votre domaine de spécialisation, consultez notre site web : www.bruylant.be
© Groupe Larcier s.a., 2015 Éditions Bruylant Rue des Minimes, 39 • B-1000 Bruxelles
EAN 978-2-8027-5033-8
Cette version numérique de l’ouvrage a été réalisée par Nord Compo pour le Groupe Larcier. Nous vous remercions de respecter la propriété littéraire et artistique. Le « photoco-pillage » menace l’avenir du livre.
LA FONDATION
BIBLIOTHÈQUE DU DROIT LUXEMBOURGEOIS
contribue au développement de la doctrine juridique luxembourgeoise par le soutien accordé à la réalisation du présent ouvrage.
L’ORDRE PUBLIC ÉCONOMIQUE ET L’ASSURANCE-VIE
PARRobert WTTERWULGHE PROFESSEUR ÉMÉRITE UCL AVOCAT AU BARREAU DE BRUXELLES ET DE PARISETFrançois MOYSE AVOCAT À LA COUR
Sommaire
Introduction
I. Le droit de l’Union Européenne
II. L’ordre public en droit belge
III. L’ordre public en France
IV. L’ordre public au Luxembourg
Conclusion
Introduction
Les années 60 se distinguent par une forte croissance économique et par le développement du processus d’intégration européenne qui s’opère par la mise en place du marché intérieur en Europe.
Du point de vue juridique, cette période se caractérise par le développement des directives d’harmonisation au niveau européen qui vise à assurer la réalisation et le bon fonctionnement du marché intérieur dans l’Union européenne. Ces directives établissent des normes qui régulent l’économie et la finance en assurant la libre prestation de services et la liberté d’établissement. Le principe de reconnaissance mutuelle va guider ce processus d’harmonisation.
Définir ce qu’est l’ordre public économique n’est guère facile. Le concept a mis du temps à émerger. Actuellement, on peut s’accorder à déclarer que l’ordre public – en droit public – comporte « deux intentions, protectrice et directrice ».1
Un domaine particulièrement sensible en ce qui concerne la notion d’ordre public économique est celui des assurances et notamment des assurances-vie. Cette notion concerne les rapports entre le droit du contrôle et celui du contrat2, en d’autres termes entre les règles prudentielles prises dans l’intérêt général, et les règles de protection du consommateur, celle-ci étant « également assurée de manière indirecte mais certaine, par la réglementation de contrôle »3.
D’ailleurs en Belgique, la nouvelle loi du 4 avril 2014 relative aux assurances a comme (un des) objectif(s) déclaré(s) d’augmenter la protection des consommateurs.
Les directives assurance-vie s’inscrivent dans cette finalité. En cette matière le législateur belge a, en transposant les directives successives dans le secteur de l’assurance, obéi à la double finalité de ces directives, d’assurer un objectif d’intérêt général à savoir le bon fonctionnement du marché intérieur d’une part et, d’autre part, d’assurer une protection renforcée et harmonisée des assurés. Les dispositions légales de transposition relèvent à ce titre, en Belgique, de l’ordre public.
La législation belge de l’assurance-vie s’inscrit donc dans l’ordre public économique décrit par G. Farjat comme « l’ensemble des règles obligatoires dans les rapports contractuels, relatives à l’organisation économique, aux rapports sociaux et à l’économie interne du contrat »4.
Il est d’un intérêt certain d’analyser dès lors, à l’aune du droit de l’Union européenne, cette notion d’ordre public, en s’inspirant de l’exemple belge, mais encore en poussant l’analyse vers le droit français, pour enfin revenir au Luxembourg sur le territoire national.
I. – Le droit de l’Union Européenne
Le droit de l’Union Européenne ne donne pas de définition de l’ordre public. La Cour de Justice de l’Union Européenne considère de façon constante qu’il appartient à l’ordre juridique interne de chaque État membre de régler les conséquences contractuelles que doit entraîner la violation des obligations qui résultent de directives d’harmonisation, en veillant au respect des principes d’équivalence et d’effectivité5.
« Les mesures que les États membres prennent à ce titre restent néanmoins soumises au contrôle de la Cour de Luxembourg qui veille notamment à ce qu’elles restent proportionnées au regard de l’objectif qu’elles poursuivent »6.
Sans définir l’ordre public, la Cour de Justice a néanmoins à diverses reprises reconnu implicitement à certaines normes, le caractère d’ordre public en confirmant « la faculté ainsi reconnue au juge d’examiner d’office le caractère abusif. »7
Dans un arrêt récent portant sur l’application de la directive relative à la protection du consommateur, la Cour de Justice s’exprime en ces termes : « il importe en outre de relever que, selon la jurisprudence de la Cour, cette directive, dans son intégralité, constitue une mesure indispensable à l’accomplissement des missions conférées à l’union, et en particulier, au relèvement du niveau et de la qualité de la vie dans l’ensemble de cette dernière (voir arrêt du 4 juin 2009 Pahon GSM, C-243/08, Rec p.I-4713 point 26, et Banco Espanol de Credito (C-618/10, point 67) »8.
« La Cour a d’ailleurs jugé que, étant donné la nature et l’importance de l’intérêt public sur lequel repose la protection que la directive assure aux consommateurs, l’article 6 de celle-ci doit être considéré comme une norme équivalente aux règles nationales qui occupent, au sein de l’ordre juridique interne, le rang de normes d’ordre public (voir arrêt du 6 octobre 2009, Asturcom Telecommunicationes C-40/08, Rec p. I-9579, point 52 et ordonnance du 16 novembre 2010, Photovost, C-76/100, Rec. p. I-1157, point 50). Il y a lieu de considérer que cette qualification s’étend à toutes les dispositions de la directive qui sont indispensables à la réalisation de l’objectif poursuivi par ledit article 6. »9.
Le rapport de la Cour de cassation française en 2013 rappelle aussi qu’en « droit de la concurrence, la Cour de Justice juge que les articles 81 CE et 82 CE (devenus articles 101 TFUE et 102 TFUE) constituent des dispositions d’ordre public qui doivent être appliquées d’office par les jurisprudences nationales (CJUE, arrêt du 1er juin 1999, ECO Swisco, C-126/97, points 36 et 39 ; CJUE arrêt du 13 juillet 2006. Manfredi, affaires jointes C-295/04 à C-298/04 points 31 et 39 ; CJUE, arrêt du 4 juin 2009, T.Mobile Netherlands CA, C8/08, point 49)10 ».
En matière d’assurance, la Cour de Justice des Communautés Européennes a confirmé à l’époque que : « Ces caractéristiques particulières propres au secteur de l’assurance ont conduit tous les États membres à introduire des législations soumettant les entreprises d’assurance à des règles impératives en ce qui concerne aussi bien leur situation financière que les conditions dans lesquelles elles s’appliquent et à un contrôle permanent du respect de ces règles »11.
De cette jurisprudence de la Cour de Justice, on peut déduire que les obligations qui résultent des directives assurance-vie sont, au niveau national, des normes équivalentes aux règles de l’ordre public. L’interprétation de la Cour de cassation tant belge que française se conforme à l’interprétation de la Cour de Justice de l’Union. Quoique moins prolixe, la jurisprudence de la Cour de cassation du Grand Duché du Luxembourg va dans le même sens.
II. – L’ordre public en droit belge
Dans un arrêt de principe du 9 décembre 1948, la Cour de cassation belge a défini l’ordre public comme : « la loi qui touche aux intérêts essentiels de l’État ou de la collectivité ou qui fixe, dans le droit privé, les bases juridiques sur lesquelles reposent l’ordre économique ou moral de la société »12. Cette définition est adoptée par la doctrine et est de jurisprudence constante. Elle a été rappelée en effet à diverses reprises par la Cour de cassation, notamment dans les arrêts du 10 mars 199413, du 29 novembre 200714 et du 29 avril 201115.
La Cour de cassation a utilement précisé la portée de cette définition dans le domaine du droit financier dans l’arrêt dit des wagons-lits.
Elle a précisé que la volonté du législateur d’assurer le bon fonctionnement du marché financier implique que les dispositions législatives soient d’ordre public. La Cour confirme l’arrêt de la cour d’appel selon lequel les dispositions de la législation financière en cause constituent « une réglementation de police de l’économie en matière d’offre publique d’acquisition et de modification du contrôle des secrets ayant fait ou faisant publiquement appel à l’épargne (…) prise afin d’assurer le bon fonctionnement du marché – et, partant, de l’économie du pays – ce qui implique que les porteurs de titres bénéficient tant des règles de la transparence et d’information que du respect du principe d’égalité entre les actionnaires. »
La Cour de cassation confirma sur base de ces considérations, que l’arrêt décide légalement que la disposition en cause est d’ordre public.16
La Cour de cassation a ajouté que le fait que « certains intérêts particuliers tirent avantage d’une disposition d’ordre public, ne modifie en rien la nature et n’exclut donc point son caractère d’ordre public, la protection de l’intérêt général étant jugé primordiale dans ce cas »17.
La législation belge qui réglemente l’assurance-vie répond à ce double souci de protéger les assurés et d’assurer le bon fonctionnement du marché dans l’intérêt général conformément à la finalité des directives assurance-vie, et plus précisément de la directive 2002/83/CE qui est d’application aujourd’hui.18
Pour déterminer la nature d’une disposition légale, il faut rechercher l’intention du législateur ainsi que les objectifs poursuivis par la disposition19. Comme l’expose B. MAES, il faut « rechercher l’intention du législateur selon l’histoire de la loi et/ou l’objet et la nature de la règle »20.
C’est dans les directives assurance-vie que réside la finalité de ces lois de transposition. Ces dernières doivent respecter l’effet utile de la directive et la finalité de celle-ci. À ce titre, les lois belges relatives au contrat d’assurance-vie doivent viser à assurer le bon fonctionnement du marché intérieur et partant concernent directement l’économie du pays.
La violation d’une disposition d’ordre public est sanctionnée en droit belge par la nullité absolue21. La nullité peut être invoquée par toute personne ayant un intérêt ainsi que par les tiers. La nullité doit être soulevée d’office par le juge. Le moyen déduit de la violation de l’ordre public peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation.
Par conséquent, les contrats conclus en violation de la législation belge relative à l’assurance-vie relevant de l’ordre public économique, sont déclarés nuls, de nullité absolue.
D’autre part, les obligations légales, notamment en matière d’information, prescrites en vertu de cette législation relative à l’assurance-vie créent un droit subjectif en faveur des assurés.
Le droit subjectif résulte de « l’obligation juridique précise qu’une règle de droit objectif met directement à charge de tiers ».
Le droit subjectif repose sur l’intérêt propre « de celui qui exige l’exécution de cette obligation ».22 Ce dernier peut alors exiger de la part du débiteur du droit subjectif que celui-ci rapporte la preuve qu’il a bien respecté son droit.
III. – L’ordre public en France
L’ordre public est davantage analysé par la doctrine en France. Pour G. Drago : « Notion complexe et protéiforme, l’ordre public apparaît comme l’horizon de l’État légal fixant les bornes de ce qui est possible et de ce qui est interdit comme le rappel des limites qu’il ne faut pas franchir afin de consacrer ce vouloir vivre ensemble qui fait une nation ».23
Une définition plus classique reprise usuellement par la doctrine est celle de Planiol qui exprime sans doute cette réalité de la façon la plus pratique : « une disposition est d’ordre public toutes les fois où elle est inspirée par une considération d’intérêt général qui se trouverait compromis si les particuliers étaient libres d’empêcher l’application de cette loi. »24
L’ordre public économique est un concept relativement récent. Une première étude consacrée à cette notion paraît être celle du doyen Ripert en 1934 dans son ouvrage intitulé « L’ordre économique et la liberté contractuelle »25. Par la suite, Gérard Farjat consacre sa thèse de doctorat en 1963 à l’étude de l’ordre public économique. Celui-ci est un des premiers à accorder un contenu juridique plus précis à cette notion. Le doyen Savatier a publié la même année son ouvrage intitulé « L’ordre public économique »26.
L’ordre public économique se distingue de l’ordre public classique en ce qu’il n’est pas seulement prohibitif et négatif mais également dispositif27. R. Savatier considère que ce concept est « plastique, de manière à tenir compte, dans leur variété, suivant les temps et les lieux, des besoins fluctuants de la politique économique. Et il répugne à s’emprisonner dans la stabilité de formules légales, pour tenir empiriquement compte des circonstances »28.
À la différence de la Belgique, la Cour de cassation française et une majorité d’auteurs français distinguent deux grandes catégories de règles d’ordre public économique : l’ordre public économique de direction et l’ordre public économique de protection29.
L’ordre public économique de direction « se propose de concourir à une certaine organisation de l’économie nationale en éliminant des contrats privés tout ce qui pourrait contrarier cette direction »30. Les dispositions d’ordre public de direction visent à la direction de l’économie et à la protection de l’intérêt général.
L’ordre public économique de protection est composé de « toutes les mesures qui tendent à la protection d’un contractant et qui modifient les relations contractuelles des parties en accordant un droit à l’une d’entre elles »31. Les dispositions d’ordre public de protection n’ont d’autre but que de protéger, dans divers contrats, la partie économiquement la plus faible32.
Cette distinction entre l’ordre public de direction et l’ordre public de protection est aujourd’hui remise en question par certains auteurs33. P. Malaurie considère que cette distinction n’est pas facile à faire entrer dans la pratique dans la mesure où il note, à juste titre, qu’il existe une interaction entre les objectifs économiques et sociaux d’une politique34. Des auteurs soulignent la difficulté de marquer précisément la frontière entre l’ordre public de direction et l’ordre public de protection dans la mesure où derrière toute règle de protection existe un intérêt social35. Cette distinction paraît être accueillie par la jurisprudence, encore qu’elle soit difficile à manier et parfois incertaine36.
Les dispositions d’ordre public de direction sont sanctionnées par une nullité absolue, qualifiée de nullité d’ordre public, tandis que les dispositions d’ordre public de protection sont sanctionnées par une nullité relative37. En effet, « on conçoit pour les premières (dispositions d’ordre public de protection) que les individus protégés soient seuls admis à les faire valoir… mais que pour sauvegarder les intérêts supérieurs (dispositions d’ordre public de direction) on ouvre largement la voie de la nullité »38.
Dans le domaine de l’ordre public économique, cette distinction constitue une vue de l’esprit. La finalité de ces lois de police est d’assurer l’intérêt économique général mais également d’assurer une égalité entre les agents économiques. Le fonctionnement du marché implique en effet le respect d’un ensemble de règles qui veillent à assurer la protection des agents les plus faibles. Un marché efficient repose sur une égale information des opérateurs économiques, que l’économiste appelle la condition de transparence. L’ensemble des règles qui imposent des informations ou répriment des abus du marché assurent certes la protection de l’agent économique le plus faible mais sont aussi autant de moyens d’assurer la transparence du marché. Intellectuellement séduisante, cette distinction entre les deux ordres publics n’est par conséquent, dans la pratique, pas fondée.
Certains auteurs en sont conscients. Selon eux, les règles d’ordre public de protection devraient toujours être sanctionnées par une nullité absolue car ils estiment qu’au-delà de la protection des personnes considérées, c’est la moralisation de l’ensemble des relations contractuelles qui est en cause39.
Dans le cas où les dispositions d’ordre public ont une finalité double – ce qui est le cas dans les domaines économique et financier – c’est-à-dire que celles-ci appartiennent à l’ordre public économique de direction mais visent également à protéger certains contractants, G. Farjat considère à juste titre que « lorsqu’une règle est à la fois de protection et de direction, il est normal que le second but l’emporte sur le premier : il y a une hiérarchie des règles d’ordre public »40.
En matière d’assurance-vie, la distinction opérée en France n’a guère de conséquence. La législation française répond en effet à un objectif d’ordre public de direction. En conséquence, comme en Belgique, la violation de ces normes est sanctionnée par la nullité absolue.
IV. – L’ordre public au Luxembourg
Au Luxembourg, la notion d’ordre public économique a émergé dans le domaine du droit de la concurrence.
Ainsi, la loi du 23 octobre 2011 relative à la concurrence41 prévoit à son article 12 que le président du Conseil de la Concurrence peut prendre des mesures conservatoires à partir du jour de la saisine du Conseil, et ce à la demande de toute partie concernée, après avoir entendu les parties en cause.
Le texte poursuit ainsi : « Ces mesures conservatoires ne peuvent intervenir que si la pratique dénoncée porte une atteinte grave et irréparable à l’ordre public économique ou à l’entreprise plaignante… ».
Cette référence à l’ordre public économique a été reprise mot-à-mot de la loi antérieure du 17 mai 2004 relative à la concurrence (ancien article 11).
Les travaux parlementaires de cette loi indiquent que le système est directement calqué d’une part sur les dispositions de l’ordonnance française de 1986, et, d’autre part, sur le texte de l’article du Règlement No 1/2003 (pour les mesures transitoires).4243
Un jugement du Tribunal administratif a statué comme quoi « l’atteinte à l’ordre public économique ne s’analysait pas en un grief qui était à communiquer par le président à l’entreprise concernée, étant donné que la notion de grief se rapporte aux faits ou agissements susceptibles de constituer un abus de position dominante, tandis que le constat d’une atteinte grave, immédiate et irréparable à l’ordre public et économique est le résultat d’une appréciation que le président du conseil porte sur la pratique dénoncée afin de pouvoir légalement prendre des mesures conservatoires »44.
Ce jugement statue donc sur un incident procédural en citant la loi de 2004 de l’époque sur la concurrence, estimant que l’atteinte à l’ordre public (et) économique était, au vœu de la loi, une des causes justifiant que le président du conseil de la concurrence prenne le cas échéant des mesures conservatoires permettant d’éviter un abus de position dominante, ancrant ainsi cette notion dans la jurisprudence administrative.
La seule correction faite dans la loi de 2011 précitée était d’abroger le mot « et » qui figurait dans l’expression « ordre public et économique » dans la loi de 2004 sur la concurrence, alors qu’il « ne semble pas donner de sens particulier ».45
L’ordre public économique a, pour sa part, été évoqué dans quelques jugements rendus par le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg46.
Dans un jugement du 1er mars 1989, le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg s’inspire de la jurisprudence et de la législation françaises. Ce jugement considère que la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d’accès et d’exercice de certaines professions est d’ordre public économique. Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg ajoute que « la finalité de la loi est double : elle tend d’une part à assurer une certaine direction de l’économie et une certaine organisation des rapports sociaux de production, et elle a d’autre part pour objet la protection des consommateurs »47. Le juge sanctionne la conclusion d’un contrat en violation d’une règle d’ordre public de direction économique de nullité absolue48. Par conséquent, il a été jugé que « les contrats conclus en violation de la loi du 2 juin 1962 sont nuls. »49
Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a également rendu un jugement le 21 avril 1993 où il a été jugé que la législation qui a remplacé la loi de 1962, citée dans le jugement précédent, à savoir la loi du 28 décembre 1988, régissant l’accès à certaines professions contient des dispositions pénales et est, par conséquent, d’ordre public économique. Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a ajouté que « cette législation tend d’une part à assurer une certaine direction de l’économie et une certaine organisation des rapports sociaux de production, et elle a d’autre part pour objet la protection des consommateurs. (…) La sanction la plus efficace pour parvenir au but visé par la loi est de déclarer nulles les opérations conclues en violation de cette législation »50. Le Tribunal a estimé que « les contrats conclus en violation de la loi de 1988 doivent être sanctionnées au plan civil par la nullité »51.
Pourtant, actuellement il ne semble pas que la violation de dispositions d’intérêt général amène, du moins dans une certaine jurisprudence relative au secteur financier, à considérer que cette violation entraîne pour le particulier lésé un droit subjectif à invoquer la nullité de dispositions violant les règles prudentielles. Du moins en est-il ainsi lorsque le demandeur tente d’obtenir du juge l’écartement d’un comportement contraire à ces mêmes règles. Ce courant de jurisprudence ne respecte pas l’effet utile des directives européennes concernées. Elle est à ce titre critiquable.
Ainsi, un arrêt récent de la Cour d’appel, s’il indique bien que « Les règles de conduite édictées tant par la loi du 5 avril 1993 que celle du 12 novembre 2012 relative à la lutte contre le blanchiment et le terrorisme ainsi que les circulaires également invoquées par V. sont [bien] conçues dans l’intérêt général », que « traduisant sur un plan strictement disciplinaire les normes déontologiques à observer par les professionnels du secteur financier ». La Cour cependant estime à tort selon nous qu’elles « ne constituent pas une base légale permettant aux particuliers d’agir directement en justice en invoquant une violation de ces dispositions ».52 Pareille jurisprudence détonne au niveau européen et semble révéler un certain mépris du droit européen et des règles d’interprétation qui s’imposent selon la Cour de Justice de l’Union.
Conclusion
En matière économique et financière, nous pouvons soutenir que toutes les dispositions légales qui ont pour finalité l’intérêt général, et plus précisément le bon fonctionnement du marché, relèvent indiscutablement de l’ordre public économique.
Par conséquent, la législation belge relative à l’assurance-vie, dite branche 23, ayant pour finalité première le bon fonctionnement du marché relève incontestablement de l’ordre public économique.
Tel devrait être le cas également au Luxembourg en matière d’assurance-vie. Faut-il rappeler que la loi du 18 décembre 2006 portant transposition de la directive 2002/65/CE concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs a introduit le droit de rétractation en matière du contrat d’assurance-vie à l’article 100 de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance.53
Il sera intéressant de suivre à la fois la position doctrinale et l’évolution jurisprudentielle quant à la portée de l’ordre public économique, alors que la législation en la matière découle directement des directives européennes.
1. E. PICARD, L’influence du droit communautaire sur la notion d’ordre public, AJDA, no spécial, 1996, p. 56.
2. M. FONTAINE, Droit des Assurances, 4e édition, Larcier, 2010, no 59.
3. M. FONTAINE, ibid., no 63.
4. G. FARJAT,L’ordre public économique, Paris, L.G.D.J., 1963, p. 38.
5. CJUE, affaire C-591/10, du 15 juillet 2012 cité par Arrêt CJUE, C-604/11, du 30 mai 2013.
6. Cour de cassation française, Rapport 2013, Titre II, chap. 1, p. 3.
7. CJUE, affaire C-429/05, 4 octobre 2007, point 62.
8. CJUE, affaire C-488/11, considérant 43, 30 mai 2013.
9. CJUE, affaire C-488/11, considérant 44, 30 mai 2013.
10. Cour de cassation française, Rapport 2013, op. cit., p. 3.
11. Cour CEE, affaire 205/84 du 4 décembre 1986, point 32.
12. Cass., 9 décembre 1948, Pas., I, p. 699.
13. Cass., 10 mars 1994, R.D.C., 1995, p. 15.
14. Cass., 29 novembre 2007, disponible sur http://www.juridat.be, consulté le 4 juillet 2014.
15. Cass., 29 avril 2011, disponible sur http://www.juridat.be, consulté le 4 juillet 2014.
16. Cass., 10 mars 1994, op. cit.
17. F. MOURLON BEERNAERT, « La querelle des anciens et des modernes. À propos de l’affaire des wagons-lits », DAOR, 1997, p. 68.
18. La directive Solvability II lui a succédé en 2009. Mais la création de l’autorité Européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) a conduit la Commission Européenne à établir une nouvelle proposition de directive : Omnibus II qui soulève de nombreux débats. En conséquence de quoi les dates de transposition et d’application de la directive 2009 Solvability II ont été postposées à deux reprises, par le biais de deux directives, le 12 septembre 2012 d’abord et ensuite le 11 décembre 2013. La date limite de transposition est fixée aujourd’hui au 31 mars 2015 et la date de mise en application et de l’abrogation de la directive 2002 Solvability I est fixée au 1er janvier 2016.
19. F. MOURLON BEERNAERT,op. cit., p. 67.
20. B. MAES, Cassatiemiddelen naar Belgisch recht, Mys en Breesch, Gent, 1993, p. 134, no 161, cité par F. MOURLON BEERNAERT,op. cit., p. 67.
21. P. VAN OMMESLAGHE,Droit des obligations, Tome I., Bruxelles, Bruylant, 2010, p. 341 ; Voy. Cass., 9 décembre 1948, Pas., I, p. 699 ; Cass., 10 mars 1994, R.D.C., 1995, p. 15 ; Comm. Charleroi, 29 août 2002, DAOR, 2002, p. 433.
22. J. VELU, Conclusions Cass. 19 avril 1987, p. 288.
23. G. DRAGO, Avant-propos, Rapport annuel 2013, Cour de cassation de Paris.
24. Cité par J. GHEDEN, Traité de droit civil, 3e éd., LCDJ, Paris, 1993, no 104.
25. G. RIPERT, « L’ordre économique », Chronique, Paris, Dalloz, 1965, p. 37.
26. R. SAVATIER, « L’ordre public économique », Chronique, Paris, Dalloz, 1965, p. 37.
27. Ph. MALAURIE,op. cit., p. 321 ; G. MARTY et P. RAYNAUD,Droit civil : les obligations. Tome 1, Paris, Sirey, 1988, p. 75.
28. R. SAVATIER,La théorie des obligations : vision juridique et économique, Paris, Dalloz, 1967, p. 166.
29. G. FARJAT,Droit économique, Paris, Presses universitaires de France, 1971, pp. 42-43 ; Voy. J. GHESTIN,Traité de droit civil : la formation du contrat, Paris, L.G.D.J., 1993, pp. 85-122.
30. J. CARBONNIER,op. cit., p. 147 ; G. FARJAT,op. cit., p. 43.
31. G. FARJAT,op. cit., p. 43.
32. F. MOURLON BEERNAERT,op. cit., p. 66 ; Cons. également J. MÉADEL,op. cit., p. 21 et suivants.
33. Cons. pour plus de précisions M. CUMYN, « Les sanctions des lois d’ordre public touchant à la justice contractuelle : leurs finalités, leur efficacité », R.J.T., 2007, pp. 1-85.
34. Ph. MALAURIE,op. cit., p. 322.
35. F. TERRE et PH. SIMLER,Droit civil : les obligations, Paris, Dalloz, 2009, p. 401.
36. G. MARTY et P. RAYNAUD,op. cit., p. 74 ; F. TERRE et PH. SIMLER,op. cit., p. 396.
37. G. FARJAT,op. cit., pp. 318-326 ; J. MÉADEL,op. cit., p. 23 et suivants ; G. FARJAT,op. cit., p. 48.
38. G. FARJAT,op. cit., p. 319.
39. F. TERRE et PH. SIMLER,op. cit., p. 401.
40. G. FARJAT,op. cit., p. 325.
41. Mémorial A no 318, p. 3755.
42. Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, J.O.C.E., L1, du 4 janvier 2003, p. 1.
43. Exposé des motifs, projet de loi 5229, p. 21.
44. T.A., 20 mai 2009, nos 24306 et 24408 du rôle, confirmé en appel : C.A. 4.3.2010, 25855C.
45. Exposé des motifs, projet de loi no 5816, p. 21.
46. Trib. arr. Luxembourg, 21 avril 1993 ; Trib. arr. Luxembourg, 12 juillet 1989 ; Trib. arr. Luxembourg, 1er mars 1989.
47. Trib. arr. Luxembourg, 1er mars 1989 ; no 36392 du rôle ; Judoc 98912052.
48. Trib. arr. Luxembourg, 1er mars 1989 ; ibid.
49. Trib. arr. Luxembourg, 12 juillet 1989 ; no 37886 du rôle ; Judoc 98911741.
50. Trib. arr. Luxembourg, 21 avril 1993, Judoc 99316271.
51. Voir également le jugement du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 9 mars 2005, no 62340 du rôle, Judoc 99860210.
52. Cour d’appel, 13 mars 2013, no 37273 du rôle.
53. Loi du 18 décembre 2006 portant transposition de la directive 2002/65/CE concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs et portant modification de : 1. la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance ; 2. la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique ; 3. l’article 63 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, Mém. À no 223 de 2006, p. 3801, abrogée entretemps par l’introduction du Code de la Consommation.
Travaux de l’association Henri Capitant
Journées Pays-Bas/Belgique 2013
« La preuve »
PREUVE ET DROITS FONDAMENTAUX EN DROITS EUROPÉEN ET LUXEMBOURGEOIS
PARSéverine MENETREY ASSISTANT PROFESSEUR À L’UNIVERSITÉ DU LUXEMBOURG
Sommaire
I. L’encadrement de l’administration de la preuve par les droits fondamentaux
A. L’administration de la preuve conforme aux droits fondamentaux
1) L’administration de la preuve dans le respect des droits fondamentaux
2) L’exemple des infiltrations policières
B. Quid de la protection des données personnelles dans l’administration de la preuve ?
II. La libéralisation de l’admissibilité de la preuve par les droits fondamentaux
A. L’articulation d’exigences contradictoires
B. Quelle admissibilité pour les preuves obtenues illégalement devant les tribunaux luxembourgeois ?
III. Un droit fondamental de la preuve comme composante du droit à un procès juste et équitable
A. Le droit fondamental de se taire
B. Le droit de faire interroger les témoins
C. Le droit à une expertise équitable
Ouvrir les Journées belgo-néerlandaises de l’Association Henri Capitant des amis de la culture juridique française consacrées à la preuve par le thème « preuve et droits fondamentaux » démontre la place essentielle que ces derniers occupent tant dans le droit de la preuve que dans un mouvement qui se dessine vers un droit à la preuve. L’influence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) sur la procédure luxembourgeoise paraît bien inscrire le Grand-Duché dans le double mouvement anticipé par le Professeur Marguénaud rapporteur général, à savoir l’encadrement d’une part et la libéralisation d’autre part de certains modes de preuve par les droits fondamentaux1.
En matière de preuve cepedant, le rôle de la Convention européenne des droits de l’homme (Conv. EDH) n’est pas aussi déterminant que l’on pourrait le croire. En effet, comme le souligne la Cour de Strasbourg dans l’arrêt Schenck, « si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves en tant que telle, matière qui dès lors relève au premier chef du droit interne »2. Il n’en demeure pas moins que la CEDH intervient de plus en plus dans le domaine probatoire. Son intervention s’opère à trois niveaux : en amont de la procédure pour ce qui a trait à l’administration de la preuve (I), au cours de la procédure en ce qui concerne l’admissibilité de la preuve (II) et en tant qu’élément fondamental de la procédure et du droit à un procès juste et équitable (III).
I. – L’encadrement de l’administration de la preuve par les droits fondamentaux
L’administration de la preuve concerne la manière dont la preuve est faite et doit respecter certaines garanties fondamentales (A). Cette exigence de conformité aux droits fondamentaux dans l’administration de la preuve soulève néanmoins la question particulière se savoir dans quelle mesure l’administration de la preuve doit se conformer à la protection des données personnelles qui tend à se « fondamentaliser » (B).
A. – L’ADMINISTRATIONDELAPREUVECONFORMEAUXDROITSFONDAMENTAUX
La preuve ne peut pas être administrée, c’est-à-dire obtenue, en violation des droits fondamentaux (1). Le cas des infiltrations policières illustre les limites dans lesquelles la preuve peut être administrée par les pouvoirs publics (2).
1. – L’administration de la preuve dans le respect des droits fondamentaux
La preuve doit être administrée conformément aux droits fondamentaux de la personne incriminée3. Par exemple, les fouilles corporelles sont strictement encadrées4. La jurisprudence est très claire : « la fouille corporelle, au contraire de la palpation sommaire des personnes contrôlées, est assimilée à une perquisition nécessitant mandat de justice ou état de flagrance »5. Comme toute mesure coercitive, la fouille doit répondre aux conditions de nécessité et de proportionnalité. La solution du droit luxembourgeois qui requiert soit une autorisation, soit un état de flagrance est conforme aux exigences posées par la CEDH6. Le respect des droits fondamentaux dans l’administration de la preuve semble une évidence. A fortiori, la prohibition de la preuve par la torture fait peu de doute dans nos esprits. La montée de l’insécurité et notamment du terrorisme a néanmoins relativisé cette certitude.
La CEDH elle-même, dans son arrêt Gäfgen, tout en réaffirmant le caractère absolu de l’interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradants, considère que les preuves matérielles recueillies au moyen d’un traitement inhumain et de menaces de torture peuvent être admises au procès dès lors qu’elles n’ont pas eu d’incidence décisive sur l’issue de la procédure7. Il convient de remarquer que l’arrêt porte sur l’admissibilité de la preuve et non sur son administration. Même si la distinction peut sembler rhétorique, elle a son importance, la preuve ne pouvant aucunement être administrée par la torture.
L’interdiction de la torture prévue à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme (Conv. EDH) ratifiée par le Luxembourg le 3 septembre 1953 s’impose aux juridictions luxembourgeoises comme aux autres juridictions des États du Conseil de l’Europe8. Néanmoins, tous ces États sont confrontés à des menaces nouvelles qui commandent la mise en place de modes de preuves particuliers. En adhérant à différents instruments internationaux et par le truchement du droit de l’Union européenne, le Luxembourg s’est dotée d’un appareil pénal et procédural permettant de lutter contre le terrorisme et la criminalité des affaires liée ou non aux activités terroristes9. L’administration de la preuve en matière de terrorisme est adaptée puisque des modes d’administration de la preuve exorbitants sont prévus, mais ne remettent pas en cause l’exigence de conformité aux droits fondamentaux. Selon des formules variables « sur réquisitions du procureur d’État et aux fins de recherche et de poursuite des actes de terrorisme ou de participation à un groupe terroriste » ou « en raison de la nature des faites et des circonstances de l’espèce », diverses fouilles de véhicules10, mesures d’infiltration11, accès aux comptes bancaires12 et écoutes en dehors du cadre de droit commun13 sont autorisés. L’administration de la preuve est ainsi renforcée dans la poursuite de fléaux tels que le terrorisme, mais sans mettre à mal les droits fondamentaux de la personne poursuivie comme l’illustre l’exemple des infiltrations policières.
2. – L’exemple des infiltrations policières
Les infiltrations policières sont régies par les articles 48-17 et s. du Code d’instruction criminelle (CIC) introduits par la loi du 3 décembre 2009 portant réglementation de quelques méthodes particulières de recherche. Le projet de loi expose les raisons de ces infiltrations et leur légitimité14. Le procureur d’État ou le juge d’instruction peut recourir à titre exceptionnel à la technique de l’infiltration lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction le justifient et si les autres moyens ordinaires d’investigation s’avèrent inopérants en raison de la nature des faits et des circonstances spéciales de l’espèce. La décision du procureur d’État ou du juge d’autoriser une infiltration policière doit être délivrée par écrit et spécialement motivée. Elle doit également mentionner le ou les faits qui justifient le recours à cette procédure et l’identité de l’officier de police judiciaire sous la responsabilité duquel se déroule l’opération. La décision fixe également la durée de l’infiltration qui ne peut en principe excéder quatre mois. L’infiltration policière n’est possible que pour une liste d’infractions graves parmi lesquelles figurent les actes de terrorisme et de financement de terrorisme, la traite des êtres humains et le proxénétisme, le trafic de stupéfiants en relation avec une association de malfaiteurs ou une organisation criminelle ou encore le blanchiment et le recel. Pour les infractions limitativement énumérées, il paraît légitime d’autoriser un officier de police judiciaire à recourir à une identité d’emprunt et à commettre, si nécessaire, une série d’actes qui, dans d’autres circonstances, seraient qualifiés d’infractions sans être pénalement responsable de ces actes. L’équilibre entre les moyens de renseignement mis en place et les droits de la défense est préservé dans la mesure où le témoignage l’infiltré ne saurait à lui seul servir de fondement à l’éventuelle condamnation d’une personne à moins que il dépose sous sa véritable identité15.
La CEDH opère une distinction entre les méthodes d’infiltration qui sont autorisées d’une part et la provocation policière d’autre part condamnée au motif qu’elle rend le procès inéquitable16. La distinction n’est cependant pas toujours évidente et en cas d’impossibilité d’établir l’existence d’une provocation policière, il convient d’évaluer la possibilité pour l’accusé de contester la régularité de l’opération pour apprécier sa conformité au droit à un procès juste et équitable17. Dans la droite ligne de cette exigence, une des décisions les plus importantes en matière de provocation policière, bien antérieure à la loi de 2009, a été rendue par la Cour d’appel le 25 mars 198818. Cette affaire est connue sous le nom de « l’affaire des faux dollars » à l’occasion de laquelle la Sûreté publique avait monté une opération visant à surprendre un individu et ses complices lors d’une tentative d’émission de faux dollars. En l’espèce la Cour considère que les faits reprochés aux prévenus sont le résultat de stratagèmes utilisés par la Sûreté publique afin de les amener à commettre des infractions. Selon la Cour, la résolution criminelle des prévenus a été renforcée par une provocation policière et que c’est à tort que les premiers juges ont rejeté l’exception de nullité des poursuites. « Cette provocation vicie les constatations de la police judiciaire et enlève toute force probante aux procès-verbaux ». Dans une décision plus récente du 5 décembre 2006, mais toujours antérieure à la loi de 2009, la Cour d’appel a jugé qu’il n’y avait pas de provocation policière dans le cas de l’appel d’un présumé dealer par l’un de ses clients en présence d’agents de police en vue de l’achat de cocaïne qui s’est fait une dizaine de minutes après le coup de téléphone. En effet, l’intervention des agents n’a pas été déterminante et 24 grammes de cocaïne ont été saisis chez lui19.
B. – QUIDDELAPROTECTIONDESDONNÉESPERSONNELLESDANSL’ADMINISTRATIONDELAPREUVE ?
Moins spectaculaire et moins médiatique que les infiltrations policières, la question de la protection des données personnelles dans l’administration de la preuve n’en est pas moins d’actualité brulante. Dans un arrêt du 18 avril 2013, la CEDH a condamné la France pour son fichier des empreintes qui centralise toutes les empreintes non seulement des personnes condamnées, mais aussi celles des personnes à l’encontre desquelles il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elles ont commis un crime ou un délit20. La CEDH considère que la France avait méconnu le droit au respect de la vie privée du requérant dont elle avait conservé les empreintes digitales malgré le classement sans suite de l’affaire. La Cour reproche au dispositif français de ne pas distinguer selon que la personne a été condamnée ou non.
Le droit luxembourgeois encadre fortement la conservation des données personnelles, mais sa législation en matière de données personnelles biologiques – proche du droit français – risque la même censure que ce dernier21. Le Code d’instruction criminelle contient un chapitre IX « de l’accès à certains traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par des personnes morales de droit public » à article unique. L’article 48-24 prévoit que les membres du personnel de l’administration judiciaire ont accès, par un système informatique, à différents fichiers de données à caractère personnel, notamment le registre général des personnes physiques et morales organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales, le fichier relatif aux affiliations des salariés, des indépendants et des employeurs géré par le Centre commun de la sécurité sociale, ou encore le fichier des étrangers exploité pour le compte du service des étrangers du ministre ayant l’immigration dans ses attributions. La consultation de ces fichiers est encadrée22. Le paragraphe 5 précise que « seules les données à caractère personnel strictement nécessaires, dans le respect du principe de proportionnalité, peuvent être consultées ».
En ce qui concerne les données personnelles biologiques, la loi du 25 août 2006 introduite aux articles 48-3 et suivants CIC porte spécifiquement sur les procédures d’identification par empreintes génétiques. Cette loi visait non seulement à conférer une base légale adéquate à l’établissement de profils d’ADN, mais aussi à encadrer les données les concernant. Elle prévoit deux genres de traitements des données à caractère personnel relatives aux empreintes génétiques, à savoir, d’une part, le traitement ADN criminalistique qui concerne les profils d’ADN établis et traités dans le cadre des enquêtes préliminaires et des instructions préparatoires en cours, et, d’autre part, le traitement ADN condamnés qui concerne les empreintes génétiques de personnes ayant été condamnés. On entend par traitement ADN l’insertion dans un fichier de profils ADN, ainsi que leur modification, consultation, comparaison et communication aux fins d’identification23.
Ce sont ces derniers fichiers concernant spécifiquement les procédures d’identification par empreintes génétiques qui peuvent soulever des interrogations. En principe, le recours aux empreintes génétiques ne peut se faire que si cela s’avère nécessaire dans le cadre bien précis de l’enquête pénale. Les profils d’ADN peuvent provenir de personnes qui ont consenti au prélèvement ou de personnes pour lesquelles le prélèvement a été exercé sous la contrainte physique. Le prélèvement de cellules humaines sous la contrainte physique n’est possible que si les faits emportent une peine criminelle ou correctionnelle dont le maximum est égal ou supérieur à deux ans d’emprisonnement, mais il n’est pas limité aux personnes inculpées. La loi luxembourgeoise s’inscrit dans cette tendance contemporaine selon laquelle la méthode d’analyse par comparaison de profils d’ADN ne développe son plein potentiel que par la constitution de bases de données génétiques larges. Ainsi le prélèvement d’ADN (y compris sous contrainte) peut être effectué sur des personnes autres que le suspect direct c’est-à-dire sur des personnes qui ne sont pas, ou pas encore, considérées comme suspects, mais qui sont néanmoins impliquées dans la genèse des faits, comme par exemple la victime ou une personne qui se trouvait sur les lieux du crime peu avant l’acte commis24. Même si la loi du 2 août 2002 sur la protection des données prévoit à son article 6 (3) que « les données génétiques ne peuvent faire l’objet d’un traitement que pour vérifier l’existence d’un lien génétique dans le cadre de l’administration de la preuve en justice, pour l’identification d’une personne, la prévention ou la répression d’une infraction pénale (…) » ; il n’est pas certain que cette loi soit en totale conformité avec la jurisprudence récente de la CEDH… à suivre.
II. – La libéralisation de l’admissibilité de la preuve par les droits fondamentaux
L’admissibilité de la preuve se pose à un stade ultérieur à celui de l’administration de la preuve. Concrètement, il s’agit du sort procédural des preuves qui ont certes été obtenues illégalement, mais qui existent. La preuve obtenue illégalement est-elle admissible ? Il revient au juge d’articuler – au stade procédural – des exigences contradictoires (A). La jurisprudence luxembourgeoise demeure attachée au principe de légalité dans l’admissibilité de la preuve, mais certaines hésitations sont perceptibles, comme elles sont perceptibles devant la CEDH elle-même (B).
A. – L’ARTICULATIOND’EXIGENCESCONTRADICTOIRES
La question des répercussions de l’utilisation d’éléments de preuve illégalement recueillis sur le caractère équitable de la procédure et du procès est une des questions les plus délicates du droit de la preuve tout particulièrement en matière pénale25. La question se pose également en procédure civile dans laquelle on voit se dessiner un droit subjectif à la preuve comme en témoigne l’admissibilité progressive aussi bien en droit français qu’en droit luxembourgeois de preuves obtenues en violation de la vie privée. Le juge doit faire une mise en balance entre le droit à la preuve et l’atteinte à un droit. L’équilibre tend à se faire en faveur de celui qui cherche à prouver. Si le juge luxembourgeois a pu écarter des preuves obtenues par vidéosurveillance au motif qu’elles avaient été obtenues sans information préalable du salarié, il tend à admettre de plus en plus libéralement des preuves dont l’obtention ne paraît guère en conformité avec la protection de la vie privée et du secret des correspondances comme en témoigne l’arrêt de la Cour d’appel du 3 mars 201126. Comme l’explique Alain Grosjean, dans cette affaire, « le premier juge avait estimé que “l’interception et la transmission faites par l’employeur du fichier litigieux envoyé à A et produite à titre de preuve ne peut être pris en considération pour établir les fautes reprochées à ce dernier, alors qu’il a été obtenu en violation du secret de la correspondance”. La Cour d’appel a réformé cette décision affirmant qu’il n’y avait pas violation du secret des correspondances en l’espèce. Dans la motivation de l’arrêt, la Cour précisait que “l’inviolabilité absolue des correspondances risque d’inciter des salariés indélicats à y loger des dossiers plus ou moins illégaux”. La Cour d’appel a estimé que le fichier en cause pouvait être pris en considération, d’autant plus que le fichier “était adressé à certains salariés de l’entreprise et que son intitulé ne dénotait a priori aucun caractère privé” »27. Comme le souligne l’auteur, l’évolution de la jurisprudence tend à tempérer les droits fondamentaux du salarié.
La tendance est moins nette en procédure pénale à l’égard des personnes incriminées du fait de la distinction entre l’administration de la preuve et l’admissibilité de cette dernière, mais la frontière est ténue. Ainsi il convient de souligner que la preuve obtenue par infiltration policière est une administration légale de la preuve. Même si elle peut impliquer la commission d’actes illégaux, la preuve est légalement recueillie. La preuve obtenue par infiltration policière se distingue donc de l’hypothèse de l’utilisation de preuves recueillies de manière illégale, mais la frontière est poreuse. Certes, en principe, les preuves obtenues illégalement doivent être écartées28, certains cas particuliers font hésiter le juge qu’il soit national ou européen.
Ainsi, dans l’arrêt Schenck, la CEDH a considéré qu’elle « ne saurait […] exclure par principe et in abstracto l’admissibilité d’une preuve recueillie de manière illégale » et « il lui incombe seulement de rechercher si le procès […] a présenté dans l’ensemble un caractère équitable29 ». La décision a fait l’objet de quatre opinions dissidentes mais a ouvert la voie à d’autres arrêts dans lesquels la Cour considère comme équitable un procès dans lequel la culpabilité est établie au moyen de preuve recueillie en violation de l’article 830. Moins hésitante, la Cour de cassation française dans un arrêt du 5 avril 2012, paraît consacrer un droit à la preuve reprochant aux juges du fond d’avoir rejeté une preuve obtenue en violation de la vie privée et du secret des correspondances sans avoir examiné « si la production litigieuse n’était pas indispensable à l’exercice [du] droit à la preuve [du requérant], et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence »31.
Les termes de l’équation sont simples : comment concilier des droits fondamentaux contradictoires ? Pour trancher ce type de conflit le juge canadien et singulièrement québécois utilise le test de la « déconsidération de la justice »32. Dans quel cas la bonne administration de la justice est-elle le plus déconsidérée : dans le cas où le juge admet une preuve illégale ou lorsqu’elle refuse de faire primer un élément de vérité ? Le juge luxembourgeois moins systématique recherche également un équilibre.
B. – QUELLEADMISSIBILITÉPOURLESPREUVESOBTENUESILLÉGALEMENTDEVANTLESTRIBUNAUXLUXEMBOURGEOIS ?
Le droit luxembourgeois illustre les hésitations inhérentes à l’admissibilité d’éléments de preuve recueillis de manière illégale. Alors que les preuves obtenues en violation du secret bancaire luxembourgeois ont conduit à une évolution de la jurisprudence belge, c’est en matière d’enregistrements de vidéosurveillance que la jurisprudence luxembourgeoise a eu le plus à faire33.
Les enregistrements de vidéosurveillance mérite une attention particulière en raison de leur soumission à la loi du 2 août 2002 relative à la protection des données personnelles. Cette loi prévoit que le traitement à des fins de surveillance peut être mis en œuvre à condition que ce traitement ait été préalablement autorisé par la Commission nationale34. Dans un premier temps, la Cour d’appel a pu juger cependant que cette autorisation n’était pas prescrite à peine de nullité. « Le fait que l’installation de la caméra de surveillance n’avait pas été autorisée préalablement n’a eu aucune répercussion sur la fiabilité de la preuve ainsi obtenue et n’a pas non plus porté atteinte aux exigences du procès juste et équitable puisque la preuve ainsi obtenue a été soumise à un débat contradictoire »35.
La position de la Cour d’appel a évolué à l’occasion d’une affaire concernant un individu, ayant proféré des menaces téléphoniques à destination du Palais grand-ducal, qui a été confondu par une vidéosurveillance installée dans le bâtiment des Postes. L’installation des caméras n’avait pas reçu l’autorisation de la Commission nationale. Par jugement du tribunal correctionnel du 13 juillet 2006 les poursuites furent déclarées irrecevables. Appel fut interjeté par le ministère public arguant que l’installation de caméra n’avait pas pour finalité l’appréhension des délinquants, mais que son utilisation en l’espèce à cette fin était parfaitement régulière. La thèse n’est pas retenue par la Cour d’appel. En revanche la Cour de cassation casse la décision estimant que le juge du fond ne peut écarter une preuve obtenue illicitement que si le respect de certaines conditions de forme est prescrit à peine de nullité et si l’irrégularité commise entache la crédibilité de la preuve, ce qui ne paraissait pas être le cas36. La Cour d’appel statuant au rescisoire ne s’incline pas. Et sa décision du 26 février 2008 écarte la preuve comme contraire à l’article 67-1 CIC et au droit à un procès juste et équitable37.
Il semblerait donc que la jurisprudence luxembourgeoise ne soit pas totalement fixée sur le sort des preuves obtenues illicitement. Dans son arrêt du 22 novembre 2007, la Cour de cassation précise qu’un procès juste et équitable n’est garanti que sous la condition fondamentale du respect de la légalité dans l’administration de la preuve, mais qu’il appartient au juge d’apprécier l’admissibilité d’une preuve obtenue illicitement en tenant compte des éléments de la cause prise dans son ensemble y compris le mode d’obtention de la preuve et les circonstances dans lesquelles l’illicéité a été commise. Au vu de ces conditions, les juges du fond sont donc libres de prendre ou non en considération la preuve illicite38. Ainsi peut-on considérer que l’arrêt final de la Cour d’appel du 26 février 2008 n’est qu’une application concrète de cet arrêt dans le sens d’une protection des droits fondamentaux39.
Alors que semble se dessiner un droit à la preuve dont on mesure mal les conséquences, on se demandera si finalement ce qui se dessine, de manière plus certaine, n’est pas un droit fondamental de la preuve.
III. – Un droit fondamental de la preuve comme composante du droit à un procès juste et équitable
À l’encadrement de l’administration de la preuve et à la libéralisation de l’admissibilité de la preuve par les droits fondamentaux s’ajoute une troisième tendance de fondamentalisation du droit de la preuve comme composante du droit à un procès juste et équitable. Cette tendance est illustrée par l’affirmation de trois droits en matière de preuve : celui de se taire (A), celui de faire interroger les témoins (B) et enfin le droit à une expertise équitable (C).
A. – LEDROITFONDAMENTALDESETAIRE
Dans l’important arrêt Bykov c. Russie du 10 mars 2009, la grande chambre de la CEDH rappelle que le droit au silence réside dans la protection de la liberté du suspect de choisir de s’exprimer ou de garder le silence lors de ses interrogatoires. Le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination et le droit au silence sont au cœur du procès équitable40. Le Luxembourg ne se démarque pas de cette conception. Une personne visée par une plainte avec constitution de partie civile peut refuser de témoigner (article 72 CIC). On « reconnaît évidemment au prévenu le droit de se taire » et ce droit « s’applique également à la partie civile »41. Le prévenu peut se taire ou encore se limiter à un rôle purement passif et ne pas démontrer son innocence. La prise de position, il y a une dizaine d’années, du procureur d’État adjoint de Luxembourg en faveur du reversement de la charge de la preuve en matière de délits d’initiés, de blanchiment d’argent et de criminalité organisée avait suscité un tollé général dans la communauté juridique luxembourgeoise42.
B. – LEDROITDEFAIREINTERROGERLESTÉMOINS
La notion de procès équitable a eu une incidence sur les règles relatives au témoignage notamment par le truchement des droits de la défense et du principe de l’égalité des armes qui imposent, sauf cas très particuliers, que les éléments de preuve soient produits en audience publique en vue d’un débat contradictoire ce qui limite la prise en considération des témoignages et renforce le droit d’interroger et faire interroger les témoins (article 6 par. 3 Conv. EDH)43. En droit luxembourgeois, le droit d’interroger et de faire interroger un témoin est largement reconnu en première instance, mais strictement interprété en appel.
Il est admis que le droit à un procès équitable comporte « le droit d’interroger et de faire interroger les témoins à charge, et d’obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge »44. L’inculpé ainsi que la partie civile ont le droit de réclamer l’audition des témoins qu’ils désirent faire entendre. Ils doivent, sous peine d’irrecevabilité de la demande, articuler les faits destinés à faire l’objet du témoignage. Ils peuvent également demander que l’inculpé soit interrogé en présence du témoin (article 69-3 CIC).
La Cour d’appel a précisé que le droit d’interroger ou de faire interroger les témoins à charge n’est « pas un droit à caractère absolu. Cette disposition (i.e l’article 6 par. 3 Conv. EDH) ne prive pas le juge national du droit d’apprécier souverainement, en fait, si un témoin tant à charge qu’à décharge doit encore être entendu pour former sa conviction. Le juge peut refuser de convoquer le témoin désigné par la défense, lorsque l’audition de ce témoin n’est pas de nature à aider à la manifestation de la vérité, à condition de motiver sa décision »45. Le droit des parties de faire entendre des témoins est subordonné à l’appréciation du juge : il « incombe d’abord au juge national de décider de la nécessité ou de l’opportunité de citer un témoin »46. En appel, le droit d’interroger les témoins est le plus souvent limité47. La Cour de cassation n’a pas hésité à rappeler à ce titre que l’audition du témoin devant la juridiction de fond peut subir des restrictions. Il n’y a selon la Cour « violation du droit à un procès juste et équitable et aux droits de la défense que si, une telle impossibilité étant constatée, la condamnation du prévenu est intervenue sur le fondement d’un témoignage qu’il n’a, à aucun moment, été en mesure de discuter, aucune confrontation avec le témoin ne lui ayant été permise »48.
C. – LEDROITÀUNEEXPERTISEÉQUITABLE
Si le droit à une expertise équitable est reconnu en matière civile, il est plus discuté en matière pénale qui seule retiendra notre attention49. Il faut d’emblée souligner que, en droit luxembourgeois, l’expertise en matière pénale est contradictoire, le prévenu pouvant désigner lui aussi un expert50.
Lorsqu’il y a lieu d’ordonner une expertise, le juge d’instruction rend une ordonnance dans laquelle il précise les renseignements qu’il désire obtenir des experts, ainsi que les questions sur lesquelles il appelle leur attention et dont il demande la solution. Dès le prononcé de l’ordonnance, l’article 87 CIC s’efforce de garantir les droits de la défense. Ainsi, l’inculpé connaît parfaitement l’objet de l’expertise et peut s’adjoindre les services d’un autre expert. L’expertise est donc contradictoire. Le droit l’inculpé (ainsi que la partie civile) de demander une expertise sur les faits qu’ils indiquent (article 88) et la possibilité de désigner un autre expert en cas de désignation d’un expert judiciaire permet d’entamer un dialogue contradictoire (article 87-1). L’inculpé peut choisir un expert qui assiste à toutes les opérations et y participe en qualité d’expert. Si l’expert choisi par l’inculpé refuse sa mission, reste à l’inculpé la possibilité de choisir un expert qui examinera le travail de l’expert commis a posteriori selon l’article 87 (5)51. Le CIC n’exige pas la présence ou la convocation des parties aux opérations52. Selon la jurisprudence, les droits de la défense sont garantis si le prévenu, qui n’a pas assisté aux opérations d’expertise, a eu connaissance du rapport et a pu le discuter librement à l’audience53.
1. Cet article reprend de manière plus analytique les points saillants du rapport luxembourgeois sur le thème « Preuve et droits fondamentaux » présenté lors des journées belgo-hollandaises de l’Association Henri Capitant des amis de la culture juridique française consacrées à la preuve. Mes remerciements vont à Christian Deprez collaborateur de recherche à l’Université du Luxembourg pour son assistance dans les recherches.
2. CEDH, 12 juillet 1988, Schenk c. Suisse, Req. no 10862/84, par. 46. V. l’excellent article de M-A. Beernaert, « La recevabilité des preuves en matière pénale dans la jurisprudence de la CEDH », Rev. Trim. D.H., 69/2007, p. 81 qui a servi de point de départ à cette réflexion.
3. Notre propos se limite ici à la procédure pénale.
4