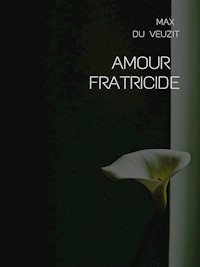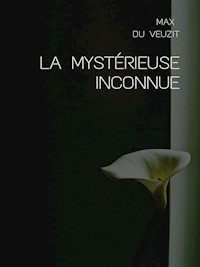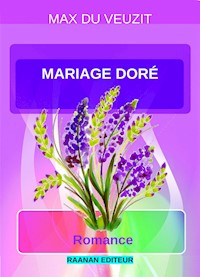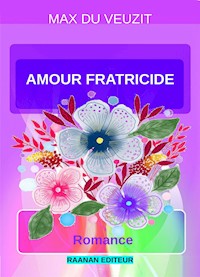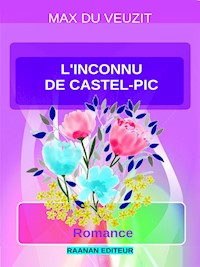1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Raanan Editeur
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
« Jamais je ne me marierai ! » proclame le jeune et séduisant comte Lucien de Parrois. La vie rêvée, pour ce farouche célibataire, ce sont les plaisirs de la capitale, l’oisiveté, les folles passions sans lendemain ! Sa tante, la marquise de Versin, s’en inquiète. Comment mettre fin à une telle dissipation ? Et si Lucien allait à Dinard, chez les cousins Kervec ? Ils ont quatre filles en âge de trouver un mari. La cinquième, Yvette, ne compte pas. Elle vient d’avoir dix-sept ans. Par jeu, par défi, Lucien accepte. Le voici en Bretagne, entouré de cousines plus ravissantes les unes que les autres. Tout irait bien sans cette peste d’Yvette. Un vrai cauchemar, cette gamine... Ses moqueries, ses inventions diaboliques ne cessent d’exaspérer Lucien. Rude leçon pour un homme qui s’estimait irrésistible ! À l’annonce de son départ, deux jolis yeux s’emplissent pourtant de larmes inattendues. L’amour aurait-il le dernier mot ? ...|Librairie Jules Tallandier|
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
SOMMAIRE
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
MAX DU VEUZIT
COUSINE YVETTE
Paris, 1935
Raanan Éditeur
Livre 1050 | édition 1
I
Tu me demandes, mon cher ami, comment je me suis marié ? Comment moi, l’ennemi achevé du mariage, le boulevardier fini dont les fredaines ont longtemps défrayé les chroniques de Paris, j’ai pu prendre femme et la rendre heureuse ? Car, elle est heureuse, ma jolie petite Yvette, la plus délicieuse femme qu’un homme puisse rêver. Je l’adore et lui suis fidèle… Oui ! fidèle, ne t’en déplaise ! Et, quoique la chose doive te paraître impossible après deux ans de mariage, je l’aime comme au premier jour, et ma pensée est toujours occupée d’elle.
Eh bien ! je vais essayer de te le raconter, comment je me suis marié. C’est toute une histoire, et quoique ce soit long, je veux te la faire connaître. Au surplus, cela te distraira dans tes déserts d’Afrique, où tu as eu le bon sens – ou la bêtise – d’aller étudier sur place la végétation.
Je veux croire que tu trouveras un intérêt croissant à lire ces lignes qui te feront connaître par avance la charmante comtesse qui est ma femme, et te feront désirer rentrer bien vite dans notre vieille France, laquelle vaut encore mieux que toutes les Afriques du monde !
Donc, je commence.
Nous étions au mois de mai… le mois de Cupidon et des folles amours, et, fatigué, vanné, par une vie un peu trop agitée, je résolus d’aller me refaire – me remettre au vert, quoi ! – à la campagne, chez la marquise de Versin, la seule tante qui me reste du côté maternel et qui habite une des plus magnifiques propriétés de Touraine.
Ma bonne tante m’accueillit avec plaisir et avec beaucoup de larmes dans les yeux. J’ai toujours été son favori et tu penses, en me voyant arriver avec les yeux cernés par le voyage et autres fatigues que tu devines, la mine mauvaise… pour les mêmes causes ! si son cœur et ses bras s’ouvrirent maternellement à l’enfant prodigue.
Ses premiers mots, pourtant, furent des mots de reproche :
— Est-il possible, mon cher enfant, que tu aies aussi longtemps négligé ta vieille tante ?
— Mais puisque me voilà, marraine !
— Oui, te voilà, enfin ! Je te préviens que je vais te garder tout l’été. Nous aurons ici, aux beaux jours, une nombreuse société, et tu ne t’ennuieras pas, à moins que tu ne fasses des sottises !
— Oh ! ma tante, protestai-je, j’en suis incapable à présent !
Elle sourit, pleine d’indulgence.
— C’est que, vois-tu, j’y suis tellement habituée de ta part !
— Mais, maintenant, c’est impossible ! J’ai vingt-neuf ans et je vous assure qu’il est temps que je devienne sérieux.
— A qui le dis-tu ! fit-elle, en levant les yeux au ciel. Nul plus que moi ne le souhaite, hélas !
Je fus mortifié de son exclamation.
— Naturellement, vous êtes sans indulgence… Jusqu’ici, vous m’avez jugé très sévèrement… A vos yeux, je suis un grand coupable !
— Hélas ! répéta-t-elle. Mais je ne veux pas te gâter ton arrivée, nous en reparlerons une autre fois.
— C’est que je ne tiens pas du tout à en reparler ! m’écriai-je navré de cette perspective.
— Rassure-toi, me dit-elle en m’embrassant. Ce ne sera pas pour te gronder…
— Je respire !
Je vécus pendant huit jours dans le plus délicieux farniente que j’eusse jamais éprouvé. Je ne croyais pas qu’on pût trouver autant de plaisir à ne rien faire !
Cependant, au bout de ce temps, j’en avais assez de la campagne, de la paix des champs et des soirées au coin du feu !
Déjà, j’aspirais au retour à Paris ; à Paris qu’on critique et qu’on méprise, et dont, au fond, on ne peut se passer quand on y a vécu.
Ma bonne tante s’aperçut de mon désir et le prévint… sans le satisfaire, toutefois !
— Tu t’ennuies déjà auprès de ta vieille tante ? me dit-elle, un après-midi qu’assis près d’elle je humais, avec sa permission, un excellent havane que ce coquin de buraliste m’avait pour une fois servi délicieux.
— C’est-à-dire, marraine, rectifiai-je, galamment, que je ne m’ennuie jamais quand je suis avec vous ; mais comme, forcément, je ne puis toujours être à vos côtés, les heures où je suis seul commencent à me paraître longues.
— C’est que ta vie n’a pas de but. Tu devrais t’occuper.
— Travailler ! m’écriai-je, stupéfait. Et c’est à moi qui n’ai jamais rien fait que vous proposez le travail ?
— Qu’y aurait-il de mal à ce que tu emploies utilement ton temps, dit ma tante, en me regardant avec un air de pince-sans-rire qui me jeta un petit froid dans le dos. Tu es solide, intelligent, instruit. Je suis sûre que tu pourrais te créer, si tu voulais, une fort belle situation… une situation qui te ferait indépendant et libre… Cela ne vaudrait-il pas mieux que de continuer la vie que tu as menée jusqu’ici ? N’en es-tu pas fatigué toi-même ?
Je n’osai répondre, car, après un repos de huit jours, on n’est pas habituellement fatigué, de quoi que ce soit.
Mon prudent silence fit soupirer l’excellente femme.
— Hélas ! ce serait trop beau que tu sois, du premier coup, de mon avis !… Pour le moment, je ne te demande pas un pareil sacrifice.
— C’est heureux !… répondis-je, froidement railleur.
La marquise ne releva pas mon impertinence.
— Tu sais combien je t’aime, mon cher Lucien, continua-t-elle courageusement. N’ayant jamais eu d’enfant et ayant été veuve de bonne heure, toutes mes affections se sont concentrées sur toi qui étais l’unique fils de mon unique sœur.
— Je vous suis reconnaissant de tant de tendresse, ma tante, répondis-je, inquiet de ce préambule attendrissant.
— Eh bien ! si tu es réellement reconnaissant à ta vieille tante de t’avoir tant aimé, pourquoi ne le lui prouves-tu pas en te mariant ?
— Me marier ! Moi ! c’est impossible !
Je m’étais levé si brusquement que le bout allumé de mon cigare vint heurter mon doigt, et cette sensation de brûlure ne contribua pas peu à me faire mal accueillir la désagréable proposition de ma tante.
— Que vois-tu d’impossible à cela ? Tu as goûté de tous les plaisirs, usé de toutes les choses permises et défendues, ébréché joliment ta fortune ; tu as, enfin, vingt-neuf ans et dans un an sonnera pour toi l’âge des vieux garçons. Ne crois-tu pas, vraiment, qu’il serait temps de faire une fin ?
— Mais il faudrait au moins que cette fin ne soit pas une chute ! fis-je avec un désespoir assez comique, car au fond, la suggestion de ma vieille parente ne me paraissait pas sérieuse, et je ne la prenais véritablement pas en considération.
— Une chute, une chute ! Je ne vois pas en quoi un mariage peut être jamais une chute ? Au contraire, cela indique, de la part du jeune homme qui se marie, un désir de bien faire, d’être enfin sérieux ; ce ne peut être qu’à son avantage.
— Mais je ne rendrais jamais une femme heureuse !
— Je suis sûre du contraire, protesta affectueusement la marquise. D’ailleurs, il suffit que tu discutes la chose pour que tu en reconnaisses la possibilité.
— Du tout, du tout !… Je ne puis admettre cette conclusion ! Je n’ai nullement l’intention de me marier !
— Soit ! Néanmoins, tais-toi et écoute-moi. J’ai des cousins qui habitent Dinard et qui sont les parents de cinq charmantes jeunes filles, dont une, entre autres, ferait une excellente femme d’intérieur par sa haute intelligence et ses non moins grandes capacités… Pour ne pas influencer ton choix, je ne te la nomme pas… Le père et la mère t’ont vu quand tu n’étais encore qu’un bambin ; ils se souviennent très bien de toi… Voici la saison des bains de mer qui arrive ; fais-moi le plaisir d’aller la passer chez eux ?
— La saison des bains de mer, à la fin de mai ! Mais, ma tante, il n’y a de monde qu’en septembre… août au plus tôt, et un vrai Parisien ne jongle pas ainsi avec les usages !
— Mai ou septembre, que t’importe, pourvu que tu trouves une bonne table, un gîte charmant, un hôte aimable, et l’occasion de faire la cour à cinq délicieuses cousines !
— Des cousines ! Vous voudriez me voir épouser une cousine ? Vous savez pourtant bien, ma tante, qu’au point de vue de la progéniture…
— Tais-toi, tu vas dire des bêtises ! Tu n’es leur parent qu’à un degré très éloigné… juste assez pour être bien accueilli en cette qualité.
— Et vous dites qu’elles sont combien ?
— Cinq, mais la plus jeune est encore un bébé. Elle a quinze ou seize ans tout au plus et elle ne compte pas. Il n’en reste donc que quatre et je te crois de tempérament à les courtiser toutes avant que d’en choisir une.
— Certes, répondis-je avec conviction, toutes les quatre à la fois, et la plus jeune aussi, même ! Ce n’est pas cela qui m’inquiète…
— Moi non plus, fit la tante en riant franchement. Seulement, je compte sur toi pour rester dans les bornes de la bonne galanterie, et ne jamais t’en écarter.
— Naturellement, des cousines !… Mais, remarquai-je tout à coup en fronçant le sourcil, si la plus jeune n’a que seize ans, quel âge a donc l’aînée ? Elle doit être déjà vieille et par conséquent…
— Au contraire, interrompit ma tante, avec tant de chaleur que je devinais en l’aînée la perle rare qu’elle m’avait annoncée. Au contraire, elle n’a que vingt-quatre ans.
— Cinq filles en huit ans ? Heu ! C’est joli ! observai-je, un peu railleur. Notre parent est un rude homme, et sa femme n’a pas dû s’ennuyer…
— Oh ! Lucien, fit ma tante, tout estomaquée, comment peux-tu parler aussi légèrement !
— Pardonnez, marraine, l’exclamation causée par la sincère admiration de ce haut fait, fis-je, le sourire aux lèvres en m’inclinant cérémonieusement devant elle.
— M. de Kervec est un homme respectable !… continua-t-elle, pas encore remise.
Je saluai derechef, si bas que mon front effleura les petits volants de sa jupe.
— Mille excuses à cet homme respectable, avec toutes les rétractations possibles : notre parent n’est pas un rude homme, puisqu’il n’a pas eu un seul garçon en huit ans !…
Il faut croire que j’avais été trop loin. La marquise, qui est très pudibonde malgré ses prétentions à vouloir être une femme à la page et moderne, se renversa dans son fauteuil, à demi pâmée.
En un clin d’œil, je fus à ses genoux et baisai ses mains avec tendresse.
— Bonne petite tante, votre misérable neveu mérite tous vos anathèmes pour ses impertinences sans nombre… Lancez-les-lui donc… mais ne vous fâchez pas !
— Lucien, tu es incroyable, tu feras mourir ta pauvre tante de chagrin.
— De vieillesse, ma tante, de vieillesse !… Quand vous aurez dépassé la centaine !
Elle répéta d’une voix plaintive :
— Tu es inconcevable, enfant !… inconcevable !… Et je prévois en plus que tu vas me refuser la seule chose sérieuse que j’aie jamais demandée.
Qu’aurais-tu fait, mon cher, si tu avais été à ma place ? Ce que j’ai fait, probablement.
— Eh bien ! marraine, vous vous trompez ; votre neveu n’est point si déraisonnable que vous le croyez ; il ira à Dinard.
— Ah ! l’amour d’enfant ! Et c’est bien vrai ?
— Tout ce qu’il y a de plus vrai. Au surplus, le pays est, dit-on, charmant. Je ne le connais pas du tout, et puisque l’occasion s’offre à moi de visiter Saint-Malo, Paramé, Dinan, le Mont-Saint-Michel, et que sais-je encore, je ne la manque pas. Il doit y avoir du reste, à cette saison, de bien jolies Anglaises dans ce coin-là, et ces misses, quand elles s’y mettent, ne sont point ravissantes à moitié.
— Encore, Lucien ! Tu recommences ?
— Du tout, ma tante ! J’examine seulement les côtés pratiques du voyage…
— Mais tu sais bien que c’est pour prendre femme que tu vas à Dinard.
— Oui, je sais, fis-je d’un air dégagé, car je n’attachais aucune importance aux projets de l’excellente femme.
J’ajoutai, d’ailleurs, pour qu’elle n’en ignorât rien :
— Comme rien n’est plus aléatoire que mon futur mariage, j’aime autant oublier ce point sombre du programme.
Ma tante leva les yeux au ciel pour le prendre sans doute à témoin de toute la patience qu’elle devait déployer envers moi.
— Mon Dieu, que les hommes sont légers !… Quels étourdis ils seraient sans nous !
— Allons donc, puisque nous ne sommes ainsi que pour donner aux femmes le plaisir de penser, et, quelquefois aussi, d’agir à notre place.
— Le monde irait mieux, reprit la marquise d’un ton tranchant, si au lieu de quelquefois, on pouvait mettre toujours !
— Diable, ma tante ! Je ne vous connaissais pas des idées si arrêtées sur le féminisme… Est-ce que, par hasard, les cinq jeunes filles, dont vous m’envoyez faire la conquête, partageraient votre manière de voir ?
Elle se mit à rire de si bon cœur que je fus mortifié de voir ma question aussi drôlement accueillie.
— Je ne vois pas ce que mes paroles ont de si comique…
— Rien en elles-mêmes, en effet, mais elles évoquent en moi l’idée de ce que serait ton mariage avec une femme imbue de féminisme.
Elle repartit de plus belle en fusées de rire.
— Toi, si indépendant, et qui n’a jamais admis le plus léger joug !… Je plains la pauvre jeune femme qui voudrait t’imposer des goûts et des idées qui ne seraient pas les tiennes.
— Vous plaignez… vous plaignez ! ronchonnai-je. Voilà bien de vos indulgences féminines. En vérité, c’est moi qui serais à plaindre, si j’épousais une suffragette.
— Rassure-toi, mon ami, les demoiselles de Kervec sont très bien élevées, et n’ont certainement pas la moindre notion sur les droits et libertés de la femme.
Elle se leva, et me tapant sur l’épaule du bout de son éventail, elle ajouta :
— Je te laisse, mon beau neveu, pour écrire tout de suite à Dinard. Rallume ton cigare qui s’est éteint pendant notre entretien, et achève-le tranquillement en attendant le dîner.
Quand je fus seul, je me mis à réfléchir à la singulière conversation que je venais d’avoir avec ma tante et je t’assure que mes pensées n’étaient pas très folichonnes.
La marquise avait dit vrai : je n’avais jamais admis le moindre joug !… Et voilà qu’avec une étrange facilité elle venait de m’imposer un énorme fardeau. Voyage, séjour, mariage, j’avais tout accepté !… Et il s’agissait de ma destinée, encore !
Où avais-je donc la tête, et par quelle sorcellerie ma tante avait-elle arraché mon consentement ?
Heureusement, je n’étais pas d’un tempérament à me ronger longtemps les poings inutilement.
— Puisque le vin est tiré, pensai-je, buvons-le, mon bel ami, et agréablement encore ! Nul ne peut nous contraindre à un mariage qui nous répugne, acceptons-en donc l’idée, sans dépit, et en nous amusant le plus possible !
Après tout, ce voyage en Bretagne, suivant de près mon séjour en Touraine, aurait l’avantage de me débarrasser de la petite Chose, des Variétés, qui commençait à m’embêter considérablement, et mettrait en fuite le jolie Machin – du corps de ballet de l’Opéra, s’il vous plaît – qui me rasait, à présent, dans les grandes largeurs.
Tout était alors pour le mieux dans le meilleur des mondes !
Ce fut ainsi que mon voyage à Dinard fut décidé !
II
Quelques jours après cette mémorable conversation entre ma tante et moi, la réponse de M. de Kervec arriva, aussi satisfaisante que la marquise l’avait souhaitée.
Il ne me restait plus, avant de partir pour chez lui, qu’à passer par Paris pour rafraîchir ma garde-robe et y acheter quelques cadeaux que ma tante m’avait conseillé d’offrir à mes cinq « cousines ».
Le soir de mon départ, ma tante, ravie de ma bonne volonté, m’accompagna jusqu’à la gare.
— A propos, mon cher Lucien, me dit-elle pendant que, sur le quai de la gare, nous faisions les cent pas en attendant l’arrivée du train de Paris, j’ai omis de te dire que la raison officielle de ton voyage à Dinard est ton désir d’étudier de près l’architecture des nombreux édifices de la région.
— L’architecture, m’écriai-je, abasourdi, mais je n’en connais pas le premier mot et c’est à peine si je suis capable de distinguer le style gothique du style Renaissance.
— Cela te suffira. M. de Kervec n’est pas un sot… Il a cinq filles à marier, et il aura très bien compris ce que ma lettre ne disait pas.
— Mais mes cousines ?…
— Ce ne sont pas elles qui te parleront d’architecture ; elles-mêmes en savent moins long que toi !… Au contraire, cette prétendue occupation te posera admirablement à leurs yeux.
— Vous ne pouviez plus aimablement, ma chère tante, me faire sentir quel oisif je suis, et combien ma vie est peu utile.
— Grand orgueilleux, qui serait enchanté de m’entendre le féliciter de sa paresse !
Je ne pus protester aux paroles de ma tante, le train entrait en gare, et je me hâtai de chercher un bon coin et de m’y installer.
— Surtout, n’oublie pas les cadeaux, et écris-moi souvent, me cria la marquise quand, par la portière de mon compartiment, je lui envoyai un dernier adieu.
Je cherchai sur mon carnet, et, bientôt, j’eus trouvé la petite annotation suivante :
« Pour les aînées, un album ou un nécessaire à ouvrage.
« Pour la plus jeune, une poupée et tous ses accessoires de toilette. »
— C’est très bien pour les aînées, mais pour la dernière, je me demande si vraiment une poupée sera bien accueillie… Elle a quinze ans, je crois ; et, à cet âge-là… Mais, bah ! ma tante doit la connaître et, puisqu’elle la traite de « bébé », c’est que réellement elle en est un…
――
Je ne restai que quelques jours à Paris et, bientôt, je me mis en route pour Dinard.
J’avais décidé de partir un peu plus tôt et de m’arrêter à Saint-Malo pour me reposer des fatigues du train, car ces voyages à longue traite n’embellissent pas ceux qui les font, et je ne tenais pas à arriver chez mes cousins les yeux battus et la mine défaite ; j’aurais ainsi donné trop mauvaise opinion de moi. Or, si l’opinion des parents m’importait peu, celle de mes cousines me touchait davantage.
Il était cinq heures du soir quand j’arrivai à Saint-Malo.
Connais-tu cette ville ? Si oui, tu as dû remarquer son abominable gare, principalement du côté dit « arrivée ». C’est noir, c’est gris, c’est sale ! Du moins cela me parut tel, ce jour-là.
J’avais fait expédier mes bagages directement pour Dinard, et n’étant chargé que d’un léger sac de voyage, je préférai me dégourdir les jambes en marchant que d’accepter les offres obligeantes des chauffeurs de taxi.
Dans la rue, j’hésitai. De quel côté me diriger ? A droite, Saint-Malo, ville ancienne, avec ses rues étroites, ses maisons sombres et ses hauts remparts. A gauche, Saint-Servan, de construction récente, avec ses grands et larges hôtels, ses villas coquettes, enfouies dans la verdure.
J’allais opter pour cette dernière, quand je me souvins à temps de la « raison officielle » de mon voyage. Venir dans un pays pour y étudier les édifices anciens et descendre dans un hôtel moderne me parut une anomalie.
Ce fut donc à Saint-Malo que je me rendis.
Après avoir assez bien soupé, je sortis et fis un tour sur les remparts qui entourent la ville.
L’endroit était presque désert ; un vent très frais soufflait du large et avait dû en chasser les promeneurs.
— Lucien de Parrois ! Quelle surprise de te rencontrer ici !
— Tiens ! m’écriai-je, Paul Le Quereu ! La surprise est pour moi, mon cher !
Nous nous étreignîmes les mains, charmés mutuellement de notre rencontre.
Nous fîmes quelques pas en silence, ayant tant de choses à nous dire que nous ne savions par où commencer.
J’examinai mon ami ; il était peu changé.
Tu te souviens de Paul Le Quereu ?
Il était au collège avec nous ; un grand maigre, rouge de cheveux et de visage et qui portait des lunettes. C’était toujours le même, sauf que ces lunettes étaient remplacées par un binocle, et qu’une maigre barbiche poussait par touffes inégales autour de son long menton.
Au demeurant, toujours l’air d’un bon garçon et un peu naïf qu’il avait autrefois.
— Par quel hasard béni es-tu à Saint-Malo ? me demanda Paul. Quand y es-tu arrivé ? Vas-tu y rester longtemps ?
— Voilà bien des questions, fis-je en souriant. D’abord, je suis arrivé ici il y a trois heures, tout au plus, et je pars par le bateau, demain matin, pour Dinard.
— Ah ! bon. Tu n’es que de passage… la peur du bateau pendant la nuit t’a décidé à cet arrêt ?
— Heu ! la peur d’être défraîchi plutôt ! Je viens de Paris et le voyage m’a fourbu.
Il se mit à rire.
— Voilà bien nos hommes chics ! Ces messieurs pratiquent tous les sports, et quelques heures passées dans un moelleux compartiment de première classe les obligent au repos. Regarde ces bras-là et dis-moi, tout maigre que je paraisse à côté de toi, si tu as de pareils biceps.
Il tendait ses poings en avant, en retroussant légèrement les manches de son veston.
Indiscutablement, la comparaison était à son avantage, ma main d’aristocrate ne pouvait entrer en parallèle avec les énormes « battoirs » qui faisaient son orgueil.
— Eh bien ! mon vieux, continua-t-il, tout le reste est à l’avenant : le dos, les reins, les jambes ; tout est solide chez moi, et après avoir fait mes cinquante kilomètres à bicyclette, je suis assez dispos pour passer la nuit au bal.
Je jetai un regard oblique sur sa mince échine qui n’en finissait plus d’être longue et étroite.
— Mes compliments, lui dis-je, on ne te croirait pas aussi solide que ça.
Il se frotta les mains, jouissant complètement de son triomphe sur un « homme chic ».
— A propos, fit-il brusquement, que vas-tu faire à Dinard ?
— Y étudier l’architecture de ce coin-là, dont certains édifices rappellent le style anglais.
Il roulait des yeux étonnés, ce qui m’amusa prodigieusement.
— Tu ne me connaissais pas ce talent-là ?
— Ma foi, non !
— Moi non plus !
— … Mais alors ?