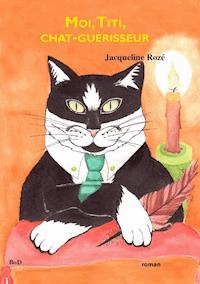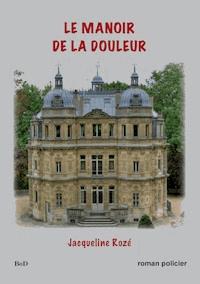5,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Te souviens-tu encore de moi Quand j'allais sans crainte vers toi Je peux parler avec émoi Car je n'avais déjà que toi J'étais à l'âge où l'on rit Et sans penser au lendemain La vie, le bonheur vous sourient Et l'amour vous prend par la main.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 238
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Le calvaire de Clermont-sur-Loire
Te souviens-tu encore de moi
Quand j’allais sans crainte vers toi
Je peux parler avec émoi
Car je n’avais déjà que toi.
J’étais à l’âge où l’on rit
Et sans penser au lendemain
La vie, le bonheur vous sourient
Et l’amour vous prend par la main.
J’avais déjà de la peine
De n’avoir point de tendresse
Sans que mon coeur ait de la haine
Malgré toute ma jeunesse.
Te souviens-tu encore de moi
Et aussi de ma promesse
Venir chercher un peu de moi
Si ceux que j’aime me délaissent.
Une dernière fois dans tes bras
J’entendrai encore ma mère
Oui, crier après moi d’en bas
Ces paroles si amères.
Et enfin, je m’élancerai
Loin de toute cette terre
À jamais, et ne saurai
Que toi tu es entière.
Sommaire
Le calvaire de Clermont-sur-Loire
RESPECT DE LA VIE
PRATIQUE
ANALYSE DES ENTRETIENS
UN TRANSFERT PUISSANT ET PERMANENT
C’est en tentant de comprendre ce qu’avait été ma vie qu’est née l’envie de me lancer dans l’écriture de ce livre. Pour ne pas passer à côté de mon être profond, j’ai tenté de scruter mon âme du plus loin que je pouvais. Parce qu’une magnétiseuse est aussi, d’abord une enfant, ensuite une femme, parce qu’une magnétiseuse est aussi quelqu’un qui peut souffrir.
J’ai vite remarqué que je ne prenais pas un chemin classique dans la vie. Dès ma petite enfance, j’éprouvais un étrange trouve, une sensibilité aiguë , ce sentiment de n’être de nulle part.
Sans cesse réclamant les bras de cette mère trop lointaine, je ne me résignais pas à lâcher prise quand vînt le temps douloureux de l’école. Cette chaleur recherchée se changea très vite en un hiver perpétuel qui vint endolorir tout mes sens si fragiles.
Mes camarades ne comblèrent jamais cette souffrance qui vivait en gésine, au quotidien, dans mon corps.
Lourde était ma peine, lourd serait mon chemin d’adulte.
Au hasard de ma tendre enfance, les images défilaient, maintenant plus vives, en mon esprit. Accabler une mère si atteinte elle-même par la vie ne me semblait pas adéquat. Mais sa propre histoire a creusé les traces profondes de mon désarroi présent et passé.
Ma mère avait commencé à travailler alors qu’elle avait seulement neuf ans. Quand son père était parti pour la guerre de 14-18, elle avait un an. Des voisines, surtout des personnes âgées, l’avaient prise sous leur aile et lui procuraient un peu de bonheur, moments inestimables. Cette joie de vivre ne devait pas durer. Dès son retour dans sa famille, arrachée à cet amour profond, elle n’eut de cesse de le rechercher et d’en tenter l’impossible deuil.
Dans sa quête illusoire, elle n’eut pas la force de me montrer ses sentiments, son amour.
Ce fut dans cette attente jamais satisfaite que je commençai à marcher sur un sol instable et inégal.
Mon père fut mobilisé en septembre 1939. J’étais bien jeune alors pour comprendre tout ce qu’impliquait son départ pour la guerre !
Maman avait trouvé un emploi dans un hôpital militaire à ce moment-là. Dans son service, elle eut d’ailleurs l’occasion de s’occuper du petit-fils de Georges Clémenceau ! Peut-être se souvient-il de madame « Trottinette » ?
Elle en profitait aussi pour aider des prisonniers français à s’évader. Elle cachait les papiers de ces hommes en suspendant leurs affaires au fil à linge qui flottait dans le potager des religieuses.
Son passé de Résistante ne lui a jamais fait oublier que derrière le costume de certains soldats allemands se cachait parfois un brave homme. Elle garde en mémoire quelques actes courageux qui permirent à des Français de sortir de l’impasse. Mon père, lui-même, doit cette chance d’avoir survécu à une terrible blessure, à des Allemands. Chance que ne connut pas mon oncle qui se fit arrêter lors de la rafle des cinquante otages de Nantes.
J’avais cinq ans. Mon père n’était toujours pas rentré et nous n’en avions aucune nouvelle. Ma mère déploya toute son énergie pour le retrouver. Je garde le souvenir des recherches que nous effectuâmes dans tous les hôpitaux, avec ma mère. Elle finit par le situer, à Rennes, dans une maternité réquisitionnée par les Allemands. Nous apprîmes qu’il avait eu le bras droit arraché et qu’il était indispensable de l’opérer pour le sauver.
Nous prîmes le car pour aller lui rendre visite. Au moment de repartir, quelques heures plus tard, beaucoup de gens s’amassaient sur la place pour ne pas manquer le dernier bus. Une bousculade s’ensuivit et je fus séparée de ma mère. Je ne savais plus où j’étais. Prise dans une tourmente de solitude et de panique, je me mis à pleurer. Une personne me prit alors dans ses bras et m’aida à me glisser par une fenêtre du car où je retrouvai ma mère complètement affolée de m’avoir perdue. À ce moment-là, le ciel de Rennes s’obscurcit tandis qu’un grondement assourdissant recouvrait les cris de terreur. Dans un ballet noir, une ronde d’avions allemands se déployait au-dessus de nous.
Mon père revint à Nantes en pyjama ! Comme un homme errant. La guerre ne donne pas, elle prend.
* * *
Pendant ce temps, c’était mon frère Bernard, qui était mon aîné de huit ans, qui s’occupait de moi. C’était un garçon attentionné qui se révélait être d’une patience d’ange. Et de la patience, il lui en fallait pur supporter mes cris stridents dès que quelque chose n’allait pas dans le sens où je le désirais ! Gentil, il se pliait à mon caprice du moment, jouer à la dînette, par exemple.
Un jour, alors qu’il avait étalé avec délicatesse sa collection de timbres sur la table de la cuisine, devant moi, je me mis à souffler plus fort que nécessaire sur mon bol de lait chaud que je prenais le temps de déguster. Mon souffle et des gouttelettes du doux breuvage protéiné s’abattirent sur la précieuse collection qui se retrouva réduite à un amas de papier mâché.
La vie avait repris son cours. Ma mère travaillait, et mon père, après une période de convalescence difficile, avait lui aussi trouvé à se faire embaucher pour nettoyer les abris. Nous étions en 1943.
Lors du bombardement, notre appartement de la rue de l’Abreuvoir, à Nantes, fut soufflé. Mes parents envisagèrent alors de partir pour Pannecé, à la campagne.
Vivre à la ferme allait nous changer de notre logement où les rats avaient élu domicile, ces énormes rongeurs, gros comme des chats, qui venaient se sustenter du peu que nous avions. Attirés par l’eau des canalisations éventrées, ils finissaient par s’empoisonner avec la Mort-aux-rats que nous leur servions sans état d’âme. Rendus fous par ce produit, ils devenaient cruels et n’hésitaient pas à nous menacer de terribles morsures.
Le jour du bombardement, le 16 septembre 1943, ma mère et moi étions au Jardin des Plantes. L’alerte retentit soudain. Je me situais dans le bas du jardin, avec quelques camarades. Le temps de remonter les allées pour rejoindre ma mère et déjà les premières bombes s’abattaient sur Nantes.
Ma mère se précipita vers moi et me poussa sous les camélias bordant l’entrée principale, avant de se coucher sur moi.
Trente-cinq ans après cet événement, de retour dans cette ville de mon enfance, j’ai éprouvé le besoin de revenir sur ce moment de bonheur. Il paraît étrange, en effet, d’associer la fureur du bombardement et la joie que j’ai ressentie à cet instant où ma mère m’enveloppa de toute sa protection, de sa tendresse… Et à soixante ans, en y revenant de nouveau, je me suis mise à pleurer devant le massif de fleurs où jadis ma mère m’avait montré son amour.
Après le désastre, nous tentâmes de rentrer chez nous. Nous assistions à une désolation intolérable. Les immeubles brûlaient, les gens hurlaient de terreur et de désespoir. Des pillards s’affairaient déjà à récupérer les biens épargnés restés dans les logements. Les habitants désespéraient de trouver encore quelque chose d’intact. Des foules hagardes erraient dans les rues, perdues, sourdes et aveugles de douleur et de peur.
« Pourquoi ? » ne cessais-je de répéter avec insistance, interrogeant ma mère.
Que dire, que répondre à la stupéfaction d’une petite fille qui découvre un monde inhumain ?
La guerre marque les esprits, elle vient ajouter aux tracas déjà là du quotidien, elle impose sa dose d’horreur là où l’homme supporte déjà tant de maux. Mais n’est-ce pas là l’envers de sa capacité à se perdre ?
La guerre, c’était aussi la faim, la cruelle sensation de vide au creux de l’estomac, jusqu’à la brûlure. Les files interminables chez le laitier dessinaient une ligne ponctuelle et fatiguée.
Je passais mon jeudi entier à attendre d’obtenir un litre de lait. Au moment où je devais me rendre au catéchisme, ma mère venait prendre le relais.
« Repasse ce soir, à nuit tombée, je t’en donnerai plus », me disait parfois le laitier.
Dans cette rue du Marchix dévastée par les bombes, des enfants tournaient autour des gros bidons. La laitière leur glissait toujours un peu de lait en supplément, prétextant que leur chat serait bien heureux d’en laper. Quelle brave femme qui songeait à ménager la fierté de ces petits mendiants de la guerre !
Les tickets de rationnement permettaient d’acheter du pain, et parfois même des bonbons au goût fade.
Dans la rue Boileau, le magasin « LU » recevait une queue interminable de personnes qui désiraient quelques biscuits.
L’après-midi, je m’agenouillais près des caniveaux et je cherchais désespérément un ou deux tickets perdus. Ils étaient si petits qu’il arrivait parfois qu’ils s’échappent d’une poche.
Après la période des tickets, les clients achetaient à la coche. Le boulanger traçait une petite ligne sur un bout de bois pour chaque achat effectué. C’était une forme de crédit.
J’ai toujours beaucoup souffert de voir les enfants dans une situation difficile. Peut-être pouvais-je y voir ma propre douleur projetée. Il en allait ainsi de ce petit garçon qui, dans les années cinquante, alors qu’il se trouvait près de l’épicerie dans laquelle je travaillais, fut interpellé par une femme, juge pour enfants par sa profession, qui l’invita à s’approcher. Elle lui proposa de lui offrir un bout de pain avec un morceau de fromage. Je me précipitai alors à la boulangerie.
La femme demanda à l’enfant d’aller se laver les mains, mais aussi le corps, à la pompe qui se trouvait en face de l’épicerie.
Nous étions en plein hiver.
Je vis ce malheureux petit affamé, déjà transi de froid, retirer ses vêtements et commencer à se frotter avec vigueur.
La vraie faim, celle qui tord de douleur, faut-il la connaître pour savoir ce que veut réellement dire « souffrir » ?
Tant de gosses étaient livrés à eux-mêmes, hantant la rue du Marchix à la recherche d’une poubelle généreuse, supportant l’insupportable, l’affront de ne pas avoir de quoi survivre.
Si vous passez dans cette rue, pensez à ces femmes syphilitiques que la faim rendait comme folles. Pour un coin de lard déniché parmi les déchets, une querelle sanglante pouvait éclater. Il y avait cette rage de vivre à tout prix, de vivre malgré tout.
Chaque rue emporte, avec le temps, ses secrets dans la pierre. Mon frère aîné disait toujours que rien ne servait d’aller au cinéma, la vie se trouvait à deux pas de chez nous. Le réel ne manquait jamais de nous sauter au visage, avec force et insistance, dès que nous en franchissions le seuil.
Malgré cela, je jouais sur les rampes des marches de la rue de l’Abreuvoir. La vie, cette terrible et lancinante présence de soi au monde, mêlait sa face noire et sa face claire.
Certains rythmaient la lente déchéance de notre quartier avec un peu de couleur.
L’allumeur de réverbères apportait une lumière chaude à notre quotidien nauséeux. Le nez collé à la vitre, j’attendais de voir l’étrange ballet, à la nuit tombante, quand il arrivait avec sa perche incandescente.
Le vitrier criait à pleins poumons. Nos pauvres vitres fragiles faisaient souvent les frais de sa maladresse.
Marcel nettoyait les marches à grands coups de jets d’eau. J’aimais voir les papiers flotter et dévaler la pente. Je m’imaginais dans un navire qui quittait le quai pour de meilleurs horizons.
Il y avait aussi le chiffonnier… Il me terrorisait. « Peaux de lapin ! » hurlait-il en arrivant avec sa charette. Je redoutais qu’il ne vienne pour me chercher et m’emmener. J’avais trois ans et j’aimais déambuler et jouer dans la rue commerçante où ma mère avait sa poissonnerie. Pour m’en dissuader, elle avait conclu un marché naïf avec cet homme : il devait me menacer de m’enlever s’il me voyait traîner dans le coin !
Nos rues étaient vivantes, habitées, bruyantes. Différemment d’aujourd’hui. Elles rassemblaient aussi des artistes en tous genres.
L’avaleur de grenouilles me fascinait. Il buvait une grande quantité d’eau puis ingurgitait une douzaine de batraciens inquiets qu’il faisait remonter vers sa bouche par un mouvement abdominal caractéristique. Magique et drôle à la fois, je pouvais rester silencieuse pendant des heures devant ses exploits. Si nous touchions son ventre, il était possible de sentir remuer les malheureuses bestioles captives.
Le dimanche, le cracheur de feu illuminait ma vie.
Il y avait aussi cet homme qui s’enchaînait et se délivrait avec une vitesse époustouflante.
Le montreur de chiens faisait tourner les petits animaux avec une adresse qui m’hypnotisait.
Et quelle ambiance ! Tout le monde parlait avec tout le monde.
Je regrette cette époque où nous étions humains et proches les uns des autres.
Mes parents pouvaient être tranquilles quand j’assistais à ces représentations !
Bientôt la guerre nous poussa à quitter le quartier. Nous ne ressentîmes pas la moindre nostalgie lorsque nous déménageâmes à Pannecé.
Réfugiés dans ce petit village, il nous fallait pourtant travailler. Mon père sciait du bois à longueur de journée pour un petit exploitant qui le revendait pour le transformer en charbon de bois.
Ma mère et moi, nous ramassions les copeaux qui nous servaient pour nous chauffer. Nous les faisions sécher sur la cuisinière.
Pendant l’hiver de 1943, notre charette ne cessait de s’embourber dans cette forêt aux chemins détrempés. Parfois, elle chavirait dans une ornière et nous devions nous résoudre à recharger malgré notre fatigue. Toutes les combines étaient bonnes à prendre. Nous nous procurions du poisson dans les étangs, nous posions des collets fumés. Mon frère trouva une idée ingénieuse pour capturer les perdrix. Quand elles venaient s’approvisionner en laine dans un champ de moutons, il les effrayait et elles allaient tout naturellement se réfugier dans une haie. Là, il n’y avait plus qu’à cueillir les malheureuses prises dans le fil de fer barbelé.
La faim se faisait moins sentir qu’à la ville bien que nous ne soyons pas à la fête.
Pour avoir un peu de beurre, il nous fallait redoubler de patience et de stratagèmes. C’était mon amie Jeannette qui, laissant rancir du beurre, le présentait ensuite à sa mère en lui disant qu’il ferait bien l’affaire pour nous autres…
Le dimanche, nous nous rendions à la messe. Mon frère Bernard m’installait sur son vélo pour me transporter. Cette bicyclette qui nous avait permis de ne pas mourir de faim quand nous vivions encore en ville, et sur laquelle mon frère parcourait cent trente kilomètres dans la journée pour aller chercher de quoi approvisionner nos pauvres placards. Chargé d’un quartier de porc, de bouteilles de lait, de vin, il pédalait jusqu’à en tomber, pour notre survie.
Les religieuses et certains fermiers n’avaient aucun scrupule à nous faire ressentir que nous étions de trop. Ils nous appelaient les « réfugieux », terme bien indélicat quand l’on est déjà fort ennuyé d’avoir à dépendre de quelques litres de lait en échange d’un lièvre.
Puis, arriva le moment de la débâcle. Cette période me marqua profondément, terriblement.
Les Allemands fuyaient.
Non loin de Pannecé, l’un de leurs trains fut attaqué. Les personnes qui arrivèrent sur les lieux après l’attaque restèrent interloquées, tant devant le spectacle désolant des cadavres qui jonchaient le sol. Les morts avaient été ballottés en tous sens, dépouillés de leurs biens. Ils gisaient à terre comme des bêtes. Mon père retrouva un portefeuille parmi les herbes. À l’intérieur, des photographies, celles d’une femme et de ses enfants.
Ces gestes de vengeance se reproduisirent. Un jeune résistant abattit un Allemand de sang-froid. Fou de haine et de douleur, le jeune homme, fils du maire, au demeurant, fut abattu à son tour à l’endroit même où il avait assassiné cet Allemand qui se rendait.
En 1944, nous reprîmes le chemin de Nantes pour retrouver notre logement de la rue de l’Abreuvoir et nos colocataires, les rats.
Ce fut aussi le retour à l’école. Rien ne m’était plus désagréable, d’autant plus que les conditions n’étaient pas réunies pour que je prenne goût à l’école et à tout ce que cela imposait.
La grosse machine à sécher les mains m’effrayait. Je hantais la cour sans très bien savoir qu’y faire.
Je rencontrais un gros problème avec ma maîtresse. J’étais gauchère et elle exigeait que j’écrive de la main droite.
Après la classe, je devais encore patienter en attendant que mon frère sorte de l’étude du soir. Sans conviction, je faisais des découpages en pleurant. Il m’était impossible d’accepter d’être séparée aussi longtemps de ma mère.
La femme de ménage se prit d’affection pour moi. Elle passait un peu de temps à mes côtés et tentait d’amenuiser ma tristesse.
À la maison, outre l’insalubrité et le froid qui régnait, je ne disposais que d’un coin de table pour étaler mes cahiers. Ma mère n’avait d’autre choix que de préparer le repas sur cet unique support. Le moulin à légumes faisait trembler ma fragile écriture, la bassine pour laver la vaisselle manquait de mouiller mes feuilles.
Plus tard, après la guerre, j’allai à l’école du Port Communeau. Mon attitude calme et triste interpella ma nouvelle maîtresse qui m’apporta beaucoup d’attention et d’affection. Ma peine en fut amoindrie, toutefois, il me restait toujours ce fond d’angoisse permanent. Si j’obtins par la suite mon certificat d’études avec mention, le fait d’avoir dû redoubler ma quatrième permit à ma mère de déclarer que je n’avais rien à faire sur les bancs de l’école. Je suivis alors des cours de sténodactylographie à l’école Vial.
* * *
Rien ne me rendait plus heureuse que de retourner à Pannecé quand arrivait l’été.
Comme un vrai cow-boy, je gardais à cheval les vaches des Gauthier. Je revivais, je savourais.
Tout mon petit univers bascula à la naissance de mon petit frère, Michel.
Si je n’étais pas vraiment l’objet des préoccupations premières de ma mère avant cet événement, ma place devint encore plus secondaire. Que pouvais-y faire ? La vie continuait et je suivais mon chemin avec une sorte de tristesse diffuse, parfois accrue, plus intense.
Pour tenter de sortir de mon isolement, et par volonté de satisfaire mes parents, je trouvai un emploi dans une épicerie de la rue du Marché.
Je livrais des casiers de quinze litres de vin que je portais sur mon épaule droite et tout m’efforçant de soutenir encore six autres bouteilles de ma main gauche.
Ces efforts au quotidien me valurent bientôt une santé défaillante. Le médecin déclara sans ambages que je devais absolument cesser cette activité. Quand il me prescrivit un arrêt de travail, je n’eus d’autre choix que de le réduire en miettes. Je devais continuer à travailler malgré mon épaule devenue bleue et insensible.
Je devais aussi laver les bouteilles dans une cave où la température de l’eau et du lieu ferait frémir le plus solide des gaillards. Évidemment, je tombai malade en contractant une pleurésie, ce qui n’arrangea pas mon état de santé déjà vacillant.
Mes parents qui avaient leurs propres problèmes ne prêtèrent guère attention à ce qui m’arrivait.
Bientôt, je trouvai une autre épicerie où j’espérais connaître de meilleures conditions de travail. Au pain quotidien, c’était son nom. Là, ce n’était plus des casiers de bouteilles de vin, mais des litres d’huile ! Cependant, j’avais à ma disposition un outil bien précieux pour soulager ma peine : un diable.
Une opportunité s’offrit à moi quand un représentant tomba malade. Je me proposai pour le remplacer. Je dus user de tous mes arguments pour convaincre monsieur Toublanc, le patron, d’accepter ma candidature pour ce poste.
Je me retrouvai alors à sillonner les routes de la région à toute vitesse sur mon vélo, quel que soit le temps ! J’étais parfois gelée et trempée jusqu’aux os, mais rien ne me satisfaisait davantage que d’enfourcher ma bicyclette pour partir à l’air libre.
Ce fut à peu près à cette période que je devins ce que l’on appelle une « chèvre ». Rien à voir avec la douce créature bêlante. Là, je devais me prêter à un jeu fort dangereux et plein de mystère pour la jeune fille que j’étais.
En 1955, nombre de jeunes femmes disparurent à Nantes, mais aussi dans d’autres villes du pays, sans laisser aucune trace. Nous entrions dans cette grande époque de la traite des blanches. L’une de mes amies avait été victime de cet abominable marché de l’humain et je m’étais juré de faire tout mon possible pour l’aider à se sortir de ce sordide gouffre.
Un inspecteur de police, ami de mon père, me fit une proposition que j’acceptai immédiatement. Il s’agissait d’attirer sur moi la convoitise de quelques proxénètes.
Un plan fut mis au point. Je devais aller m’installer sur un banc du Jardin des plantes et me laisser aborder. Je n’avais rien à craindre, m’assura l’ami de mon père, des hommes planqués aux alentours veilleraient à ma sécurité.
Dès le premier jour, l’appât que je représentais fonctionna. Un homme s’approcha de moi et entreprit un discours qui ne manquerait pas d’intéresser la police.
Au fil des jours, mais toujours sous haute surveillance, je m’infiltrai peu à peu dans le milieu. Quand j’y repense, des années plus tard, je me dis que je n’avais tout de même pas froid aux yeux ! Ces hommes étaient prêts à tout pour leur business, et allaient jusqu’à anesthésier leurs victimes pour ensuite les embarquer pour l’étranger.
Rapidement, je me fis admettre dans un groupe de proxénètes. J’appris leurs habitudes, où se trouvait leur planque, un repaire dans un restaurant de Clermont-sur-Loire. Pour plus de discrétion et de sécurité, ils se déplaçaient en barque sur le fleuve.
Je découvris alors avec horreur que certaines épiceries du Quai de la Fosse cachaient des captives. Qui aurait pensé que ces bons commerçants servaient une si sordide entreprise ?
À force de conversations avec mes « faux amis », je savais maintenant où se trouvaient les filles destinées à prendre la route pour Marseille, dans un premier temps.
Quand il fut décidé du déplacement d’un premier groupe de filles, la panique s’empara sérieusement de moi. Je devais assister au départ. Je demandai donc à mon patron s’il pouvait rester dans les environs de l’endroit où les filles partiraient.
Au moment le plus crucial de l’opération, mû par je ne sais quel instinct, monsieur Toublanc se précipita parmi les voyous en hurlant. Il s’ensuivit une bagarre. Un coup de poing l’atteignit sur l’oeil, brisant le verre de ses précieuses lunettes.
Voyant cela, les policiers dissimulés autour de la scène n’eurent d’autre choix que d’intervenir.
Avec le recul, je me demande à présent d’où me venait cette incroyable capacité à me lancer dans de telles aventures. Il me fallait reconnaître avoir eu beaucoup de chance. Allez savoir pourquoi, ces malfrats m’avaient toujours respectée et je n’avais jamais eu aucun problème avec eux.
Après cette affaire, je quittai mon emploi à l’épicerie, Le Pain quotidien, pour être embauchée à La Maison du fromage. Une évolution logique !
Très vite, je découvris que l’épicière trompait son mari. Jusque là, rien n’aurait su me mettre dans une situation douloureuse… Sauf que la brave dame me demanda de la couvrir au cas où son époux rentrerait de façon impromptue.
Très mal à l’aise et incapable de rentrer dans son jeu, je décidai d’aller trouver un prêtre que je connaissais pour lui demander conseil dans la bonne marche à suivre. Bien sûr, il m’enjoignit de ne pas rentrer dans cette histoire, et même de m’éloigner de la dame en question.
J’allais annoncer à l’épicier que je les quittais et lui demander mon compte, quand lui-même me donna mon congé. Je compris qu’il n’était pas dupe de la situation.
Je commençai alors à travailler à l’UFCV comme monitrice dans un centre sanitaire tenu par des religieuses. J’avais en charge un groupe d’une dizaine d’adolescentes. Ma collègue Marie-Thérèse en avait autant.
Ces gamines placées là, abandonnées par leur famille, avaient vécu beaucoup de traumatismes et pouvaient parfois avoir des comportements difficiles à gérer.
Un jour, nous décidâmes, Marie-Thérèse et moi, d’emmener nos groupes jusqu’au phare de La Turballe. Après la visite, les jeunes filles souhaitèrent rester un moment sur la plage. Elles s’amusaient, chahutaient à qui mieux mieux, heureuses de cette sortie. Cependant, la mer commençait à monter dangereusement. La prudence nous imposait de réunir notre petit monde pour rebrousser chemin. Nous appelâmes les demoiselles qui restèrent indifférentes à nos appels. L’inquiétude grandissait en nous ; le risque devenait réel et nous dûmes faire preuve d’une patience sans nom pour être enfin entendues.
Lorsque nous rentrâmes à l’institut religieux, ramenant notre groupe sain et sauf, nous demandâmes à rencontrer la mère supérieure. Marie-Thérèse et moi avions décidé de partir. Un grand silence suivit notre annonce. Nous la réitérâmes.
Très calme, la supérieure nous proposa de retrouver tranquillement nos esprits et nous apporta des tartines de confiture. Elle nous invita alors à réfléchir notre décision.
Nous nous rendîmes à la chapelle et, après avoir discuté, décidâmes de persévérer. Par contre, je me voyais dans l’obligation d’aller discuter avec les meneuses de la troupe. Au cours de cet échange, j’appris que ces gamines nous reprochaient pour la plupart notre « vie privilégiée ». Une vie de famille, une liberté qu’elles-mêmes souffraient de ne pas connaître, enfermées là, dans cette institution, la majeure partie de leur temps.
Je tentais de leur expliquer que si nous étions ici, parmi elles dans ce lieu, c’est que notre vie de famille n’était peut-être pas si enviable que cela.
Ceci eut pour effet de calmer l’animosité ambiante et de rétablir un certain ordre. Dans les jours qui suivirent, je remarquai qu’il n’était plus nécessaire de rappeler aux filles qu’elles devaient faire leur lit et qu’elles étaient moins rebutées par les tâches du quotidien. Tout se passait avec beaucoup plus de douceur entre nous. J’avais réussi à gagner leur confiance, à ma grande joie.
La profonde misère dépasse les idées que nous pouvons nous en faire. Pour exemple, cette petite fille que son père vint chercher alors qu’il s’était évadé de prison. Quand elle nous revint, elle était tellement choquée et meurtrie de ce qu’elle avait vécu, que nous nous demandions comment elle s’en sortirait, comment parviendrait-elle à se construire ?
Était-ce d’avoir vu tant d’horreurs que la mère supérieure devint aveugle à l’âge de quarante-cinq ans ?
Marie-Thérèse et moi souhaitions devenir soeurs missionnaires. Nous adressâmes donc notre demande auprès de l’abbé Chupin. Celui-ci nous confronta avec intelligence à notre désir.
Pour mon amie, les choses se passèrent bien, mais en ce qui me concernait, l’abbé Chupin me conseilla de ne pas m’obstiner dans ce choix : mon tempérament trop entier pourrait me le faire regretter.
Cependant, il m’orienta vers un centre à Bailly, en Seine et Oise, pour travailler avec des enfants handicapés.
La rencontre avec la directrice du centre me refroidit. C’était une Alsacienne qui, tous les lundis, nous faisait servir de la choucroute !
J’avais vingt-trois ans, je découvrais la vie. J’étais très naïve !
La vie dans ce centre n’était pas tous les jours simples. Il nous fallait veiller au comportement sexuel de ces jeunes garçons entre eux.
Un jour, alors que j’avais décidé de séparer les couples qui s’étaient formés, un garçon, que l’on surnommait l’orang-outan à cause de sa force, me coinça la tête entre les barreaux d’une chaise. Je crus ma dernière heure arrivée !
Je rencontrais une violence sourde, profonde, et à mes risques et périls, je devais intervenir pour éviter le pire, parfois.
Je gardais le souvenir de notre voisin, alors que j’étais encore chez mes parents, qui avait jeté son fils par la fenêtre !
Ma réaction avait été sous l’effet de l’impulsivité. Je m’étais ruée chez ces gens, avais forcé leur porte et exigé que cesse ces maltraitances.
Quand les agents du Service de Protection de l’Enfance vinrent frapper à notre porte pour recueillir mon témoignage, ils me certifièrent que je garderais l’anonymat. Mes parents refusèrent de m’adresser la parole pendant quinze jours.
* * *
C’est plus fort que moi. Le sentiment d’injustice m’a toujours guidée et permis d’agir. Et ce sentiment n’a fait que croître au cours des années.