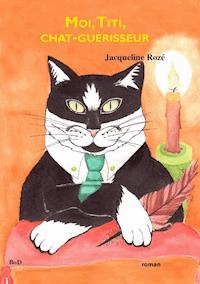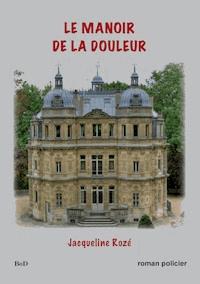Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Avec ce livre La mal venue, Jacqueline Rozé nous confie le parcours douloureux qui fut le sien dans ses relations familiales tout au long de son enfance, de son adolescence, mais aussi d’une grande partie de sa vie de femme. Vaillante, en recherche d’affection, son chemin peut être considéré comme un véritable combat de chaque jour. Elle explique ainsi la raison de ses réactions parfois brutales, de sa façon de parler d’une voix qui se veut sans faille. Ce difficile apprentissage d’une enfance sans amour lui permet de prendre désormais comme une leçon les obstacles qui se présentent à elle, mais aussi de comprendre davantage encore ceux qu’elle côtoie en tous lieux, même si certains voient cela comme une faiblesse de sa part. Malgré ses épreuves, Jacqueline est parvenue à regarder devant elle pour continuer à avancer en dispensant aux autres amour, considération et mieux-être. Si elle n’a réalisé tous ses rêves, certains furent accomplis, dont celui de l’écriture qu’elle doit à sa mère qui sut dans ses dernières heures implorer son pardon. Elle tient aussi, à travers ces pages, à exprimer sa reconnaissance et rendre hommage à ces personnes rencontrées dans la campagne du Cellier, à celles qui l’accueillirent dans leur ferme en 1945 et 1946, comme leur propre enfant, lui témoignant amour et respect, la soutenant moralement. La mal venue, une histoire poignante, terrible, dont on ne sort pas indemne.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 243
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Du même auteur :
Les marches de la sagesse - 2006, Les 2 Encres - 2015, BoD
La mal venue - 2006, Les 2 Encres - 2016, BoD
L’ingénue des Folies Siffait - 2009, Les 2 Encres - 2016, BoD
Marchands de mort - 2010, Les 2 Encres - 2016, BoD
Adieu primevères et coquelicots - 2010, Les 2 Encres - 2016, BoD
Le Ressac de la Loire (poésies) - 2011, Les 2 Encres - 2016, BoD
Le manoir de la douleur - 2011, Les 2 Encres - 2016, BoD
Les Sourires d’inconnus - 2012, Les 2 Encres - 2016, BoD
Le leurre d’une vie - 2013, Les 2 Encres - 2016, BoD
Moi, Titi, chat-guérisseur - 2015, Les 2 Encres - 2015, BoD
À Bernard, mon frère, aujourd’hui disparu.
« La douleur qu’on refoule vous étrangle,
elle bouillonne à l’intérieur
et se voit contrainte de redoubler de violence. »
Ovide
« L’épreuve est nécessaire à la connaissance de soi.
C'est l’expérience qui nous fait prendre la mesure
de nos propres forces. »
Sénèque
Sommaire
Introduction
Chapitre 1
Chapitre 2
Chapitre 3
Chapitre 4
Chapitre 5
Chapitre 6
Chapitre 7
Chapitre 8
Chapitre 9
Chapitre 10
Chapitre 11
Chapitre 12
Chapitre 13
Chapitre 14
Chapitre 15
Chapitre 16
Chapitre 17
Chapitre 18
Chapitre 19
Chapitre 20
Chapitre 21
Introduction
Je tiens tout d’abord à préciser que ce livre n’est pas une plainte et à souligner que mes souffrances personnelles ont aussi provoqué le malheur de bien des gens. Une personne en particulier fut la cause de mes douleurs : ma mère. Elle-même a beaucoup souffert au cours de son existence, si bien que son cœur s’est peu à peu fermé, devenant hermétique au monde extérieur. Lorsque je suis née, elle était donc incapable d’éprouver de l’amour, elle-même n’ayant jamais été aimée. Notre connaissance de la psychologie pourrait aujourd’hui permettre de la soigner, mais à son époque, elle dut assumer seule la dépression qui s’em-para d’elle en réponse à toutes ses souffrances. Inconsciemment, elle me refusa son amour ; elle ne pouvait pas aimer un enfant qu’elle avait pourtant porté.
C’est ainsi qu’elle reproduisit sur moi l’injustice dont elle-même avait été victime. Mais je ne peux pas lui en vouloir car je reconnais le grand malheur que fut sa vie.
Ma mère est née en 1913. Elle a connu la Première, puis la Seconde Guerre mondiale. Un an après sa naissance, son père fut envoyé au combat et il n’en revint qu’en 1919. Durant ce temps, ma grand-mère eut alors trois enfants à charge : un garçon et deux filles, dont ma mère était la plus jeune. Ma grand-mère fit tout ce qui était en son pouvoir afin que ses enfants ne manquent de rien. Elle travailla autant qu’elle le put : elle devint femme de ménage, garde-malade la nuit, et soigna les gens. L’inconvénient, c’est qu’elle n’était jamais à la maison, ses enfants durent donc apprendre à être autonomes.
Les voisins remarquèrent rapidement ces trois petits livrés à eux-mêmes. Un couple à la retraite, sans enfant, touché par la situation, se proposa pour s’oc-cuper du plus jeune de la fratrie. Ils adoptèrent ma mère et la recueillirent chez eux. Durant quatre ans, ils s’occupèrent d’elle, la comblant d’amour et veillant à sa bonne éducation. Mais arriva le jour où son père adoptif mourut ; folle de douleur, sa femme en perdit la tête.
À l’âge de huit ans, ma mère retourna donc vivre dans sa famille, laissant derrière elle cet aperçu d’un bonheur éphémère. Elle avait connu l’amour, elle l’avait touché, quel doux sentiment pour une enfant que de se sentir aimée ! Mais à peine eut-elle pris conscience qu’elle détenait un trésor inestimable – cet amour qu’elle conservait jalousement au creux de son cœur – que la vie le lui arracha, comme si le droit d’être aimée était refusé à cette petite fille. Peut-être qu’au fond d’elle-même ma mère est restée cette enfant brisée par la vie dès le plus jeune âge. Je ne peux pas en vouloir à une enfant.
Pourtant je suis forcée d’admettre que son comportement vis-à-vis de moi m’a toujours bouleversée : je ne comprenais pas pourquoi ma propre mère ne m’aimait pas. Face à ce manque d’amour, j’ai alors adopté un air sévère et bourru, qui par la suite ne m’a plus quittée. J’ai dissimulé ma tristesse derrière une façade hostile au monde extérieur. Pourtant j’aime les gens et lorsque j’apprends à les connaître, je redeviens alors moi-même : un être qui a soif d’amour, qui sans cesse cherche à combler ce vide affectif, toujours présent.
C’est pourquoi je veux raconter mon histoire, je veux crier au monde qui je suis vraiment : une personne comme tant d’autres à la quête du bonheur.
Ma mère m’a souvent dit qu’elle m’avait eu trop tôt, ou peut-être était-ce trop tard, elle-même n’en savait rien. Je n’ai jamais eu le courage de lui demander ce que cela signifiait, j’ai seulement retenu que, dans tous les cas, je n’étais pas née au bon moment.
Je vins au monde dans un quartier de Chantenay, à Nantes. On ne connaît pas exactement le jour de ma naissance, mes parents ont donc décidé que le 18 mars 1935 serait ma date anniversaire. Ils m’ont dit que c’était un lundi et que j’avais vu le jour – ou devrais-je dire la nuit – aux alentours de vingt-trois heures.
J’avais déjà un grand frère, Bernard, de sept ans mon aîné. C’était un enfant issu d’un premier mariage du côté de mon père. Les moments passés avec lui sont les plus beaux de ma vie : son amour pour moi était sans borne, il me donnait toute son affection. Il n’est malheureusement plus parmi nous aujourd’hui et je tiens d’ailleurs à lui rendre hommage. Tout comme moi, Bernard était rejeté par nos parents. À la maison, on ne l’aimait pas, et il en a beaucoup souffert. Malgré tout, mon frère m’a prouvé qu’il était capable d’amour.
À sept ans et demi, Bernard avait encore des airs de bébé avec sa petite bouille joufflue et son duvet de cheveux blonds. Il avait été élevé par sa grand-mère, avant de rejoindre son père, lorsque celui-ci rencontra sa nouvelle femme. Ma mère était alors âgée d’à peine vingt et un ans, et elle était complètement dépassée par son union avec un homme de dix ans son aîné, et par cet enfant de sept ans, incapable de se débrouiller tout seul. Mon arrivée dans la famille, un an après leur mariage, ne fit qu’accentuer son désarroi… tant de responsabilités pour une si jeune femme !
Lorsque j’étais petite, mon père m’adorait : il disait que j’étais un vrai petit clown, car je n’avais pas mon pareil pour dérider le front des plus soucieux. Hélas ! Je ne me rappelle pas de cette belle époque, avant que mon père ne parte pour la guerre. Seul un souvenir me revient. À presque deux ans, je ne marchais toujours pas, me contentant simplement de sauter à pieds joints lorsque j’éprouvais le besoin de faire de l’exer-cice. Préoccupé par ce retard, mon père prit les choses en main. Il acheta une magnifique colombe sur le marché de la place Émile Zola, qu’il installa dans une volière tout au fond du jardin. Il vint ensuite me trouver et me dit d’un ton solennel :
– Ce bel oiseau est pour toi. Lorsque tu auras appris à marcher, tu pourras alors aller l’admirer.
Aussitôt, je me levai et d’un pas incertain, je me dirigeai à travers le jardin jusqu’à la cage de l’oiseau. La colombe était si belle que je ne pouvais en détacher mon regard. Je l’observai durant des heures avant de regagner la maison, le regard brillant.
Tous ces souvenirs sont inscrits en moi, indélébiles. Je m’étonne parfois de pouvoir ressusciter les choses avec autant d’exactitude. Je suis alors troublée lorsque je m’aperçois que je ne me rappelle que vaguement de mon père durant ma tendre enfance. Le seul souvenir où il est vraiment présent n’est même pas directement lié à lui, mais plutôt à l’extase ressentie à la vue de cette magnifique colombe qu’il m’avait rapportée.
Je me rappelle aussi du jour de son départ à la guerre, en 1939. Je ne crois pas qu’il se soit tourné vers moi ou qu’il m’ait embrassée pour me dire au revoir. Durant son absence, il ne m’a jamais écrit, ne serait-ce qu’une simple carte. À son retour, il ne s’est pas intéressé à moi plus qu’auparavant ; il travaillait beaucoup et partait souvent en déplacement sur des chantiers. J’ai l’impression qu’à chaque fois que j’ai essayé d’aller vers lui, il m’a repoussée.
Chapitre 1
J’allais avoir trois ans lorsque mes parents déménagèrent pour prendre une poissonnerie rue Vaucanson. Elle était tenue par ma mère. Ma mémoire commence à partir de cette période. Je me souviens de l’épicière qui me donnait parfois une orange, et de la bouchère qui me gavait de dragées. Dès que je le pouvais, je me sauvais de la maison : j’avais commencé à marcher très tard et je comptais bien rattraper le temps perdu ! C’est ainsi que je volais dans les airs, sillonnant le quartier. Très occupée par la gérance de son commerce, ma mère avait peu de temps à me consacrer. Aussi, lorsqu’elle me courait après, cela me donnait l’im-pression qu’elle s’occupait de moi. C’était lors de mes escapades que l’on prenait conscience de mon existence.
C’est sans doute à cause de mes évasions à répétition qu’elle décida de m’inscrire à l’école maternelle, le jour de mes trois ans. J’étais de loin la plus jeune de tous les élèves, et ces enfants, bien plus âgés que moi, me terrifiaient. Tous mes souvenirs concernant cette période sont imprégnés d’angoisse : j’avais peur de tout et de tout le monde. Chaque matin, ma mère devait me traîner sur le trajet de l’école pour enfin réussir à me laisser dans les bras d’une institutrice, malgré mes hurlements de protestation.
Bernard, mon frère, essayait bien de me consoler en m’achetant de temps à autre une gomme à mâcher, mais rien n’y faisait : je détestais l’école.
Bien plus tard, j’avais alors dix-huit ans, je faisais le marché avec ma mère, lorsqu’une jeune fille de mon âge s’exclama en me voyant :
– Tiens ! Ne serait-ce pas la petite fille qui, il y a longtemps, se roulait par terre pour ne pas aller à l’école ?
Mes prouesses avaient marqué bien des esprits, et si la réflexion me fit sourire, ma mère, quant à elle, se contenta de pincer les lèvres et de détourner le regard. Ce simple épisode avait suffi à accroître un peu plus le mépris qu’elle avait à mon égard.
Ma seule consolation était que chaque année l’école offrait un cadeau à tous ses petits élèves. On nous expliquait que le père Noël était passé dans la nuit et nous avait déposé cette montagne de cadeaux. L’année de mes quatre ans, je reçus un petit baigneur russe. Il portait une tenue typique et un bonnet rouge en velours. C’était la première fois de ma vie que je possédais une poupée, et je l’aimai immédiatement. Je l’appelai Jacky et passais des heures à jouer avec. J’ima-ginais que j’étais sa maman et je le dorlotais comme un vrai nourrisson. L’année suivante, je reçus une poupée ressemblant au petit chaperon rouge ; je décidai aussitôt qu’elle serait la petite sœur de Jacky. J’avais une petite mallette bleu marine qui fit office de lit et de moyen de transport pour mes deux enfants. Je ne les abandonnais jamais, ils m’accompagnaient partout, même à l’école. Un an plus tard, alors que mon petit Russe avait deux ans (j’imaginais qu’il était né le jour de Noël !), il disparut de la salle de classe pendant la récréation. Nous étions en 1941 et je dois dire que les Russes n’étaient pas très aimés à cette époque, mais allez expliquer cela à une fillette de six ans ! J’eus beaucoup de chagrin, mais ma priorité fut de consoler mon petit chaperon rouge qui, j’imaginais, devait être très secouée par la disparition de son frère.
Après avoir perdu ma précieuse poupée à l’école, ce fut au tour de mon béret de disparaître lors d’une sortie scolaire.
La maîtresse nous avait emmenés, mes camarades et moi, visiter le somptueux château de Nantes, dont les salles, la cour et les remparts me laissèrent sans voix. Je voulais tout voir tant ce lieu me semblait magique, et pour ne pas en perdre une seule miette, je me penchai au-dessus du pont pour mieux apercevoir les douves qui cernaient le château. C’est à ce moment-là que le drame se produisit : je baissai un peu trop la tête et mon béret glissa avant d’entamer une longue chute pour aller se poser délicatement sur la surface de l’eau verdâtre. Tout s’était passé si vite que je n’avais pas eu le temps de réagir. Lorsque je tendis les bras dans le vide, il était trop tard. La maîtresse s’approcha de moi et perçut mon regard plein de détresse. Elle tenta de me réconforter en me disant qu’elle se procurerait un autre béret, semblable au mien, mais rien n’y fit. Je restais inconsolable car je savais pertinemment ce qui m’attendait lorsque ma mère s’apercevrait de la disparition du béret. De retour à l’école, la maîtresse attendit avec moi que ma mère vienne me chercher afin de lui expliquer la situation. Celle-ci l’écouta sans mot dire, puis me ramena à la maison en me tenant fermement par le bras. La suite, je ne la connaissais que trop bien. Elle se mit à hurler en m’insultant de tous les noms d’oiseaux, avant de m’infliger une correction mémorable. Ce ne furent pas tant les coups qui me firent souffrir ce jour-là, mais plutôt la réaction disproportionnée de cette mère qui ne m’aimait pas. Pourquoi tout ce grabuge à cause d’un malheureux béret ? Aujourd’hui encore, lorsque j’y repense, l’incompréhension et mon angoisse de petite fille resurgissent, elles me serrent la gorge, me tordent le ventre et un seul mot s’impose alors à mon esprit : Pourquoi ?
Nous déménageâmes ensuite dans les marches de l’abreuvoir. Suite à ce déménagement, mes parents décidèrent de vendre la poissonnerie, espérant en tirer un bon prix car elle tournait bien. Très vite, ils trouvèrent un acheteur et signèrent l’acte de vente. Seulement, le soi-disant acheteur était de mèche avec le notaire, et ils ne versèrent jamais l’argent à mes parents. Ma famille se retrouva sur la paille, nous n’avions plus rien et étions endettés jusqu’au cou.
À l’époque, je n’avais que quatre ans, mais je pense que c’est à partir de ce moment-là qu’ils se vengèrent sur moi des malheurs que leur infligeait la vie.
Je dus changer d’école et ma mère m’obligea à y aller tous les jours, sauf le jeudi où je me rendais chez une vieille demoiselle qui me gardait. Elle était très gentille et me gâtait de crêpes et de gâteaux, tout en essayant de calmer mes colères à l’aide de son vieux phonographe à pavillon qui scandait des chansons pour enfants. Mes cris et mes pleurs finirent par avoir raison de sa patience : le phonographe me faisait peur et je ne voulais pas de ses gâteaux. Ce que je voulais, c’était ma maman…
Après avoir déménagé, je dus changer d’école, ce qui n’atténua en rien mon aversion pour celle-ci. La nouvelle maternelle n’était guère différente de la précédente, si ce n’est que j’y fis une grande découverte, à savoir l’existence de la paire de ciseaux ! On me contraignit malgré moi à en apprendre l’utilisation, ce qui ne fut pas une mince affaire. Mes difficultés s’expliquent très simplement du fait que j’étais gauchère et donc incapable de manipuler des ciseaux avant tout conçus pour les droitiers. En temps habituel, la concierge de l’école me surveillait après la classe, en attendant que Bernard vienne me récupérer. Mais après une discussion entre mes parents et l’institutrice, il fut convenu que désormais je resterais dans la classe afin de m’en-traîner au découpage, cette fois-ci sous la surveillance de la femme de ménage. Cette brave femme me prit en pitié lorsqu’elle s’aperçut que, malgré toute ma bonne volonté, les ciseaux ne m’obéissaient pas, et, pour éviter que je me fasse gronder le lendemain, c’est elle qui faisait le travail à ma place. La maîtresse ne s’aperçut pas de la supercherie et elle criait à qui voulait l’entendre qu’à force de persévérance on finissait par venir à bout des plus récalcitrants !
Je quittai la maternelle pour l’école primaire, ce qui n’arrangea pas ma situation. Les institutrices étaient encore plus sévères. Les coups de baguettes qui pleuvaient régulièrement ont marqué mes doigts et mes souvenirs. J’avais toujours la peur au ventre sur le chemin de l’école, mais à six ans, il n’était plus question de se rouler par terre pour essayer d’y échapper. Je n’avais personne à qui confier mes angoisses et pourtant j’en avais gros sur le cœur. Ma plus grosse difficulté fut d’apprendre à écrire de la main droite. Lors des dictées, je perdais automatiquement le fil, car je n’arrivais pas à écrire aussi vite que les autres. Cela me perturba tellement que mon cerveau n’enregistrait que très lentement une suite d’informations pour la retranscrire à l’écrit, si bien que, même au collège, je fus incapable d’effectuer correctement mes travaux de sténodactylographie.
Lorsque la vieille demoiselle jeta son tablier et ne voulut plus entendre parler de moi, ma mère dut chercher quelqu’un d’autre pour me garder le jeudi. J’avais alors cinq ans et il était difficile de trouver quel-qu’un qui acceptât de garder une si petite fille. Finalement, je fus placée chez des religieuses, à Saint-Simi-lien. Normalement, ces dames ne s’occupaient que d’adolescents, mais elles furent très heureuses d’ac-cueillir parmi eux une petite fille à la frimousse d’ange. Malgré tout, les religieuses ne me laissaient pas chômer : elles n’hésitaient pas à me faire travailler en dépit de mon jeune âge. C’est ainsi que je me retrouvais à faire de la charpie destinée à servir de pansements aux blessés de guerre, à partir de simples morceaux de tissus. Le travail était fatigant et monotone : il consistait à défaire l’étoffe fil après fil, jusqu’à ce que la vision se trouble, que les doigts s’engourdissent au point de perdre toute leur dextérité. Les religieuses me faisaient peur avec leurs tenues sombres et leurs regards sévères. Les grands me persécutaient, ils me volaient mon goûter et cherchaient sans cesse à m’ef-frayer. Souvent, ils se postaient derrière moi lorsque je faisais de la balançoire, et s’amusaient à me pousser si fort que je devais fermer les yeux pour ne pas défaillir de peur. Je pleurais alors toutes les larmes de mon corps, et à la fin de la journée, ma mère me retrouvait épuisée, la mine déconfite. Saisissant mon désarroi, elle me retira du couvent et décida de me prendre avec elle le jeudi lorsqu’elle partait travailler dans un hôpital militaire. J’aimais bien cet endroit où tout le monde était gentil avec moi, émerveillé par mon calme et ma douceur.
Le samedi restait tout de même ma journée préférée, car ma mère ne travaillait pas ce jour-là et nous en profitions pour aller nous promener au jardin botanique. Un sentiment de pur bonheur m’envahissait, je me sentais libre, délivrée des contraintes habituelles. J’aimais marcher à ses côtés, à travers la verdure du parc. J’embrassais du regard le magnifique tableau que formaient toutes ces couleurs et j’admirais la beauté des fleurs. Mais cette courte journée, qui chaque semaine signait une trêve entre ma mère et moi, était bien vite oubliée dès lors qu’un nouvel incident éclatait à la maison.
En 1941, la guerre battait son plein ; les alarmes résonnaient dans toute la ville par intermittence régulière, et il était strictement interdit aux enfants de s’éloigner de leurs maisons. Cependant, je voyais souvent de jeunes garçons qui, bravant l’autorité parentale, se retrouvaient en ville au bus du jardin des plantes, côté gare du nord. Il y avait une grande fontaine à laquelle ils se rafraîchissaient et s’amusaient parfois à en boire l’eau à l’aide d’une grande feuille de camélia. Moi aussi je voulais aller à la fontaine jouer avec eux, mais je n’osais pas les suivre. Un jour, je pris mon courage à deux mains, et voyant ma mère occupée, je courus avec eux. Lors de mon retour, je pris garde à bien me sécher avant de rentrer à la maison, mais quelle ne fut pas la colère de ma mère lorsque je fis mon apparition sur le seuil de la porte ! Elle me traîna dans un coin de la pièce et m’infligea une correction mémorable en m’accablant de reproches :
– Comment oses-tu me désobéir alors que je me tue à la tâche pour pouvoir t’élever ?
J’eus beau lui dire que j’étais restée dans les environs et que je n’étais pas allée m’amuser à la fontaine, elle ne voulut rien savoir. Plus tard, elle m’expliqua que, malgré mes précautions, le bas de ma robe était trempé, ainsi que mes cheveux ; elle avait donc compris où j’avais passé l’après-midi. Après cet incident, j’ai pris conscience qu’il était inutile d’essayer de tromper une mère et que, bien souvent, la vérité parle d’elle-même.
Par la suite, j’ai rarement essayé de lui jouer de nouveaux tours, car j’avais bien trop peur de sa réaction.
Parfois, lorsque je n’étais pas sage, ma mère menaçait de se débarrasser de moi et de me vendre au chiffonnier ambulant. C’était un homme qui sillonnait la ville pour récupérer les vieilles étoffes et vendre tout un tas de tissus et de peaux, s’arrêtant de maison en maison. Pour annoncer son arrivée, il criait d’une voix forte et grave qui ne cessait de m’impressionner. Lors-qu’il s’approchait, je repérais de loin sa grande silhouette massive et son odeur de vieux cuir. Il me faisait terriblement peur et je courais me cacher dès que je l’entendais arriver.
Cet automne-là, j’étais tout excitée à l’idée de laisser derrière moi la monotonie de mon quotidien pour partir à la campagne avec ma famille. Nous nous rendions chez des parents proches qui possédaient des hectares de vignes. C’était la période des vendanges et, comme chaque année, mon père allait les aider. Ces quelques jours étaient un pur bonheur : j’adorais me promener dans les allés de raisins et participer à ma façon à toute cette agitation. Je choisissais les plus belles grappes et me gavais, à en avoir mal au ventre, de grains juteux et sucrés. À la fin de la journée, ma bouche et mon menton étaient violets et mes vêtements joliment tachés !
Cette année-là, le moment des vendanges avait malheureusement perdu sa magie : la gaieté habituelle avait disparu et tout le monde se préoccupait de la tournure des événements.
Je ne comprenais pas pourquoi les adultes semblaient si soucieux et je préférais donc la compagnie de mes semblables, beaucoup moins taciturnes. Je m’entendais particulièrement bien avec un petit garçon espiègle qui me faisait sans cesse découvrir de nouveaux jeux. Lorsque je le revis deux ans plus tard, il n’était plus l’enfant pétillant de vie que j’avais connu. Il ne m’adressait plus la parole, il ne parlait d’ailleurs à personne, et semblait toujours triste, le regard perdu. J’appris plus tard que son père avait été fusillé par les Allemands, sous ses yeux, aux côtés de cinquante autres otages. Ces hommes avaient payé pour la mort du Lieutenant Colonel Hotz, un Allemand assassiné par un résistant. Le père du petit garçon qui faisait lui aussi partie de la Résistance, avait été trahi par sa femme qui l’avait vendu aux Allemands.
Durant la guerre, beaucoup ont perdu la vie pour leurs actes héroïques. Je me rappelle d’un officier ingénieur allemand, celui justement qui a construit le grand tunnel sur l’Erdre. Il fut lui aussi fusillé par ses compatriotes car il distribuait aux Français des laissez-passer qui leur permettaient de rendre visite aux membres de leur famille faits prisonniers. C’était un homme bon, qui n’hésitait pas à fournir aux femmes de faux papiers pour qu’elles puissent voir leur mari ou leur fils.
À cette époque, le frère de ma mère avait été arrêté par l’armée allemande. Sa femme l’avait dénoncé car il possédait un vieux fusil de chasse, ce qui était interdit si l’arme n’était pas déclarée à la préfecture. Chaque jeudi, ma mère m’emmenait avec elle à la prison pour lui rendre visite et lui porter un colis. Elle pensait que, accompagnée d’une fillette, les Allemands la laisseraient tranquille. Bien souvent, ce fut cet officier ingénieur qui nous fournit de faux laissez-passer pour nous permettre d’entrer.
Lors de l’une de nos visites, ma mère fut interpellée par un officier allemand qui nous conduisit dans une petite salle, celle où il avait coutume de mener les interrogatoires. Il voulait lui faire avouer qu’elle était un membre actif de la Résistance. Ma mère lui tint tête et rejeta ses accusations. Elle me tenait par la main et je sentais qu’elle tremblait en me serrant de plus en plus fort. Elle n’en menait pas large devant cet homme à la stature imposante, pourtant elle ne baissait pas les yeux, soutenant son regard inquisiteur. J’eus très peur ce jour-là et je me rendis compte à quel point j’aimais ma mère.
Cette même année 1943, Nantes connut une semaine de bombardements ininterrompus. La ville ressemblait à un champ de bataille. Des cadavres jonchaient les rues, les maisons étaient éventrées, tout n’était que ruines. Au cours d’une attaque, notre logement fut soufflé par une bombe et, comme tant d’autres, nous nous retrouvâmes à la rue. Nous dormions désormais dans des abris de misère et récupérions tout ce que nous trouvions, car nous n’avions plus rien. Chaque jour, les pompiers nous fournissaient un peu d’eau que nous utilisions avec parcimonie. La Croix Rouge distribuait des gâteaux secs qui constituaient notre unique repas, n’ayant plus de quoi nous nourrir. Nous avions tout perdu. Mon père prit alors la décision de partir. Il se procura une charrette et un vieux cheval pour faire le voyage, direction la campagne, où la vie était plus facile.
Durant plusieurs jours, nous marchâmes, ne nous arrêtant que le soir pour nous installer dans un bois et dormir à la belle étoile. Marcher des journées entières était harassant pour une fillette de mon âge, mais je ne me plaignais pas, concentrée à mettre un pied devant l’autre pour ne pas m’arrêter. Lorsque nous arrivions au pied d’une côte, il fallait pousser la charrette de toutes nos forces pour aider le vieux cheval à gravir la pente.
Ce voyage était, pour mon père qui avait perdu un bras à la guerre, un vrai calvaire ; son handicap lui compliquait énormément la vie.
Enfin, un soir, alors que nous avions effectué une quarantaine de kilomètres, nous arrivâmes dans un petit village du nom de Pannecé. Très affaibli par le voyage, mon père décida que nous nous installerions dans ce village où mon frère vivait déjà.
Malgré l’hostilité des paysans à notre égard, nous réussîmes à trouver un logement. L’un d’eux accepta de nous louer une maisonnette qui lui servait de grange. Mon père se fit embaucher comme bûcheron ; il apprit donc à scier et à couper du bois à l’aide d’une seule main. Ses journées étaient épuisantes et lorsqu’il rentrait le soir, il filait se coucher aussitôt le repas terminé. Parfois il m’emmenait à la pêche. Nous passions alors des heures côte à côte à guetter nos hameçons, sans échanger la moindre parole. Malgré tout, je me sentais bien à ses côtés et ce furent pour moi des instants privilégiés.
Ma mère essayait de nous rendre la vie supportable avec le peu dont nous disposions. Bien souvent elle sollicitait mon aide pour les tâches ménagères, me réservant les plus ingrates. Ainsi, je me retrouvais à ramasser les ronces des fossés pour faire du feu, car nous étions bien trop pauvres pour acheter du bois. Il était interdit de prendre les branches tombées des arbres, car elles appartenaient à notre propriétaire. Je passais donc des heures à réunir des tas de ronces, avant de rentrer, couverte d’égratignures, à la maison.
Une voisine eut pitié de moi et un jour que je passais devant chez elle, elle m’interpella. C’était une femme douce, qui avait à peu près la soixantaine et s’appelait madame Claude. Elle me prit dans ses bras lorsque je m’approchai, et me dit que je ne devais plus cueillir de ronces, car c’était bien trop dangereux pour une si petite fille. Elle alla chercher un fagot de bois et un morceau de lard, les apporta à ma mère, et lui dit que, désormais, nous devions venir la trouver lorsque nous aurions besoin de quelque chose. La gentillesse de cette femme était exceptionnelle, car pour la plupart des habitants du village, nous étions des réfugiés et ils nous fuyaient comme la peste. L’un de nos voisins par exemple lançait ses oies à ma poursuite dès que je m’approchais de sa ferme. Seul le curé nous témoignait un soupçon de sympathie, mais à moi, il me faisait peur : il n’avait plus d’oreilles, celles-ci avaient gelé dans les tranchées lors de la première guerre.
Il me reste aussi de très bons souvenirs de cette année passée à Pannecé. Je me rappelle à quel point j’aimais les longues promenades en famille, et les journées où nous allions pêcher des gardons et des ablettes, confortablement installés à l’ombre d’un saule.