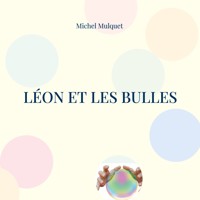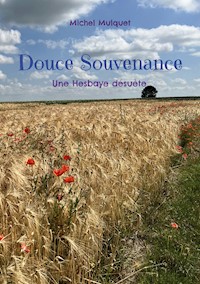
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Französisch
Petites vidéos de la campagne hesbignonne fixées sur le disque dur de ma mémoire par les petites caméras d'un regard d'enfant. Images brutes exhumées et livrées sans les filtres de la convenance ou de l'analyse scientifique et rapportées sans acrimonie ou complaisance, mais d'une encre souvent incisive.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 182
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Combien j’ai douce souvenance1
1Souvenir du pays de France, F.-R. de Chateaubriand
Combien j’ai douce souvenance Une Hesbaye2 désuète
battage dans les années trente
2région fertile de Wallonie
Si par aventure, Uiop de ses touches m’a trahi, ou si mes correcteurs s’assoupirent, puissiez-vous cher lecteur m’accorder une once de mansuétude.
Prologue.
J’ai rapporté la réalité vue au travers d’un regard d’enfant vivant sa première décennie dans les années cinquante, yeux qui sans doute peuvent encore malgré les ans percevoir de temps à autre un certain parfum candide d’un monde polychrome.
Cette réalité décrite ici fut devant mes yeux de petit homme, s’inscrivant profondément dans les premières pages de mes souvenirs. La plupart de ceux-ci n’ont plus été exhumés depuis tant d’années, les personnes évoquées nous ayant abandonnés en général depuis près d’un demi-siècle, et ma famille liégeoise n’appréciant pas les évocations burdinnoises.
Seules quelques saillies amusantes agrémentaient de temps à autre les conversations, sans plus d’intérêt que la forme de la tasse de thé qui accompagnait nos rencontres familiales.
1. Les bois du cerf
Il en est de nos origines comme des bois d’un cerf ; toujours deux ramures conduisent à l’animal, sinon que mes bois sont loin d’être symétriques !
Ma branche liégeoise
Je suis apparu de la convergence de deux sources fécondes : l’une bien liégeoise par Denise, ma frêle petite mère, l’autre hesbignonne par mon père Jules.
Enfant non planifié, je suis le fruit d’un échec, celui de la méthode contraceptive de Monsieur Ogino, que mes parents n’honorèrent jamais plus à partir de ma naissance : « avec Ogino, on fait des oginettes » avait si bien résumé le gynécologue de la famille !
Mon émergence fut attendue avec impatience par ma mère qui, après deux garçons, souhaitait de tout cœur une jolie petite fille. Non seulement je suis arrivé avec un mois de retard par rapport aux prévisions des oracles, mais Maman put ranger sans appel le rose de ses projets. Si on y ajoute que je respectai la tradition des bébés super-lourds de la fratrie, mais encore que je décidai de découvrir le monde au milieu de la nuit, je ne remplis aucunement les critères du cadeau divin !
Pauvre mère qui accoucha en trois essais de plus d’un mètre soixante de nourrisson et supporta près de quinze kilos de marmouset ! Notre père fut même vilipendé pour son inconséquence ; exploiter ainsi cette misérable femme malingre certainement tuberculeuse : pourtant, le bacille responsable, ce fut moi et mes plis d’enfant replet !
On éclôt quelque part, brindille d’un arbre méconnu
La corolle maternelle portait la coloration du sud ensoleillé et s’appelait Rosa, emblème de la pudeur au IIIe Sc., et bien qu’une origine médiévale lointaine et méconnue restât possible, mais totalement ignorée, Maman est née au cœur de Liège d’un père peintre en bâtiment employé au « Nord belge » qui devait évoluer plus tard en SNCB. Lambert, fut passionné d’imprimerie qu’il pratiqua bien au-delà de sa retraite, mais en outre dessinateur adroit formé à saint Luc, amateur de musique chorale à quatre voix « homme » dépeignant la condition misérable des ouvriers, pièces sociales que Zola n’aurait reniées, telle l’horreur de la vie des mineurs de fond dans « Le coup de Grisou » que plus aucun groupe n’attache au paysage de son répertoire.
Il appartenait à une fratrie nombreuse dont nous ne connaissons pas grand-chose, sinon que son père louait des charrettes à bras « Dju d’là », lisez Outremeuse, à l’époque populeuse et populaire située au cœur profond de Liège.
Tout petit, je rejoignais souvent son atelier imprégné de cette odeur particulière, synthèse des émanations de solvant, d’encre, d’atmosphères teintées de mystère ! Encombré de machines énormes se disputant l’espace ; une rogneuse qui m’aurait coupé un membre d’une seule manœuvre, une relieuse, les casiers souillés de noir et ces trésors de caractères mobiles gravés inversés et qui auraient certainement charmé le génie de Léonard. Et puis, éclairé par la proximité de la fenêtre, deux « pédales », mécaniques merveilleuses vomissant au rythme des rouleaux encreurs les copies de ce message de plomb illisible que mon grand-père avait édifié ligne par ligne, lettre par lettre au creux du composteur.
J’observais souvent cette naissance avec dans les yeux une constellation de perles ; j’aurais tant souhaité moi aussi composer, me noircir les mains et donner le jour à ces imprimés, faire-part ou cartes de visite que de la poudre d’or pouvait anoblir. Une de ces après-midi passées une fois de plus dans l’atelier me fit promettre à Lambert, « quand je sera pensionné, je viendra t’aider ».
OK, l’assimilation du futur simple et des notions temporelles restaient à intégrer, mais l’école gardienne et les efforts de mes parents allaient bientôt y remédier !
Au lendemain de la Grande Guerre, il avait épousé au retour du front une frêle jeune fille prénommée Maria, demoiselle aux cheveux blond vénitien issue d’une famille aux relents un rien bourgeois dont la maman appartenait à une des branches ramifiées des Quitin aux gènes en forme de portée musicale et dont le papa, corniste d’orchestre, fut certainement la source probable des attraits de notre phylum liégeois pour les jolies notes. Les circonstances le laissèrent orphelin de naissance, tarissant dès lors définitivement toute recherche généalogique sur le patronyme Delleur.
Ainsi Maria, ma grand-mère de Liège, eut pour père un compagnon d’Eugène Ysaÿe au conservatoire de Liège, jouant dans des formations instrumentales, membre d’harmonies se produisant sans doute sur un de ces kiosques condamnés par le progrès ou accompagnant les processions pour lesquels il entretenait un réel intérêt, mais encore animant à la manière des Strauss les bals du samedi où il connut mon arrière-grand-mère.
L’histoire familiale retint que notre musicien fut séduit par la jolie dentition de Mademoiselle Quitin, elle qui arborait une prothèse, ce à quoi elle répondait qu’elle fut attendrie par sa chevelure opulente, lui qui voyait son front s’agrandir !
Petit bonhomme, il avait montré de belles dispositions pour Euterpe, et l’institution dans laquelle il avait été placé lui acheta un cor à pistons, ce qui jeta la base d’un futur couple romantique.
À la naissance de sa petite-fille Denise, c’est à travers une rivière d’émotions contenues qu’il transcrit sur de multiples portées que bois, cuivres et percussions se partagèrent : ainsi germa une marche pour harmonie, bien entendu titrée « Denise », dont je n’ai retrouvé que quelques pupitres. Un ami organiste et compositeur s’essaya à une résurrection, mais le matériel qui m’était parvenu ne présentait que trop peu de fragments. « Denise » restera, à notre plus profond regret, dans le cimetière des œuvres oubliées.
Dans son grand âge, sentant que la musique ne serait plus que dans l’évocation du passé et les mélodies fredonnées, il décida d’offrir son instrument à un jeune orphelin doué. Ainsi, il fit don de son cor qui fut exploré de son vivant !
Paradoxal, évidemment ! Habituellement, le « don du corps » n’est exploité qu’une fois le décès confirmé !
Au soir de ses jours, il aimait à prendre notre maman sur ses genoux, lui faisait poser sa menotte de dix-huit mois sur la sienne. Il sifflotait alors une de ces mélodies peuplant sa mémoire, battant les temps au rythme de la pulsation, semant dans un terreau tellement favorable l’avenir d’une pianiste.
Après sa mort, son épouse accompagnée de Maria suivait souvent les harmonies fréquemment présentes dans les processions, le parfum de son corniste soulevant cette pluie douce qui humidifie les miroirs de l’âme désolée.
Maria apprit la couture auprès de sa maman, occupation professionnelle qu’elles partagèrent jusqu’à la disparition de notre arrière-grand-mère à la fin des années trente. Avoir marié un musicien l’avait sans aucun doute encouragée à serrer fermement les cordons de la vie courante et matérielle, exerçant avec une intransigeante autorité qui empêcha Denise de poursuivre au conservatoire : Denise serait maîtresse, et savoir jouer Chopin ou Brahms suffisait largement pour initier les enfants aux riches arcanes de l’art des notes.
Maman ne fut pas institutrice, et ne put entrer au conservatoire ! Il faut dire aussi que la survenue de notre père dans ses jours allait régler son avenir.
Sa mère que j’appelais Marraine de Liège afin de la distinguer de la sœur de Papa qui se prénommait également Maria, elle qui m’a porté sur les fonts baptismaux. Elle habitait une maison menue de Grivegnée où elle tenait une papeterie riche de cahiers, feuilles de farde, stylo, et objets classiques, mais encore caverne fertile en souvenirs de communion : missels, liseuses en cuir, chapelet ou petite vierge. À l’arrièreboutique, mon grand-père avait installé son atelier duquel sortaient tous les imprimés que son épouse vendait.
Au premier étage, nos grands-parents vivaient sur trois pièces remplies de chaleur et de cordialité. Maria et Lambert n’étaient pas bien grands, et ils n’avaient pas trouvé le matériel génétique nécessaire pour faire émerger leurs deux enfants audessus de la moyenne inférieure. Marraine et Maman ne voyaient pas grand-chose dans la foule entourant les défilés ou les processions.
Maria était une petite dame à l’humour très fin que masquait un visage qu’il fallait déchiffrer pour le bien interpréter. Elle portait lunettes dont les verres installés dans une monture transparente accompagnaient ses lectures, notamment du journal étalé sur la table qu’elle commentait à l’adresse de mon grand-père, les deux pieds sur un passet, si l’on veut bien m’autoriser ce belgicisme. Par habitude, elle commençait par les avis de décès qu’elle ponctuait de mémorables « Oh, Lambert, sais-tu bien qui est mort ? ».
Marraine bénéficiait d’une solide connaissance du français, en particulier de l’orthographe qui servait quotidiennement dans la correction des épreuves imprimées.
Grande amatrice d’opérette, elle profitait d’un abonnement « aux galeries » de l’opéra, entendez « Théâtre royal de Liège », retrouvant ainsi régulièrement un fidèle club fermé de vieilles adhérentes qui n’hésitaient jamais à soutenir le chœur, voire à le suppléer lorsque le compositeur se retournait dans sa tombe. Eh oui, les accidents, cela arrive aux meilleurs interprètes, surtout à cette époque où les chanteurs honoraient largement leurs déficiences solfégiques ! Moi qui ne suis pas vraiment attiré par ce genre musical, enfant, j’ai entendu une importante partie de ce répertoire au cours de ces jeudis après-midi que je passai au Royal au milieu de ce cénacle appréciant, commentant, fredonnant, et j’aimais cela !
Ah, joyeuse veuve, que d’« Heures exquises qui nous grisent… »
Lorsque les mois se font funestes
Le début des années cinquante se révéla très difficile pour la famille. Maman, toujours aussi transparente, se remettait d’un accouchement compliqué, répondait aux multiples sollicitations des trois fruits de ses entrailles âgés de 10, 6,5 et 3 ans, maintenait la barque du ménage, le timonier assurant seul le support pécuniaire.
Malheureusement, Papa prit froid, et rapidement la situation se dégrada fortement l’obligeant à garder le lit dans un état s’aggravant. Une pneumonie à cette époque représentait une affection lourde et l’on parla bientôt du triduum fatidique que l’on surmonte, ou qui condamne ! Il y avait moins de 10 ans que la pénicilline était réellement utilisable. Fut-elle employée, je ne puis le dire !
Par bonheur, Jules surmonta l’infection, mais eut besoin de plusieurs semaines de soin. Maman se partageait entre la chambre du malade et les exigences multiples du rez-de-chaussée, gravissant allègrement les étages pour répondre aux demandes du grabataire, et redégringolant les volées de l’escalier pour continuer son travail ménager et assurer les interpellations répétées que trois enfants imaginatifs impliquaient.
Elle s’exténuait toujours un peu plus, jusqu’à ce que surviennent l’exorbitance et la dépression qui expédièrent bientôt le benjamin, c’est-à-dire moi, à la campagne dans la famille de Papa pour un exil salvateur long de très nombreux mois.
Ainsi allaient se forger les brassées d’anecdotes pittoresques de mes toutes premières années.
2. Ma ramure paysanne
La branche patronymique burdinnoise
Papa hurla son premier cri au milieu de la Grande Guerre.
Il faut dire que notre grand-père avait « pioché » un haut numéro, le dispensant de toute activité belligérante, ce qui explique peut-être la naissance de ce petit enfant qui devint notre géniteur. Il se prénomma Jules, comme son oncle, martyr abattu tout au début de son arrivée dans les tranchées. Réformé en raison de sa myopie, il fut volontaire et, partant, se retrouva au front. Par un concours malheureux, il passa devant un clapet qui eut dû être refermé après un tir à la carabine, et ne remarqua point qu’il constituait une cible de choix qu’un Allemand adroit ne rata pas. Une balle l’atteignit entre les deux yeux, éclaboussant ses lunettes de son sang de héros.
Un peu compliqué à voir, la relique, quand on ne dépasse pas trois pommes, et que l’on vous présente deux verres tachés cerclés de métal, mais on peut comprendre pourquoi la famille entretenait la mémoire de cet oncle disparu alors que l’armée n’en avait pas voulu.
Papa était le puîné d’un premier enfant de trois ans son aîné prénommé Arsène en honneur de notre arrière-grand-père.
À sept ans, je ne sais à la suite de quelles circonstances, il vint à décéder, plongeant ses parents dans un deuil dont le voile devait partiellement survivre jusqu’en nos primes années. Sans doute est-ce en partie l’origine d’une certaine froideur qui exsudait et imprégnait l’atmosphère de Burdinne, mais encore aussi la raison qui devait amener notre père au pensionnat de Saint Quirin, à Huy. Chez nous, jamais Papa n’a fait allusion à un quelconque souvenir de sa jeunesse sans qu’il ne fût lié à son collège, à son internat.
Notre Arsène fondateur fit édifier dans la partie médiane du village de Burdinne une maison flanquée de part et d’autre de la porte centrale à sa droite d’une écurie, à sa gauche, outre le corps de logis, d’étables et grange donnant sur une cour garnie d’un fumier. Il faut préciser que cet honorable ancêtre conduisait la malle-poste menant à Huy, et que souvent, en fin de journée, ce sont les chevaux qui ramenaient Arsène occupé à compter les éléphants roses. Comme il fut constructeur de son habitation qui accueillit la lignée, nous avons toujours été identifiés à partir de cette référence ; imaginez, « Michel, d’à Jules, d’à Hubert, d’amon Arsèn », mais on peut continuer : fils de François-Charles, fils de Nicolas-Clément (1 792), fils de Nicolas (1 768), fils de Antoine (1 730 ?).
Merci Grand-Papa qui a effectué ces recherches, mais, entre-nous, appelez-moi Michel !
Je conserve la réminiscence des anneaux fixés dans la façade qui servaient à retenir temporairement les animaux et j’aidai avec efficacité Hubert, mon Grand-Père, à transformer l’écurie en pièce de vie qui allait devenir la « Grande » ou « la Belle » place, suivant le locuteur ! Soyons honnêtes, je me souviens d’avoir, tout petit bonhomme, blessé le mur du fond de l’étable donnant sur la cour arrière avec le modeste marteau totalement métallique que mon grand-père utilisait pour réceptionner les voies qu’il installa là où Arsène mena sa malleposte. Heurtant l’extrémité d’un rail, Hubert, et plus tard son fils Jules, étaient capables de détecter au son perçu les « pailles », ou irrégularités de structure, rendant l’acier impropre à l’usage d’une voie vicinale.
Arsène ayant bien profité de la dive bouteille et de nombreux kilos de tabac, vit se réduire son espérance de bénéficier de sa pension pour s’évaporer prématurément dans la cinquantaine finissante d’un cancer de la gorge.
Ainsi Hubert reprit le bien, mais sans la diligence, et récupéra à meilleure fin l’écurie désormais inutile, enrichissant le rez-de-chaussée d’une pièce de plus largement nécessaire.
Arsène avait limité l’espace de vie à une élégante place, prolongée par une cuisine étroite dans laquelle la famille vivait, apprêtait les repas que le ménage consommait sur une vieille table de bois visitée par d’importuns xylophages, ou tuant les dernières heures du jour au son d’une volumineuse radio à l’ébénisterie soignée. La « Belle Pièce » fut réservée aux réceptions des étrangers dans une salle à manger breughélienne, et derrière la fenêtre à rue, un salon nanti de fauteuils opulents accueillait les observateurs masqués par le moucharabieh végétal qu’offraient de généreuses plantes vertes, déchiffrant une existence tellement passionnante lorsque les voisins, les inconnus, ou le bétail passaient devant la maison.
Ma forclusion bucolique
Appelez cela xénélasie, pétalisme, ostracisme ou tout autre beau mot de la langue française, mais ce fut pour moi une période d’exclusion difficile à comprendre pour le jeunet que j’étais ; mais il est vrai que la situation familiale à la maison rendait mon énergie quelque peu encombrante et incompatible avec l’état de santé de nos parents. Croyez cependant qu’effectivement, je vécus cette évacuation vers Burdinne avec une nette coloration d’exil !
Mon Grand-père était un homme timide, austère, et donc taiseux, voire dur avec ce petit avorton qui ne retenait guère son attention, et sans doute son affection. Seul le premier enfant mâle avait éveillé son intérêt. Très imprégnée de l’esprit du XIXe, la primogéniture lui était une évidence : il lui accorda le parrainage zélé, veillant à l’intégrité du « patrimoine », spoliant ainsi les puînés de toute quelconque valeur transmise, mobilière ou foncière. Cette volonté fut strictement et intégralement respectée, et uniquement l’aîné, bien entendu prénommé Arsène comme le fondateur, a reçu le portefeuille d’actions, la maison, etc. Heureusement, mon frère Christian et moi avons été élevés dans la pleine conscience de ces dispositions, aussi nous parurent-elles naturelles et ne soulevèrent-elles aucune acrimonie.
Ses moustaches recourbées légèrement jaunies par sa pipe au long tuyau reposant sur son abdomen m’interrogeaient : comment diable le guidon restait-il en forme ? Bien sûr, on pouvait supposer que quelques reliefs de potage y contribuaient, mais le mystère demeurait impénétrable ! Et puis un jour de toilette, je retrouvai le rasoir de barbier, le blaireau, le bassin émaillé tellement semblable au matériel de Papa, mais je découvris en outre le fer à friser les bacchantes que l’on faisait chauffer sur la cuisinière ! Quelle révélation improbable, et ma foi, assez insolite que pour éveiller mon caractère souriant. Par circonspection, et à la ferme invitation de mon grand-père, je me repliai prudemment.
Imprégné de ses obligations professionnelles, pourtant désormais obsolètes, Parrain de Burdinne ainsi que nous le nommions, gardait l’habitude de chausser ses lunettes de lecture à la sombre monture, rejoignait la belle et grande place, ouvrait un haut vieux secrétaire à l’écritoire inclinée, pour se plonger dans d’antiques registres, évocation des équipes d’ouvriers qu’il dirigeait sur différents chantiers vicinaux. Dans un petit casier, bien protégé, les bésicles tachées du sang de l’oncle Jules attendaient patiemment la suivante ostension. L’endroit était sacré, et les reliques héroïques de 14 encourageaient l’obéissance !
Odile, son épouse, que nous appelions Nénenne, partageait sa vie depuis tant d’années qu’ils devaient certainement avoir toujours été âgés, ridés, et inaccessibles. Je dois à la vérité de souligner que ma grand-mère me considérait modérément, sinon un peu mieux, mais peu d’intimité ne nous rapprochait. Il me revient cependant que petit, elle me prenait sur ses genoux, puis me faisait glisser au sol ; mais cela demeure la seule vidéo dans ma pinacothèque neuronale dans laquelle elle joue un modeste rôle maternel !
Elle possédait de longs cheveux blancs, très légèrement jaunis çà et là que ma marraine et tante, sœur cadette de Papa, brossaient pour bientôt les ordonner en chignon tellement commun en cette époque dans nos campagnes profondes.
Embrasser Nénenne, c’était monter à l’assaut de sa petite taille cambrée pour recevoir avec un coup de menton un baiser fugace de sa bouche édentée dépourvue de prothèse portée uniquement pour la messe dominicale, exhumée de l’eau de son bocal pour être insérée, mais pas avant d’avoir enfilé le manteau et les chaussures déformées par les « aguesses3 », disposé le chapeau, apprêté le missel. Un jus Belgas en forme de monnaie à la réglisse colorant légèrement le matériel dentaire achevait de rafraîchir l’haleine pendant l’ascension vers la place où siège toujours l’église historique.
Par quelle douleur profonde le chemin de la vie de ce couple l’avait-il conduit pour vivre ainsi dans la sécheresse que tellement peu d’échanges affectueux reliaient ? La mort de leur garçon à l’aube de l’adolescence ? Très certainement. Mais des écueils nombreux avaient dû les marquer sans que leur pudeur les autorisât à les décrire.
Ma marraine et tante
Sœur cadette de Papa, Maria me tint sur les fonts baptismaux avec Freddy, le frère de Maman, se partageant l’audacieuse mission de parachever, voire suppléer l’éducation donnée par mes parents qui, fort heureusement, se révéla aussi complète que je voulus bien la recevoir.
Elle résidait avec mes grands-parents dans la maison d’Arsène où elle exerçait le métier de modiste qui, à cette époque, vivait au gré des événements familiaux : communions, mariages, et sans aucun doute surtout les décès. Nous en étions toujours au large usage des chapeaux et des tulles arborés en période d’affliction dont l’importance devait traduire non seulement le degré de filiation, mais encore le temps écoulé depuis le départ du disparu. On passait ainsi du « grand deuil » au demi puis au « quart deuil » matérialisé par une adaptation de la longueur du voile. La désolation sinistre du Vendredi saint porté sur leur visage survivait sans espoir de résurrection qui aurait enterré ces pratiques avec le défunt. Chez les hommes, un ruban noir affiché au revers du veston suffisait, une fois remisés les vêtements sombres du « grand deuil ».
Souvent habillés de ténèbres, de mauve ou d’autre couleur terne, les patriarches du village endossaient tous les départs et les peines que vieillissant nous avons tous à déplorer. Ainsi, se maintenaient-ils prêts pour le décès suivant !
Mais comme partout à cette époque, la messe dominicale restait un moment privilégié pour sortir « endimanché », arborant les dernières tenues récemment acquises, et bien entendu les chapeaux vendus par Maria se taillaient toujours une belle part de l’intérêt féminin. C’était aussi l’opportunité de rappeler à tout le monde que les deuils étaient bien portés, les morts honorés, et les flammes consumant la mémoire bien présentes. Évidemment, Marraine savait évoquer aux bonnes personnes que telle parente au Xe degré du défunt avait acheté tel couvre-chef, mesure objective de son attachement. Les enchères marchaient toujours assez bien.