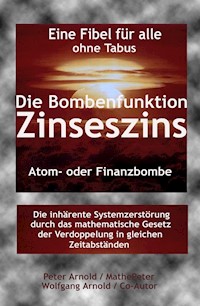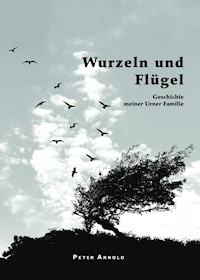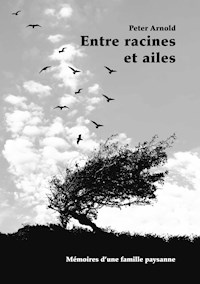
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Französisch
Le livre relate l'histoire de la famille dans laquelle l'auteur est né, une famille nombreuse et modeste issue de la petite paysannerie comme il en existait autrefois des milliers dans la Suisse centrale dont il est originaire. Le récit englobe plus de cents ans, de l'époque des grands-parents jusqu'à nos jours. Il nous fait revivre le lent passage du mode de vie précaire de l'ère préindustriel à l'abondance qui caractérise notre temps, à travers un processus qui laissait les traditions longtemps subsister à côté de la modernité. Nous y rencontrons entre autres un grand-père aux allures de patriarche, authentique paysan de montagne; des parents qui peinaient à nouer les deux bouts mais qui faisaient tout pour assurer à leurs onze enfants un meilleur avenir; une Église catholique ultramontaine qui régissait sur les consciences et réglait la vie de la naissance jusqu'à la mort; une fratrie organisée en hoirie pendant près de quarante ans après la mort prématurée de leur père. L'histoire est contée avec tendresse et pudeur, mais sans taire les aspects sombres et conflictuels.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 278
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
En mémoire de mes parents
Pour Line, Sébastien, Nirine, Spenta et Albert
Table des matières
Chapitre 1
Se souvenir d’autrefois
Chapitre 2
Jusqu’à ce que la mort les sépare
Chapitre 3
L’univers des grands-parents
Chapitre 4
Vers une vie commune
Chapitre 5
Famille paysanne – famille ouvrière
Chapitre 6
Ensemble dans la vieille ferme
Chapitre 7
Éveil à de nouvelles réalités
Chapitre 8
Une décennie de lumière et d’ombres
Chapitre 9
La famille doit se réinventer
Chapitre 10
Quand je ne serai plus
Chapitre 11
Méditations d’un pendulaire
Grand-papa et petit-fils
Né en 1945, Peter Arnold a fait des études de philosophie, sociologie et anthropologie à Paris, Genève et Fribourg-en-Brisgau, terminées par un doctorat en sociologie. Il a passé une grande partie de sa vie professionnelle au service de la Coopération au Développement du Gouvernement Suisse, entre autres à Madagascar, au Bangladesh et en Tanzanie. Marié, père de deux enfants et grand-père d’un petitfils, il est aujourd’hui retraité et vit à Gland (VD).
1
Se souvenir d’autrefois
On ne peut donner que deux choses à ses enfants : des racines et des ailes.
Sagesse populaire
Quand je pense à mon enfance, la première image qui remonte en moi est celle de la vieille ferme à Schattdorf, le village du bas du canton d’Uri où je suis né un jour d’octobre 1945. Encore aujourd’hui, elle suscite en moi de fortes émotions. C’est dans cette maison que j’ai passé les douze premières années de ma vie, jusqu’au printemps de 1958, date à laquelle j’ai quitté mes pénates pour aller poursuivre des études secondaires dans un internat de la vallée du Rhin saint-galloise. Depuis, mon parcours de vie m’a conduit dans bien des endroits du monde, chaque fois pour quelques années seulement. Uri n’en fit plus jamais partie. Sentimentalement cependant, je suis toujours resté attaché au coin de terre où j’ai passé mon enfance avec mes parents et mes frères et sœurs. Même après mon mariage j’ai continué à dire « je rentre à la maison » quand je m’apprêtais à aller à Schattdorf. Il a fallu les remarques répétées, mi- moqueuses, mi- ironiques, de mon épouse et de mes enfants pour que je comprenne ce que signifiait cette tournure de phrase.
J’ai grandi avec quatre frères et sœurs plus âgés que moi et six plus jeunes. À l’époque, dans cette Suisse centrale profondément catholique, la tradition voulait qu’on souhaite aux jeunes mariés une descendance nombreuse. Avoir beaucoup d’enfants était interprété comme un cadeau du ciel. Mais en avoir onze était quand-même exceptionnel.
Nous sommes tous nés dans la vieille ferme familiale.
Il s’agissait d’une bâtisse comme il en existe encore beaucoup dans la région, une maison mitoyenne avec une étable dont elle partageait le toit. En allemand ce type de construction s’appelle « Gadenhaus ». Ma maison natale faisait en effet partie d’une petite ferme de trois hectares que mon père avec héritée de son père. Mais je n’ai jamais connu mon père autrement que comme simple ouvrier du bâtiment. Il avait mis ses terres en location. Aussi loin que je m’en souvienne, c’est son plus jeune frère qui s’en occupait. Oncle Xaver était resté célibataire. Comme il était seul et travaillait pratiquement sans machines, il comptait fermement sur notre aide, particulièrement pendant la fenaison et la saison des regains. En ce qui me concerne, ce n’était pas pour me déplaire, bien au contraire. Si je n’avais pas, au plus profond de moi, nourri un autre rêve, je crois que j’aurais choisi de devenir paysan. Oncle Xaver s’est finalement, lui aussi, décidé autrement. À la surprise générale, il est entré en 1965, à cinquante ans passés, au couvent bénédictin d’Einsiedeln où il est décédé en 2005 comme Frère Josef.
À l’heure où j’écris, la vieille ferme n’existe plus. Elle a été démolie vers la fin des années soixante-dix, à un moment où elle n’appartenait déjà plus à notre famille. Je me suis souvent demandé : quand l’avais-je vue pour la dernière fois ? Je serais incapable de le dire. Dans mes souvenirs, par contre, elle n’a pas disparu, je la vois encore clairement devant moi comme s’il ne s’était pas écoulé plus d’un demi-siècle depuis la dernière fois que j’y suis entré.
Façade orientale de la vieille ferme
Le bâtiment était situé à une douzaine de mètres en contrebas de l’auberge du « Brückli » dont notre ferme avait autrefois été une annexe. La construction datait probablement du début du siècle et était orientée est-ouest. La partie résidentielle faisait face au soleil levant. Entre l’auberge et la maison s’étendait une petite place enherbée où clapotait une fontaine. La maison était fabriquée en bois, mais reposait sur un mur crépi qui entourait le parterre. Celui-ci abritait une seule pièce servant de buanderie, d’atelier et d’entrepôt. La charpente des parois était habillée de petits tavillons arrondis brûlés par le soleil. En été, des géraniums fleurissaient devant les fenêtres. La surface habitable était calculée au plus juste. On y accédait au sud par un escalier en bois à ciel ouvert en haut duquel se trouvait une porte donnant sur un petit vestibule. C’est de là qu’on entrait au premier étage. Tout d’abord dans la cuisine avec la grande table, que notre père avait fabriquée, puis dans le salon d’où une autre porte s’ouvrait vers la chambre à coucher des parents. De la cuisine, un escalier raide et sombre, sans fenêtres, montait au deuxième étage qui comportait deux chambres à coucher, une pour les garçons et une pour les filles, chacune meublée de deux lits. Sous l’escalier et en haut de celui-ci, deux pièces-armoires étaient installées qui servaient de garde-manger, et en face des chambres à coucher se trouvait un galetas fourre-tout, un vrai royaume à souris, dont la fenêtre donnait sur le tas de foin au-dessus de l’écurie.
Chaque pièce de la maison était éclairée par la lumière électrique, et la cuisine était munie d’un évier surmonté d’un robinet d’eau froide. Par contre, il n’y avait pas de chauffage central. Seule la cuisine et le salon étaient équipés d’une source de chaleur. Dans la cuisine, un vieux potager en fer chauffait bien sûr en toute saison. Le salon était doté d’un petit fourneau rond et élancé. Potager et fourneau étaient alimentés par du bois. En hiver, des fleurs de givre se formaient sur les fenêtres des chambres à coucher. Il fallait faire un effort sur soimême pour se lever le matin. Les toilettes se trouvaient en haut de l’escalier d’accès, derrière le vestibule. Il s’agissait d’un petit cabinet où on faisait ses affaires assis sur un caisson en bois muni d’une simple ouverture au-dessus de la fosse septique. Un couvercle de fortune faisait son possible pour empêcher les effluves de se répandre. Chasse d’eau, salle de bain, baignoire ou douche étaient encore des équipements de luxe que peu de maisons possédaient.
En ces temps-là, la plupart des familles étaient logées ainsi. Elles occupaient encore des habitations beaucoup moins spacieuses que celles que nous connaissons de nos jours, malgré le fait qu’elles étaient sensiblement plus nombreuses. Il va sans dire que l’ambiance était souvent très animée dans notre maison. Impossible en tout cas de s’éviter ou de s’ignorer mutuellement.
Pourtant, plus le temps passait et plus notre famille grandissait, plus les aînés commençaient à trouver la maison bourrée de défauts : trop exigüe, peu confortable, difficile à entretenir ou simplement pas assez moderne. Pour cette raison, nos parents prirent au début des années soixante la décision courageuse d’en construire une nouvelle sur les terres de notre ferme, à quelques encablures de l’ancienne. Pour maintenir le coût du logement à un niveau acceptable, ils optèrent pour une construction à deux appartements. Les murs de fondation et le plancher du premier étage étaient en béton, les autres parois fabriquées en bois, avec une poutraison agencée en colombages. Les façades étaient couvertes de plaquettes en fibrociment. Le parterre comprenait un garage, une chaufferie, une buanderie, une cave et un atelier de travail. Pour accéder aux appartements, on empruntait un escalier étroit, avec des marches en bois qui craquaient sous les pas. Le premier étage était loué et le deuxième réservé à la famille, famille qui disposait en outre d’un étage supplémentaire aménagé dans les combles. Chaque appartement comprenait une cuisine, une salle de bain, un salon, trois chambres et deux balcons. Dans les combles se trouvaient quatre chambres additionnelles et des toilettes.
La nouvelle maison rénovée (2017)
Le déménagement eut lieu fin 1962. Pour notre famille, il entraînait des changements importants. Au lieu de trois chambres à coucher, nous en disposions désormais de sept, plus une mansarde sous un pan des combles que je m’étais appropriée. Chaque enfant dormait maintenant dans son propre lit. Parfois, quand les frères et sœurs étaient absents, l’un ou l’autre avait même une chambre pour lui tout seul. La maison offrait par ailleurs tous les éléments de confort usuels de l’époque : chauffage central à mazout, eau chaude, machine à laver, salle de bain avec baignoire et douche, WC avec chasse d’eau, cuisinière électrique et frigo. Tout ceci rendit la vie plus facile à notre mère. Grâce au chauffage central, plus personne ne devait se glisser en frissonnant sous les couvertures d’un lit froid, et avec la cuisinière électrique en plus, la corvée de bois était devenue obsolète. Un appareil de téléphone, accroché à la paroi du hall d’entrée, facilitait les contacts avec le monde extérieur.
La construction du nouveau foyer soulignait la séparation entre logement et entreprise agricole qui, du point de vue du revenu, était déjà consommée depuis belle lurette. Financièrement parlant, elle était risquée, mais elle cadrait bien avec l’essor économique qui depuis peu avait commencé à secouer jusque dans ses fondements, telle une tempête de foehn encore jamais vue, un Uri resté profondément paysan, et d’annoncer l’avènement d’une ère complètement nouvelle. Prévoyants, mes parents s’étaient montrés ouverts à ces changements, les avaient même anticipés. Cette attitude devait, à nous les jeunes, faciliter grandement le choix de la voie à suivre. Il nous permettait de nous envoler sur les ailes de la conjoncture vers des destinées totalement différentes du mode de vie traditionnel de nos ancêtres, tous sans exception paysans.
La vente des terres de la ferme en 1970 rendit définitive la rupture avec l’ancien temps. Elle s’exprime notamment par le fait que depuis, dans notre famille, plus aucune personne, ni de ma génération ni de celle de nos enfants ou petits-enfants, n’a opté pour un métier agricole. De ce point de vue, notre famille s’est totalement détournée de l’occupation qui avait été pendant des siècles pratiquement l’unique source de subsistance de nos aïeux. En outre, parmi mes frères et sœurs, seule l’aînée est restée vivre à Uri. Tous les autres se sont établis ailleurs en Suisse. Quant à moi, j’ai passé une bonne partie de ma vie sur différents continents et parmi des populations appartenant à des cultures et parlant des langues étrangères.
Pour moi, la nouvelle maison exprime également, mieux que tout, une coupure marquante dans la trajectoire de ma famille d’origine. Quand je pense à son développement et à sa dynamique internes, je crois distinguer des différences très nettes entre les temps d’avant et d’après. Toutefois, pour notre fratrie, elle aussi appartient désormais à l’histoire. Parce que notre mère y jouissait d’un droit de logement jusqu’à la fin de sa vie, nous avions décidé en 1971, après la mort prématurée de notre père, de l’administrer en hoirie. Après son décès en 2008, la raison de continuer ainsi ayant disparu, nous décidâmes de la dissoudre et de vendre la maison.
Pour moi, l’histoire de ces deux maisons est symptomatique, non seulement des changements que ma famille biologique a traversés au cours de son existence, mais elle caractérise aussi l’évolution de la société dans laquelle nous vivons. Présentement, il n‘y a pratiquement plus rien qui serait resté inchangé à Uri depuis l’époque de mon enfance. Les possibilités de formation, le monde du travail, l’influence de l’Église catholique, la mobilité des gens, la conception des loisirs, les modes de communication, la mentalité et les normes sociales, tout est différent. Tant de choses semblent en mutation, si peu persistent comme avant. Même des témoins matériels qui ont traversé des siècles sont en train de disparaître irrémédiablement. À chacune de mes visites, Uri, le pays de ma jeunesse, m’apparaît un tantinet plus étranger. J’éprouve de la peine à reconnaître dans le Schattdorf aux allures urbaines, avec ses immeubles, quartiers de villas et zones industrielles, le village paysan dans lequel j’ai grandi.
Même de notre ferme toute trace a disparu. Elle a été remplacée par un quartier résidentiel. Si je ne l’avais pas vu de mes propres yeux, je ne pourrais imaginer qu’autrefois y paissaient les vaches de mon oncle et fleurissaient à chaque printemps des douzaines de pommiers, poiriers et cerisiers.
L’auberge du « Brückli » est toujours là, mais comme elle a été rénovée de fond en comble en 1976, peu de choses subsistent de l’ancienne bâtisse. Elle a gardé son nom, mais le minuscule « pont » à côté duquel elle avait été construite et dont elle avait reçu le nom n’existe plus depuis longtemps. Il s’agissait en fait d’un simple dallage en bois, d’à peine deux mètres de large. Sous lui, coulait autrefois un petit cours d’eau appelé « Gangbach ». Sur le pont passait la route du Gothard, un mètre et demi au-dessus du lit du ruisseau, raison pour laquelle la route était obligée de former une légère bosse. Quand le col du Gothard était ouvert, le trafic était intense. Parfois il était si dense que les véhicules n’avançaient qu’au pas. Pendant les sept mois de l’année où il était fermé par contre, la circulation ressemblait à un filet d’eau. En hiver, il était même de coutume d’y réserver une voie aux enfants pour faire de la luge.
Le petit pont lors d’une dernière crue. A droite l’auberge du «Brückli», au fond la vieille ferme (1973).
Rénovation du „Brückli“ (1976). Le petit pont a disparu, la route du Gothard est élargie. À gauche notre ferme.
La plupart du temps, le « Gangbach » n’était qu’un ruisselet paisible. Cependant, après de longues pluies ou des orages violents, ce qui arrivait souvent en été, il pouvait gonfler dangereusement et se transformer en torrent. Raison pour laquelle il était bordé de solides digues qui nous servaient de terrain de jeu. Lors d’intempéries, le petit pont devait être enlevé pour empêcher les éboulis amenés par le torrent de boucher le passage et prévenir les eaux de dévaster les alentours. Aussi longtemps que le danger persistait, la circulation était détournée sur une autre route. Pour nous les enfants commençaient alors quelques jours excitants pendant lesquels le bruit ininterrompu des moteurs en provenance de la route cessait totalement ; il régnait un silence inhabituel. S’il n’avait pas plu de manière continue, nous aurions pu jouer sur la fameuse route du Gothard sur laquelle transitait l’Europe entière. On comprend aisément que cette situation ne plaisait guère aux associations routières et aux autorités qui voyaient de plus en plus le petit pont comme un obstacle au développement du trafic. Au début des années soixante-dix, on décida donc de déplacer le cours du « Gangbach ». Depuis 1974, il emprunte un nouveau lit loin de l’auberge. Du coup, le pont ne servait plus à rien. On fit disparaître la bosse et élargir la route en l’abaissant de deux mètres. Cependant, dans l’intervalle, le bruit du trafic du Gothard s’est également déplacé. Depuis l’ouverture du tunnel routier du Gothard, voitures, camions et motos empruntent, été comme hiver, l’autoroute qui longe la Reuss au milieu de la plaine. Evidemment, la circulation s’est entretemps accrue considérablement. Chaque année, des millions de véhicules roulent maintenant vers le sud et le nord. L’ancienne route du Gothard est réservée au trafic local qui, lui aussi, a augmenté sensiblement.
Mais il n’y a pas que les traces visibles de l’entourage où se passait autrefois notre vie de famille qui sont en train de disparaître. Ma mémoire aussi donne des signes de fatigue. Je dois reconnaître que le vieillissement est un voleur impénitent. Mais alors que ma vie antérieure s’éloigne inexorablement, d’innombrables questions commencent à me tarauder, notamment sur comment mes frères et sœurs et moi-même avons, chacun à sa manière, vécu notre famille au fil des années. Je sens aussi émerger en moi une envie pressante de raviver la mémoire de mes parents. En même temps, je reconnais que je ne sais que peu de choses sur leurs origines et l’univers idéologique dans lequel ils ont grandi, si différent du monde actuel, mais encore très influent dans mon enfance. Par conséquent, je me représente aisément la difficulté que doit avoir la génération de mes enfants à se faire une idée des conditions de vie qui régnaient au temps de ma jeunesse, d’imaginer par exemple comment on peut grandir avec une fratrie aussi nombreuse et dans un contexte où les conduites étaient encore gouvernées par la tradition.
Voilà pourquoi j’ai décidé d’essayer de lutter contre l’oubli en redonnant corps aux souvenirs que je peux encore ressusciter, afin de les préserver de l’érosion qui les guette et de les conserver vivants pour ceux qui viendront après moi, de me remémorer les racines familiales, émotionnelles et idéologiques que mes parents nous ont transmis parce qu’ils voulaient qu’on devienne « des gens bien ». De me souvenir de ce qu’ils m’ont offert afin que je puisse voler de mes propres ailes. De me demander quel rapport j’ai entretenu avec ces racines au cours de mon existence, et jusqu’où les ailes m’ont porté.
La famille dont je raconte l’histoire, pour unique qu’elle soit, était une famille très ordinaire, du moins presque. Des centaines et des milliers de semblables existaient alors en Suisse centrale. Ce qui explique qu’elle a toujours mené une existence discrète, à l’abri de la grande histoire dont elle reflète pourtant les péripéties. Elle a été façonnée par elle comme elle a contribué, à sa mesure, à la façonner. Cet aspect me fascine au point que j’en ai fait le fil rouge de mon récit en veillant à mettre constamment en parallèle la trajectoire de la famille et l’évolution de son environnement économique et social. Mon histoire n’a donc rien d’une fiction, même si occasionnellement elle fait appel à un brin de fantaisie pour donner couleur à tel ou tel détail. Toutefois elle est clairement subjective parce qu’elle est d’abord un voyage vers moi-même. C’est moi qui orchestre la trame de la narration, c’est moi qui guide le lecteur et la lectrice à travers le dédale de la souvenance.
Je me hâte cependant d’ajouter qu’il ne s’agit pas uniquement de mes propres réminiscences. Je n’aurais pas pu écrire ce livre en me fiant exclusivement à elles. Pour une part, le récit dépasse souvent mon histoire personnelle. En plus, j’ai quitté mon foyer familial assez jeune, donc je n’ai pas pu assister à tous les événements que je relate. Mais j’ai eu la chance de grandir avec de nombreux frères et sœurs et une vaste parenté dont je n’ai pas hésité à solliciter la mémoire pour compléter et corriger la mienne. Il m’a aussi été nécessaire de consulter des archives dans l’espoir d’y trouver une réponse à telle ou telle question qui me tarabustait. Finalement, je me suis plongé avec délectation dans la collection de photos laissée par ma mère. C’est à toutes ces sources que je puise, tâchant d’en restituer ce qui me paraît être la « substantifique moelle », avec un regard empreint de tendresse, mais sans nostalgie excessive.
2
Jusqu’à ce que la mort les sépare
Pourrait-on imaginer moment plus solennel pour commencer une biographie de famille que son acte fondateur ? Car si, à première vue, le 13 mai 1937 était un jour semblable à tous les autres, jeudi avant la Pentecôte, pour mes parents et leur descendance, il restera à jamais marqué d’une pierre blanche.
C’est en effet ce jeudi que Dominik Arnold et Marie Imhof, mes futurs parents, ont choisi pour se rendre ensemble tôt le matin, à l’église paroissiale de Schattdorf qui trône majestueusement au-dessus du village à la lisière de la forêt. Consacré en 1733, le sanctuaire impressionne par sa silhouette blanche et élancée visible loin à la ronde. Autrefois, il était un lieu de pèlerinage populaire. Construite en style baroque, l’église abrite notamment un maître-autel surmonté d’un retable remarquable, œuvre du fameux sculpteur sur bois valaisan Jodok Ritz. L’artisan y a intégré une statue en gothique flamboyant, vestige de la petite église précédente, qui représente le couronnement de la Mère de Dieu. Autrefois, les croyants lui attribuaient des pouvoirs miraculeux et vinrent en nombre prier la Vierge Marie pour qu’elle intercède en leur faveur, comme vont le faire ce 13 mai 1937 Dominik et Marie. Cependant ils ne sont pas venus en pèlerins, mais pour accomplir un rite qu’ils n’accompliront qu’une seule fois dans leur vie. Devant Dieu et la Sainte Église, ils veulent se donner leur consentement mutuel à se prendre pour mari et femme.
À vrai dire, ils n’étaient pas seuls à se marier. À leur côté, il y avait un autre couple, le frère aîné de Marie et sa fiancée. Autrefois, ce genre de mariage à plusieurs était fréquent. Il permettait d’en partager les frais. En revanche, il est tout-àfait possible que les quatre se fussent retrouvés seuls avec le prêtre, à moins que quelques paroissiens désireux d’assister au premier office du matin aient également été présents. Mais plus personne n’est là pour me le confirmer. Les registres paroissiaux attestent en tout cas que les deux couples n’étaient pas accompagnés de témoins, ils se contenteront d’officier l’un pour l’autre. L’union était bénie par le curé. Après le « oui » de consentement, les jeunes mariés échangèrent les alliances qu’ils porteront désormais toute leur vie ; bien des années plus tard, ma mère portait également celle de son époux décédé, comme le voulait la tradition. En souvenir du mariage, le curé leur remit ensuite un document commémoratif signé de sa main, décoré d’une photo sur laquelle on reconnaît l’église du village et au fond les montagnes enneigées qui surplombent Schattdorf. Elle est encadrée par un Christ style Art Nouveau un peu kitsch qui ouvre largement ses bras, un ange tenant sur ses genoux le Saint Enfant et une représentation des noces de Marie et Josef. Au-dessous, des lettres solennelles annoncent : « En mémoire du Saint Sacrement de mariage ». Nos parents conserveront soigneusement ce document.
En ce qui concerne leur âge respectif, Marie et Dominik formaient une paire inégale. À vingt-huit ans, Dominik était en âge de se marier. Marie par contre n’avait que dix-huit ans et demi, elle n’était donc pas encore majeure. Tous les deux étaient originaires du Schächental. Selon les papiers officiels ils étaient bourgeois du même village, Spiringen. Ils habitaient aussi dans la même commune. Toutefois, Dominik n’était venu qu’il y a peu de temps s’établir à Schattdorf pour s’occuper de la ferme que son père venait d’y acquérir. Près de celle-ci, les parents de Marie possédaient le petit domaine « Kleinried », complété par un mayen dans la commune d’Erstfeld, haut perché au-dessus de la plaine de la Reuss. C’est sur ces deux propriétés que Marie avait passé les premières années de sa vie.
Le document de mariage
J’ai de bonnes raisons de penser qu’ils s’étaient rencontrés pour la première fois deux ans auparavant, grâce à la sœur de Dominik qui l’avait suivi à Schattdorf pour s’occuper du ménage. Pendant un court laps de temps elle avait fréquenté l’autre marié, le frère de Marie, suffisamment longtemps en tout cas pour permettre à Dominik de faire la connaissance de sa très jeune et jolie sœur. Apparemment, l’attraction était partagée, du moins assez pour que la décision mûrisse lentement chez les deux jeunes gens d’unir leurs destins et de fonder une famille.
Au début de 1937, ils avaient entrepris les démarches nécessaires pour concrétiser cette alliance. Ils avaient frappé à la porte de l’office d’état civil de Schattdorf pour annoncer leur projet et le faire publier dans la feuille d’avis du canton. Évidemment, le couple avait aussi été chez le curé pour se faire instruire. Selon la tradition, celui-ci avait ensuite, trois dimanches de suite, lors de l’office principal, rendu public la promesse de mariage du haut de la chaire et prié l’assistance de lui faire connaître tout obstacle éventuel à l’union. Manifestement, personne ne l’avait rendu attentif aux liens de consanguinité lointains qui caractérisaient les fiancés, liens qui auraient pourtant, selon les normes du droit canon encore en vigueur, exigé le dépôt d’une demande de dispensation. En effet, dans l’ascendance de Dominik et de Marie figure un couple d’ancêtres communs. Pour conclure, les deux fiancés comparurent lundi 10 mai 1937 devant le représentant de la commune pour la cérémonie du mariage civil.
Pour l’État, mes parents étaient donc déjà mari et femme ce matin du 13 mai 1937. Mais pour eux, ce mariage civil était un détail négligeable. Tous les deux avaient été élevés dans la foi catholique. Seul leur importait le « je le veux » à l’église. Pour rien au monde ils n’auraient renoncé à la bénédiction divine, d’autant plus que cela aurait été vécu comme un faux-pas terrible par toute la population. Cependant, le mariage à l’église conférait aux noces un aspect sacré et intangible. Le consentement des époux devant l’autel d’unir leurs destins pour le meilleur et pour le pire et de se soutenir mutuellement quoiqu’il arrive jusqu’à la mort, était un serment à ne pas prendre à la légère. En ces temps, pour ceux qui le prononçaient il était encore inimaginable qu’autre chose que la mort puisse rompre le lien. L’Église catholique n’enseigne-t-elle pas que ce que Dieu a uni, nul homme ne le sépare ? Ce qui de nos jours n’est qu’une simple déclaration d’intention revêtait encore un caractère irrévocable. Pour les mariés d’alors, divorcer plus tard était tout bonnement impensable, et peu d’entre eux se décideront un jour à le faire quand-même.
À l’époque, le mois de mai était déjà un mois de mariage privilégié. En 1937 sa réputation de printemps des amours n’était pas surfaite. Tout au long de ce mois il régna un temps particulièrement radieux, à tel point que la récolte de foin se termina inhabituellement tôt. Seul le jour du 13 faisait exception en montrant un visage maussade. Toute la journée, des trombes d’eau tombaient du ciel. Si, comme le dit le proverbe, mariage pluvieux signifie mariage heureux, l’union de Marie et Dominik fut donc placée sous les auspices les plus favorables !
En tout cas, le mauvais temps n’altérait en rien la bonne humeur des futurs époux. Ils étaient décidés à célébrer dignement et dans les formes « le plus beau jour de leur vie » où ils allaient quitter la communauté des célibataires pour rejoindre le cercle des mariés. Pour eux, il aurait été impensable de sauter dans leur tenue de travail immédiatement après le détour à l’église, comme tant d’autres le faisaient encore. Pour marquer l’événement, les deux couples avaient loué auprès d’un garage une voiture avec chauffeur qui vint chercher Marie et son frère au « Kleinried ». Pour rejoindre la route du Gothard depuis la ferme, l’automobile devait d’abord suivre un cours d’eau, puis le traverser sur un petit pont. Pour effectuer la manœuvre, la voiture était forcée de faire un virage très large, la poussant à quitter le chemin et à empiéter sur le pré saturé d’eau. Ce qui devait arriver arriva : la voiture s’embourba. On fut obligé d’aller chercher une vache pour la tirer d’affaire.
Après la cérémonie à l’église, toute la compagnie se retrouva pour un repas de fête chez les parents Imhof. Le père avait exprès donné l’ordre de tuer un veau. Les yeux de ma mère brillaient chaque fois qu’elle nous racontait ce détail. Pour elle c’était la preuve manifeste que son père avait un faible pour elle et était un homme particulièrement généreux. Mais Josef et Marie étant les deux premiers enfants qu’il mariait, aurait-il eu un autre choix que de mettre les petits plats dans les grands ?
Pendant le repas de noces, le salon où se déroulaient les agapes était plein à craquer. Après les festivités, le couple entama sa lune de miel en allant passer trois jours à Madonna del Sasso au-dessus de Locarno, un geste de plus qui souligne à quel point il leur tenait à cœur de donner à leur mariage un côté festif. Car à l’époque, faire un voyage de noces était encore le privilège de gens fortunés. Il n’était pas seulement coûteux financièrement, Dominik avait aussi dû trouver quelqu’un pour s’occuper du bétail pendant son absence.
Un rendez-vous qu’ils n’auraient voulu manquer sous aucun prétexte était le passage au studio du photographe pour la traditionnelle photo de mariage. Joliment encadrée, celle-ci sera, bien visible, fièrement accrochée au mur de notre salon. Je l’ai toujours regardée avec émotion. Pour moi, elle est un document d’époque magnifique. Elle m’apparaît comme un livre plein de messages secrets qui ne se dévoilent que petit à petit, fruits d’une lecture attentive.
Les deux jeunes mariés y prennent visiblement une pose soigneusement étudiée. Cet homme à la physionomie svelte portant un costume noir élégant, un nœud papillon, des souliers laqués brillants, un chapeau posé en toute décontraction à hauteur du genou, une petite fleur coquette (est-elle naturelle ?) à la boutonnière, un mouchoir blanc dans la pochette de la veste, est donc mon père. Il a fière allure, fixe l’appareil d’un regard clair (devine-t-on ses yeux bleus ?), sérieux, calme et satisfait. Est-ce qu’on lui donnerait ses vingt-huit ans ? Oui, sans doute à cause de son front dégarni et de sa chevelure blonde coiffée en arrière, déjà un peu clairsemée.
La photo de mariage
Debout à côté de lui se tient ma mère vêtue d’une robe noire et simple que les mariées portaient alors et qui s’arrêtait juste au-dessus des chevilles. Elle servira plus tard d’habit du dimanche. Dans les cheveux de ma mère, une couronne gracile à peine visible fixe un léger voile blanc qui descend derrière son dos jusque par terre. Voile et couronne attestent que la personne qui les porte est encore vierge, ce qu’on attendait naturellement d’une mariée. Celle qui osait les porter après avoir perdu sa virginité risquait de s’exposer à d’humiliants blâmes publics. La grande gerbe de fleurs (prêtée par le photographe ?) que maman porte dans la saignée du bras droit et le petit nœud blanc dans sa main confèrent à l’image une note solennelle. Sa chevelure noire est sobrement coiffée, juste une raie décente qui la partage en deux. Ses souliers brillent également, la plus petite poussière en a été enlevée. Son visage paraît moins sérieux que celui de son mari, j’ai même l’impression d’y deviner un léger sourire. Elle semble être un peu plus petite que son conjoint. Mais j’ai de la peine à voir en elle la femme presque gamine qu’elle était encore en vérité.
Pourtant, son très jeune âge avait été un problème pour Marie. Ma mère insistera plus tard inlassablement sur ce point chaque fois qu’elle revenait sur ses épousailles. Si elle avait été seule à décider, elle aurait attendu encore un peu, mais notre père aurait fortement insisté pour qu’ils se marient. Les deux n’avaient donc pas été d’accord sur ce point. Y avait-il eu d’autres différents entre eux ? Rien en tout cas que ma mère trouvait digne d’être mentionné. Nous les enfants, par contre, avons souvent ressenti des différences entre nos parents, pas seulement d’âge, mais aussi concernant leur caractère. Par les contacts que nous entretenions avec la parenté, nous devinions que ces différences n’étaient pas seulement une affaire de personnalité. Bien que mon père et ma mère aient grandi dans des milieux paysans assez semblables et sur des fermes à peine séparées d’une vingtaine de kilomètres, le contexte dans lequel ils avaient été élevés et l’éducation qu’ils avaient reçue divergeaient sensiblement. Les rapports qu’ils entretenaient avec leur père respectif, en particulier, semblent avoir joué un rôle capital dans leur développement personnel. Alors que ma mère adorait son père, les sentiments que nourrissait mon père envers le sien étaient plus mitigés, malgré tout ce qu’il lui devait.
3
L’univers des grands-parents
Authentiques paysans à l’ancienne
De tous mes aïeux, je n’ai connu que mes grands-mères avec qui j’avais peu de contact. Les grands-pères étaient déjà décédés lorsque je suis né.
Mais d’une certaine façon mon grand-père paternel m’était quand-même familier, du moins en avais-je l’impression. Sa nombreuse descendance voyait en lui une figure hors du commun, on en parlait comme d’un personnage de légende. Secrètement, j’en étais fier. Ce grand-père se nommait Dominik Arnold. Il était né en 1858 dans une belle ferme de montagne sise au lieu-dit « Getschwiler », à une altitude de mille trois cents mètres sur le territoire de la commune de Spiringen. Son berceau se trouvait donc au fond du Schächental, au pied du col du Klausen qui relie Uri à Glaris. Aujourd’hui, les voyageurs parcourent la vallée sur une jolie route panoramique, mais à l’époque il n’existait que des sentiers muletiers sur lesquels les éleveurs conduisaient leurs troupeaux vers les riches pâturages de l’Urnerboden, de l’autre côté du col.
Le petit Dominik était l’aîné de Peter et Anna, elle aussi une Arnold. Dans le canton d’Uri, ce patronyme est étroitement as