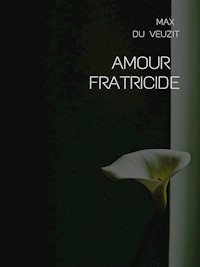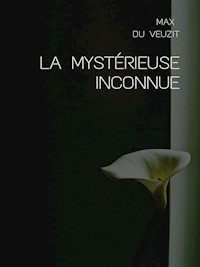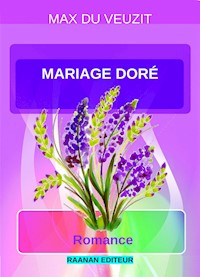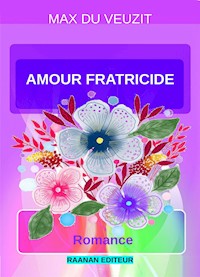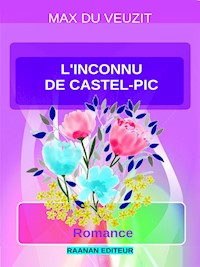1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Raanan Editeur
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
De graves événements m'obligent à m'éloigner de France", annonce à sa femme Gys de Wriss, prince d'Ampolis, peu de temps après son mariage. Gys n'est jamais revenu au foyer. Il ignore la naissance de sa fille Gyssie, la mort de sa femme. Bilan de cette longue séparation : un ménage détruit, une tombe, un berceau. Gyssie, à dix-huit ans, aidée dans ses démarches pour retrouver son père par Alex Le Gurum, le découvre en Hollande. Aux reproches de sa fille qui l'accuse d'avoir fui ses responsabilités, Gys de Wriss répond : "Que venez-vous me parler d'amour paternel ? A votre âge, quel poids peut-il avoir pour vous qui serez poussée vers un autre être pour une vie nouvelle? J'ai fait de vous une fille de prince. N'est-ce pas suffisant ? Voulez-vous de l'argent?" Sous l'outrage, Gyssie jette le cahier de confidences de sa mère au visage de celui qui la renie. " Tenez ! lisez cela. Vous comprendrez peut-être... " Il reste à Gyssie l'amour d'Alex. Mais cet amour-là est-il sincère ?...|Librairie Jules Tallandier|
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
SOMMAIRE
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
Notes
MAX DU VEUZIT
FILLE DE PRINCE
Paris, 1935
Raanan Éditeur
Livre 1048 | édition 1
Fille de prince
À Mohamed Zouari, caïd,
en affectueux hommage.
M. du V.
Ce récit n’est pas entièrement œuvre d’imagination. Il repose sur un fait absolument authentique : un mariage que contracta, en toute confiance, dans une légation inconnue, une jeune fille de bonne famille.
Tous les noms de lieux, de races ou de personnages ont naturellement été changés.
Je m’excuse de ne pouvoir donner plus de précisions, tous les héros de ce petit drame vivant encore à l’heure actuelle.
M. du V.
I
Dans l’air lumineux, encore frais à cette heure matinale, la cloche de la vieille église tinta allègrement.
Lorsque la dernière vibration se fut éteinte, la porte de bois patiné par les ans tourna sur ses lourdes ferrures et, sous le porche sombre, apparut la claire silhouette d’une blonde jeune fille vêtue de blanc.
Celle-ci était grande et souple avec des yeux d’un bleu limpide et le teint éblouissant des Nordiques.
De toute sa personne se dégageait un parfum de fraîcheur, de vie saine et d’ardente jeunesse. Pourtant, son regard en cet instant semblait voilé de mélancolie.
On était au matin du 18 juillet et Gyssie de Wriss, princesse d’Ampolis, pour célébrer son vingtième anniversaire, venait d’entendre la messe dans cette humble église d’un vieux village breton.
Derrière elle, une paysanne âgée avait, à son tour, franchi le porche du saint temple.
Arrêtée une seconde, pour permettre à la femme de la rejoindre, la jeune fille promena son regard grave sur l’enclos funéraire dont elle connaissait tous les recoins.
– Il semble qu’il y ait de la tristesse dans l’air, aujourd’hui, murmura-t-elle pensivement.
– Oh ! ma princesse, protesta sa compagne. Le soleil brille derrière la brume... Et, de même que rien ne peut ternir l’éclat de la jeunesse en fleur, aucune pensée ne doit assombrir réellement ton front de vingt ans... Un si bel âge !... Tourne tes regards vers l’avenir, ma princesse.
Gyssie ne répondit pas.
Une sensation d’isolement s’appesantissait sur elle en ce jour commémoratif où elle allait s’agenouiller sur la tombe de celle qui était morte de lui avoir donné la vie, vingt ans auparavant. Elle songeait aussi que le seul cœur qui pût battre à l’unisson du sien était celui de la vieille Bretonne qui l’accompagnait. Mais toute la tendresse de la chère vieille pouvait-elle compenser le manque de baisers d’une vraie maman ?
Le petit cimetière rustique, fleuri entre ses dalles de pierre, comme un jardin bien entretenu, entourait l’église selon la séculaire coutume de nos villages français.
Sans avoir besoin de se consulter, la jeune fille et la vieille femme se dirigèrent ensemble, par les allées étroites, vers une tombe de granit, soigneusement parée de fleurs nouvelles.
Ensemble, elles se recueillirent, graves et silencieuses, devant la grande pierre funéraire allongée sur le tertre et sur laquelle était gravée cette inscription :
Ci-git
Madame Gys de Wriss
Princesse d’Ampolis, Duchesse de Marzon
Née Valentine Chauzoles
Morte dans sa vingt-deuxième année,
munie des sacrements de l’Église.
In pace.
Les yeux de Gyssie se remplirent de larmes en relisant le nom bien-aimé de la jeune mère qu’elle n’avait pas connue. C’était une émotion plus douce que vraiment triste... un regret sans amertume... quelque chose qu’elle exprima à mi-voix, pour elle-même :
– Ma petite maman... ma pauvre petite maman de vingt et un ans... nous avons presque le même âge, elle autrefois et moi maintenant... Vois-tu, Mamie, ajouta-t-elle en s’adressant à la vieille paysanne, c’est étrange : lorsque je pense à ma mère, – et j’y pense bien souvent ! – je ne peux me la représenter que comme une toute jeune femme, presque une enfant comme moi... Il me semble que c’est une sœur que j’ai perdue... une sœur que j’aurais tant aimée !
– C’est vrai, répondit la Bretonne... elle était si jeune, si douce et si confiante... une enfant comme toi, en effet.
– Je lui ressemble, n’est-ce pas ?
La vieille femme regarda intensément la jeune fille et secoua doucement la tête :
– Peu, dit-elle. Tu as le même sourire et tu as la même intonation de voix... Souvent, je crois entendre la chère Madame. Mais tu ne lui ressembles pas. Tu es plus grande et tu es blonde... sans doute comme...
Elle s’arrêta soudain. Ce fut Gyssie qui continua simplement :
– Comme mon père.
Et elle soupira.
Son père ! Elle ne le pleurait pas comme un mort, puisque rien ne prouvait qu’il fût décédé ; mais qu’était-il de plus ou de moins, en vérité ?
Gyssie ne le connaissait pas... Elle ne l’avait jamais vu.
Lui-même semblait ignorer encore qu’il possédait en France une enfant, fruit de son mariage, une fille qui portait son nom et qui, tous les jours, priait Dieu de le ramener auprès d’elle.
Et Gyssie, entre la tombe de sa mère et la pensée d’un père si lointain, soupira de nouveau, car elle se sentait doublement orpheline.
– Ah ! mamie, fit-elle avec émotion, je n’ai plus que toi sur la terre. Tu es tout ce que je possède comme affection... C’est marraine et toi qui avez été vraiment toute ma famille ; mais elle est partie, elle aussi ! Je n’ai plus que Mamie qui m’a élevée... ma bonne Mamie qui ne m’a jamais quittée et à qui, cependant, je ne suis unie par aucun lien du sang.
– Je t’ai reçue à ta venue au monde, est-ce que ce n’est pas un lien suffisant pour que tu sois vraiment ma fille ?
Spontanément, Gyssie se pencha vers sa nourrice et l’embrassa ; puis, câlinement, elle se suspendit à son bras.
– J’ai beau être grande, j’aime encore m’appuyer sur toi, bonne amie, expliqua-t-elle. Tant que je t’aurai, je ne serai pas réellement seule.
Cependant les deux femmes sortaient du cimetière et s’engageaient sur la route. Elles eurent vite fait de traverser le village de Coatderv, qui n’est pas très grand et dont le vieux nom breton signifie le « bois de chêne », justement parce qu’il s’allonge, comme un étroit ruban, à la lisière d’une forêt de chênes séculaires.
Le chemin, ombragé de grands arbres, conduisant au manoir de Kerlan, passait devant une petite maison paysanne, isolée du reste du bourg et qui semblait inhabitée depuis longtemps.
Devant cette masure, la jeune fille retint sa compagne et dit :
– Entrons à Ty-Coz, Mamie... Puisque c’est aujourd’hui mon anniversaire, je veux revoir l’endroit où je suis née.
– Bien volontiers, ma Gyssie, répondit la vieille femme, un peu émue de cette demande. J’avais prévu ton désir : j’ai la clef sur moi... entrons donc !
La serrure grinça et il fallut pousser bien fort les deux battants de la porte, le bois étant gonflé par l’humidité. Ty-Coz, « la vieille maison », ne recevait pas tous les jours la visite de sa propriétaire, Marie-Yvonne Guillou, la vieille femme justement qui avait élevé Gyssie et que celle-ci nommait affectueusement « Mamie ».
L’air, dans la grande et unique pièce du rez-de-chaussée, conservait cette légère odeur de fumée et de suie mouillée spéciale aux maisons rustiques, même lorsque le foyer est éteint depuis longtemps.
– Il y a dix-neuf ans que c’est inhabité. Malgré ses murailles épaisses, Ty-Coz commence à être fort délabrée, observa Maryvonne avec un soupir de regret devant les méfaits du temps.
– Quand je serai riche, Mamie, je la ferai remettre à neuf et nous aurons une belle maison.
– Oh ! protesta la nourrice. J’espère bien que plus tard tu habiteras le palais de ton père, ma princesse.
– Ça ne m’empêchera pas de revenir me reposer ici... Comprends bien, bonne amie, que, quoi que l’avenir me réserve, je n’oublierai jamais le lieu où je suis née et où j’ai grandi auprès de vos deux chères affections... Coatderv, c’est marraine et toi... vingt années heureuses et sans souci... Puisse le reste de ma vie ne pas être inférieur à ce passé si doux...
– Que le Ciel t’entende, ma jolie !
II
Par la porte ouverte, le soleil illumina gaiement tous les coins de la chambre, faisant reluire la nacre des coquillages rangés sous les armoires en guise d’ornement, disposition qu’on rencontre quelquefois en Bretagne, dans les maisons soignées, afin que les dessous des meubles apparaissent nets et propres, autour du sol de terre battue.
Gyssie s’était assise sur le coffre en bois de châtaignier qui servait de banc, au coin de la cheminée, en face du lit principal qu’elle fixait d’un œil un peu pensif.
– C’est donc là que je suis née, murmura-t-elle. C’est là que ma petite maman, si peu de jours après ma naissance, s’est endormie de son dernier sommeil.
De nouveau, une émotion profonde se traduisait dans sa voix lente. Cependant, son regard pensif s’attardait sur l’oreiller où la chère tête maternelle avait dû reposer.
– Ma maman !... jusqu’à son dernier souffle, c’est là qu’elle a dormi, pensa-t-elle encore à haute voix.
– Allons, mon petit, chasse ces idées sombres.
Mais Gyssie ne l’entendit pas. Elle continua de fixer le lit clos.
– Personne, depuis elle, n’y a couché, n’est-ce pas ?
– Non, bien sûr ! Une vraie princesse l’avait occupé... une autre y était née ! C’était sacré !... Moi, d’abord, je préférais l’autre couchette... celle du fond de la pièce... Toi, on t’avait mise au bas de l’armoire... Elles sont si profondes, nos armoires en Bretagne, qu’elles peuvent abriter un bébé.
Un nouveau silence au bout duquel Gyssie tourna la tête et avec un frisson regarda la table. Cette longue table sur laquelle toute la maisonnée prend ses repas, tous les jours ; mais cette même table sert aussi, selon la coutume bretonne, à dresser les lits funèbres pour la veillée des morts.
– C’est là qu’elle fut exposée, balbutia-t-elle. Face à mon armoire. D’un côté la vie et, de l’autre... Ah ! comme c’est atroce de partir si jeune en laissant un bébé derrière soi.
– Allons, allons, Gyssie ! Qu’est-ce que ça veut dire d’avoir des idées pareilles ? Une fleur pousse, une autre se dessèche... C’est la vie ! Nul n’y peut rien et il faut s’y résigner : Dieu fait bien ce qu’il fait !
La femme parlait simplement, bien qu’un peu contrariée. Son fatalisme breton qui lui faisait accepter si religieusement et si raisonnablement les événements, bons ou mauvais, ne pouvait comprendre les réflexions démoralisantes de celle qu’elle avait élevée.
Mais Gyssie n’était pas une Bretonne de pure race et sa résignation, malgré les années écoulées en ce coin de primitives coutumes, n’arrivait pas à se mettre à l’unisson de celle de sa vieille compagne.
Cependant, habituée depuis l’enfance au respect de sa nourrice, elle ne proféra pas d’autres paroles décourageantes et s’efforça, au contraire, de prendre un ton plus enjoué :
– Ma maman !... C’est aujourd’hui que je vais enfin vraiment la connaître... J’ai tant attendu ce jour, Mamie... J’espère que tu n’as pas oublié ?
– Bien sûr que non, je n’ai pas oublié ! répondit Maryvonne, presque indignée de la supposition. Je vais accomplir tout à l’heure la promesse que j’ai faite à celle qui a eu confiance en moi... C’est un grand jour pour toi, ma petite princesse. Tu vas pouvoir lire aujourd’hui tout ce que notre chère Madame a écrit à ton intention... Il y en a un gros cahier... et aussi des photos, des papiers d’état civil, des bijoux... J’entends toujours ta pauvre maman me dire de sa voix faible : « Maryvonne, je compte sur vous pour donner ces pages à ma petite Gyssie, le jour de ses vingt ans. »... Elle avait écrit les dernières lignes un matin qu’il lui semblait être plus forte... Elle faisait même des projets, ne se croyant pas si malade... Et, le lendemain, elle était partie... Que le bon Dieu la repose !
– Et ces choses que tu dois me remettre, elles sont ici, Mamie ? questionna, soucieuse, Gyssie après un silence douloureux.
– Non, ma fille, j’ai tout emporté quand ta marraine a voulu que nous allions demeurer au château. Le coffret est chez nous. Rentrons maintenant et je te le donnerai.
– Oui, allons ! fit la jeune fille, un peu sombre.
En silence, elles gagnèrent leur logis.
Quelques instants après, Maryvonne remettait à Gyssie un humble coffret de bois blanc.
– Le cahier de ta maman est là-dedans... Je n’y ai pas touché... tel que ses faibles mains ont noué le nœud qui scelle les pages, tel il est resté. Tu trouveras aussi dans le fond de la boîte tous les papiers qui te concernent et ceux de la chère dame, avec les modestes bijoux qu’elle possédait... Vois-tu bien, Gyssie, toutes ces choses m’ont paru sacrées et d’une grande valeur pour toi. Je te les ai conservées précieusement. À toi d’en prendre soin à présent... N’oublie pas que personne ne pourrait reconstituer ces documents si tu les égarais.
– Ne crains rien, ma bonne. Ces reliques me sont aussi précieuses qu’à toi.
Gyssie prit la boîte de bois avec une sorte de respectueuse ferveur et, serrant contre sa poitrine le trésor qui lui était confié, elle l’emporta au château, afin d’être bien seule dans la chambre qui, depuis des années, lui avait été personnellement réservée, à côté de celle qu’occupait alors sa marraine.
Assise devant le coffret posé sur la table, elle resta d’abord un moment sans bouger.
Une émotion poignante la dominait et, pour la surmonter, elle demeurait les mains jointes, les yeux au loin, dans une sorte de silencieuse prière.
Par la fenêtre, largement ouverte en ce beau jour, la jeune fille avait devant elle le parc dans toute sa profondeur, avec la longue ligne de chênes trois fois séculaires qui le limitait dans son pourtour.
À sa droite, auprès de la grille d’entrée, se dressait le petit pavillon qu’elle habitait avec Maryvonne.
La maison principale, le pavillon et le parc, c’était toute la vie de Gyssie... ses vingt ans n’avaient jamais eu un autre horizon.
Et voici que du petit coffret de bois blanc allait jaillir tout un monde qu’elle ignorait... une famille, peut-être ?... bien des choses qu’elle ne soupçonnait pas, tout au moins !
Alors, pensivement, avec une sorte de timidité, elle ouvrit la boîte.
Un modeste cahier d’écolier, ceinturé d’un ruban rose, apparut à ses yeux angoissés.
D’une main qui tremblait, Gyssie le prit délicatement.
« Personne ne l’a ouvert depuis que ta mère en a noué le ruban », avait dit Maryvonne.
L’enfant, le cœur serré, se pencha vers le cahier et posa longuement ses lèvres sur le nœud inviolé.
Ce cahier que, pendant de longues années, personne n’avait touché, ce cahier qui n’avait subi que le contact des mains maternelles, conservait tout son magnétisme. Il était vraiment pour Gyssie quelque chose de sa jeune mère... quelque chose de vivant, de tangible... comme un peu de sa chair qu’elle aurait frôlée.
– Ma petite maman... ma pauvre petite maman de vingt ans...
Malgré les années écoulées, elle avait l’impression de baiser les doigts maternels et deux lourdes larmes roulaient sur ses joues pâles...
Gyssie, la petite princesse orpheline, pour la première fois de sa vie, prenait contact avec les siens...
――
Entre la couverture et la première page du cahier, un feuillet avait été ajouté, avec ces mots tracés d’une écriture tremblante :
« Pour ma fille, ma Gyssie bien-aimée, afin que le jour où elle aura vingt ans elle connaisse la pauvre maman qui n’aura pu prendre soin de son enfance sur la terre, mais qui, de plus haut, continuera à veiller sur elle et à l’aimer. »
Gyssie, ayant lu les premières lignes, s’arrêta. Les yeux brouillés de larmes, elle essayait d’évoquer, au fond de sa pensée, la figure de la chère disparue dont une photographie agrandie ornait la tête de son lit.
Dans son silencieux recueillement, il lui sembla qu’une voix très douce, au fond de son cœur, – « une voix qui ressemblait à la sienne », comme avait dit Maryvonne, – lui murmurait tout bas :
– Lis, maintenant...
Alors, Gyssie surmonta son émoi, essuya ses yeux et lut cette sorte de testament :
« 17 février. – C’est pour toi, mon enfant, que je ne connais pas encore, que je veux écrire l’histoire de ma vie. Je suis si seule, à présent, sur la terre !...
« Je n’ai plus rien, ni parents, ni amis, ni mari, hélas ! près de moi... Rien pour me réconforter que ta fragile petite vie, mon enfant, que je sens s’éveiller en mon sein... que mon amour pour toi qui déjà remplit mon cœur !
« Et j’ai peur, parfois... Une étrange angoisse me saisit... Si mon Gys, mon mari bien-aimé, tardait trop à revenir... si mon petit prince (car ce sera un petit garçon) arrivait avant le retour de son père... et si moi, trop faible, je venais à lui manquer ?
« Mais non, courage !... Je dois avoir du courage !...
« Je suis un peu malade, ce soir. Le silence de la nuit m’impressionne, et c’est peut-être pourquoi je pense, en cet instant, à tant de choses tristes.
« Mais je ne dois pas, je ne veux pas me laisser aller à de pénibles pressentiments. Je dois et je veux être forte pour deux !
« J’ai déjà vu tant de choses, tant de souffrances, en moi et autour de moi, qu’il me semble difficile de croire au bonheur. Mais puisque j’ai triomphé jusqu’ici de la malchance, je saurai encore supporter cette attente, cette solitude et toutes les difficultés qui peut-être suivront.
« Mon amour pour mon cher mari et pour notre enfant me soutiendra. La rédaction de ce journal que j’entreprends m’aidera à passer les heures si longues de l’attente...
« Valentine de Wriss,
« Princesse d’Ampolis. »
Je suis née à Lyon, dans la grande ville austère et calme où le soleil voilé de brume ne rit pas tous les jours.
Et mon enfance, elle aussi, ne connut guère de sourires.
J’étais l’unique enfant de mes parents qui n’étaient déjà plus jeunes, lors de ma venue au monde. Ma mère en avait eu la santé fort ébranlée et elle resta, paraît-il, continuellement souffrante depuis ce jour-là jusqu’à celui où elle mourut. J’avais à peine deux ans quand ce malheur arriva et je n’ai pu en garder aucun souvenir.
La nourrice elle-même n’était pas restée à la maison. Elle était retournée avec son mari dans une ferme que mon père possédait à la campagne et dont il avait confié le soin à ce ménage.
Cette brave femme m’aimait beaucoup et je peux dire que les seuls moments heureux de mes premières années furent ceux des séjours que j’ai faits à sa ferme, durant les mois d’été.
C’était la liberté, le soleil, le grand air. Et c’était surtout un peu de tendresse, de gros baisers et de petites gâteries dont j’avais si grand besoin.
À vrai dire, je ne me rappelle bien nettement que les dernières vacances passées auprès de la brave femme. Je pouvais avoir six ou sept ans.
J’avais dû arriver à la ferme au commencement de l’été, au temps des cerises. Je vois encore les arbres du verger chargés de fruits rouges et délicieux. Quelles bonnes parties j’ai faites, cette année-là, avec les deux enfants de Nounou : ma sœur de lait Marguerite et Gaston, l’aîné ! À Lyon, j’étais toujours solitaire dans la grande maison silencieuse ; il ne serait jamais venu à l’idée de mon père qu’une petite fille puisse avoir besoin de sauter, de rire et même de crier avec des êtres jeunes comme elle. Je n’avais donc jamais joué avec d’autres camarades de mon âge.
Aussi, la ferme de Nounou me semblait-elle être un vrai paradis. Marguerite était douce et gentille. Elle était âgée d’un an de plus que moi, ce qui lui faisait prendre au sérieux un rôle de sœur aînée, si bien qu’elle me gâtait autant que le faisait sa mère.
Gaston était plus turbulent, mais il possédait une imagination débordante lorsqu’il s’agissait d’inventer des jeux.
Je voudrais m’attarder sur ces souvenirs joyeux... les seuls, hélas ! que garde ma mémoire... Mais le bon temps allait finir cette année-là pour ne plus revenir jamais !...
Je ne me rappelle pas avoir manqué de quelque chose chez ma nourrice. Il y avait toujours en abondance une saine alimentation, du lait chaud, des œufs frais, du beurre exquis et des fruits délicieux.
J’étais lavée soigneusement chaque matin et mon linge était toujours bien lessivé. Mais la brave femme avait fort à faire, elle ne pouvait nous surveiller toute la journée et, dame ! le soir, en revenant de nos expéditions dans la campagne ou de nos ascensions dans les arbres, nous étions plus ou moins poussiéreux et dépenaillés. Les ronces ont tant de malice !
Et c’est ainsi que le malheur arriva...
Par une fin d’après-midi, mon père arriva à l’improviste.
Nounou était à la laiterie et son mari aux foins.
Père ne trouva donc personne à la ferme, ce qui, sans doute, commença à le mettre de mauvaise humeur. Il alla jusqu’au petit bois où, sous l’inspiration de Gaston, nous étions en train de jouer aux sauvages.
Je me rappelle chaque incident de cette journée qui fut la dernière que je passai à la ferme.
Nous avions enlevé nos tabliers pour en faire des turbans ; les entremêlant de feuilles de fougères, nous cherchions à imiter les coiffures de plumes des Peaux-Rouges.
C’est en cet appareil, avec un jupon déchiré, des égratignures sur les bras et la figure amplement barbouillée de mûres, que je me présentai à M. le juge au tribunal civil !
Un monstre ne lui aurait pas causé plus d’horreur. Mais l’horreur de mon père était glacée comme tout ce qui venait de lui ; elle ne se manifesta que par un silence lourd d’orage pendant qu’en ma compagnie il remontait vers la ferme.
J’ai eu, à ce moment, mon pauvre petit cœur bien serré. Un pressentiment semblait me dire que mon frêle bonheur d’enfant allait finir. Je crois que c’est à cette minute-là que j’ai fait la première expérience de ce que peut être un chagrin véritable.
Instinctivement apeurée par la venue inattendue de mon père et par son air mécontent, j’errais tristement autour de la maison où Nounou et son mari étaient enfermés avec lui.
J’entendais sa voix nette et coupante, alternant avec les explications confuses du ménage.
Quelques mots me parvenaient :
« Désordre, enfant mal tenue, mal soignée, maladie, danger... »
Puis, il y eut un silence assez long, après lequel ma nourrice vint me chercher.
Elle avait les yeux rouges.
Me conduisant dans ma chambre, elle me revêtit de ma robe du dimanche.
Elle ne pouvait parler, mais elle m’embrassait bien fort ; et moi, je la regardais, très inquiète, avec une grosse envie de pleurer.
Cependant, lorsqu’elle se mit à faire un paquet de mes petits vêtements, elle ne put retenir ses larmes, ce qui fit jaillir les miennes.
– Ma Vali... ma chère petite fille que je vais perdre, disait-elle en me prenant dans ses bras et en me serrant sur son cœur maternel.
La voix impérieuse de mon père, appelant du bas de l’escalier, coupa nos épanchements et nous fit descendre bien vite.
Dans la grande salle, les deux hommes se tenaient debout. Le visage du juge semblait inflexible et glacial, alors que le front du régisseur était barré d’un pli soucieux.
Sur la table, il y avait des papiers épars et un gros registre noir.
– Viens, Valentine, dit mon père.
Il voulut me prendre la main, mais je me dégageai pour courir me réfugier dans les jupes de la fermière.
– Nounou ! Nounou ! ne me laisse pas partir. Je ne veux pas te quitter.
Tous sanglotaient, moi plus fort que les autres.
Mon père fronçait le sourcil devant mes pleurs qui semblaient blâmer sa décision...
C’est ainsi que j’ai quitté les seuls êtres qui m’aient témoigné de la tendresse et donné du bonheur.
Je ne les ai jamais revus.
J’ai su, depuis, que mon père était venu ce jour-là examiner les comptes de la ferme et que son indignation de me trouver loqueteuse et barbouillée avait coïncidé avec la constatation de quelques irrégularités dans la tenue des livres.
J’ai toujours supposé que lesdites irrégularités étaient involontaires et que le pauvre fermier, presque illettré, n’en était pas plus responsable que sa femme ne l’était de ma tenue de sauvageonne.
Mais c’étaient des choses que mon père ne pardonnait pas !
Ces braves gens furent renvoyés. On mit à leur place un autre métayer et je ne retournai plus jamais à la ferme.
J’ai insisté un peu longuement sur cet épisode de mon enfance ; d’abord parce qu’il eut une grande importance pour moi et de graves répercussions sur ma petite existence ; ensuite, parce qu’il montre, sous son jour le plus typique, le caractère autoritaire de mon père.
Austère et dur pour lui-même, il l’était autant, sinon plus, pour les autres. Je ne me rappelle pas avoir vu sur son visage une marque d’émotion quelconque et s’il lui arrivait de sourire, – oh ! bien rarement ! – c’était avec amertume ou ironie.
Dans toute sa vie, privée ou publique, et vis-à-vis de moi comme de tout le monde, il était « Monsieur Chauzoles », juge au tribunal civil !
C’est tout dire…
――
Ce fut à partir de ce moment, c’est-à-dire vers sept ans, que je commençai à me rendre compte de tout ce qui me manquait et à en souffrir plus ou moins consciemment.
La grande maison n’était pas gaie ! Il semblait que la présence de cet homme grave et dur pesait sur tout et sur tous d’un poids oppressant.
Les deux femmes qui nous servaient étaient bien stylées. Tout était en ordre et leur travail était fait d’une façon automatique et impeccable, bien que l’une fût déjà vieille et sans entrain.
Heureusement, Marine, la femme de chambre qui s’occupait maintenant de moi, était dans la maison depuis longtemps. Elle avait connu ma mère.
C’est peut-être ce qui contribua à l’attacher un peu à cette pauvre petite chose abandonnée que j’étais à cette époque. Elle n’aurait pas osé rire ou chanter dans notre sévère demeure, mais elle me soignait consciencieusement et je lui dois d’avoir été une petite fille proprement entretenue, élégante même, et bien portante.
Marine, en vérité, occupa toute mon enfance abandonnée. Je l’aimais pour elle-même, mais aussi parce qu’elle savait raconter de belles histoires. Je l’aurais écoutée durant des heures entières, car lorsqu’elle le voulait bien, Marine pouvait me narrer des choses merveilleuses.
Elle avait été placée, dans sa jeunesse, chez un meunier dont le Ciel avait particulièrement béni l’union. Dix enfants leur étaient nés et, sur les aventures de cette nombreuse nichée, Marine était intarissable. Dix enfants ! Combien cela était captivant pour moi, pauvre gosse isolée, qui n’en voyais jamais aucun ! C’étaient, paraît-il, des enfants très bien élevés et les histoires de Marine avaient presque toujours un but de « bon exemple », sauf lorsqu’il s’agissait du petit Marcel qui était le mauvais sujet et le petit diable de la bande !
Et c’était naturellement lui et ses farces qui m’intéressaient plus que tout !
Il était taquin, malicieux, insupportable, mais que n’aurais-je pas donné pour connaître un petit Marcel avec qui j’aurais joué... et même avec qui je me serais chamaillée quelquefois !
――
Vers cette époque, mon père intervint encore une fois dans mon existence pour décider qu’il était temps de commencer mon instruction.
Naturellement, il ne voulait pas m’envoyer à l’école communale ; tout son snobisme et ses hautes prétentions bourgeoises s’y opposaient.
Pourquoi ne me mit-il pas en pension ? Je ne l’ai jamais su et ce point est resté un profond mystère pour moi, car je ne pense pas qu’il eût pu trouver un plaisir quelconque à me garder auprès de lui.
Il choisit donc un cours privé, tel que pouvait le choisir M. le juge Chauzoles ; c’est-à-dire le cours le plus étroit, le plus sombre et le plus sévère de la froide ville de Lyon. Ce fut cependant là que je passai les meilleurs moments de mon adolescence.
C’était le contact avec des êtres jeunes, avec des fillettes de mon âge. Et l’émulation ajoutait à l’intérêt de l’étude.
Il y eut aussi cet attrait de curiosité d’un cerveau d’enfant privé de toute distraction. J’aimais les livres avec une vraie passion et, dès que je pus lire, je me jetai sur tous ceux qui tombèrent sous ma main.
Heureusement, ce goût ne déplaisait pas à mon père, et comme sa bibliothèque austère ne contenait aucun ouvrage frivole ou dangereux pour la jeunesse, il ne songea jamais à m’en interdire l’accès. Je lui en suis vraiment reconnaissante.
――
Cependant, les années se succédaient et mes études s’achevaient.
Je venais de passer mon brevet supérieur. Le cours ne conduisait pas plus loin et j’entrevoyais avec terreur les mois qui allaient venir et la maison triste où je serais prisonnière auprès d’un père de plus en plus sombre, taciturne et sévère.
Nous en étions arrivés à ne presque plus nous adresser la parole.
Les repas, que nous prenions en tête à tête, étaient rapides et silencieux. Mon père dédaignait, sans doute, d’engager une conversation sérieuse avec une « petite fille » et moi, complètement paralysée par cette froideur, je ne me sentais plus le courage de faire aucune avance.
Par ailleurs, je n’avais pas d’amies. Les jeunes filles que j’avais connues au cours n’avaient jamais été que des compagnes de travail que je ne fréquentais pas en dehors des heures scolaires. Enfin, l’attitude glaciale de mon père avait éloigné de chez nous celles qui s’étaient risquées à venir me voir.
D’un autre côté, je n’avais pas le droit de sortir seule.
Mon père m’autorisa cependant à faire une visite d’adieu à Mlle Harland, la directrice de mon cours.
Je la connaissais depuis longtemps, mais très imparfaitement.
Elle paraissait parfois, dans les classes, un peu majestueuse et presque imposante. Elle fixait sur nous un regard profond, scrutateur, qui nous intimidait un peu ; je n’aurais pas osé lui parler la première.
Ce jour-là, elle me reçut avec une cordialité qui me surprit agréablement. J’étais déjà « une ancienne », c’est-à-dire une amie plutôt qu’une élève.
Elle me parla de mes succès aux examens et de la satisfaction que j’avais donnée à mes professeurs ; j’avais toujours été notée, en effet, comme une très bonne élève.
– Le travail ne me coûtait aucun effort, répondis-je en toute sincérité ; l’étude était pour moi la meilleure distraction.
Je sentis son regard profond se poser sur le mien ; mon ancienne directrice comprenait plus de choses que je ne lui en disais.
Elle me demanda à brûle-pourpoint :
– Et maintenant, que comptez-vous faire, Valentine ?
Une détresse infinie dut se lire dans mes yeux car, sans me donner le temps de répondre, elle ajouta d’une voix très douce :
– À votre âge, mon enfant, il faut se créer une occupation utile, un but dans la vie. La fin des études laisse un grand vide, généralement ; il faut le combler... J’ai pensé à quelque chose pour vous...
– Quoi donc, mademoiselle ?
Elle sourit de la hâte avec laquelle j’avais posé cette question et expliqua :
– Une de mes bonnes amies a fondé ici, l’année dernière, sous le patronage de la Croix-Rouge, un dispensaire-école où des jeunes filles bien élevées, comme vous, vont faire des études d’infirmière... Notre pays a besoin de femmes sachant soigner les enfants et les malades, car nos œuvres publiques ne suffisent pas toujours à leur tâche...
Mon cœur se mit à battre, plein d’espoir. Mon visage s’éclairait. Allait-elle donner un but à ma misérable vie ?
Elle continuait, justement :
– Est-ce que cela vous plairait, Valentine, d’occuper ainsi vos loisirs ?
– Oh ! oui !
Je ne pus ajouter autre chose ; j’étais émue et ravie. La directrice reprit :
– Vous allez avoir dix-huit ans. Trois ans d’études vous conduiront à votre majorité. Si ces cours vous intéressent, je peux vous faciliter les formalités d’admission. Il faudrait le consentement de votre père.
Toute ma joie tomba d’un coup.
– Alors, c’est impossible, murmurai-je, déçue.
– Pourquoi donc ? Je suis sûre que M. Chauzoles ne me le refusera pas, à moi. Voulez-vous me laisser arranger cette affaire, ma petite Valentine ?
– Oh ! mademoiselle, vous feriez cela ?
Sans réfléchir, d’un élan spontané, je me jetai dans les bras de cette excellente femme dont je découvrais soudain le cœur généreux et délicat.
――
L’intervention de Mlle Harland réussit parfaitement.
Son âge, sa situation respectée de tous, peut-être même les palmes académiques qui ornaient son corsage, tout inspira confiance à mon père qui la connaissait depuis longtemps. Il accorda son consentement.
C’était une vie nouvelle qui commençait pour moi, une véritable libération !... Ces trois années furent les plus douces que j’aie vécues à Lyon, puisqu’elles m’éloignèrent de cette austère maison paternelle.
La maison ? J’y vivais bien peu, maintenant.
Dès le matin, je partais seule pour le dispensaire, car Marine ne traînait plus comme une ombre languissante derrière moi.
Je me rappelle combien je marchais allègrement dans l’air frais de ces matins d’automne ! J’éprouvais la joie d’une prisonnière qui a recouvré la liberté.
Chez moi, je ne voyais plus mon père qu’aux heures des repas.
J’étais parfois si animée par mon travail et l’excitation de ma nouvelle vie, que je me laissais aller à lui parler de mes occupations, de mes projets et même de mes idées.
Il me regardait alors avec étonnement, comme s’il était surpris d’entendre une petite fille lui tenir des propos de grande personne. Il me répondait tout de même, mais avec un air si supérieur que j’en étais de nouveau glacée et que le silence retombait entre nous.
Mais je ne m’en attristais plus. Aussitôt le déjeuner terminé, je filais comme une flèche vers mon cher dispensaire.
III
Les deux dernières années me parurent encore meilleures que la première. Elles furent surtout plus libératrices et m’habituèrent à penser et à agir par moi-même.
Je fis mon premier stage dans un hôpital assez loin du centre de Lyon et, pendant trois mois, je ne pus rentrer déjeuner à la maison.
Mlle Harland avait dû intervenir une nouvelle fois auprès de mon père, afin que je pusse manger à une cantine universitaire où se retrouvaient des étudiants et des jeunes filles comme moi.
Tous et toutes étaient de bons camarades. Le repas n’était pas fameux, mais l’atmosphère était si gaie, si cordiale, que je ne pensais même pas à ce que j’avalais. Quelle différence avec la somptueuse et triste salle à manger où j’avais passé des heures si mortellement ennuyeuses !
Le retour chez nous, le midi, après ces trois mois de déjeuner à la cantine, me parut d’autant plus pénible.
Mais ma résolution était prise : je ne voulais plus rester à la maison ! Dès que j’aurais obtenu mon second diplôme, je ferais comme quelques-unes de mes camarades, j’irais à l’hôpital-école où l’on pouvait être interne et où je demeurerais, à mon tour, comme monitrice.
C’est ce que j’exposai, avec courage, à mon père, le lendemain du dernier examen, que j’avais passé avec succès.
Il m’écouta avec son air glacial et, lorsque j’eus fini, il me dit d’un ton sans réplique :
– Je ne donnerai pas mon consentement à cette nouvelle fantaisie.
– Pourquoi me refuseriez-vous, père, ce que vous m’avez accordé jusqu’à présent ? dis-je en faisant un gros effort pour vaincre ma timidité.
– Jusqu’à présent, il s’agissait d’études faites sous la direction de Mlle Harland que je connais. Ces études te plaisaient et je n’ai pas voulu t’en priver. Puisque cela t’amusait d’obtenir ce diplôme, je t’ai laissée faire. Une jeune fille de notre monde peut passer des examens, même plus ou moins bizarres, mais il est inadmissible qu’elle utilise les diplômes ainsi obtenus. Tu ne seras pas infirmière dans un hôpital.
Il eut ce sourire amer et sardonique que je lui avais vu parfois et il s’exclama :
– Infirmière !... La fille d’un juge au tribunal civil de Lyon ! Infirmière !... Voyez-vous cela !
Je fus épouvantée de la vie qui m’attendait. La peur de cette existence solitaire me donna l’audace de discuter son refus.
– Père, il n’y a rien à faire à cela ! C’est ma vocation ; je désire être infirmière.
– Ta vocation ! s’écria-t-il en haussant violemment les épaules. Sais-tu seulement ce que c’est, pauvre petite, qu’une vocation ?
Il s’était levé.
Appuyé des deux mains sur le bord de son bureau, me dominant de toute sa haute taille, il articula lentement en appuyant sur chaque syllabe :
– Ta vocation est de rester dans la maison de ton père et d’y attendre le mari qu’il te choisira. À tout autre absurde projet, je dirai : non ! non et non !
Je sentis un désespoir et une révolte farouche monter en moi. Je dus serrer les lèvres, afin de ne laisser échapper aucune parole irrespectueuse pour celui qui était tout de même mon père.
– Jamais ! jamais ! répéta-t-il avec colère.
J’eus ce courage de ne rien répondre et de sortir du bureau paternel sans retourner la tête.
Dehors, j’éclatai en sanglots...
――
La situation était devenue bien difficile pour moi.
Après la scène que j’avais eue avec mon père, j’étais allée voir Mlle Harland.
J’étais décidée, puisque j’allais avoir vingt et un ans quinze jours plus tard, à attendre cette date de ma majorité et à passer outre à la défense intransigeante qui m’était faite.
J’en parlai à Mlle Harland qui hocha la tête et me déconseilla une telle désobéissance filiale.
Elle ne pouvait pas savoir à quel point la maison paternelle était intolérable pour moi et elle essayait de me convaincre de renoncer à mon projet.
– Songez, ma chère enfant, à la situation où vous allez vous mettre vis-à-vis de votre père : ce sera la rupture complète, vos deux vies séparées, sa vieillesse solitaire et votre propre avenir compromis !
– C’est lui qui l’aura voulu, dis-je, le cœur serré. Je ne demande qu’à aimer mon père, mais il repousse ma tendresse aussi bien que mon désir de dévouement.
– Tout cela est bien triste, ma pauvre petite, et je ne vois pas le moyen pratique d’arranger les choses. Personnellement, je ne puis vous aider contre votre père. Par ailleurs, il vous est impossible, actuellement, d’aller dans l’hôpital où vous désiriez entrer, il n’y a plus une seule place de monitrice disponible, on me l’a assuré, hier encore.
C’était le coup de grâce, et je faillis perdre courage. Je me ressaisis cependant, tant mon désir de travailler était grand. Tout valait mieux que l’existence dans cette sombre maison, près de cet homme si dur qui n’avait pas un cœur de père.
– Je réfléchirai, dis-je avec un calme apparent.
Mes réflexions étaient toutes faites. Pour agir, cependant, il me fallait attendre cette fameuse majorité.
Les enfants qui vivent heureux auprès de leurs parents ne savent pas ce que ce mot de « majorité » représente d’espoirs et de pensées libératrices pour ceux qui sont opprimés. J’écris ces lignes en 1916, mais je suis sûre que, dans quinze ou vingt ans, les jeunes générations connaîtront de moins cruelles et de moins tyranniques obligations filiales.
J’étais parfaitement décidée à partir pour Paris ; aussi, pendant les quinze jours qu’il me restait à attendre, rassemblai-je en cachette mon mince bagage et pris-je toutes mes dispositions pour ce départ.
J’avais un peu d’argent bien à moi, mon père m’ayant, au cours de mon enfance, donné chaque semaine de petites sommes auxquelles je n’avais pas touché.
Mlle Harland fut navrée de ma résolution quand je la mis au courant.
Elle ne pouvait, ouvertement, me donner raison contre mon père ; ce qui ne l’empêchait pas de regretter que j’en fusse réduite à cette extrémité d’un départ clandestin.
Cependant, ne voulant pas m’abandonner à mes propres moyens, elle m’écrivit un mot de chaude recommandation pour la directrice d’un hôpital franco-américain qu’elle connaissait particulièrement, et ce fut cette dernière qui me donna une place, peu de temps après mon arrivée à Paris.
――
Avant de m’éloigner de Lyon et de la maison où s’était écoulée toute mon enfance, j’écrivis cette lettre à mon père :
« Mon père,
« Je dois vous quitter, le cœur serré de partir sans votre consentement. Je suis navrée d’être obligée d’agir ainsi contre votre désir, mais j’ai peur de continuer à vivre l’existence inutile que je mène à Lyon.
« J’ai vingt et un ans, et je vous fais observer très respectueusement que je suis en âge de disposer de mon sort. Mon plus cher désir est de me créer une situation qui me permette de suffire à mes besoins. J’aurais été heureuse que vous m’en facilitiez les moyens. Or, vous vous refusez à m’aider. Je ne peux sacrifier ma vie, ni ce que je considère comme une impérieuse vocation, à votre volonté.