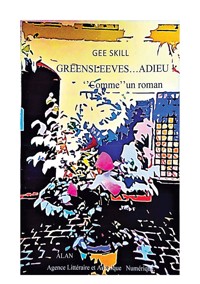
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Publishroom
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Französisch
A L’occasion d’un énième déménagement, la narratrice Geneviève Audet-Lambert , Enseignante - chercheuse en pédagogie et documentation, retrouve vingt-cinq cahiers étalés de 1969 à1989 contenant des réflexions, des lettres de ses amis, surtout celles de son amie Polonaise Janina Medynska et de son compagnon Henri van Wentzinger écrivain, éditeur, critique d’Art tous disparus ainsi que de nombreux articles de presse relatant les évènements joyeux et les drames qui ont déferlé sur le monde pendant toutes ces années jusqu’à la chute du mur de Berlin. Au fur et à mesure elle revit sa vie dans toutes ces villes. Paris, Genève, Aix-Les-Bains, Annemasse et la rencontre avec un’ ’Juste’’ le frère Raymond Boccard. Puis, Angers et l’Enseignement Catholique. Ses nombreux voyages autour du monde comme guide accompagnatrice de la compagnie Wagons-Lits Cook tandis qu’Henri voyage lui avec La Marine à bord du mythique Porte-hélicoptères Jeanne d’Arc ’’La Jeanne’’. La Grande Dame en Noir, allégorie puissante symbolise tous les deuils traversés, plus ou moins accompagnés par l’ancien chant mélancolique Greensleeves qui revient comme un leitmotiv et sert de Requiem universel. On entre aussi dans les arcanes des vies professionnelles, dans les combats acharnés pour la sauvegarde des œuvres d’Art en péril partout dans le monde, dans les voyages du pape Jean-Paul II et dans la naissance de SOLIDARNOSC en Pologne. Et tant d’évènements oubliés !
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 310
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Couverture
Page de Tire
Gee Skill
GREENSLEEVES… ADIEU !
“Comme” un roman
Volume 1
Danses de la vie…
Coquillages que les marins ramènent à la maison… Comme les lignes de nos vies incertaines et entreroisées.
ALAN /Agence Littéraire et Artistique Numérique
ISBN 978-2-38625-373-7
Le Code de la propriété intellectuelle interdit les copies ou reproductions destinées à une utilisation collective. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite par quelque procédé que ce soit, sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit, est illicite et constitue une contrefaçon, aux termes des articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
L’histoire commence le 11 Mai 1969 à 9h30, dans l’ascenseur et dans l’escalier monumental du hall d’entrée de la Librairie Armand Colin* 103 Boulevard Saint-Michel. Paris 5ème. Elle s’arrête le 15 Octobre 2009 à 15 h 30 à l’église Saint-Séverin. Paris 5ème.
Première Vague : 1969-1989.
Volume 1.
“Une prière amie nous suit au-delà de ce monde,
Un souvenir pieux prononce encore notre nom,
Mais, bientôt le ciel et le terre ont fait un pas,
L’oubli descend, le silence nous couvre,
Aucun rivage n’envoie plus sur notre tombe
La brise éthérée de l’amour.
C’est fini, c’est à jamais fini,
Et telle est l’histoire de l’homme dans l’amour”…
Lacordaire*
39ème conférence de Notre-Dame de Paris (1846)
In Memoriam
In Memoriam
A mes chers parents.
Au frère Raymond Boccard “Juste”.
A Ollivier Ceyrac
A Hubert Comte.
A Hentiette Coursier.
A Jean-Paul II
A Antoine Léon.
A Sabina et Anthony Mallet
A Adrian Marino
A Janina Medynska.
A Elizabeth Potocka
A Rose et Anthony Radziwill
A Colinette et MariusVauthier
A tous mes amis disparus.
PREMIER TOUBILLON
Tourbillons pétrifiés, vis sans fin,
Tournoiements comme des coquillages …
Nos projets.
NAISSANCE D’UN ECRIVAIN PHILOSOPHE
Dans la cour d’un immeuble ancien de la Rue de Seine* à Paris*, derrière une porte cochère à deux vantaux en bois peint de couleur vert foncé, se trouve une sorte de petit arbre extraordinaire qui attire les foules crédules et incrédules à chaque début du printemps.
Ce camélia planté dans un grand pot de zinc vieilli mais inaltérable, au milieu d’une vieille cour pavée à l’ancienne, produit désormais des fleurs en forme d’ancre marine bleues et or, et des pompons rouges de béret de marin, mais, attention, certaines fleurs violettes parmi les plus belles ont des pouvoirs magiques. Moi seule en connais la cause, le secret, le langage et le mystère. Je vais vous raconter cette histoire.
Un poète un peu prestidigitateur et magicien à ses heures, a habité ici pendant cinquante ans. Il y a planté des rêves, élevé des papillons, merveilleux bijoux éphémères, les plus beaux du monde et les plus rares. Comme le marquis de Goulaine*, il recevait chaque jour du monde entier, chenilles et chrysalides si bien que chaque matin était un nouveau printemps, propice à toutes sortes d’émerveillements. Il a écrit plus de cinquante livres, beaucoup dessiné, parfois gravé et sculpté avec les outils des meilleurs graveurs et sculpteurs qu’il admirait. J’ai traversé des centaines de fois cette cour sur les ailes d’un autre messager divin, celui que Lakmé*, appelle “le dieu de la jeunesse, le dieu du printemps…celui qui nous protège par ses baisers ardents, par qui s’ouvrent les calices et les roses chaque jour, le dieu de la jeunesse, le dieu de l’amour”.
L’amour et le monde tout entier étaient présents dans l’appartement biscornu, sous la forme de tissus indiens tendus au-dessus du lit, de bouddhas du Gandhara*, et du Tibet*, d’un tambour tibétain, de masques de tous pays, de statuettes de toutes cultures. De quoi rêver à l’infini et à l’éphémère, au temps, à la durée, aux traces laissées par les hommes au moyen de l’Art et de ses outils, qui nous survivent et nous transcendent.
C’était un endroit légendaire à plus d’un titre. Autrefois à cet emplacement, se situaient un hôtel et un bistrot nommé “Chez Constant”* où les chantres de la “bistrologie”* venaient échanger leurs savoir boire, et leur savoir écrire : Robert Giraud*, dit Bob, le copain de Doisneau* et tant d’autres, les fondateurs de la revue “Bizarre”*
Henri les connaissait, car il s’intéressait à l’argot et au vin, donc aux “écrivins”*… A quoi ne s’intéressait-il pas ? Sa curiosité de touche-à-tout, était universelle, elle s’arrêtait seulement à la porte des nouvelles technologies, si bien qu’il ne savait pas ce que les “subtils poignardeurs”* écrivaient à propos de lui quand il exposait “Face à face” masques et “Ready-made”* à la galerie Flak*, rue des Beaux-Arts*.
Pourtant le contenu des blogs et de certains sites Internet qui parlaient de lui, le stupéfiaient comme par exemple http://www.lepoignardsubtil.hautefort.com/tag.
Le “papier lumière” n’était pas de son monde. On aurait dit qu’il avait deux cerveaux.
Touche-à-tout éclairé et cultivé, savoir encyclopédique, son sens de l’observation lui faisait repérer, illico, des détails révélateurs et fondamentaux, aussi bien chez les gens que dans les œuvres d’Art.
Il en prenait connaissance uniquement parce que je lui en procurais “la version papier”, seul support valable selon lui, depuis le passé le plus reculé, et certainement jusqu’à la fin des temps civilisés. C’était pour lui une évidence et une facette affichée de sa philosophie personnelle. C’était aussi une forme de logique prophétique de sagacité populaire et de bon sens : les écrits restent. Le papier sera toujours là, alors que la lumière fugitive s’effacera inévitablement. Ne serait-ce qu’une grande panne générale… Cher dinosaure !
Il semblait vraiment avoir deux cerveaux. C’est très difficile à expliquer. Il avait une intelligence paradoxale rapide, hypersensible, à fleur de cortex, et une intelligence pratique développée à l’extrême, une adresse sans égale qui s’appuyait sur le lien essentiel entre la main (les mains) et le cerveau, en passant par l’outil, mais, certainement pas par Internet. “Il faut savoir habiter ses mains. A la fin, quand tout aura disparu les hommes redevenus sages, redécouvriront la merveille que furent et que sont les outils.” disait-il d’un air grave. C’était le sujet de la thèse de doctorat de philosophie qu’il avait soutenue, après la mort de son Père, et une longue et douloureuse période de chômage aussi inattendue qu’injuste. Ce fut une période noire de sa vie, que nous traversâmes ensemble. Les malheurs se succédaient, les grands malheurs très rapprochés les uns des autres, je l’aidais de mon mieux. Que faire devant la douleur de l’autre ? On se sent si impuissant, tellement inutile. Son tempérament bouillonnant, son caractère impétueux, son sens aigu de la répartie, sa faconde bourguignonne et “presque” méditerranéenne, son humour décapant, ses “bonnes manières”, son rire communicatif, sa délicatesse naturelle, en faisaient un convive très recherché, bien que parfois redouté dans certains dîners parisiens où je n’aurais pas passé une heure. De surcroît, il était fin gourmet. Il aimait capter l’attention de son auditoire et pour cela, ne reculait devant aucun subterfuge, à la limite de la prestidigitation. Il était pédagogue, sans lourdeur didactique, partageur, passionné, ardent, et un peu cyclothymique.
Il trouvait des clés pour tout, et il les emmenait avec lui. Sa nature curieuse, avide, originale, l’avait mené sur les terrains les plus diversifiés et les plus insolites autour du monde, avec ou sans la Marine, comme il aimait à le dire, jeune et simple matelot à bord du “Cassard” et plus tard à bord de “La Jeanne” !
Pas un chantier archéologique majeur, pas un musée, même le plus modeste, ne lui avaient échappés. Chaque maillon de la chaîne humaine le passionnait, depuis l’origine des temps. L’outil le plus simple mène à la main qui le manie. La main mène à l’ouvrier, à l’agriculteur, au peintre, au grand Léonard de Vinci*, au sculpteur, au plus grand des sculpteurs : Michel Ange*. Ensuite il suffit d’observer et de partager et les outils et l’Art de tous les temps et de tous les pays. S’arrêter devant un tableau, un dessin exécuté de la main gauche ou de la main droite, ce n’est pas la même chose. S’arrêter devant une sculpture, en faire le Tour, la regarder sous des lumières différentes, observer un tableau en détail, de près, de loin, par morceaux. Admirer les monuments, les protéger de l’usure naturelle et des destructions par l’homme. Tous ces artistes qui nous ont laissé tant à voir, méritent qu’on leur consacre un peu de notre temps. Parfois ils y ont laissé leur santé et même leur vie : Modigliani* ou van Gogh*, et tant d’autres. Que serait notre quotidien sans l’Art ?
Pour l’Art, nous étions d’accord et combattions ensemble sans nous lasser, on nous appelait “les Croisés”, mais, Henri et moi avions des conceptions très opposées du mariage, quand la question fut évoquée entre nous.
J’avais mis plusieurs années à sortir d’une difficile histoire d’amour avec un ingénieur Anglais de quinze ans mon aîné, divorcé avec deux enfants. J’avais vingt-deux ans à l’époque. Il était mon premier grand amour, sans compter les amours enfantines et adolescentes. Pressée par mes trente ans, je souhaitais désormais avoir rapidement un premier enfant et “construire un foyer” dans la fidélité réciproque, et la solidarité de toute une vie, avec la bénédiction de l’Église et de mes parents, sur un socle solide, dans ce monde mouvant.
Illusion ? Sottise ? Rêve ? Erreur ? Habitude ? Idéal ? Imagination ? Folie ? Chimère ? Innocence ? Naïveté ? Étrangeté ? Utopie ? Mascarade ? Comédie ? Poésie ? Ineptie ? Lubie ? Nostalgie ? Convention ? Coutume ? Pari ? Intérêt ? Écran ? Commodité ? Paravent ? Pacte ? Sacrement ? Henri, célibataire convaincu, avec ses quarante-trois ans, et ses projets artistiques d’écriture, de dessin et de sculpture, s’imaginait mal en futur “bon père de famille”. Il ne voulait pas d’enfant, surtout pas d’enfant. Cela venait de loin. Il soutenait qu’il tenait à moi, mais qu’un mariage avec enfants à la clé, ne pourrait pas marcher alors qu’un mariage intelligent, merveilleux, fantastique dans la liberté réciproque serait l’œuvre de notre vie. Un mariage avec la liberté en prime, comme des oiseaux libres, lui semblait être un chemin assuré vers le bonheur… “Des oiseaux libres”, surtout pas de cage et plusieurs oiseaux… Nous n’avions pas la même conception de la liberté dans le mariage. La fidélité physique lui semblait une utopie, pire, une mutilation. Excellent sémanticien ; pour lui, dans sa pensée et dans son langage, infidélité se disait : “naturelle diversité”. Mieux valait être prévenue avant, ou être d’accord sur le fond et sur les formes. C’était honnête et cela avait le mérite de la clarté. C’est ce qu’il proclamait pour se protéger et sous l’influence de l’épopée de Gilgamesh dans laquelle il s’était plongé corps et âme, pour une traduction en français, d’après le texte en anglais établi par la grande N.K. Sandars dans la version de 1972.Il se méfiait de toutes les cages potentielles, de tous les enfermements possibles, de toutes les situations contraintes, qui risqueraient de le mettre en situation de faiblesse ou de dépendance. Les demi-dieux volent comme des oiseaux libres, ils ne supportent ni filet, ni cage, ils volent. Le mariage risquait-il de ressembler à une cage ? Quand le moment se présenta de faire des choix, Il fallut se mettre d’accord sur les modalités. Je n’y arrivai pas. J’étais fidèle par nature, en amour et en amitié, et j’attendais la réciproque, sur tous les plans. Sa “ naturelle diversité” englobait bien des domaines, mais ne pouvait pas s’appliquer selon moi, aux lois et à l’esprit du mariage. Nous nous étions rencontrés six ans auparavant, lors de l’inauguration du musée Vasarely* au château de Gordes* dans le Vaucluse*, où Henri devait faire une partie des discours de clôture. Il avait montré l’intelligence du choix d’un tel lieu : Une demeure ancestrale qui menaçait de tomber en ruine, si le maire du village, Justin Bonfils*, n’avait eu l’idée astucieuse de mettre ce lieu historique à disposition de l’Art, Victor Vasarely*, acceptant d’en assurer la restauration. Scellant ainsi l’alliance entre le passé, le présent et le futur, la demeure seigneuriale de la Renaissance, accueillait la modernité avec un peintre visionnaire.
Mon Père avait participé aux éclairages spéciaux, avec des procédés de “lumière noire” et autres effets. Henri, rentrait de Stockholm*, parce qu’il venait d’écrire une série d’articles sur Giacomo Balla* peintre Italien futuriste, et de publier un livre consacré entièrement au tableau de “L’Automobile-lumière”*(1912), magnifique exemple de l’Art cinétique, exposé au Muséum d’Art Moderne de Stockholm*. Son discours montrait les points communs entre les deux peintres : Balla* et Vasarely*, et aussi les différences. Nous avions fait le voyage de retour vers Paris* ensemble dans le même train. Le train est un allié des conversations révélatrices, et des confidences. Merci à ce train.
J’avais appris ce jour-là, l’essentiel sur le caractère d’Henri, ses aspirations, ses passions, ses combats, et même ses haines, du moins, je le croyais, mais j’étais bien jeune pour soupçonner la complexité de cet homme hors du commun, dont nul ne pouvait faire le Tour. Il avait ainsi organisé sa vie, en hiérarchisant les facettes qu’il voulait dévoiler aux uns et cacher aux autres de telle sorte que nul ne puisse se targuer de le connaître ou de retracer sa vie. C’est une manière de se protéger, tant qu’on peut tout maîtriser.
Cette façon de vivre simultanément plusieurs vies, et une foule de personnages, est fascinante pour celui qui la vit, et, parfois pour ceux qu’il rencontre, mais gare aux dérapages non contrôlés, et aux déraillements. C’est à dire qu’il faut être doté de toutes les qualités du caméléon, animal, très intelligent, qui capte si bien la lumière. Henri était habile, rusé, adroit, délicat, volontaire, persévérant, et séduisant en diable. Il lui fallait aussi nécessairement être doté d’une bonne mémoire et d’une excellente santé pour assumer son personnage.
Par la suite, nous nous croisions de temps en temps, lors de réunions de travail chez tel ou tel éditeur, dans des congrès, des salons du livre à Paris, en province : à Nancy, * au Mans*, mais aussi à Francfort*, à Madrid*, à Genève*, à Londres*. Chez John Murray*, 50 Albemarle Street, où nous déjeunions parfois ensemble, avec Valerie Ripley*, responsable des droits étrangers avec laquelle nous avions tous deux plusieurs projets d’édition.
Nos comptes bancaires étaient souvent “dans le rouge”. Il collectionnait des monnaies gauloises et grecques très belles, très rares et très ruineuses, des tableaux, des dessins, des estampes des photographies d’Art, des sculptures et objets d’Art, souvenirs ethnographiques choisis à l’occasion de chaque voyage en France ou à l’étranger.
Il avait ramené un tambour tibétain en bronze pesant trois cents livres, transporté du Tibet(!)Les avatars du voyage depuis le Tsang Po* jusqu’à Paris auraient pu occuper une conversation pendant toute une soirée, et même plusieurs, à l’infini. Il collectionnait aussi des outils de toutes les époques et de tous les pays, y compris des drilles encombrantes. L’une d’elle d’un format exceptionnel avait trouvé refuge dans sa thébaïde en Bourgogne près de Givry*, trop monumentale pour loger dans l’appartement de la rue de Seine* à Paris*.
J’avais la passion des livres d’Art et des tapis d’Orient, des netsukes, des tikis, des nécessaires à couture, des peignes et épingles à cheveux, des statuettes crétoises, des porcelaines I’ Mary, des pierres à feu, des minuscules bronze de Vienne* animaliers, des petites pierres de lune ou pierres de rêve chinoises, des boîtes à encre solide, des pierres polies paysagères d’Angleterre* et d’ailleurs, de quelques météorites.
Il m’appelait Miss Météore*, toujours en mouvement, et en déplacements liés à mes activités professionnelles et à mon désir de découvrir le monde, moins que lui cependant.
Pendant les réunions ennuyeuses, il me dessinait le soleil et la lune sur laquelle on venait tout juste de marcher. Il y avait aussi des petites fusées avec des étoiles au sommet. Pégase*, des oiseaux en plein vol à la manière de Braque*, des cucurbitacées de toutes sortes : melons d’Espagne, pastèque ouverte, potirons, pâtissons, poivrons rouges, verts ou jaunes. Jacinthes, capucines, harpe. Archer, violon, clairon, tranchoir, coffres, piano, cithare, téorbe, gondole couverte, épi de maïs, livre, tambourin, bateau à voile, chat mécanique, fourches, plume à écrire, squelette de poisson, moulin à vent, masque de carnaval, cafetière, tasse, carafe, rouleau à pâtisserie, serpent, cochon, chapeau mexicain, lorgnon, colombe, lion lecteur, le hibou Frédéric, le loup des Ardennes, chapeau tyrolien, flèche, canon, bélier, arc de triomphe, couronne, cloche, tour Eiffel*, miroir, tente indienne, coquillages, tortue, papillon stylisé, masque, que sais-je encore ? En guise de signature, subtile anamorphose une étoile éclatée dont les branches arrivaient à se rejoindre par des procédés habiles et inattendus. Il avait le goût du secret, des charades et devinettes comme celles de Léonard de Vinci* dont il possédait toutes sortes d’éditions.
Un calumet avec cette légende : La hache de guerre sera-t-elle enterrée à Wounded-Knee* ? Qu’en pensez-vous ? Je suis en train de traduire leurs chants, voulez-vous les lire ? Comment ne pas être émerveillée, ou émue, ou ne pas rire de toutes ces trouvailles ?
Retour d’Asie
Je revenais d’un voyage en Asie à l’occasion de l’exposition universelle de Kyoto*. Henri s’y trouvait aussi au mois d’Août, mais étant encore presque des inconnus à cette époque, nous ne l’avons découvert que bien plus tard. J’avais accompagné un groupe pour un voyage de découverte, au Japon*, en Thaïlande*, à Hong-Kong* et à Macao où se réfugiaient des Chinois dissidents. Eddy Souza*, “Chinois de Chine”, m’avait remis un paquet pour son fils, exilé à Macao* et qu’il n’avait pas vu depuis deux ans. Nous avions dû renoncer au Cambodge*, en raison des activités du Viêt-Cong*, et de l’arrivée des forces militaires américaines. La situation était jugée trop dangereuse pour les touristes. Les temples d’Angkor* étaient devenus inaccessibles. C’est eux que nous voulions voir. Deux journalistes occidentaux avaient été enlevés. Le général L’on Noli* venait de remplacer Norodom Sihanouk*, que j’avais rencontré à l’hôtel à Nara*, au Japon*. Il m’avait remis un message pour la France. Rien que cela. “Excusez du peu”, dirons certains, mais c’est ainsi.
Une partie du groupe retourna à Kyoto*, pour passer une journée au Rock Garden du Ryōan-ji* temple Zen au jardin mondialement célèbre.
L’autre partie du groupe, avait choisi d’aller en avion de ligne interne, se recueillir à Hiroshima*. Ils étaient tous revenus transformés pour le restant du voyage, et de leurs jours. Tout le monde devrait aller à Hiroshima*, ou Nagasaki*, pour vivre chaque jour de sa vie dignement, comme un présent qui ne reviendra jamais. Là, impossible de nier notre humaine fragilité, notre destinée éphémère et infinie, notre appartenance à la chaîne humaine, dont nous brisons les maillons sans jamais en tirer les leçons. Mais quand tout cela finira-t-il ?
Revue de presse.
Plus près de nous, “Le Printemps de Prague*” venait d’être sauvagement et impitoyablement réprimé par l’invasion des chars russes et le massacre des populations comme en1956 à Budapest. * C’est dans leurs gènes.
Cette année-là Eisenhower*, Golda Meir* et Ho Chi Minh* étaient morts presqu’en même temps. De Gaulle* battu à un referendum s’était retiré et je revois encore sa haute silhouette à côté de “Tante Yvonne” marchant tous deux dans la lande irlandaise où il était parti se ressourcer. Sharon Tate* avait été massacrée à Los Angeles* et la jeunesse chantait et dansait à Woodstock* hostile à la guerre sans fin au Viet Nam*. Et un homme avait pour la première fois marché sur la lune. Certains disaient que ce n’était pas vrai.
*
Voyager moins loin.
Voyager loin commençait à devenir dangereux. Je n’avais pas vocation à devenir agent secret. Je commençais à sélectionner mes voyages d’études au bout du monde. Dommage ! Mes parents s’inquiétaient trop pour ma sécurité. Pour voyager si loin, il faut avoir l’esprit tranquille, sinon on ne voit rien de ce qu’on était venu chercher : Les Antiquités, les musées, les monuments, les curiosités naturelles et construites, les gens d’hier et d’aujourd’hui, et les parties inconnues de nous-mêmes.
Je choisis donc des pays réputés moins dangereux, mais, comme on le sait, le danger ne vient pas toujours de là où l’on croit. Les destinations suivantes étaient la Suède* et la Laponie*, puis l’Autriche* et la Yougoslavie*. Il m’arriva en Yougoslavie une étrange aventure.
J’étais pendant les vacances universitaires, guide-accompagnatrice pour la compagnie “Wagon-lit Cook*” sous le patronage d’Air-France*, Conseillère de séjour auprès du Ministère de la Jeunesse et des sports, professeure-accompagnatrice en Angleterre*, pour la Ligue de l’Enseignement et en Allemagne* pour l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse (OFAJ)*. J’écrivais aussi quelques articles en “freelance”.
Ecrit sur le temple Zen* du Ryōan-ji*
A mon retour j’avais trouvé dans mon courrier un petit paquet joliment ficelé. C’était un envoi d’Henri van Wentzinger* qui y avait rassemblé quelques dessins du Ryōan-ji* avec des textes de sa composition. Un des textes disait :
– Qu’en pensez-vous ?
C’est en travaillant à un projet de collection sur la sculpture et la peinture asiatiques que nous en avions parlé a posteriori. Il était question d’un livre sur les peintres et dessinateurs japonais du 19ème siècle, et sur Hokusai* en particulier. A cette époque il n’était pas si connu qu’aujourd’hui en Occident, et pas tant apprécié des Japonais non plus. C’est ainsi que nous avions sympathisé lors d’une réunion éditoriale un peu ennuyeuse, il me semble. Il avait écrit un texte bouleversant intitulé, “Hokusai* ou le naturel au galop”J’avais acquis pendant mon séjour à Kyoto*, une série d’aquarelles pour un prix très raisonnable, Yamada*, Kobaya*, Amiata*. Illustres inconnus, Son père, lui avait donné des estampes d’Hokusai*, il m’invita à aller les voir chez lui, rue de Seine, en tout bien tout honneur évidemment. Je remarquais sous l’immense bibliothèque, des flocons de poussière énormes qui indiquait qu’aucune femme n’habitait ici. Il ne me fit pas visiter le reste de l’appartement. Je l’invitai en retour à venir chez moi, voir mes aquarelles japonaises qu’il trouva de grande qualité. Ma bibliothèque de plus de trois mille livres, l’impressionnait et il passait tout au peigne fin, éditeur, date d’édition, auteurs, préfaciers avec le regard aiguisé d’un spécialiste…Pisasso*, Michel Ange*, Fra Angelico*, Piero della Francesca*, calligraphes et dictionnaires arabes, côtoyaient beaucoup de manuels universitaires de littérature, de linguistique, de psycho-sociologie qu’il appréciait moins. Il se méfiait des intellectuels (elles). A bon entendeur(se), Salut ! Il disait d’un air rêveur :
– C’est bien de dormir avec Michel-Ange, et, en parlant de la calligraphie arabe :
– Savez-vous lire ces petits vermicelles ?
Tout étonné que je réponde oui, et que je dessine pour lui son nom, en forme de vermicelles améliorés et gracieux. L’arabe était ma deuxième langue au lycée Delacroix à Alger*. Mon professeur était Monsieur Al Hamani*. J’avais par la suite pris quelques cours de calligraphie avec Hassan Massoudy*, grand calligraphe du 20ème siècle. Il vous apprenait tout sur le roseau et les autres instruments, les plumes métalliques, le matériel de coupe. La position du corps du calligraphe, la position de la main. L’encre. Les supports. Le point. Le plein et le vide. Le rythme. L’espace infini. Le miroir. La force expressive de la ligne. Le point-mesure. Le point ornement.
*
Je venais de quitter un poste de chargée d’étude à la direction de l’information de l’Union des Caisses centrales de la Mutualité agricole, rue d’Astorg*, à Paris*.
Je venais d’accepter un nouveau poste à la direction d’un département de Recherche et Développement aux éditions Armand Colin* 103, Boulevard Saint-Michel à Paris, à proximité des jardins du Luxembourg* et de la rue Abbé de L’Épée*.
J’avais terminé à Bordeaux* mes études supérieures en Lettres, en Sciences humaines et en journalisme. De mes études en journalisme, avec Robert Escarpit, * Raymond Amouroux*, Jacques Ellul*, j’avais gardé l’habitude de faire chaque matin une revue de presse. Cet exercice m’a toujours aidé dans ma vie professionnelle et personnelle, et je n’ai jamais cessé de le pratiquer.
Armand Colin* : “Labeur sans soin, labeur de rien”.
J’avais quitté l’enseignement, au profit d’un travail plus intéressant dans l’édition à Paris*. Pour de jeunes diplômés, c’était facile, et j’avais le choix entre plusieurs propositions. L’édition m’avait toujours passionnée. Le vieil André Salmon* venait de décéder à Sanary-sur-Mer* au début du printemps, en mars je crois. Henri, le connaissait pour ses écrits sur la peinture, et en particulier ses critiques de Cézanne* sur lequel il venait, lui aussi, d’écrire une série de notices pour les éditions Braun*, en français, en anglais, en espagnol et en russe qu’il maîtrisait très bien. Il avait fait après ses études de droit à Dijon*, un passage aux “Langues orientales”, sur lequel il était très discret.
Je travaillais également à un projet d’édition des critiques littéraires de cet écrivain. J’essayais par ailleurs, de sauver la magnifique “petite”, collection de Cluny*, créée par Max Leclerc*, mais qui ne se vendait hélas, plus, je proposais d’y ajouter des auteurs contemporains, mais cela entraînait des droits d’auteur, ou des négociations avec les ayants-droits. Trop long à mettre en place. Nous avions passé un accord avec Flammarion*, pour étudier quelles collections garder, et comment les rajeunir. Le marasme s’étendait à toutes les éditions savantes. Pour faire des économies, Jean-Max Leclerc*, “loua” les services de notre équipe de Recherche et Développement à plusieurs éditeurs : Klincksiek*, Longman*, Albin-Michel*. Je fus chargée d’examiner ce qu’on pouvait faire des Classiques africains coédités avec le CNRS*, et de faire des propositions pour la collection “Nouvelle Bibliothèque Scientifique” paraissant chez Flammarion*.
Henri devait inventer des collections d’Art en petit format, comme l’astucieuse Petite Encyclopédie de l’Art, éditée par Hazan*, rue de Seine*, tout près de chez lui. Il n’était pas rare qu’il nous invite à boire un verre chez lui, après les réunions passionnées ou tristounettes, selon les jours et les participants. La véhémence de mon combat lui plaisait. Il me soutenait dans mes prises de parole.
Les réunions chez Armand Colin* se tenaient dans la très imposante salle du conseil d’administration où trônait sur les étagères une édition originale de l’Encyclopédie de Diderot*. Ce lieu imposant chargé d’histoire nous servait de bureau, car il n’y avait pas d’autre place dans l’immeuble pour loger les quatre nouvelles recrues, Paul Girot* : chargé du secteur universitaire des langues étrangères et de la philosophie, Jean-Louis Stein* : pour l’histoire et la géographie, Bernard Morel*, commissaire aux prix à la mentalité soixante-huitarde : pour le droit et l’économie, et moi : pour la littérature française et la linguistique. Avant notre arrivée, Jean-Claude Natali couvrait tous les secteurs, on lui laissa les sciences naturelles, la physique, la chimie et les mathématiques. Au début, il ne nous appréciait pas follement, puis il fût gagné par notre bonne humeur à son corps défendant Avait-il le choix ? Il fit contre mauvaise fortune, bon cœur. Nous étions censés apporter le renouveau nécessaire au redéploiement du secteur universitaire. Nous avions entre vingt-quatre et trente ans, et tous célibataires. Nous étions très joyeux et nous prenions des fou-rires, qui faisaient sortir Rémi Bourrelier* par la porte communicante de son bureau mitoyen. Il était curieux de savoir ce qui pouvait nous faire rire à ce point, des rires sonores, intempestifs. Les murs d’Armand Colin* n’en avaient sans doute pas entendu d’aussi éclatants, depuis longtemps. Nous passions pour de joyeux drilles. Jean-Louis était le boute-en-train et Paul, le philosophe, qui au début était sur la réserve, n’avait pas tardé à se mettre à l’unisson.
Mon travail de recherche de nouvelles collections me passionnait. Je partais dans toutes les Universités de France métropolitaine, et les universités francophones Belges* et Suisses*, à la recherche de nouveaux auteurs, ce qui impliquait de nombreux et longs déplacements. Il fallait inventer de nouveaux concepts de collections universitaires, car après 1968, les cours magistraux n’existaient plus et les manuels de la (pourtant très belle) collection des manuels “U” ne se vendaient plus, les étudiants n’en ayant plus l’usage.
Accident à Rouen*
Lors d’un déplacement à Rouen*, l’équipe avait failli être amputée d’une moitié.
Jean-Louis et moi sortions du restaurant vers vingt et une heures, quand en traversant, (fort heureusement), dans les “passages cloutés”, pour rejoindre notre hôtel, un camion fou glissant sur la chaussée mouillée nous a heurtés, et projetés à vingt mètres à ce qu’ont raconté les témoins. Je me souviens seulement de mon réveil dans l’ambulance nous conduisant à l’hôpital. Jean-Louis me tenait la main, en me disant de ne pas bouger. Il ne s’arrêtait pas de répéter en riant sans cesse :
– Ne t’en fais pas ma petite Geneviève, la vie est une vallée de larmes qu’il nous faut traverser. Ne t’en fais pas, nous travaillons pour Armand Colin* ! Ne t’en fais pas ma petite Geneviève. Sans fin la même phrase répétée en riant, comme une douce mélodie.
L’ambulancier essayait de maintenir ma jambe disloquée en disant à Jean-Louis de continuer à me parler. Il répétait sans fin la même phrase. Je hurlais de douleur à la moindre secousse. Je demandais où nous étions. Je voulais voir ma jambe, mais je ne pouvais pas bouger le cou, ni soulever ma tête. Ils m’affirmaient tous deux que ma jambe n’était pas cassée, mais, je la sentais en tire-bouchon. J’étais glacée, mes longs cheveux épais, habituellement tressés, étaient épars et tout dégoulinants. Il pleuvait en abondance ce soir-là, les secours avaient paraît-il tarder à arriver. Ma tête à ce qu’on m’avait dit, avait heurté le trottoir, puis j’avais rebondi sur la chaussée détrempée.
A l’arrivée à l’hôpital, nous sommes restés sans secours, ni assistance, pas même un comprimé d’aspirine, ni un verre d’eau jusqu’à minuit au moins. Je pleurais et Jean-Louis riait d’un rire nerveux, en me répétant toujours la même phrase, puisqu’on lui avait dit de ne pas s’arrêter. En ces circonstances, on peut sans doute, c’est excusable, manquer d’imagination dans le discours. Enfin un interne est arrivé, a demandé à voir les radiographies. L’accompagnateur a répondu que nous n’avions encore vu personne. On cherchait un infirmier ou une infirmière, enfin quelqu’un habilité à pousser mon chariot. Un infirmier qui passait par là, fit remarquer qu’il fallait traverser deux cours sous la pluie pour accéder par le chemin autorisé à la salle de radiographie. Personne n’avait le droit de le faire. Enfin un aide-soignant humain et courageux prit l’initiative héroïque de me transporter par l’intérieur, en traversant à ses risques et périls, les services interdits. Je lui demandais comment était ma jambe. Il me répondit en souriant gentiment qu’elle ressemblait à une queue de petit cochon. C’était un Algérien* au grand cœur. Il m’affirmait que c’était “juste” la rotule et qu’il était sûr que la jambe n’était pas cassée. J’étais soulagée de l’entendre. On fit les radiographies. Je hurlais. Il avait vu juste, il n’y avait rien de cassé à la jambe. La rotule était simplement passée de l’autre côté du genou et se trouvait quelque part derrière, puis on passa la tête aux rayons X, je ne savais pas qu’elle était cabossée. C’était juste un traumatisme crânien, agrémenté d’un hématome temporal exceptionnel, qui grossissait à vue d’œil. L’interne me mit un marché en main. Pour le traumatisme crânien, il fallait attendre le neurologue qui ne viendrait qu’à sept heures. Il devait être deux ou trois heures du matin. En revanche, il pouvait s’occuper de la jambe. Je n’avais toujours pas avalé le moindre calmant. Le marché était le suivant : soit il m’envoyait en chirurgie pour ouvrir le genou et récupérer la rotule, soit il essayait de la réduire à la main sans ouvrir. Jean-Louis avait disparu. J’étais seule dans une ville inconnue, et pas très vaillante. Que faire ? Personne pour m’aider à prendre la décision. J’optais pour la tentative de réduction de la luxation à la main. Je ne savais pas ce que cela voulait dire. Je demandais un analgésique, sans succès, soit qu’il n’y en eût pas dans le secteur, ou qu’il y eût une contre-indication ? Toujours est-il que deux infirmiers me maintinrent fermement sur le brancard en me souriant avec compassion, comme pour s’excuser du geste barbare et primitif qu’ils entreprenaient sur ma personne. L’interne cherchait où pouvait être cette “putain”de rotule. Le mot de Cambronne* retentissait aussi sur tous les tons et arpèges associés, et d’autres mots que je ne connaissais pas, sans doute issus, du milieu médical ? Je suppliais, j’implorais d’arrêter. Je voulais être endormie et opérée. Trop tard. On y est presque dit l’interne. Je la sens, elle est là, ma rotule bien sûr. Cela s’éternisait. Si seulement j’avais pu le mordre, l’assommer, l’insulter, que sais-je ? Tout d’un coup, je sentis une grande déchirure, comme si un tranchoir me coupait le genou en petits morceaux ; puis une masse glissa dans un bruit sec, la jambe reprit sa forme originelle, et la douleur s’arrêta net. L’interne posa sa main sur mon front. Bravo, vous avez été très courageuse. Vous avez évité l’opération. On attacha ma jambe droite dans une gouttière. On l’entoura d’un linge et l’on posa sur le genou une grosse poche de glace à renouveler sans interruption. On ne me nettoya pas le visage ensanglanté, le sang venait du cuir chevelu et collait les cheveux en une masse indémêlable et terriblement lourde. A cette époque mes cheveux noirs ondulés et très épais, descendaient jusqu’à la taille. Le plus urgent semblait être de savoir où me faire passer la fin de la nuit. Il fût décidé de me mettre en Otto-rhino-laryngologie, (ORL), le seul service en fait, où il restait une chambre. Ma voisine de chambre qui devait être opérée de la gorge poussa un cri terrifié et terrifiant en me voyant entrer sous la lumière crue, aveuglante. Je devais ressembler à une créature de Frankenstein*. On la rassura sur son sort et sur le mien. Elle veilla toute la nuit sur moi, et me changeait toutes les heures la poche de glace en me demandant d’un air suppliant si elle ne me faisait pas mal. Pour que le drap et les couvertures ne pèsent trop lourd on posa un grand cerceau au-dessus de mes jambes, et les draps par-dessus. Je demandais où était Jean-Louis. On me répondit qu’il était en médecine interne, mais qu’il allait bien. Ensuite, une infirmière vint m’annoncer que mes parents qui habitaient à Bordeaux* avaient été prévenus, dans la nuit, et s’étaient mis immédiatement en route. Ils pensaient que j’étais morte ou quelque chose d’approchant. Ils s’arrêtaient dans les très rares stations-services ou les hôtels ouverts sur la route à des heures si tardives, pour téléphoner. Mon Père qui conduisait, avait du mal à calmer les sanglots déchirés de ma Mère. J’imagine a posteriori, leur voyage. Quand ils arrivèrent dans la matinée, le neurochirurgien m’examinait, en ORL, toujours. Mes parents essayaient de comprendre pourquoi je me trouvais en ORL, mais personne ne pouvait leur donner d’explication cohérente. On les priait de patienter dans le couloir. Ils demandèrent à voir Jean-Louis, mais on leur apprit qu’il avait signé une décharge de responsabilité, pour sortir et rejoindre Paris* par ses propres moyens. Enfin, le neurochirurgien sortit de la chambre. Quel insensé pourrait me faire croire que nos Anges gardiens ne veillent pas en permanence sur nous ? Ma mère en pleurs tomba dans ses bras, au bord de l’évanouissement. C’était le fils de l’obstétricien qui m’avait mise au monde vingt-six ans plus tôt, à la clinique Lavernhe à Alger*, 21, avenue Pasteur. Tél.346-17. Inch’Allah !
Un ami de toujours. Que faisait-il là ? L’émotion et les premières effusions passées, avec quelques précautions oratoires, ils surent enfin que j’étais bien vivante, Ouf ! Alléluia ! Alléluias ! Mais, cet arceau sur mes jambes ? Que cachait-il ? Ma Mère se précipita, arracha draps et couverture d’un geste rapide, Ouf ! Bis, les deux jambes entières étaient là, même pas plâtrées, on pouvait les toucher, elles semblaient normales, et sans opération ! Tout allait pour le mieux (dans le meilleur des mondes possibles.) évidemment. “Si je suis tombée parterre, c’est la faute à Voltaire”* Et pour le cerceau “c’est la faute à Rousseau”* nous le savons tous depuis longtemps.
L’infirmière pour compléter le dossier d’admission, demanda à ma Mère, la confirmation de mon identité et quelques autres renseignements :
Nom : Audet-Lambert.
Prénom : Geneviève, Yvonne.
Date de naissance : 5 Mai 1946.
Lieu de naissance : Alger.
Nationalité : Française.
État-civil : Célibataire.
Taille : 1.70m.
Poids : 58 kilogrammes.
Couleur des cheveux : châtain clair.
Couleur des yeux : marron.
Signes particuliers : néant.
Traitements en cours : aucun.
Profession : Responsable Recherche et Développement.
Employeur : Éditions Armand Colin.
Adresse de l’employeur : 103 Boulevard Saint-Michel, Paris 5ème.
Domicile : rue (de) Vaugirard à Paris, 6 ème.
– Avez-vous l’intention de porter plainte contre le chauffeur du camion responsable de l’accident ?
– Oui.
L’étape suivante était de savoir si j’étais transportable, et comment rentrer à Paris*. Mon Père dirigeait une entreprise générale de tout électrique, de laquelle il ne pouvait pas s’absenter trop longtemps. Il fallait rapatrier ma voiture. Ma mère n’était pas en état de rester seule à Rouen* avec moi, et pour combien de temps ? Les médecins et les spécialistes n’étaient pas d’accord pour me rapatrier à Paris*, d’ailleurs, il fallait trouver un lieu d’accueil adapté à mes différentes blessures. On téléphona à plusieurs hôpitaux parisiens. Aucun ne pouvait m’accueillir. La journée se passa en négociations. Pendant ce temps, une infirmière vint enfin me laver le visage et les cheveux devenus une masse compacte et collante. J’avais l’impression que ma tête allait éclater. Je demandais un miroir, qu’on ne m’apporta jamais.





























