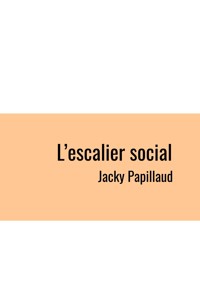
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Französisch
L'escalier Social, par opposition à l'Ascenseur Social, est le parcours d'un autodidacte qui a commencé sa vie professionnelle à 15 ans avec comme seul diplôme un CEP (Certificat Etudes Primaires). Il a gravi marche après marche pour terminer Cadre dirigeant dans un Groupe International. À la fin de sa carrière, il est Directeur Commercial des Grands Comptes dans le secteur de la grande distribution et des réseaux de services. Malgré l'implantation internationale de ses clients, il ne parle pas l'anglais, mais il se débrouille pour conclure ses contrats malgré tout. Il connaît la dureté du métier dans les années 60, où la semaine hebdomadaire de travail est de 55 heures voire plus. C'est un travailleur acharné, un fonceur qui se bat avec ses armes, et il a la chance de rencontrer quelques grands patrons qui l'orientent pour lui permettre d'évoluer et grandir dans son groupe. Il validera plus de 200 trimestres à la Sécurité Sociale, et avec le bénévolat qui suivra son départ à la retraite, il aura plus de 60 années d'activité.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 331
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Avant d’ouvrir ce récit, c’est avec honneur et une grande émotion que je laisse à Maurice le soin de l’introduire, par ses propres mots.
Ancien Directeur Général Habitat France de Saint-Gobain, Maurice est un homme d’une immense culture, doté d’un regard affûté et d’une humanité rare. Il me connaît depuis longtemps et a pris le temps de lire ce livre dans le moindre détail, d’en comprendre chaque nuance, chaque étape. Son analyse, empreinte d’empathie, d’intelligence et d’amitié sincère, m’a profondément touché.
Je ne pouvais souhaiter plus belle introduction à ce récit.
Sommaire
Préface de Maurice Manceau.
Avant-propos
Toute une vie professionnelle.
Ma première marche de plain pied
Fin de l’apprentissage conventionnel
Mes premières années de salarié
Déménagement de Saint-Jean à Niort
La période militaire
Le retour à la vie civile
Du col bleu au col blanc
Le début de la fin de Sagelec en 1975
Le début d’une autre aventure
Train de vie exceptionnel et situation atypique
Débute une seconde aventure
Reporter photographe
Nouvelle qualification
Mon premier voyage long-courrier
Un titre de reconnaissance
Projet du rachat d’une PME Saintongeaise
En 1986, je pars de La Rochelle pour
Création du pôle nucléaire
Mission aux Antilles
Le comité de direction de ma Région
Je me sédentarise à Caudéran, quartier de
Formation comportementale
En 1993, Veritas-Auto, groupe Bureau
En 1995, mutation de Bordeaux à Rouen
Un contrat très lucratif
Croyance sans superstition des chiffres
En 1997, mutation de Rouen à BV Paris
Une organisation drastique
Les associations professionnelles
Une période faste
Mission à Dongguan en Chine
Reprise de mes activités commerciales
Un faux départ en retraite en 2008
Les grandes négociations. La grande
La grande distribution coopérative
La grande distribution indépendante
Le groupe Accor Hôtels
Les enchères inversées
Les enseignes de détail
Quelques moments croustillants
Une autre enseigne dans les tissus
Enseigne de distribution presse/journaux
Un site de manufacture
Magasin de vêtements
Une rencontre fortuite
Les grandes enseignes étrangères
Chaîne de magasins espagnols
Un groupe d’assurance indépendant
Mes interlocuteurs privilégiés
Un nouveau rôle de bénévole
2013 : le vrai départ à la retraite
Une vocation
2013 nouveau départ pour Bureau Veritas
2017 : nouveau contrat de collaboration
L’individu est au centre de toute relation
Arrivée aux derniers étages de mon
L’arrivée au Roof top
Une conclusion de soixante années
L’ESCALIER SOCIAL versus
L’épilogue
Quelques derniers mots…
Préface de Maurice Manceau.
Le plaisir de parcourir le récit de la vie professionnelle d’un ami est souvent source de découverte plus ou moins importante, dans cet ouvrage » Escalier ascensionnel » j’ai été comblé.
Tout d’abord pourquoi un tel titre alors que plus couramment on parle d’ascenseur et non pas d’escalier ascensionnel ?
En reprenant la lecture des épisodes de la vie de Jacky, ce n’est pas une montée mécanique sans regard d’un point A à un point B mais bien la construction architecturale d’un escalier avec des marches permettant des pauses avec à chaque fois un apprentissage, une compétence, permettant de monter la marche supérieure.
Est ce qu’il avait un objectif précis ? Je ne l’ai pas soupçonné, mais la sensation que son ouverture d’esprit l’emmenait avec une curiosité rare et constructive a permis de construire lui-même son escalier comme un vrai maître d’œuvre et compagnon qui réalise son chef d’œuvre.
J’ai eu la chance de connaître Jacky seulement il y a Vingt-cinq ans alors qu’il arrivait en pleine maturité de sa vie de cadre d’entreprise et j’étais loin de m’imaginer à cette époque le parcours qu’il avait fait pour être à son poste, sa vie d’apprenti dès le plus jeune âge, ses choix plus ou moins délibérés sur le premier métier, les entreprises qui étaient ses employeurs qui ne réussissaient pas toujours au mieux et malgré toutes ces embûches, Jacky a réussi à grandir grâce à ses réelles capacités, son intelligence et son esprit et envie d’apprendre.
La réussite est d’autant plus exemplaire dans un monde où tout lui devait être beaucoup plus difficile que pour ceux qui sortant des écoles prestigieuses n’avaient qu’à choisir leur devenir.
Pourtant il a su cohabiter avec ces cadres supérieurs sans avoir à rougir et a su donner des résultats dans une des plus grandes entreprises de contrôle européennes.
Pour le souvenir personnel de notre première rencontre, nous avions lui et moi un actionnaire commun, majoritaire chez Veritas et minoritaire chez Saint Gobain et nous avions pris le parti d’en faire notre lien de petite cousinade…
L’empathie de Jacky et sa relation jamais égalée sur l’ensemble des intervenants de nos professions lui ont permis de s’insérer dans tous les milieux en laissant une image du pro respectable avec qui on avait envie de parler et demander avis si besoin, en clair celui avec qui on pouvait être fier de l’avoir comme ami.
Comme tous les curieux, avides d’apprendre et voulant progresser, il s’est intéressé à tout, la culture est souvent source de recherche qu’elle soit dans les techniques actuelles, les sujets philosophiques…, et il apparaît aujourd’hui comme le senior avec qui on aime bien discuter.
Heureux d’avoir pu connaître ce parcours aussi complet avec un si beau résultat et gardant en mémoire tous les échanges pendant toute cette seconde période qui nous ont souvent permis d’aller plus vite dans nos réseaux.
Le mot réseau chez Jacky est une donnée de base et tous ceux qui ont pu le côtoyer peuvent exprimer le plus grand respect par sa capacité dans chaque domaine à aiguiller tel ou tel pour répondre aux différentes demandes.
A lire cet ouvrage, on aura encore plus d’admiration pour le grand professionnel qu’est Jacky.
Maurice Manceau, Past DG Habitat France Saint Gobain., Past président CAH (Club de l’Amélioration de l’Habitat), Association publique/privée, Anah, Ademe, Puca, Industries et Fédérations nationales, Membre du bureau du Plan Bâtiment Durable.
Préambule
Pourquoi avoir choisi l’Escalier Social plutôt que l’Ascenseur Social, plus communément employé par n’importe quel quidam ? La réponse pourrait se trouver dans l’intitulé du questionnement, l’un étant beaucoup plus rapide que l’autre. Même avec le meilleur entraînement, on n’arrive pas dans les mêmes temps en haut de la tour First, à la Défense, si on appuie sur un bouton ou si on en monte une par une les 954 marches. Nous sommes sur deux dynamiques différentes dans la progression sociale et professionnelle, et qui sont particulièrement intéressantes pour un autodidacte.
L’ascenseur social représente une ascension plus rapide, qui est souvent facilitée par des opportunités extérieures. Il sous-tend à la base une solide formation universitaire donnant une légitimité naturelle à l’évolution tout au long de sa vie. La reconnaissance précoce, parfois liée à des circonstances ou événements de l’existence, favorise une accélération de la carrière, avec toujours, cependant, le risque de la chute.
L’escalier social est quant à lui le symbole d’une progression plus lente, graduelle, mesurée et basée sur un effort soutenu et constant. De mon point de vue, car c’est celui que je retiens dans mon parcours, il implique le développement régulier de compétences, par l’expérience de l’apprentissage. Pour l’autodidacte, l’escalier social est généralement la voie principale, car il doit tout apprendre par lui-même, souvent sans diplôme ou certification formelle reconnue. En l’absence de soutien institutionnel, construire une légitimité dans son domaine, au travers de ses réalisations, demande patience et persévérance.
Avant-propos
Avant d’entrer dans le vif du sujet, il me semble important de rappeler les différences qui existent entre un livre destiné à un large public et l’autobiographie, qui revêt un aspect très personnel et dont la source est inspirée d’un vécu.
L’écriture d’un livre.
Un livre, qu’il soit de fiction ou de non-fiction, a généralement pour objectif de raconter une histoire, partager une idée ou explorer un thème. Il n’est pas nécessairement lié à la vie de l’auteur, et peut être écrit à la première, deuxième, voire troisième personne, ou bien encore avec différents narrateurs. L’auteur, en fiction, dispose d’une plus grande liberté créative, et peut imaginer des personnages avec des perspectives multiples, ainsi que des intrigues et des modes narratifs. Il a le choix également de s’inspirer de la réalité ou de créer une œuvre totalement fictive.
Dans la non-fiction, rien n’oblige l’auteur, non plus, à se centrer sur des récits personnels. L’exposition d’analyses ou d’opinions est elle aussi possible.
En fonction du thème retenu, un livre ne s’adressera pas toujours au même public. S’il est de fiction, il est destiné en général à une large audience, avec l’intention de divertir, d’instruire ou de provoquer des réflexions sur des thèmes universels.
L’écriture d’une autobiographie.
Le principal but d’une autobiographie est de raconter la vie de l’auteur lui-même, en portant l’accent sur ses expériences personnelles, ses réflexions et ses souvenirs. La première différence par rapport à un livre « classique », dirons-nous, est qu’il sera écrit à la première personne, car l’auteur raconte directement sa propre histoire, avec son propre point de vue.
C’est un récit factuel qui repose sur la réalité des événements vécus par l’auteur. Il doit être fidèle à sa vie, même si certaines parties, parfois, sont susceptibles d’être embellies ou sujettes à une interprétation subjective.
L’autobiographie, bien qu’elle permette de choisir un certain style et une réflexion personnelle, est davantage contrainte par la réalité et la vérité historique. Elle se concentre en particulier sur les faits et la chronologie du parcours de l’auteur.
Par définition plus personnelle qu’un quelconque ouvrage, elle intéresse principalement ceux qui veulent en savoir plus sur celui qui l’a écrite, ou qui sont curieux à propos de l’époque ou le milieu dans lequel tout s’est déroulé.
Je n’ai pas le talent d’un écrivain et je n’en ai pas non plus la prétention. Mon objectif avec cette biographie est qu’elle soit la plus sincère possible, sachant bien sûr qu’elle sera inévitablement sujette à une certaine part de subjectivité. Si j’ai choisi de raconter mon histoire, c’est parce que j’ai appris à mes dépens à quel point il est important de suivre ses rêves, même contre vents et marées. De mon enfance modeste à ma carrière inattendue, qui commence dès l’âge de 14 ans, chaque étape a forgé la personne que je suis aujourd’hui.
J’ai toujours imaginé que ma vie suivrait un chemin tracé. Ou plus précisément, même sans savoir exactement par où j’allais passer, j’avais une idée très claire de ce que je ne souhaitais pas dans mon parcours. Cela s’est révélé notamment au tout début de ma carrière professionnelle, quand j’ai compris que le travail que j’exerçais n’allait pas me permettre de m’épanouir dans la vie.
Toute une vie professionnelle.
J’ai eu une scolarité courte. En 1950, l’obligation scolaire était fixée à l’âge de 6 ans. La loi Jules Ferry de mars 1882 avait aussi rendu l’instruction impérative jusqu’à 13 ans, avec la possibilité de quitter l’école dès 11 ans, en possession d’un certificat d’études. C’est après le Front populaire de 1936 que la loi Zay a porté la durée de la scolarité jusqu’à 14 ans. Il faudra attendre 1959 pour que celle-ci soit prolongée et obligatoire jusqu’à 16 ans. Et c’est bien plus tard, sous la présidence d’Emmanuel Macron, que l’âge sera abaissé de 6 à 3 ans pour tous les écoliers. Il y avait déjà de nombreuses écoles maternelles, avant cela, qui prenaient les enfants à partir de 3 ans révolus, à condition qu’ils soient libérés des couches-culottes.
Pour me résumer, je suis donc de la génération qui a été soumise à l’instruction obligatoire de 6 à 14 ans, ce qui comprenait les cours préparatoires aux classes de fin d’études primaires. De ce fait, j’ai davantage contribué au financement des études de mes concitoyens, par l’impôt, que j’en ai été bénéficiaire. Et je peux en dire de même à propos de la Sécurité sociale et de l’assurance chômage, puisque je n’ai jamais cessé de travailler. Je suis de ceux qui ont cotisé pour la scolarité, par le biais de l’Éducation nationale, et je cotise de nouveau pour l’allocation chômage ! C’est notre généreux système par répartition, au nom de la solidarité, qui favorise les plus démunis, ou les moins chanceux, ce qui n’est pas absurde, mais coûteux.
Encore beaucoup d’incertitudes.
En me resituant dans cette période de ma vie, tout juste sorti de l’école et entré en apprentissage, j’observe que ma perception de l’escalier, sur le moment, reste encore floue. Cette question, en général, peut susciter une gamme de sentiments complexes et contradictoires, en fonction du contexte personnel, des attentes sociales et de l’expérience de l’apprenant. Je me souviens en tout cas que, dans ces circonstances, c’est un sentiment de liberté qui domine en moi, car je n’ai plus à suivre d’horaires scolaires stricts. J’entrevois aussi la possibilité de me lancer dans un parcours plus concret et professionnel, ce que je perçois comme une première étape vers l’indépendance. Je ressens comme une excitation le fait d’intégrer le monde du travail, stimulé par une sorte de maturité précoce.
Le titre de ce livre est L’escalier social par opposition à l’ascenseur social. Ce titre est un symbole riche et varié qui tend vers un objectif plus élevé, que ce soit spirituel, intellectuel ou émotionnel. Monter un escalier m’évoque l’effort nécessaire pour progresser, ce qui à l’époque se reflète dans ma volonté d’atteindre un but dont la finalité n’est toutefois pas encore clairement définie.
J’aurai l’occasion dans ce livre de marquer un point d’étape à chaque palier de ma vie professionnelle. Le premier prend place ici, avec ma première expérience de travail. Dans cette période, je viens de relever un premier défi, celui de mon choix professionnel. Mais il me reste encore beaucoup d’obstacles à surmonter, tant professionnels que personnels.
Ma première marche de plain pied
Ma vie professionnelle a commencé le 8 juin 1962, date à laquelle j’ai été reçu à l’examen du certificat d’études primaires de l’Académie de Poitiers. De toute ma reconnaissance intellectuelle, c’est le plus grand en termes de format. Il m’a été remis avec le livre de Jules Verne, « L’île Mystérieuse ». Après quelques semaines de vacances, il fallait que je trouve une voie professionnelle. Deux possibilités s’offraient alors à moi : poursuivre mes études en intégrant le Lycée de Pons, en quatrième d’accueil – la filière technique de l’époque – ou bien entrer dans le monde du travail. Je pense que, si j’avais émis le souhait de continuer à étudier, mes parents m’auraient accompagné financièrement. Mais ce n’est pas ce désir que j’ai eu, peut-être à tort. Cependant, je ne regrette pas mon parcours. Même s’il m’a obligé à me battre beaucoup plus que d’autres, j’ai néanmoins eu la satisfaction de parvenir à faire tout ce que je voulais, ou presque, parce qu’on ne réussit jamais tout.
C’est donc vers la voie professionnelle que je me suis orienté, sans savoir pour autant vers quel métier aller. Comme j’étais passionné par les voitures (passion qui ne m’a d’ailleurs jamais quitté !), mon père m’a naturellement accompagné chez le carrossier Saint Aubert, dont l’atelier était à côté de la maison, ou presque. Celui-ci, malheureusement, avait déjà retenu quatre apprentis, et il lui était difficile d’en prendre un de plus. Le marché du travail était très ouvert ces années-là, et l’apprentissage fleurissant.
À défaut de ce premier choix, un concours de circonstances m’a conduit vers un autre métier. Ma tante, en effet, connaissait un artisan électricien dans le centreville de Saint-Jean-d’Angély, l’entreprise Piau. Il était d’accord pour prendre un jeune en apprentissage. J’ai été intégré le lundi 3 septembre 1962, jour du Saint-Pie X, et nous étions quatre employés, en comptant le patron, qui était proche de la retraite.
Le démarrage dans le métier avait un côté un peu folklorique ! Ce vieux compagnon était de l’ancienne école et il avait vraiment le sens des économies. Il récupérait toutes les chutes de fil, un véritable arc-en-ciel de couleur qu’il mettait bout à bout, isolées au « chatterton » blanc et collant des deux côtés. Rien à voir avec le scotch plastifié d’aujourd’hui, de différentes couleurs permettant d’identifier les conducteurs électriques. Le fil rentrait dans le tube avec une couleur et ressortait à l’autre bout d’une autre couleur, tout en étant passé par plusieurs teintes entre les deux. On appelle ça faire des épissures, ce qui est formellement interdit aujourd’hui. À cette époque, nous avions du fil électrique beaucoup plus petit dont nous nous servions pour faire des scoubidous. Nous étions déjà dans le cycle de l’économie circulaire avec notre papy !
J’ai commencé dans le métier en travaillant chez des particuliers. Avec le temps, en comparant la technologie lors de mon début de carrière avec celle qui s’est imposée au fil des décennies, lorsque j’inspecte le travail, j’ai pu constater à quel point les évolutions ont été importantes. Électricien est un très beau métier : diversifié et techniquement d’un bon niveau, il offre une grande liberté. Dans la corporation du bâtiment, un électricien est apte à réaliser tous les travaux d’ouvrage, ce qui n’est pas le cas des autres compagnons. Cette profession, en effet, requiert des compétences techniques qui ne relèvent pas que du bon sens. C’est cela qui la rend formidable, et le fait que tout ait très vite évolué vers l’électronique lui donne un attrait supplémentaire.
Peu de temps après avoir été engagé s’est formé un groupement d’artisans en électricité, plomberie, chauffage, zinguerie et couverture, sous la forme d’une coopérative, ce que nous appelions une SCOP (Société Coopérative Ouvrière de Production à Personnel et Capital Variable). Le nom de cette société était la SAGELEC (Société d’Application Générale d’ÉLECtricité), et son siège, qui regroupait quatre artisans, était situé 45 rue du Faubourg Taillebourg, à Saint-Jean, à quelques centaines de mètres à peine du domicile où je résidais avec mes parents. Je me souviens encore (c’est sans importance, mais bon pour la mémoire) du nom des quatre artisans qui composaient la boite : L’artisan où j’étais sous contrat, les établissements Timoléon à Saint-Jean, Fournat à Tonnay-Boutonne et Pelletier à Aulnay de Saintonge. C’est ce dernier qui a été élu président de la SCOP et qui, par la suite, a pris le pouvoir absolu du groupement, évinçant les patrons fondateurs. Il avait déjà des prédispositions pour être patron. Dans son magasin d’Aulnay de Saintonge, il affichait des délais de réparations bien plus longs que la réalité, afin de laisser croire qu’il avait énormément de travail, gage de compétence s’il en est. Dans ce petit bourg, tout le monde pensait qu’il fallait plutôt confier son matériel à cet artisan. Certes, il était débordé parce qu’il recevait trop de travail, mais cela signifiait en contrepartie qu’il était qualifié. Mon père avait signé un contrat d’apprentissage pour trois ans avec le PDG, Daniel Pelletier, et c’est à partir de ce moment que je suis passé d’un court séjour dans l’artisanat au monde de l’entreprise.
Mes premiers salaires d’apprenti étaient loin d’être impressionnants. La première année, je gagnais dix francs par mois, la seconde vingt, et la troisième et dernière cinquante francs. Pour les ouvriers, les salaires étaient versés toutes les fins de semaine, en espèce, puisqu’à l’époque personne n’avait de compte en banque. Ces premiers revenus, en tous cas, m’ont surtout été utiles pour m’équiper en outillage, car chaque compagnon devait posséder sa propre caisse à outils, qu’il équipait à ses frais. Je continuais de loger chez mes parents, et même s’ils n’étaient pas riches, ils ne me demandaient pas de payer de pension alimentaire. Il faut dire que j’étais loin de gagner suffisamment pour pouvoir participer aux charges de la maison. Nous vivions simplement, mais ne manquons de rien d’essentiel. Mon seul luxe était la mobylette sur laquelle je me déplaçais, et que mon père et ma mère m’avaient offerte après l’obtention de mon certificat d’études, contre ma promesse de leur rembourser… promesse à vrai dire vite oubliée ! Cet engin avait une valeur de 500 francs. Je me suis exercé au démontage et remontage du moteur, dans l’espoir de lui donner une puissance supplémentaire, afin d’aller plus vite sur la route. Ce ne fût pas vraiment efficace, mais instructif. J’avais déjà cet instinct du bricolage manuel, le sens de la technique !
Pour information, le recensement de la population, en cette année 1962, comptabilisent en France 46 530 000 habitants.
Nos conditions de travail étaient très rudes physiquement. Dès sept heures du matin, il nous fallait quitter l’atelier pour rejoindre les chantiers à Niort, La Rochelle, Melle, Angoulême ou Saint-Maixent-l’École, par exemple. Le retour, lui, se faisait à 19h arrivée à l’atelier, et ce du lundi au samedi midi. En tout, cela représentait plus de 55 h par semaine, soit 1 900 h par an, avec trois semaines de congés. La quatrième ne nous sera accordée qu’après mai 1968. Le salaire (garanti) pour 173h33 mensuelles était de l’ordre de 313 francs… Le samedi matin était consacré au nettoyage des outils et à la préparation des commandes, ainsi qu’à leur chargement dans les véhicules.
Nos conditions de vie sur les chantiers étaient difficiles. Nous devions travailler par tous les temps, et étions exposés au froid et aux courants d’air. Qui plus est, nos tâches étaient très physiques, et nous manipulions des charges de 50 kg et plus, sans avoir reçu la moindre formation sur les bonnes postures à adopter.
J’ai commencé mon métier en étant affecté au changement de tension des usagers. Le courant diffusé jusque-là dans les foyers était de 110 v, sans disjoncteur général de protection. Nous devions le faire passer sur un réseau de 220v, installer le disjoncteur et récupérer les appareillages des particuliers, ou selon les cas leur donner un auto-transfo pour les alimenter. Nous étions ceux qui introduisirent les fameux compteurs bleus, destinés aux installations domestiques. La publicité était : « Demandez le Compteur Bleu 6 Kilowatts pour Vivre Mieux ». Il faudra attendre les années 90 pour l’utilisation des nouveaux compteurs électroniques à affichage digital, qui sera remplacé à son tour par le Linky à partir de 2015. En 1962, l’usage de l’électroménager était encore réduit, et se résumait le plus souvent à un réfrigérateur, un sèche-cheveux et une bouilloire. On trouvait aussi quelques équipements de radio, mais l’arrivée du transistor a très vite amorcé la disparition du poste à galène. De nombreux appareils fonctionnent au gaz avec bouteille, avec des installations qui n’étaient pas conformes. C’est en 1964 que l’organisme chargé de faire respecter les normes de sécurité a été créé, à la suite de multiples accidents et disjonctions intempestives, qui impliquaient la responsabilité d’EDF. Il s’est mis en place progressivement, et depuis plusieurs décennies aucune installation neuve ne peut être mise en service sans son sésame, qui atteste de la conformité.
Il était délicat de mener à bien nos tâches dans les familles, car nous devions pour cela faire le tour des habitations dans leurs moindres recoins, ce qui générait des suspicions. La communication était encore limitée, à cette période où les réseaux sociaux n’existaient pas, et on s’informait de tout ce qui se passait par le journal, la radio et les veillées entre voisins, autour du feu. C’est de ces discussions que partaient les nombreuses rumeurs, les commérages, du bouche-à-oreille, sans se soucier de la véracité des propos véhiculés. Cette forme de propagation d’informations persiste, mais elle a changé de support et de portée avec les réseaux sociaux. Même si elle reste similaire, elle peut créer en quelques heures des vagues de désinformation et d’émotions collectives. En même temps, il existe des plateformes de vérification des faits, malheureusement a posteriori, ce qui revient à dire que ces espaces virtuels sont tout aussi puissants, sinon plus que nos veillées campagnardes. Elles offraient l’avantage de permettre de se parler directement, autour d’un bon vin chaud.
En ce qui nous concerne, nous débarquons sans avoir été annoncés, et la crainte du voleur était de mise…
Notre outillage, lui, était assez sommaire et nous ne disposions pas de machines électro portatives pour percer et visser ni d’engins pour transporter les charges. Les trous dans les parpaings et le béton se réalisaient au tamponnoir, ou à l’aide d’un marteau et d’un burin, pour faire des percements dans les murs. Je partais le soir avec ma main gauche ensanglantée, la tête du marteau ratant régulièrement sa cible pour s’écraser sur mes doigts. Les plus anciens, qui étaient beaucoup plus habiles que moi, me rassurent comme ils pouvaient : « C’est le métier qui rentre, petit ! »
Nous disposions en principe de compagnons manœuvres, qui devaient se charger de ces dures tâches, mais ils n’étaient pas en nombre suffisant. D’autre part, puisqu’ils étaient pour la plupart issus du monde agricole et gagnaient chichement leur vie, ils ne venaient sur les chantiers que pour y glaner un complément de salaire. À la période des châtaignes, des champignons ou des morilles, nous avions l’avantage de bénéficier de leur générosité pour apprécier ces produits totalement bio ! Leur priorité restait la ferme, qu’ils tenaient le plus souvent avec leur épouse. Ils n’étaient donc pas présents tous les jours, et c’est en général aux apprentis qu’on demandait de remplacer la main-d’œuvre manquante.
Petit à petit, heureusement, l’entreprise a investi dans du nouvel outillage électrique. J’ai vu arriver les premières perceuses à percussion puis, sur le chantier de Tonnay-Charente, ce sont les premiers perforateurs qui ont fait leur entrée. Mais ils fuyaient de l’huile noire aux extrémités, et tombaient souvent en panne. Tous les travaux de second œuvre, en tous cas, étaient réalisés en apparent. Il fallait percer les dalles en béton, car rien n’était encastré à l’origine du coulage des dalles. Je précise que le percement des dalles en béton armé se faisait par le dessous pour éviter des éclats trop importants. Ces planchers en béton faisaient quand même 15 cm d’épaisseur, biceps et triceps assurés d’être bodybuildés.
Plusieurs très gros chantiers ont rythmé ces années…
La ZUP de La Rochelle
L’un de nos plus gros chantiers a été lié à la construction de logements dans la ZUP (Zone Urbaine Prioritaire) de La Rochelle. Nous étions dans une époque où la France recevait une multitude d’immigrés maghrébins, venus principalement d’Algérie ou du Maroc pour être engagés dans le bâtiment. Il fallait les héberger avec leur femme et leurs nombreux enfants… ainsi parfois qu’un troupeau de moutons ! J’en ai vu plusieurs, en effet, dans des appartements tout neufs !
À Mireuil, un quartier de La Rochelle, nous avons dû réaliser les travaux d’électricité de 250 maisons en raquette, ainsi que l’installation d’appareils de chauffage à air pulsé. Ils existaient déjà à l’époque, même si c’est au fioul qu’ils fonctionnaient. Autant dire que les émanations de ces engins étaient plutôt sympathiques… Toutes ces constructions étaient financées par les offices HLM, principal bailleur social en France dans ces années.
Le midi, c’est dans un immense réfectoire que nous nous retrouvions, à plus de cinquante ouvriers, pour nous restaurer. Chacun apportait avec lui sa gamelle, préparée la veille. Le lieu qui nous accueillait était mal chauffé, mais aussi très mal isolé, recouvert simplement de tôles ondulées. Les hivers étaient très rigoureux dans les années 60, malheureusement, avec des températures de – 5 à – 10º. Nous n’avions pas droit aux intempéries alors que ces périodes, pourtant, étaient reconnues par la fédération du bâtiment et permettaient aux maçons et à différents corps d’état d’être payés en restant à leur domicile. Mais pour nous et pour tous les métiers du second œuvre (sauf les plâtriers*, car l’eau gelait dans la gâche), aucune pause de ce genre n’était octroyée.
*Le plâtrier avait cependant une technique très personnelle et imparable pour éviter que l’eau de sa gâche ne gèle, il y soulageait sa vessie, efficace et écologique.
Il n’est pas inutile de se rappeler qu’à cette époque, les hivers étaient beaucoup plus longs et froids qu’aujourd’hui. D’ailleurs, le mois le plus glacial de tout le 20e siècle a été celui de janvier 1963, lorsque j’étais encore dans ma seconde année d’apprentissage.
Nous ne connaissions pas encore le Placoplatre, devenu très commun de nos jours, et tous les murs et plafonds étaient donc briquetés puis enduits au plâtre blanc et avec une autre catégorie, « l’ours blanc », pour les soubassements de murs exposés aux chocs, notamment dans les établissements scolaires et les hôpitaux. Quand on rénove de vieilles bâtisses, désormais, on retrouve encore ce type de construction très solide, mais aussi hélas très sonore, la brique étant un conducteur phonique naturel.
Le départ du chantier, le soir à 18 h, était un rituel que je n’ai jamais oublié. Nous accomplissions ce chemin du retour dans une camionnette bâchée du genre Peugeot 203 ou 403, emmitouflés dans notre pull-over. Le trajet dura une bonne heure, et nous ne pouvions éviter de respirer les gaz d’échappement, extrêmement noirs et polluants, produits par la combustion du diésel. Parfois, c’est dans un fourgon tôlé un peu plus confortable que nous prenions place. Mais nous restions assis sur des bancs en bois, en prise directe avec les trous et bosses de la route. Les nationales que nous empruntions alors n’étaient pas toujours très bien entretenues (phénomène récurrent encore en 2025), et la vitesse n’y était pas limitée, ce qui n’est plus le cas. Pour ne rien arranger, les véhicules étaient mal éclairés, freinaient très mal et souvent que sur une seule roue ! Le freinage brutal était donc proscrit au risque de visiter au mieux le bas-côté, au pire celui qui aurait eu la malchance de faire la même route à contresens.
Nous avions tout de même une tradition agréable, sur le parcours, qui consistait à nous arrêter à mi-chemin pour aller prendre un ballon de blanc, dans un bistrot. Il est bon de rappeler, toutefois, que l’alcool était un fléau terrible sur les chantiers, à cette époque. Les terrassiers, maçons, ferrailleurs et autres coffreurs terminaient bien souvent leur journée dans un état d’ébriété très avancé. Les accidents sur les chantiers ou lors des trajets, par conséquent, n’étaient pas rares.
L’usine Rhône-Poulenc, à Melle
Si un souvenir m’est resté profondément gravé de ce chantier de pétrochimie, c’est bien celui de mon bleu de travail entièrement raide, au point qu’il tienne debout tout seul par l’humidité ambiante dans la cabane « tunnel » en tôle ondulée, par – 10 ou – 12º ! Pour pouvoir l’enfiler, je devais allumer le chalumeau à gaz, et le dégeler… il en était de même pour les croquenots. Afin de nous réchauffer, en milieu de matinée et d’après-midi, nous avions la possibilité de boire un Viandox bien chaud dans un gobelet, avant de repartir aussitôt à notre besogne. En revanche, nous ne déjeunions plus sur le chantier, mais dans une pension de famille située à quelques kilomètres de notre base de travail.
Cette usine en structure totalement métallique était ouverte à tous les vents, et j’y faisais des pontés (pont en câblette de cuivre, avec une cosse sertie à chaque bout) pour assurer la continuité électrique des tuyauteries, en pontant la vanne de fermeture. Malgré la ventilation naturelle, nous subissions les odeurs nauséabondes ainsi que les jets de vapeur intermittents, avec le risque associé de se brûler le visage ou d’autres parties du corps. Sur place, c’est de l’alcool à 90º qui était produite, pour l’industrie pharmaceutique ainsi que des fabriques de spiritueux, comme Ricard. Cela a donné lieu à une anecdote amusante : lors de la maintenance, au mois d’août, nous vidangions les fonds de cuve en inox, pour concocter notre alcool anisé, une sorte de pastis avec 50 % d’eau distillée et des extraits d’anis achetés en Andorre ! Dire que c’était bon… mais c’était buvable ! C’était une consommation strictement personnelle et qui ne générait aucun business… en serait-il autant aujourd’hui ?
Le travail là-bas, cependant, était très dangereux, les dispositions SEVESO n’existant pas encore. Nous intervenions dans des zones à haut risque d’explosion, juchés sur de grandes échelles en bois ou en aluminium, et sans aucune mesure de protection. Notre tâche, alors, consistait à passer des câbles accrochés à des corbeaux métalliques, à 5 ou 6 mètres du sol. Pour ne rien arranger, j’ai toujours souffert du vertige, une pathologie dont on ne se guérit pas. En haut de ces échelles, j’étais donc soumis à de fortes angoisses !
Les câbles avec lesquels nous travaillions étaient en aluminium. C’était l’époque où Péchiney en faisait la « promotion », et ils étaient moins chers et plus légers que ceux en cuivre. En revanche, ils étaient plus compliqués à mettre en œuvre, en termes de connectiques.
Malgré les vicissitudes du métier, il y avait de bons moments. Pour exemple, cette petite anecdote sur un chantier voisin, où nous intervenions pour un tout autre travail sur des maisons individuelles. J’étais seul avec un chef, dont la description physique qui va suivre ne constitue pas du tout une atteinte à son intégrité ni une moquerie malsaine, mais correspond à un état naturel que lui-même se reconnaissait : un gabarit imposant par la taille, et surtout par le poids, qui le contraignait, notamment l’hiver, à arriver avec sa proéminence ventrale en plein courant d’air, sa jaune (cigarette au papier maïs) pendant du côté droit, et ayant raté le convoi des rasoirs Gillette du matin. Le coup de peigne était à la hauteur du moment, et il allait en pull ou chemise même par des températures négatives. Il avait toujours chaud, mon Lily (son nom de chef) ! Qu’à cela ne tienne, car bien sûr son arrivée était remarquée par tout le monde, y compris le patron. En effet, les derniers à partir de l’atelier, à cause du réveil mal réglé de Lily, c’était nous ! Notre véhicule attribué était une Renault 4L première génération de 27cv, qui atteignait péniblement les 100 km/h. Nous étions dans l’année 1965 ce jour-là, et partions en direction de Melle sur notre chantier de maisons individuelles. Ce véhicule en moyen/mauvais état devait supporter le poids de son chauffeur – bien plus du quintal, je le rappelle – et sa cigarette jaune en état de consumation permanente. Je lui servais d’allumeur de Gitanes jaunes, puisqu’au volant il ne pouvait pas se concentrer sur la longueur de la flamme du briquet, allant jusqu’à se roussir les sourcils.
Pour imager un peu la position du pilote, il remplissait de façon débordante le siège du conducteur de la 4L, le corps légèrement incliné sur le volant, les deux mains à 10h10, et avec l’instinct de se balancer d’avant en arrière au moment d’un dépassement, ayant le sentiment de faire ainsi avancer plus vite la pauvre 4L. Jusque-là, tout va bien… Pas un mot tout au long du parcours, mon Fangio restait concentré sur sa conduite, noyé dans ses pensées un peu enfumées par la « jaune » qui lui caressait le visage et le faisait tousser, d’où mes grands moments de solitude durant ces courts instants. Ses réflexions, d’ailleurs, étaient mimées de façon inaudible, mais visible sur ses lèvres, entre « la jaune » toujours là et l’autre partie de sa bouche. Je n’aurais su les interpréter, tant le message était indiscernable. Et au milieu de cela, en pleine ligne droite (fort heureusement, la DDE avait bien tracé la route à cet endroit), mon pilote est subitement tombé, son imposant train arrière ayant fait une chute de quelques centimètres sur le plancher de la voiture ! Les sangles en caoutchouc, qui constituaient l’essentiel de l’assise du siège, venaient de rompre sans préavis ! Il me faut reconnaître que, même seul, il m’a été difficile de ne pas m’esclaffer face au spectacle improvisé… lui n’a pas partagé mon amusement, cependant, car il manquait d’humour.
Nous avons poursuivi notre route, alors que son champ de vision était intercalé entre les branches du volant et le bas du pare-brise. Cela a été suffisant, heureusement, pour nous permettre d’arriver sans encombre, le voyage avait été passablement animé.
Au fond c’était un gentil, le Lily. Pas toujours très courageux, mais en revanche systématiquement à l’écoute de son transistor. Cet appareil le suivait partout, en particulier durant la période du tour de France, où il commentait avec d’autres compagnons le duel Anquetil-Poulidor.
C’est en cette fin d’année 1963, le vendredi 22 novembre, que le Président des États-Unis d’Amérique, John Fitzgerald Kennedy a été assassiné à Dallas. Je me souviens de l’arrivée tonitruante d’un camarade de l’entreprise, qui parlait en verlan, qui nous a crié haut et fort : « le présidit Kénédant est mort ! » Humour un peu décalé, s’il en était !
Bâtiments de casernement, en Poitou-Charentes:
J’ai travaillé plusieurs mois avec une autre équipe, qui intervenait dans les bâtiments de casernement, à Niort, Angoulême et Saint-Maixent-l’École (à l’ENSOA – École Nationale des Sous-Officiers d’Active). Notre rôle consistait à réaliser des installations électriques en tube d’acier, fileté et vissé à l’appareillage. Il s’agissait d’un travail très méticuleux, pour lequel il était nécessaire de tracer des lignes bien droites, fixer des colliers pour recevoir le tube en acier, et visser les boîtes de dérivation, les interrupteurs, et les prises de courant sur ces tubes filetés. Le filetage, ensuite, était exécuté par nos propres soins, avec une filière à manuelle sur un établi trépied. Toute erreur était interdite, car la moindre faute de calcul sur la longueur ou la destination nous aurait obligés à refaire la totalité du travail. C’est donc une expérience au cours de laquelle j’ai pu apprendre à œuvrer de manière extrêmement minutieuse, en mettant un gros accent sur la précision.
Dans les années 1962, nous ne disposions pas encore de gaines ou de tubes en matière plastique, et les conducteurs électriques étaient gainés avec du coton sous de la baguette en bois, ce qui s’appelait une moulure, ou bien du tube Bergman, du nom de l’inventeur allemand, avec une enveloppe en aluminium et un isolant intérieur en papier goudronné. C’était l’idéal pour prendre une décharge électrique ou, comme on le disait, « une bonne châtaigne ! »
En ce qui concerne mon apprentissage, j’allais tous les jeudis en cours de technologie. Ils étaient prodigués par un instituteur à l’école Gambetta, à Saint-Jean. Le soir, en rentrant des chantiers bien éreintés par ma journée, je filais au centre de formation, à quelques kilomètres à peine de chez moi, pour apprendre à souder. Ces cours étaient dispensés dans un lycée technique de 19h30 à 20h30/21 h. Cela me laissait juste le temps de dîner pour rejoindre mon lit, car le lendemain matin c’était le lever à 6h30. J’avais la volonté d’apprendre la soudure sous tous ses aspects, halogène et à l’arc. Je pressentais sûrement que le métier d’électricien ne remplirait pas toute ma curiosité professionnelle. Bien m’en a pris, car je me suis passagèrement orienté quelques années après sur la plomberie et le chauffage, où la soudure est un incontournable. Pour la petite histoire, j’avais construit un cabanon de jardin en tôle et cornière d’environ 2 m2, que j’avais préfabriqué et ensuite monté dans le jardin de mes parents, au bord de la Boutonne. Cette rivière débordant tous les hivers, elle envahissait alors tout l’outillage stocké dans mon abri. Je ne sais pas si depuis il a été classé « monument historique », mais le fait est que depuis, et aux dernières nouvelles, il est toujours resté debout, cela malgré les presque 60 ans qui ont passé et les inondations récurrentes.
Les conditions dans lesquelles nous déjeunions progressaient légèrement. Nous nous rassasions au restaurant, ou plus précisément dans une cantine améliorée qui préparait des plats peu raffinés. Mais elle nous permettait, au moins, de manger chaud et en bonne quantité. Ces repas étaient financés par la prime de panier, qui commençait à s’institutionnaliser dans les entreprises et était prise en charge par les employeurs. C’était menu unique, avec plusieurs entrées, un plat très consistant, le fromage, le dessert, et café et vin à volonté. Cela n’aidait pas nécessairement à optimiser le travail qui devait être réalisé l’après-midi !





























