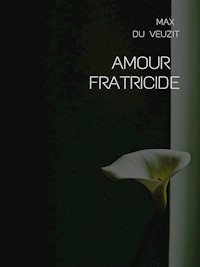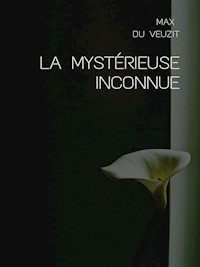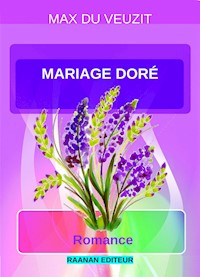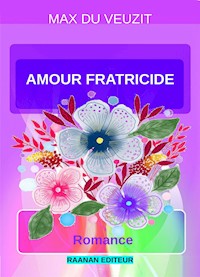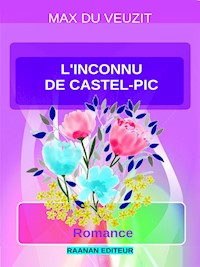2,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Unie, dans des circonstances étranges, à Yves Le Kermeur, Noële Sabatier découvre avec stupeur que son mariage. n'a été qu'une duperie. Aucune intimité, pendant leur lune de miel, n'existe entre les jeunes époux. Quels mobiles ont poussé Yves à vouloir, dans ces conditions, unir sa vie à la sienne ? Car c'est un homme inconnu d'elle, à peine entr'aperçu dans l'obscurité de la chambre nuptiale, qui lui prend les lèvres et lui mur-mure des mots d'amour. Quelle est l'identité du visiteur nocturne? Quand Noële la connaîtra, quand elle demandera des explications à son mari, ce dernier ne pourra que répondre : « Vous avez été pour lui "la tentation ". - Ainsi, répond-elle, vous m'avez offert vôtre nom alors que votre frère, qui m'aimait, lui, aurait voulu m'épouser et que ses horribles blessures, après l'avoir défiguré, ne le lui permettaient pas ? Maintenant, je veux partir d'ici, parce que je sais. - Vous ne le pouvez pas, Noële, car vous êtes ma femme. - Mais vous m'avez toujours dédaignée ! ». Il est des insultes, des humiliations qu'une épouse ne peut oublier. Yves saura-t-il retenir Noële, se faire pardonner son dédain ?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 267
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
L'homme de sa vie
Pages de titreIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIPage de copyrightMax du Veuzit
L’homme de sa vie
Max du Veuzit est le nom de plume de Alphonsine Zéphirine Vavasseur, née au Petit-Quevilly le 29 octobre 1876 et morte à Bois-Colombes le 15 avril 1952. Elle est un écrivain de langue française, auteur de nombreux romans sentimentaux à grand succès.
I
Noële Sabatier avait dix-neuf ans quand Narcisse Bonnet, son tuteur, vint la retirer définitivement de l’orphelinat où elle avait été élevée.
Sa mère était morte en lui donnant le jour et son père, chirurgien d’avenir, ne lui survécut que quelques années.
Il mourut, après la guerre, des suites d’une piqûre infectieuse contractée en opérant un blessé.
Il y eut des discours sur sa tombe, on parla de lui comme d’un héros victime du devoir. À titre posthume, on lui décerna même la croix de la Légion d’honneur ; mais il était sans fortune, et il laissait derrière lui une fillette de sept ans que nul parent ne se souciait d’élever.
Un chimiste, Narcisse Bonnet, alors âgé de soixante-trois ans, offrit de se charger de l’orpheline. Il avait beaucoup connu son père et, dans un mouvement de générosité dont l’enfant devait lui être toujours reconnaissante, il accepta sa tutelle et la sauva de l’Assistance publique.
Malheureusement, les meilleurs mouvements ne portent pas toujours en eux leur récompense.
La guerre venait de finir et, bien que sérieusement augmentée déjà, la vie chère ne sévissait pas encore aussi durement qu’elle devait le faire quelques années plus tard.
La profession de chimiste comporte beaucoup d’aléas et n’a pas la réputation d’enrichir son homme. Il faut croire qu’il en fut bien ainsi pour Narcisse Bonnet.
Noële connut auprès de lui quelques mois de tranquillité qui adoucirent ses débuts d’orpheline et lui permirent de ne pas désespérer de la vie.
Puis, subitement, avec l’augmentation des prix de toute espèce, la gêne parut sévir dans le logement du modeste chimiste, qu’une femme de ménage venait nettoyer chaque matin. En même temps, la présence de la fillette sous son toit apporta soudain une gêne et un embarras au vieux célibataire qu’était Narcisse Bonnet.
Une enfant, même sage et affectueuse, est toujours un lien qui entrave les mouvements.
Pour ne pas la laisser seule au logis, le soir, son tuteur devait se priver de sa partie de cartes au café.
Finis aussi les soirées au cinéma, les petits dîners qu’on déguste seul, en gourmet, dans un restaurant choisi, les consommations qu’on offre à une amie de rencontre pour s’illusionner encore sur ses succès de sexagénaire impénitent.
Fini, tout ça !
Et, quand c’est à cause d’une gamine de sept ans, sur laquelle on s’est trop facilement attendri, qu’on subit toutes ces petites privations, on regrette bien vite le beau geste qu’on a eu... Et, du regret, on passe encore plus vite aux moyens de revenir aux anciennes habitudes !
C’est ce qui arriva pour Narcisse Bonnet.
Six mois après la mort de Raoul Sabatier, le vieux chimiste faisait entrer sa fille au couvent Saint-Marc, à Nanterre, où, moyennant une modeste rétribution annuelle, elle était admise au milieu de trois cents autres fillettes orphelines et sans famille.
Durant de longues années, le tuteur parut oublier Noële. De rares fois, il vint la visiter ; mais, la plupart du temps, il se contentait d’envoyer, au début de l’année, la modeste indemnité qui représentait le prix de sa pension et de son entretien.
Elle resta à Saint-Marc jusqu’à l’âge de dix-neuf ans. Puis, un beau matin, son tuteur vint la chercher. Il était accompagné d’une femme d’un certain âge, qu’il lui présenta comme une sœur venue vivre auprès de lui.
La femme ne fut pas très sympathique, dès l’abord, à l’orpheline. Ses premiers regards la détaillèrent de la tête aux pieds, et il lui parut qu’il y avait de la malveillance dans son examen.
Les religieuses de Saint-Marc, qu’elle quitta les larmes aux yeux, lui permirent d’emporter ses modestes effets et les quelques souvenirs qu’elle avait mérités durant son si long internat.
Noële, au départ du couvent, était donc assez chargée et ses deux bras étaient encombrés d’un tas de paquets mal enveloppés et insuffisamment ficelés, qu’elle risquait de perdre à chaque détour du chemin.
Il eût donc été naturel que la sœur de Narcisse Bonnet lui offrît charitablement de se charger de quelques-uns.
Il n’en fut rien, et, ses précieux objets entassés contre elle, les bras largement ouverts pour les encercler tous, la jeune fille suivit le couple qui, par un tramway, la ramenait, après onze ans, au logis du vieux chimiste.
Ce n’était pas pour y rester, comme on le lui fit comprendre tout de suite.
– Vous ignorez peut-être, Noële, fit le vieillard, quelle est au juste votre situation. Je ne suis qu’un vieux bonhomme plongé dans mes bouquins, et c’est un fichu fardeau que j’ai pris à la mort de votre père en me chargeant de m’occuper de vous.
Elle courbait la tête, humblement, devant ce préambule qui présageait le pire.
– Je vous en suis profondément reconnaissante, balbutia-t-elle avec sincérité, mais gênée comme une coupable.
– Je ne vous demande pas de reconnaissance, riposta le vieil homme, un peu bourru. Le peu que votre père vous a légué a servi à vous élever jusqu’à l’âge de quinze ans. J’aurais pu, alors, vous faire travailler et vous auriez peut-être gagné votre subsistance. Je n’ai qu’un faible mérite : celui d’avoir voulu que vous terminiez vos études. Il m’aurait été désagréable de penser que la fille de Sabatier n’eût qu’une instruction élémentaire, quand son père avait été mon ami. Ce n’est pas pour vous que j’ai agi : c’est pour la paix de ma conscience.
– Mais, moi, monsieur, j’ai contracté une grande dette que...
– Ta ta ta ! Encore une fois, je ne vous demande rien... sinon de vous tirer d’affaire toute seule, à présent. Je suis vieux et mes moyens ne me permettent plus de nourrir une bouche inutile. Il faut que vous gagniez votre vie, désormais.
– Oui ! oui ! affirma-t-elle, toute confuse qu’il insistât si fort pour une question qu’elle trouvait naturelle et à laquelle elle était loin de vouloir se dérober. C’est mon plus vif désir ; dites-moi ce qu’il faut faire et je vous obéirai.
– Je n’attendais pas moins de votre bonne volonté, remarqua la femme sans aménité. Mais je connais les « jeunesses d’aujourd’hui » ! Toujours en l’air, toujours évaporées, elles ne tiennent pas en place et se trouvent mal partout. Or, mon pauvre frère n’a pas besoin de tout ce tintouin à son âge.
Un peu de honte fit rougir l’orpheline à la pensée d’appartenir à ces scabreuses « jeunesses d’aujourd’hui ».
– Je ferai de mon mieux, madame, affirma-t-elle de nouveau avec un pauvre geste d’humilité.
– Eh bien ! écoutez-moi, je vous ai trouvé une situation enviable, si vous savez vous y tenir... Je me suis renseignée, c’est une place sérieuse. Dans un château du Midi, on demande une personne instruite pour servir de secrétaire. Vous allez y aller.
– Dans le Midi ? fit Noële, effarée. Mon Dieu ! où m’envoyez-vous ?
– Qu’est-ce qui vous gêne d’aller là-bas ?
– Je n’ai jamais voyagé, avoua craintivement la jeune fille.
– Justement, ça vous apprendra à vous débrouiller seule ! Pour un début, c’est un salutaire exercice.
– Mais est-ce que je saurai aller si loin, toute seule ? insista piteusement l’orpheline.
– Vous êtes sotte, ma pauvre fille ! Quand on a une bonne adresse dans sa poche et qu’on dispose d’une langue pour demander sa route, on doit savoir se diriger. Vous allez donc partir là-bas, dès ce soir.
– Mon Dieu ! protégez-moi, balbutia l’enfant, alarmée par la perspective de ce voyage nocturne. Aller si loin ! sans avoir jamais voyagé !... Oh ! madame ! Conduisez-moi !
Un sanglot mal réprimé lui coupa la voix.
– Je ne suis jamais sortie seule, comprenez-vous, madame ?
– Allons ! intervint avec autorité la sœur du chimiste, vous êtes encore plus sotte que je ne me l’imaginais de croire que je pourrais vous accompagner à la Côte d’Azur ! Essuyez vos yeux, petite bourrique, et écoutez-moi sans m’interrompre. Votre train part ce soir, à neuf heures. Il vous déposera demain, vers quinze heures, à Nice. De là, un autre train vous conduira au village de Roquebillière, où se trouve le château de Montjoya.
Et, lui tendant un papier que Noële, effarée, prit sans protester davantage :
– Voici votre itinéraire... j’ai noté tous les renseignements ainsi que l’adresse exacte de l’endroit où vous devez aller. Enfin, voici une lettre d’introduction auprès de M. Le Kermeur, le propriétaire de Montjoya, qui demande un secrétaire. Serrez précieusement ces trois papiers dans votre poche et aidez-moi à réunir tous vos paquets, car vous ne pouvez voyager ainsi affublée !
Il en fut fait ainsi que la femme le désirait, Noële comprenant qu’il ne fallait pas essayer de discuter les ordres qu’on lui donnait.
Deux grands cartons, qui avaient contenu des robes, suffirent à caser la modeste lingerie, les minces effets et les bibelots de l’orpheline. Une bonne ficelle réunit le tout, faisant un paquetage très propre à porter.
Puis, la femme mit à part, dans un panier, du pain, du fromage et deux pommes.
– Vos provisions de bouche. Ne les mangez pas toutes d’un seul coup, car vous n’arriverez que demain, tard dans l’après-midi, à Roquebillière. Et votre bourse sera légère, les moyens de mon frère ne lui permettant pas de mieux remplir votre porte-monnaie.
Elle lui tendit pourtant une faible somme d’argent.
– Voici douze francs. Ne les dépensez pas, afin de pourvoir aux événements. Le prix de votre billet, en troisième classe, est un gros sacrifice que s’impose mon frère !... Et tâchez de vous plaire là-bas, ma petite, car il nous serait matériellement impossible de vous en faire revenir.
La jeune fille opina de la tête. Trop timide pour oser exprimer ses pensées, elle comprenait bien, néanmoins, que c’était le dernier secours qu’elle recevait de son tuteur, et qu’il ne faudrait plus jamais avoir recours à sa générosité.
Le vieil homme, cependant, eut un élan vers elle quand vint l’heure du départ.
– Ma petite Noële, fit-il en l’embrassant, soyez honnête et courageuse, comme votre brave père. Je regrette que mes moyens ne me permettent plus de m’occuper de vous davantage. Je suis vieux et j’ai besoin de ma sœur.
Il désigna la chambre où celle-ci était allée mettre son manteau pour conduire l’orpheline à la gare.
– Vous avez vu, continua-t-il, en baissant la voix ; elle ne veut plus que vous me donnez de l’embarras. Je crois qu’elle a raison et que, devant les difficultés de la vie chère, c’est une nécessité.
Il s’arrêta, hésita une seconde ; puis, après s’être assuré que sa sœur ne pouvait le voir, il ajouta, tout bas :
– Prenez ceci, Noële, et cachez-le pour qu’elle ne le découvre pas ; je ne veux pas vous savoir totalement démunie de monnaie ! Plus tard, quand vous aurez réussi, écrivez-moi pour me donner de vos bonnes nouvelles.
Malgré le singulier égoïsme de cette dernière recommandation, Noële embrassa chaleureusement le vieux chimiste.
Ce billet de cinquante francs qu’il venait de lui glisser dans la main, en cachette, devait représenter pour lui beaucoup de privations. Et soudainement la jeune fille se rendait compte qu’elle avait dû lui coûter bien des sacrifices jusqu’à ce jour.
Ce fut cette ultime impression de la bonté de son tuteur que l’orpheline emporta comme un viatique réconfortant, en quittant Paris. Seule au monde, désormais, il y avait eu pourtant quelqu’un de charitable pour se pencher vers sa détresse isolée et lui donner l’illusion d’une affection attentionnée.
*
Dans le coin du compartiment de troisième classe où la sœur du chimiste l’avait installée, Noële se faisait toute petite, un peu apeurée devant les visages inconnus qui l’entouraient.
Pourtant ses voisins immédiats, pas plus que la femme assise en face d’elle, ne paraissaient faire attention à sa modeste personne. Mais il y avait à l’autre extrémité du compartiment deux jeunes gens qui s’égayaient fortement.
Et parfois, il lui semblait que leurs yeux moqueurs se tournaient de son côté.
Elle était vêtue du costume de l’orphelinat de Saint-Marc, c’est-à-dire d’une grande blouse grise qu’ornait un simple col blanc. Un canotier de paille rigide dansait au-dessus de ses cheveux tirés en arrière par un chignon lourdement roulé sur la nuque. Enfin, ses pieds étaient chaussés de gros souliers cloutés, presque des godillots militaires.
L’ensemble n’avait rien d’élégant, loin de là, et cette tenue inesthétique ne parait Noële d’aucun charme.
Sans être coquette, la pauvre gosse se rendait compte de son accoutrement, mais elle n’y pouvait rien. Cette blouse, ce chapeau et ces souliers représentaient pour elle son costume du dimanche, et c’était tout ce qu’elle possédait de mieux dans sa garde-robe.
Au pensionnat, où toutes les fillettes, pareillement vêtues, portaient un uniforme, l’orpheline n’avait jamais eu à rougir de son costume. Mais dans ce train, roulant vers la Côte d’Azur, l’élégance des voyageurs ne lui échappait pas ; et, atrocement gênée de sa livrée de misère, elle se rencognait le plus possible dans l’angle du compartiment.
Ce fut pour elle un soulagement de voir ses compagnons de voyage s’assoupir sous une lampe mise en veilleuse.
Et, comme à chaque cahot du train son chapeau dansait, heurtait la vitre et lui tirait lamentablement les cheveux, elle osa le retirer et le mettre dans le filet.
La jeune fille s’était promis de veiller toute la nuit, tant la nouveauté de sa situation, au milieu d’inconnus, lui donnait de craintes ; mais, à l’âge de Noële, le sommeil a raison des plus grands soucis et, bientôt, elle s’endormit profondément.
Les cris des employés, les sifflets du train, les appels des voyageurs qui se pressaient autour du buffet, la réveillèrent en gare de Valence. Son estomac criait famine et Noële envia le chocolat chaud que les voyageurs absorbaient sur le quai, dans une grande tasse de carton. Sagement, elle se contenta d’un peu de pain tartiné de fromage. Puis, elle resta, le nez collé aux vitres, à voir défiler le paysage.
Après Marseille, la mer, qu’elle n’avait pas vue depuis sa prime enfance, la remplit d’admiration. Du train, la côte est splendide et emprunte mille aspects.
Noële resta debout, dans le couloir du wagon, afin de ne pas perdre la splendide perspective des flots bleus perpétuellement agités et de la Côte ensoleillée, où des milliers de somptueuses villas se nichent au milieu des fleurs, des palmiers et des sombres aloès.
Une déception, pourtant, attendait l’orpheline à Nice.
D’abord, il lui fallut changer de gare, la ligne qu’elle devait emprunter ne faisant pas partie de la même compagnie. Puis, quand elle eut gagné l’autre réseau, elle apprit avec un gros désappointement que les trains n’allaient plus jusqu’à Roquebillière, où elle devait descendre pour Montjoya.
– Bah ! conseilla l’employé tranquillement, gagnez toujours la Vésubie. Arrivée là, vous trouverez sûrement une voiture pour aller plus loin.
Le conseil était donné un peu légèrement, puisqu’il ne tenait pas compte de l’heure d’arrivée du train.
La nuit tombe vite au mois de février, et quand Noële arriva au terminus du petit train, il y avait déjà longtemps qu’il faisait complètement noir. Elle ne pouvait songer, eu pleine obscurité, à poursuivre sa route. D’ailleurs, à cette heure, il n’y avait plus de voitures allant vers Roquebillière.
Force lui fut donc de coucher à l’hôtel. Et, bien qu’elle sût se contenter d’une modeste chambre, d’un bol de soupe et d’une tartine de pain, cette dépense inattendue greva lourdement son budget et indisposa l’orpheline.
Mais quelle surprise au réveil !
Du Midi, Noële n’avait entrevu, jusqu’ici, que la grande mer bleue et les villas ensoleillées. N’ayant pour se guider dans ce long voyage que l’itinéraire dressé par la sœur de son tuteur, elle ne se rendait que vaguement compte de sa destination.
Aussi quand, levée de bon matin, selon son ordinaire, elle vit se dresser autour d’elle les sommets des Alpes maritimes, avec, à ses pieds, le Var et ses cailloux, pendant que sur l’autre rive se dressaient, tels deux châteaux forts, sur des arêtes de rocher, les villages de Bonson et de Gilette, l’orpheline se demanda soudain dans quelle région nouvelle sa destinée la guidait.
– La montagne ! bégaya-t-elle, étranglée d’émotion. La vraie montagne !
Jamais, encore, Noële n’avait vu si beau spectacle. Son âme en tressaillit d’une émotion intense faite d’admiration et d’enthousiasme, en même temps que sa jeunesse s’effara de ce monde nouveau qu’elle apercevait pour la première fois.
Dominant tout, et plus fort que l’attrait de la nouveauté, une peur irraisonnée la dressa contre l’inconnu qui l’attendait.
Ces flancs abrupts des montagnes, ces maisons espacées qui paraissaient nichées dans des creux de rocher, ces villages inaccessibles construits des siècles auparavant pour se défendre contre les hordes sauvages, comme contre des bêtes féroces, tout contribuait à effaroucher l’orpheline.
Une ardente prière glissa en elle vers le Maître de toutes choses.
– Mon Dieu ! protégez-moi, je suis si petite, et c’est l’immensité !
Voulant mieux se rendre compte de sa destination, elle entra dans l’une des boutiques du village, et acheta une carte de la région.
Quelques minutes après, la carte étalée sur une table de café, les sourcils froncés sous l’effort de l’attention, elle suivait du doigt le tracé de la route qui l’avait amenée jusque-là... de celle qu’elle devait suivre pour arriver à Montjoya !
Elle enregistrait les méandres du chemin et les altitudes le dominant. Comment son parcours suivait la vallée de la Vésubie, c’était en elle un soulagement de voir qu’il ne s’élevait pas trop vite.
– Néanmoins, comprit-elle, ça s’enfonce ! Roquebillière est tout à fait au milieu des montagnes... mon tuteur aurait pu me l’expliquer.
Elle songea aux bonnes religieuses et à ses compagnes de Saint-Marc qu’elle avait quittées deux jours auparavant, et il lui sembla qu’elle était aux antipodes de Paris.
– Comme c’est loin, mon Dieu ! Jamais je ne les reverrai... Ici, c’est tout à fait l’exil.
Et, insecte minuscule au milieu de la splendide et grandiose nature, attachée au sol comme un prisonnier enchaîné entre de hautes murailles, Noële leva la tête vers les nues azurées qui couraient librement.
Il lui parut que la contemplation du ciel la libérait de son malaise. Sous le beau ciel de Provence, ses inquiétudes s’estompaient. Un réconfort lui venait de là-haut !
« Tout de même, philosopha-t-elle avec courage, le firmament est le même qu’à Paris et, les étoiles, c’est pareil ! c’est toujours la France, quoi ! »
Alors ?
Cette contemplation bienfaisante lui faisait accepter l’aventure. Elle adoptait la région inconnue.
Puisque Montjoya il y avait, en route pour Montjoya !... et bravement, sans inutiles regrets !
*
Il était près de dix heures du matin quand le long autocar où Noële avait pris place la déposa à Roquebillière.
Seule, maintenant, au bord d’une grande route, avec ses deux cartons posés à terre, l’orpheline, un moment, regarda autour d’elle.
L’aspect du petit bourg avec ses maisons vieillottes, ses toits décolorés, ses rues cahoteuses et grimpantes, ne lui parut pas hostile. Une ceinture de montagnes aux flancs verdoyants bornaient l’horizon. À mi-hauteur, le village du Belvédère s’étageait coquettement au milieu de nombreuses villas. Sur la rive droite de la Vésubie, une petite église dressait son humble carcasse de pierre de taille, vestige d’une population disparue ; les lieux, somme toute, étaient agréables et accueillants.
Ne sachant vers quel point du paysage se diriger, l’orpheline interrogea un passant sur l’emplacement de Montjoya.
L’homme, un ouvrier agricole, s’arrêta et lui désigna un des plus hauts sommets au-delà de la vallée.
– Là-bas, le Montjoya.
Un instant, elle regarda, sans comprendre, la montagne sombre au sommet immaculé de neige qu’on lui désignait. Puis, devinant un malentendu, elle précisa :
– Je parle d’une maison qui appartient à M. Le Kermeur... Une maison qui s’appelle Montjoya.
L’homme parut chercher dans sa mémoire :
– Je ne vois pas... à moins que ce ne soit cette grande demeure qui se dresse de l’autre côté de la Gordolasque, vers Tres-Crous.
Il s’arrêta, eut un petit sifflement, puis reprit :
– Si c’est cette maison, c’est loin d’ici.
– De quel côté ?
– Là-bas, sur les hauteurs... tout à fait dans la montagne.
La jeune fille suivit du regard la direction qu’indiquait le bras de l’homme.
– De Saint-Rock, on voit la maison à vol d’oiseau. Pour y aller, faut passer par le Planet et Saint-Jean. Ce n’est pas ici, vous voyez.
– En effet ! fit Noële, interdite par tant de lieux inconnus.
– Mais il faut vous assurer que je ne confonde pas. Tenez, voici le facteur : il vous renseignera mieux que moi.
Interrogé à son tour, le nouveau venu confirma que Montjoya était situé sur l’autre rive de la Gordolasque, dans les rochers de la Traverse.
En riant, il observa :
– Sûr qu’il ne faut pas avoir peur de la solitude pour aller s’établir si loin de toute autre habitation ! C’est le désert, autour de Montjoya, la plus proche maison est située à deux heures de marche.
Et comme la jeune fille l’écoutait, sidérée, il continua, heureux de bavarder.
– Mon père a connu l’endroit dans sa jeunesse.
Il n’y avait que des pierres et quelques pans de murailles encore dressés. On prétend que ces vestiges dataient des Romains... quelque bastion défendant la vallée. Et voilà qu’à la fin du siècle dernier un original très riche est venu dans le pays. Il a acheté tout le plateau et a utilisé les pierres pour construire des bâtiments immenses. Un moment, il y eut jusqu’à trente domestiques et trois cents têtes de bétail, là-haut ! C’est énorme comme construction : une grande bâtisse et des tas de communs à l’entour. Tout ça au bout d’un plateau verdoyant et fertile. Le site est merveilleux, il y a un panorama splendide d’où l’on découvre plus de trente villages échelonnés sur les rives de la Vésubie et de la Gordolasque. Pour ça, il n’y a pas mieux situé : l’endroit est unique... lorsqu’on y est arrivé ! Parce que, pour y grimper, c’est une autre affaire. Une vraie route du diable... à moins que ça ne soit le chemin du Paradis !
Son gros rire, partagé par le villageois, éclata bruyamment comme s’il venait de faire une belle plaisanterie.
Mais le petit visage de Noële ne s’éclairait pas. Depuis quelques minutes même, sa mine s’allongeait terriblement.
– Je ne pourrai jamais aller si loin à pied. Et avec mon paquet, encore.
– On vous y attend ?
– Oui.
– M. Le Kermeur aurait pu envoyer une de ces voitures à votre rencontre. Avant la montée de la Traverse, il a installé un grand garage où sont remisées plusieurs autos, et il a un téléférique qui diminue sensiblement le trajet. Ce n’était pas du luxe de se mettre à votre disposition.
– M. Le Kermeur ignorait le jour exact de mon arrivée.
– Il aurait été sage de l’en prévenir.
– C’est trop tard, maintenant. Et je voudrais tant arriver avant la nuit. Comment faire pour aller là-bas ?
– Il faut trouver une voiture pour monter à Saint-Rock. Vous ne pourrez vous tromper ensuite, de partout on découvre les bâtiments de Montjoya.
– Mais cette voiture où la trouver ? Et, avoua-t-elle piteusement, si c’est trop cher, je ne pourrai payer.
Elle pensait à ses frais d’hôtel, à la somme exigée par le conducteur de l’autocar pour la conduire ici, et un serrement de cœur l’étreignait à la perspective d’une nouvelle dépense qui ferait fondre complètement ses derniers deniers.
– Écoutez, ma petite dame, fit le facteur aimablement, si vous voulez m’accompagner, on causera en route. Moi, je rentre au bureau ; mais en passant devant l’hôtel des Touristes, je pourrais voir s’il n’y a pas quelque client susceptible de monter au Belvédère. Dans votre intérêt, je ne vois rien de mieux à vous conseiller.
– Je ne demande qu’à suivre vos conseils, monsieur ; tout ce qui pourra abréger ma route sera une bénédiction.
Toutes ses craintes revenaient contre la montagne hostile. Elle songeait qu’en ce mois de février les jours étaient courts et froids. Pourrait-elle arriver à destination avant la nuit ?
Elle eut la chance, grâce au brave facteur, de pouvoir utiliser la voiture d’un voyageur de commerce qui allait dans la direction voulue.
Saint-Rock, qu’on lui avait montré du doigt sur le flanc d’une colline, lui avait paru assez rapproché.
Elle s’étonna des longs détours en zigzag et toujours en montant, qu’il fallait faire pour y parvenir.
Pour la première fois, elle eut l’impression de ce qu’était réellement la montagne, et la longueur des routes en lacets qui la sillonnaient. Et, quand son compagnon lui désigna du doigt, de l’autre côté d’un vallon, les murs de Montjoya, elle ne se réjouit pas d’être si près d’un but plus apparent que réel.
– Pour vous rendre service, je vais commencer ma tournée par l’extrémité du pays. Je vous déposerai au pied même du chemin qui mène à Montjoya.
Elle mit dans son remerciement toute la gratitude dont elle se sentait remplie pour tant de complaisance. Et, quand elle alla de l’avant, seule, enfin, sur le sentier pierreux et broussailleux qui grimpait les pentes escarpées, elle marcha gaillardement avec l’impression de toucher au terme de son voyage.
Au bout d’une heure, cependant, elle ne paraissait guère avoir avancé. Lorsqu’un endroit était assez découvert pour lui permettre d’examiner les alentours, elle avait l’impression qu’à ses pieds et tout près d’elle Saint-Rock se confondait avec Roquebillière, tandis que, là-haut, les bâtiments de Montjoya dormaient, très éloignés, sous le ciel bleu bordé de sites neigeux.
Une seconde heure de marche mit le comble à sa lassitude. Elle n’avançait plus qu’à petits pas, les pieds butant sur les cailloux pointus de la sente, les bras coupés par la charge de son paquet. Plusieurs fois déjà, elle s’était écroulée sur le sol durci, ne demandant avec effroi si elle aurait la force de se remettre debout et de reprendre la longue montée. Elle s’était crue bonne marcheuse, alors qu’elle manquait d’entraînement, et que sa longue claustration entre les murs de l’orphelinat faisait d’elle une anémiée malgré sa belle constitution.
Si longue que soit une route, pourtant, quand les pieds la grignotent pendant longtemps, on en voit toujours la fin.
Entre les grands arbres dénudés, Noële, après plus de trois heures de marche, vit soudain surgir une clarté. Bientôt elle fut sur le plateau où, dans l’air vif et transparent, Montjoya dressait vers les nues ses épaisses murailles de pierre grise et son donjon crénelé.
Ce fut en elle un soulagement.
Enfin ! Elle était arrivée !
Ses jambes étaient si lasses qu’elle s’assit un moment pour mieux reprendre haleine.
Un instinct de coquetterie la porta à essuyer son visage, à lisser ses cheveux bruns, à brosser de la main ses vêtements poussiéreux ; puis, le cœur battant et s’efforçant de vaincre son émoi, elle marcha vers la maison principale avec tant de lassitude qu’elle chancelait sur ses jambes.
Une vieille femme la précéda jusqu’à un cabinet de travail dont elle ouvrit la porte.
– Monsieur, une dame vous demande.
Dans la pénombre de cette fin d’après-midi d’hiver, Noële distingua un homme de trente à trente-cinq ans.
De dessus un gros livre qu’il compulsait, il leva les yeux vers l’arrivante.
– Monsieur Le Kermeur ? interrogea celle-ci timidement.
– C’est moi, mademoiselle ; vous désirez ?
Sans mot dire, elle tendit la lettre. Surpris, l’homme la prit et la lut. Un profond étonnement se répandit sur sa physionomie. Puis, Noële enregistra une sorte de crispation qui l’inquiéta.
– C’est insensé ! Je demande un secrétaire, je précise pour quels travaux et dans quel site nous sommes... Et l’on m’envoie une femme, une jeune fille ! Qu’est-ce qu’on veut que je fasse de vous ici, ma pauvre enfant ?
– Je puis faire le même travail que n’importe quel autre secrétaire.
– Il n’y a pas de place sous mon toit pour une secrétaire de votre âge ! C’est tout à fait ridicule, et je regrette de vous décevoir, mais il m’est impossible de vous accepter.
– Oh ! balbutia Noële, qui croyait voir soudain tous les objets tourner autour d’elle. Cela ne veut pas dire que vous me renvoyez ?
– Je ne puis vous garder, cependant, mademoiselle.
– Je suis venue parce que vous demandiez quelqu’un, monsieur.
– Évidemment, mais vous ne faites pas du tout mon affaire.
– J’ai mes diplômes, mon bachot... je parle anglais.
– Connaîtriez-vous le chinois que ma réponse serait la même : je ne veux pas de femme chez moi. Cela est péremptoire et ne souffre aucune exception.
La voyageuse courba la tête, désolée de sa malchance, de sa lassitude... de cette réception... Tout dansait devant ses yeux et elle crut qu’elle allait s’évanouir, dans ce bureau, aux pieds de cet homme sans pitié.
Le dos appuyé au mur, elle restait debout, les yeux clos, si pâle qu’elle aurait attendri le moins sensible des cœurs.
Mais l’homme ne faisait déjà plus attention à elle. La tête replongée, à nouveau, dans ses bouquins, il paraissait avoir oublié la présence de la visiteuse.
Cependant, comme celle-ci ne bougeait pas, il appuya son doigt sur un bouton électrique. Et la servante accourue à son appel, il ordonna :
– Reconduisez mademoiselle.
Noële eut le désir de l’implorer. Elle tendit les mains vers lui, mais il ne la regardait pas, et elle comprit combien toute insistance serait vaine.
Alors, en titubant, elle suivit machinalement la femme qui la reconduisait dehors.
Quand la jeune fille, son paquet sous le bras, se retrouva sur le bord du sentier, ses forces l’abandonnèrent tout à coup et elle s’écroula, terrassée par la fatigue autant que par sa déception.
Cet écrasement de tout son être lui fut bienfaisant ; quelques larmes qu’elle versa ensuite la soulagèrent de son énervement. Bientôt elle put s’asseoir, et, la tête dans les mains, elle essaya d’envisager sa situation.
Hormis Montjoya qu’on venait de lui interdire, elle était éloignée de tout lieu habité et dans l’impossibilité physique de gagner à pied une autre habitation.
D’ailleurs, qu’aurait-elle fait au Belvédère ou à Roquebillière ? Point n’était besoin de sonder les flancs de son porte-monnaie pour savoir qu’il ne contenait plus de quoi payer un gîte.
D’un autre côté, son tuteur lui avait défendu de recourir à lui, et même, en supposant qu’il consentit encore quelque secours, son envoi parviendrait trop tard, comme l’aide des religieuses de l’orphelinat qu’elle pourrait peut-être implorer.
C’était tout de suite qu’elle avait besoin d’assistance, et, dans cette nature sauvage, à cette heure et en cette saison, l’abandonnée ne voyait aucun appui à espérer.
En dehors du château, il n’y avait pour elle aucun refuge.
Pauvre être passif, on lui avait dit de partir et elle s’était mise en route, obéissant à la directive donnée. Son but était d’atteindre M. Le Kermeur, et elle était venue jusqu’à lui...
Où voulait-on qu’elle aille, maintenant ? Vers quelle destination porter ses pas ?
Il ne lui paraissait même pas qu’elle eût à chercher autre part.
D’ailleurs, les bois étaient sombres à cette heure. Déjà, le sentier ne s’y distinguait plus et la montagne apparaissait dangereuse avec ses pentes à pic et ses gigantesques échancrures.
Quant à la vallée, séjour des hommes heureux, des foyers tièdes, des habitations closes la nuit, un grand brouillard sombre l’envahissait peu à peu, et les moindres recoins s’ouataient de brume.
Bientôt, la montagne elle-même s’ensevelirait d’ombre.
Une peur atroce fut en Noële : celle de passer la nuit dehors, perdue dans cette immensité. Frissonnante, les bras croisés sur sa poitrine dans un geste d’instinctive défense, elle se leva et regarda autour d’elle.
Bien que ses jambes fussent raides et ses pieds douloureux, abandonnant sur place son paquet, la jeune fille longea l’enclos de pierres entassées qui bordaient, de ce côté, l’immense propriété.
Les aboiements des chiens, dans leurs niches, signalèrent, au passage, sa présence inquiétante en ces lieux.
Voyons, n’y aurait-il pas dans cette grande demeure un être humain qui aurait pitié de sa détresse et la sauverait des ténèbres ?
Jamais comme en cette circonstance, elle n’avait tant souffert d’être seule au monde.
Elle pensa à sa mère dont elle n’avait jamais connu les caresses.
Dieu ne pouvait pas permettre qu’en son paradis une mère se désintéressât de l’enfant laissée sur la terre.
De là-haut, cette mère lui devait protection. Et l’orpheline eut vers la morte cet appel désespéré :
« Oh ! ma mère, ne m’abandonnez pas. Vous qui avez payé ma naissance de votre vie, pouvez-vous m’oublier en une pareille détresse ? »
Cette certitude que sa mère morte avait encore des devoirs à remplir vis-à-vis d’elle lui fit dresser la tête vers le ciel, comme si, au-delà des nues, son regard avait pu monter jusqu’à Dieu et lui réclamer l’assistance qu’il devait à toute créature humaine pour le seul fait de l’avoir créée.
Des vers qu’elle avait répétés autrefois, à l’école maternelle, revinrent à sa mémoire et furent doux à son cœur.
Aux petits des oiseaux, Dieu donne la pâture...
Laisse-t-il ses enfants jamais dans le besoin ?
Phrases d’espoir qui, malgré l’hostilité des choses, lui faisaient croire à un secours inattendu.
Dans la cour, derrière la maison, Noële vit un hangar rempli de paille. Elle songea que l’obscurité venue, elle se glisserait entre les bottes et y reposerait chaudement, sinon tranquillement, car elle avait l’effroi instinctif des ténèbres.
Elle repéra bien l’endroit, puis elle revint vers son paquet auprès duquel elle se rassit, moins découragée de savoir où, à défaut d’autre abri, elle pourrait passer la nuit.
Un restant de pain, que Nicole tira de son paquet, fut tout ce qu’elle prit comme nourriture, elle en aurait volontiers dévoré trois fois plus, mais c’était tout ce qui restait de ses maigres provisions.
La jeune fille achevait minutieusement de ramasser les miettes tombées sur ses genoux, quand, dans la pénombre, une forme féminine se dressa devant elle.
– Le maître m’envoie vous chercher. Il a dit que vous ne pouviez rester ici, cette nuit. Vous dormirez à Montjoya.
L’orpheline suivit tout naturellement la femme, comme si elle s’attendait à cette tardive charité... N’était-ce pas, au fond, le secours divin qu’elle avait escompté ?
Mais elle ne s’illusionnait pas : elle savait que les mêmes difficultés se dresseraient pour elle le lendemain matin.
Pour l’instant, dans sa tête affaiblie par la fatigue et la misère, une seule chose dominait et la plongeait dans une béatitude : elle allait coucher à l’abri... dans un lit, sous un toit... auprès d’êtres civilisés, et protégée contre les bêtes sauvages de la montagne mystérieuse.