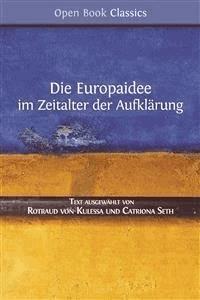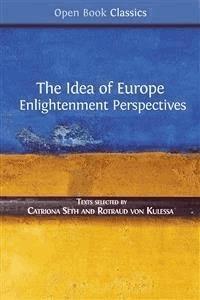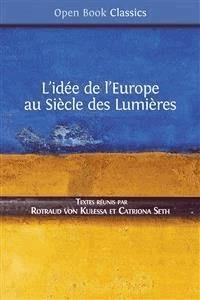
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Open Book Publishers
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Französisch
Face aux défis – entre autres politiques – auxquels sont confrontés différents pays européens, les chercheurs dix-huitiémistes ont souhaité revenir sur des expressions anciennes de valeurs partagées et les interrogations passées sur des questions qui restent souvent d’actualité. Au Siècle des Lumières, nombre d’hommes et de femmes de lettres ont envisagé l’avenir du continent en particulier pour entériner leur souhait de garantir la paix en Europe. Les textes, réunis dans cette anthologie, et signés des grands écrivains du temps (Rousseau, Montesquieu, Voltaire, Kant, Hume ou encore Staël), comme d’oubliés de l’histoire, présentent, avec quelques excursus chronologiques (de Sully à Hugo) les réflexions de penseurs d’un dix-huitième siècle aux bornes chronologiques étendues – l’émergence et la chute de l’Empire engendrent des bouleversements nombreux –, sur l’Europe, son histoire, sa diversité, mais aussi sur ce qu’ont en commun les nations qui composent, dans leur variété, un ensemble géographique. Ils mettent en évidence les origines historiques d’un projet d’union européenne, le souhait de consolider les liens du continent avec le Maghreb ou la Turquie, l’importance accordée au commerce et les inquiétudes suscitées par les sursauts de l’histoire, mais aussi l’espoir placé dans les générations futures.La Société française d’étude du XVIIIe siècle, l’Université d’Augsburg, l’Université d’Oxford ont généreusement contribué à la publication de ce volume.In view of the challenges—many of which are political—that different European countries are currently facing, scholars who work on the 18th century have compiled this anthology which includes earlier recognitions of common values and past considerations of questions which often remain pertinent nowadays. During the Enlightenment, many men and women of letters envisaged the continent’s future in particular when stressing their hope that peace could be secured in Europe. The texts gathered here, and signed by major thinkers of the time (Rousseau, Montesquieu, Voltaire, Kant, Hume or Staël for instance), as well as by writers history has forgotten, present the reflections, with a couple of chronological extensions (from Sully to Victor Hugo) of authors from the long eighteenth century—the French Empire and the fall of Napoleon generated numerous upheavals—on Europe, its history, its diversity, but also on what the nations, which, in all their diversity, make up a geographical unit, have in common. They show the historical origins of the project of a European union, the desire to consolidate the continent’s ties to the Maghreb or to Turkey, the importance granted to commerce and the worries engendered by history’s convulsions, but also the hope vested in future generations.The Société française d’étude du XVIIIe siècle, Augsburg University and the University of Oxford have generously contributed towards the publication of this volume.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
L’IDÉE DE L’EUROPE
L’idée de l’Europe
au Siècle des Lumières
Textes réunis par Rotraud von Kulessa et Catriona Seth
https://www.openbookpublishers.com
© 2017 Rotraud von Kulessa et Catriona Seth
Cet ouvrage est licencié sous une licence internationale Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0). Cette licence vous autorise à partager, copier, distribuer et transmettre l’ouvrage à des buts non commerciaux, à condition de l’attribuer à son auteur (sans pour autant laisser entendre qu’il vous soutient ou qu’il soutient votre utilisation de l’ouvrage). Toute attribution doit comporter l’information suivante :
Rotraud von Kulessa et Catriona Seth (éd.), L’idée de l’Europe au Siècle des Lumières. Cambridge, Royaume Uni : Open Book Publishers, 2017. https://doi.org/10.11647/OBP.0116
Pour accéder à des informations détaillées et mises à jour sur cette licence, merci de vous rendre ici : http://www.openbookpublishers.com/product/610#copyright
Des détails supplémentaires sur les licences CC BY sont disponibles ici : http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Tous les liens externes étaient fonctionnels au moment de publication et ont été archivés via Internet Archive Wayback Machine à https://archive.org/web
Le matériel numérique et les ressources associés à ce volume sont disponibles à https://www.openbookpublishers.com/product/610#resources
Tous les efforts ont été faits pour identifier et contacter les détenteurs de droits d’auteur et toute omission ou erreur sera corrigée si une notification est faite à l’éditeur.
La Société française d’étude du XVIIIe siècle, l’Université d’Augsburg, l’Université d’Oxford ont généreusement contribué à la publication de ce volume.
Ceci est le sixième volume de notre série Open Book Classics.
ISSN (Imprimé) : 2054-216X
ISSN (Numérique) : 2054-2178
ISBN Broché : 978-1-78374-343-8
ISBN Relié : 978-1-78374-344-5
ISBN Numérique (PDF) : 978-1-78374-345-2
ISBN ebook Numérique (epub) : 978-1-78374-346-9
ISBN ebook Numérique (mobi) : 978-1-78374-347-6
DOI : 10.11647/OBP.0116
Image de couverture: Cannibal Queen, Colours (2011), https://www.flickr.com/photos/cannibal_queen/5791733736/. Couverture conçue par Heidi Coburn.
Tout le papier utilise par Open Book Publishers est certifié par les programmes de ressources renouvelables SFI (Sustainable Forestry Initiative) et PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes).
Imprimé au Royaume Uni, aux États-Unis et en Australie par Lightning Source pour Open Book Publishers.
Table des matières
Pour faciliter les repérages du lecteur, nous avons donné aux extraits des titres qui figurent en gras après l’indication du nom de l’auteur et du texte dont est tiré le passage.
Préface
1
1.
Friedrich Schiller, « Ode à la joie »
Un hymne pour l’Europe
5
2.
Maximilien de Béthune, duc de Sully, Mémoires
Le grand dessein d’Henri IV
7
3.
Charles-Irénée Castel de Saint Pierre, Projet pour rendre
la paix perpétuelleL’Europe : un projet pour la paix
10
4.
Jean-Jacques Rousseau, Extrait du Projet de paix perpétuelle
Examen du projet de l’abbé de Saint-Pierre
13
5.
Emmanuel Kant, Essai philosophique sur la paix perpétuelle
La paix universelle
18
6.
Charles-Irénée Castel de Saint Pierre, Projet pour rendre la paix perpétuelle
Quelle dimension donner à l’Union européenne ?
21
7.
Jean-Jacques Rousseau, Jugement sur la paix perpétuelle
L’Union européenne : un projet peu réaliste ?
23
8.
Edward Gibbon, Histoire de la décadence et de la chute de l’Empire romain
Voir au-delà des limites nationales
25
9.
Louis de Jaucourt, Article « Europe » dans l’Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers
L’Europe dans l’Encyclopédie
26
10.
Diego de Torres Villarroel, Voyage fantastique du Grand Piscátor de Salamanque
La géographie de l’Europe
29
11.
Anonyme, Supplément à l’Encyclopédie
Histoire et enjeux politiques
30
12.
Maximilien de Béthune, duc de Sully, Mémoires
Un Parlement européen avant la lettre ?
33
13.
Charles-Irénée Castel de Saint Pierre, Projet pour rendre la paix perpétuelle
L’Europe et l’Islam
35
14.
Voltaire, Essai sur les mœurs
La richesse de l’Europe : son héritage culturel !
36
15.
Marie-Jean-Antoine-Nicolas de Caritat de Condorcet, Esquisse d’un tableau historique des progrès de l’esprit humain
Régler pour apaiser
38
16.
Charles-Irénée Castel de Saint Pierre, Projet pour rendre la paix perpétuelle
Le voisinage de la Russie
39
17.
Voltaire, Le siècle de Louis XIV
L’Europe chrétienne comme grande République ?
40
18.
Louis-Antoine Caraccioli, Paris, le modèle des nations étrangères ou l’Europe française
L’unité dans la diversité ?
41
19.
Charles-Louis de Secondat, baron de La Brède et de Montesquieu, L’Esprit des lois
Le commerce européen
43
20.
Charles-Irénée Castel de Saint Pierre, Projet pour rendre la paix perpétuelle
La tolérance religieuse
46
21.
Louis-Antoine Caraccioli, Paris, le modèle des nations étrangères ou l’Europe française
La richesse de la cuisine européenne
48
22.
Charles-Louis de Secondat, baron de La Brède et de Montesquieu, Lettres persanes
L’Europe vue par les Persans
50
23.
Germaine de Staël, De la littérature considérée dans ses rapports avec les institutions sociales
La littérature du Nord au Sud
53
24.
François-Ignace d’Espiard de La Borde, Esprit des nations
Des caractères nationaux
56
25.
Louis-Antoine Caraccioli, Paris, le modèle des nations étrangères ou l’Europe française
La diversité linguistique en Europe
59
26.
August Wilhem Schlegel, Résumé des rapports européens de la littérature allemande
Le rôle de l’Allemagne dans la culture européenne
61
27.
Gabriel-François Coyer, Voyage d’Italie et de Hollande
L’enlèvement d’Europe
63
28.
Charles-Irénée Castel de Saint Pierre, Projet pour rendre la paix perpétuelle
L’union économique ?
64
29.
Charles de Villers, Constitutions des trois villes libres-hanséatiques
Un marché commun européen
66
30.
Stanislas Leszczynski, Entretien d’un Européen avec un insulaire du Royaume de Dumocala
L’empire de la raison
69
31.
Tomás de Iriarte, « Le Thé et la Sauge », Fables littéraires
La circulation des richesses
71
32.
Louis-Antoine Caraccioli, Paris, le modèle des nations étrangères ou l’Europe française
La sociabilité européenne
73
33.
Charles-Irénée Castel de Saint Pierre, Projet pour rendre la paix perpétuelle
La Sûreté des frontières de l’Europe
76
34.
Marie Leprince de Beaumont, Magasin des adolescentes
L’Europe coloniale
77
35.
Louis-Jules Barbon Mancini-Mazarini-Nivernois, duc de Nevers, Fables de Mancini-Nivernois
Une autre voie pour l’éducation ?
79
36.
Louis-Antoine Caraccioli, Paris, le modèle des nations étrangères ou l’Europe française
L’importance du commerce
81
37.
Johann Gottfried Herder, Idées sur la philosophie de l’histoire de l’humanité
Diversité et unité de l’Europe
83
38.
Françoise de Graffigny, Lettres d’une Péruvienne
Critique des mœurs européennes
85
39.
David Hume, Discours politiques
La civilisation européenne
87
40.
Louis-Antoine Muratori, Traité sur le bonheur public
Le progrès de la justice en Europe
89
41.
Louis-Antoine Caraccioli, Paris, le modèle des nations étrangères ou l’Europe française
Rapprochement des Européens
91
42.
Germaine de Staël, Corinne ou l’Italie
L’Italie et les origines de la culture européenne
94
43.
Marie-Anne du Boccage, Lettres sur l’Angleterre, la Hollande et l’Italie
L’Europe et la mode française
96
44.
Friedrich Schlegel, Voyage en France
L’Europe entre déclin et renouveau
97
45.
Charles-Irénée Castel de Saint Pierre, Projet pour rendre la paix perpétuelle
Richesse linguistique de l’Europe
99
46.
Novalis, La Chrétienté ou l’Europe
Un avènement spirituel
100
47.
Louis-Antoine Caraccioli, Paris, le modèle des nations étrangères ou l’Europe française
Le café : endroit de sociabilité européen
102
48.
Johann Gottfried Herder, Idées sur la philosophie de l’histoire de l’humanité
Le bonheur en Europe
105
49.
Germaine de Staël, De l’Allemagne
Aux origines de l’unité européenne
107
50.
José Cadalso, Lettres marocaines
La diversité européenne à travers le regard étranger
108
51.
William Robertson, Histoire du règne de l’empereur Charles-Quint
Navigation et échanges commerciaux
110
52.
Johann Gottfried Herder, Idées sur la philosophie de l’histoire de l’humanité
L’Europe et sa longue histoire de migrations
113
53.
William Robertson, Extraits de l’Introduction à l’histoire de Charles-Quint
L’union dans la diversité
115
54.
Diego de Torres Villarroel, « Sonnet », Divertissements de la Muse
L’Europe, unité politique
116
55.
Louis-Antoine Caraccioli, Lettres récréatives et morales sur les mœurs du temps
À quoi ressemblent les Européens ?
117
56.
James Boswell, Journal d’un tour des Hébrides avec Samuel Johnson
Se vouloir cosmopolite
118
57.
Louis-Antoine Caraccioli, Paris, le modèle des nations étrangères ou l’Europe française
L’Europe à l’heure française
119
58.
David Hume, Discours politiques de Monsieur Hume
Équilibre des pouvoirs et paix future
120
59.
José Cadalso, Lettres marocaines Une république des savants
124
60.
Jean-Charles Simonde de Sismondi, De la littérature du Midi de l’Europe
L’Europe dépassée à l’avenir ?
125
61.
Germaine de Staël, De l’Allemagne
L’union des philosophes
126
62.
Louis-Antoine-Léon de Saint-Just, « Discours de 1794 »
Une idée neuve en Europe
127
63.
Marie-Jean-Antoine-Nicolas de Caritat de Condorcet, Esquisse d’un tableau historique des progrès de l’esprit humain
Une vision humanitaire
128
64.
Jean-François Melon, Essai Politique sur le Commerce
Atteindre l’équilibre des pouvoirs
129
65.
Jean-Jacques Rousseau, Considérations sur le Gouvernement de Pologne
Vers une uniformisation culturelle ?
130
66.
José Cadalso, Lettres marocaines
L’Europe et l’Afrique
131
67.
Emmanuel Kant, Idée d’une histoire universelle du point de vue cosmopolitique
L’accomplissement des buts de la Nature
133
68.
Napoléon, cité par Emmanuel-Auguste-Dieudonné-Marius de Las Cases, Mémorial de Sainte-Hélène
Gouverner l’Europe?
135
69.
Marie-Jean-Antoine-Nicolas de Caritat de Condorcet, Esquisse d’un tableau historique des progrès de l’esprit humain
Connaître le monde pour le rendre meilleur
136
70.
Benjamin Constant, De l’esprit de conquête et de l’usurpation dans leurs rapports avec la civilisation européenne
La fin des guerres en Europe ?
137
71.
Napoléon, cité par Emmanuel-Auguste-Dieudonné-Marius de Las Cases, Mémorial de Sainte-Hélène
Visions d’avenir
139
72.
José Cadalso, Lettre à Tomás de Iriarte
Critique de l’eurocentrisme
140
73.
Napoléon, Correspondance de Napoléon Ier
Hégémonie politique et union européenne
141
74.
Alexandre-Frédéric-Jacques de Masson de Pezay, Les soirées Helvétiennes, Alsaciennes et Franc-Comtoises
L’Europe sans frontières
142
75.
Jean-Charles Simonde de Sismondi, De la littérature du Midi de l’Europe
Des Influences multiples
143
76.
Jean de Müller, Lettres de Jean de Müller à ses amis MM. de Bonstetten et Gleim
Quel avenir pour l’Europe ?
144
77.
Benjamin Constant, De la liberté des anciens comparée à celle des modernes
Le caractère des échanges modernes
146
78.
Pierre-Simon Laplace, Exposition du système du monde
L’Unité par les mesures
148
79.
Victor Hugo, « Le Rhin »
Le couple franco-allemand comme pilier de la paix en Europe
149
Bibliographie
153
Didier Robert de Vaugondy, Atlas Universel (1737), carte n°14. © Bibliothèques-Médiathèques de Metz ATR 5132
Préface
© 2017 Rotraud von Kulessa et Catriona Seth, CC BY 4.0 https://doi.org/10.11647/OBP.0116.01
Le 25 mars 2017, le traité de Rome, qui jetait les bases d’une communauté économique européenne, a fêté ses 60 ans. Au Palazzo dei Conservatori, sur le Capitole, des représentants de six pays — les trois nations du Benelux, l’Allemagne de l’Ouest, la France et l’Italie — s’étaient réunis dans un climat de confiance pour mettre sur pied un accord international. Universitaires, juristes, diplomates, les douze signataires, dont certains étaient entrés en résistance ou avaient été emprisonnés pendant la guerre, entendaient renforcer les liens entre leurs pays et contribuer, par les échanges commerciaux, à stabiliser le continent. Or, six décennies plus tard, l’Union Européenne, qui compte désormais 28 États-membres (ou bientôt 27, avec le retrait britannique à l’horizon) doit affronter des réserves croissantes face au projet qui lui a donné le jour et à son expression. Le scepticisme est désormais dans l’air du temps, où que l’on regarde. Il est parfois nourri par un populisme qui cherche, par le retour aux particularismes et aux nationalismes, le salut d’une partie de la population dépassée par la mondialisation.
Face aux défis actuels — entre autres politiques — auxquels sont confrontés différents pays européens, les chercheurs dix-huitiémistes européens ont souhaité revenir sur des expressions anciennes de valeurs partagées et les interrogations passées sur des questions qui restent souvent d’actualité. Au Siècle des Lumières, nombre d’hommes et de femmes de lettres ont envisagé l’avenir du continent en particulier pour entériner leur souhait de garantir la paix en Europe. Les textes qui suivent, signés des grands auteurs du temps (Rousseau, Montesquieu, Voltaire, Kant, Hume ou encore Staël), comme d’oubliés de l’histoire, présentent, avec quelques excursus chronologiques (de Sully à Hugo) les réflexions de penseurs d’un dix-huitième siècle, aux bornes chronologiques étendues — l’émergence et la chute de l’Empire engendrent des interrogations nombreuses —, sur l’Europe, son histoire, sa diversité, mais aussi sur ce qu’ont en commun les nations qui composent, dans leur variété, un ensemble géographique. Ils mettent en évidence les origines historiques de l’idée d’union européenne avec des textes comme le Projet pour rendre la paix perpétuelle en Europe (1713). L’abbé de Saint-Pierre, auteur de cet essai, tente de proposer une solution novatrice aux convulsions violentes qui ont secoué son pays, la France, et les États voisins au moment de la guerre de succession d’Espagne : une union plutôt qu’un équilibre des puissances, et une association de la Turquie ou des pays du Maghreb pour les intégrer aux réseaux commerciaux, plutôt que de les en exclure. Il défend ce qu’il appelle « un Traité de Police suprême, ou d’Arbitrage européen, qui tienne toutes les parties de l’Europe unies en un même Corps. »
Comme lui, d’autres proposent des plans, relèvent des temps forts du passé, imaginent des développements futurs. Parfois ils se fourvoient, comme nous l’apprend le recul de deux siècles. Ils expriment à l’occasion des idées que nous ne partageons pas toujours ou qui paraissent désormais caduques. Ils ont en commun d’avoir voulu réfléchir à ce qui fait l’Europe dans sa bigarrure comme dans sa singularité, et aux manières d’en envisager l’avenir, d’en avoir célébré la diversité, d’en avoir souhaité, souvent, l’union.
Si au début du XIXe siècle l’idée de l’existence de caractères nationaux et d’identités y afférant continue de se frayer un chemin, des penseurs comme Germaine de Staël — à qui le prince de Ligne écrit « C’est bien pour vous qu’on pourrait mettre sur l’adresse : Au génie de l’Europe » —, ou encore Victor Hugo, qui envisage un modèle fédéral à l’américaine, n’arrêteront pas d’insister sur l’importance de l’unité européenne pour désamorcer les conflits futurs. Dans son célèbre discours au Congrès de la Paix de 1849, annonçant une époque où une guerre entre Paris et Londres, entre Pétersbourg et Berlin, entre Vienne et Turin paraîtrait aussi absurde et impossible qu’entre Rouen et Amiens ou Boston et Philadelphie, Hugo se faisait le héraut d’un avenir radieux : « Un jour viendra où la France, vous Russie, vous Italie, vous Angleterre, vous Allemagne, vous toutes, nations du continent, sans perdre vos qualités distinctes et votre glorieuse individualité, vous vous fondrez étroitement dans une unité supérieure, et vous constituerez la fraternité européenne, absolument comme la Normandie, la Bretagne, la Bourgogne, la Lorraine, l’Alsace, toutes nos provinces, se sont fondues dans la France. » Il donnait le nom d’États-Unis d’Europe à ce qui correspond aux visions des fédéralistes de notre siècle. Il imaginait les progrès de la technique accompagnant ces avancées fraternelles : « Grâce aux chemins de fer, l’Europe bientôt ne sera pas plus grande que ne l’était la France au Moyen Âge ! Grâce aux navires à vapeur, on traverse aujourd’hui l’Océan plus aisément qu’on ne traversait autrefois la Méditerranée ! Avant peu, l’homme parcourra la terre comme les dieux d’Homère parcouraient le ciel, en trois pas. Encore quelques années, et le fil électrique de la concorde entourera le globe et étreindra le monde. »
L’optimisme de Victor Hugo aurait été mis à mal par la montée des populismes et la crainte de l’étranger qui entachent à l’occasion les relations actuelles au sein des sociétés occidentales, mais garde une résonance pour nous qui refusons de nous laisser vaincre par l’esprit de suspicion et nous identifions par un héritage et des ambitions communs, qui célébrons nos différences comme des occasions de partage et d’enrichissement. Sachons écouter Gibbon pour lequel le véritable philosophe pense à l’échelle de l’Europe et ne se laisse pas contraindre par les frontières nationales. Examinons les propositions de Constant pour amener la fin des guerres. Les aspirations de ces penseurs éclairés, même si elles sont parfois marquées au coin de leur temps ou d’un eurocentrisme passé de mode, méritent d’être entendues. Nous sommes leurs héritiers. Ceux qui nous succèdent pourront, à bon escient, demander des comptes sur le devenir de ce legs intellectuel. La présente anthologie, fruit d’une collaboration internationale, offre une diversité d’approches et d’idées et peut-être parcourue au gré de l’envie du lecteur. Elle se veut à l’usage de tous les Européens et sera traduite en anglais et en allemandi.
Les éditrices tiennent à remercier tout particulièrement les collègues et amis qui leur ont apporté une collaboration précieuse à l’occasion de la préparation de ce volume, Nicolas Brucker (Metz), Denis de Casabianca (Marseille), Carole Dornier (Caen), Fabio Forner (Vérone), Marie-Claire Hoock-Demarle (Paris), Juan Ibeas (Vitoria), Frank Reiser (Freiburg), Ritchie Robertson (Oxford et Göttingen), Lydia Vázquez (Vitoria) ainsi que les institutions suivantes : la Société française d’étude du XVIIIe siècle, l’Université d’Augsburg, l’Université d’Oxford.
i Les extraits qui ne sont pas tirés d’éditions de langue française ont été traduits par les soins des contributeurs au présent volume. L’orthographe a été modernisée.
1. Un hymne pour l’Europe
Associé à la neuvième symphonie de Beethoven, un poème de Friedrich Schiller (1759–1805i), l’« Ode à la joie », est devenu l’hymne européen après avoir été chanté dans des salles de concert et des camps de concentration, en Allemagne et bien au-delà des frontières. Symbole de réconciliation, il témoigne à la fois d’une culture classique commune et de l’aspiration à un avenir de fraternité. Le poème, rédigé en 1785, est marqué par le piétisme des proches de l’auteur, mais aussi par un esprit d’ouverture.
O Freunde, nicht diese Töne!
Ô amis, pas de ces accents !
Sondern laßt uns angenehmere anstimmen
Laissez-nous en entonner de plus agréables,
und freudenvollere.
Et de plus joyeux !
Freude, schöner Götterfunken
Joie, belle étincelle des Dieux,
Tochter aus Elysium,
Fille de l’Élysée
Wir betreten feuertrunken,
Ivres de feu, nous pénétrons
Himmlische, dein Heiligtum!
Dans ton sanctuaire, ô divinité !
Deine Zauber binden wieder
Ta magie unit à nouveau
Was die Mode streng geteilt;
Ce que la coutume a sévèrement divisé.
Alle Menschen werden Brüder
Tous les hommes seront frères
Wo dein sanfter Flügel weilt.
Là où ta douce aile se déploie.
Wem der große Wurf gelungen,
Celui qui a eu la grande chance
Eines Freundes Freund zu sein;
D’être l’ami d’un ami,
Wer ein holdes Weib errungen,
Celui qui a trouvé une épouse jolie,
Mische seinen Jubel ein!
Qu’il mêle sa jubilation à la nôtre.
Ja, wer auch nur eine Seele
Oui, de même celui qui n’appelle sienne
Sein nennt auf dem Erdenrund!
Qu’une seule âme sur toute la terre,
Und wer’s nie gekonnt, der stehle
Et que celui qui jamais ne l’a su se dérobe
Weinend sich aus diesem Bund!
En pleurs à cette union !
Freude trinken alle Wesen
Toutes les créatures boivent la joie
An den Brüsten der Natur;
Au sein de la Nature ;
Alle Guten, alle Bösen
Tous les bons, tous les méchants,
Folgen ihrer Rosenspur.
Suivent son chemin de roses.
Küsse gab sie uns und Reben,
Elle nous a donné des baisers et la vigne,
Einen Freund, geprüft im Tod;
Un ami, jusqu’à la mort.
Wollust ward dem Wurm gegeben,
Même le ver a reçu la volupté
und der Cherub steht vor Gott.
Et le chérubin se tient devant Dieu.
Froh, wie seine Sonnen fliegen
Joyeux, comme ses soleils qui volent
Durch des Himmels prächt’gen Plan,
Sur les routes splendides des Cieux,
Laufet, Brüder, eure Bahn,
Poursuivez, frères, votre course,
Freudig, wie ein Held zum Siegen.
Euphoriques, comme le héros qui vole à la victoire.
Seid umschlungen, Millionen!
Soyez embrassés, millions!
Diesen Kuß der ganzen Welt!
Ce baiser du monde entier !
Brüder, über’m Sternenzelt
Frères, au-dessus de la voûte étoilée
Muß ein lieber Vater wohnen
Un père chéri doit habiter.
Ihr stürzt nieder, Millionen?
Millions, vous vous agenouillez ?
Ahnest du den Schöpfer, Welt?
Monde, pressens-tu ton créateur ?
Such‘ ihn über‘m Sternenzelt!
Cherche-le au-dessus du firmament !
Über Sternen muß er wohnen.
Il doit demeurer au-delà des étoiles.
Friedrich Schiller, « Ode à la joie », 1785
Pour lire le texte original en ligne (édition de 1808) : https://de.wikisource.org/wiki/Ode_an_die_Freude
i https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anton_Graff_Schiller_(1).jpg
2. Le grand dessein de Henri IV
Les mémoires de Maximilien de Béthune, duc de Sully (1559–1641ii), sont le seul témoignage que nous ayons du grand dessein de Henri IV (1553–1610), roi de France dès 1589, à savoir la confédération d’une Europe chrétienne. Cela lui paraissait tellement chimérique, dit-il, qu’il écouta à peine le monarque la première fois que celui-ci envisagea devant lui « un système politique par lequel on pouvait partager et conduire toute l’Europe comme une famille. » Henri IV pense qu’aucune des nations concernées ne pourra rejeter l’idée compte tenu des avantages qui peuvent en être tirés : « Le profit qu’on leur assure, outre le bien inestimable de la paix, surpasse de beaucoup la dépense à laquelle on les engage. » Dans le contexte des conflits en Europe et notamment dans l’objectif d’enrayer le pouvoir de la couronne espagnole et d’apaiser les conflits religieux, le souverain français conçoit ce plan, en consultant la reine d’Angleterre Élisabeth afin de garantir une paix solide en Europe. Son projet inspira celui de l’abbé de Saint-Pierre au XVIIIe siècle.
Il [Henri IV] voulait rendre la France éternellement heureuse, et comme elle ne peut goûter cette parfaite félicité, qu’en un sens toute l’Europe ne la partage avec elle, c’était le bien de toute la chrétienté qu’il voulait faire, et d’une manière si solide, que rien à l’avenir ne fût capable d’en ébranler les fondements. […]