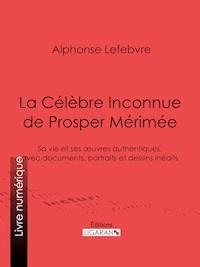
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Französisch
Extrait : "Au commencement du XIXe siècle vivait à Boulogne-sur-Mer, une famille bourgeoise jouissant d'une certaine aisance et parfaitement apparentée, du nom de Paillet-Dupont, en ménage depuis le 17 janvier 1786. Les Paillet sortaient d'une race de marins énergiques et travailleurs, ayant apporté leur intelligente contribution à la prospérité commerciale du pays. Quant aux Dupont, ils étaient brasseurs de père en fils, de génération en génération."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 419
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ceci n’est pas une œuvre littéraire, quoique le fond et les détails forment un véritable roman. C’est plutôt une étude psychologique sur une personnalité incomprise, parce qu’on a négligé d’approfondir le mystère qui l’entoure. C’est un travail de dissection, une dissertation, un plaidoyer si l’on veut, écrit sincèrement et consciencieusement, en s’appuyant sur des documents authentiques et une correspondance particulière, qui n’était pas appelée dès lors à voir le jour. C’est en même temps un hommage rendu à la femme, un devoir accompli en vue de la vérité.
Dans ces conditions modestes, je puis, sans prétention, me permettre de présenter ce livre au public.
L’AUTEUR.
Le 27 septembre 1873, la Bibliographie de la France, journal de la Librairie, annonçait la publication prochaine des lettres de Mérimée sous le titre de Lettres à une Inconnue. Elles parurent le 29 novembre. En moins d’un mois l’édition fut épuisée, et l’on dut faire une seconde édition, qui parut le 24 décembre.
La curiosité fut vivement excitée ; les amis de Mérimée, eux-mêmes, qui n’étaient pas au courant de cette amitié amoureuse, furent très surpris de cette révélation. Mme de Montijo, alors à Paris, manda même aussitôt près d’elle un de ceux qu’elle savait avoir approché le plus Mérimée dans les dernières années de sa vie, pour l’interroger sur ces relations qu’elle ignorait, quoiqu’elle eût été chargée, souventes fois, par son illustre ami, d’envois à l’adresse de l’Inconnue.
Les suppositions se donnèrent libre cours. On passa en revue toutes les femmes de la société auxquelles Mérimée aurait pu adresser ces lettres, et on fit des unes ou des autres l’heureuse destinatrice. On se laissa entraîner jusqu’à désigner – sans raison – Mme de Montijo. Et deux ans après, dans l’introduction qu’il fit aux Lettres à une autre Inconnue, H. Blaze de Bury écrivait : « Ici, il y eut une bague, et celui-là, sans nul doute en saurait plus long que vous et moi sur l’anecdote, qui aurait pu suivre les mouvements du mystérieux talisman et connaître la main vers laquelle il s’en retourna aussitôt après la mort de Mérimée. » Or, on lit dans le testament de Mérimée : « … À Madame de Montijo, une bague avec In memoria de P.M. » On parla aussi de Mme D…, sans réfléchir que, vers 1853, Mérimée avait été supplanté dans son affection par Maxime Du Camp.
Le nom de Jenny Dacquin courait cependant. Il figure dans la Pall-Mall Gazette du 1er janvier 1874 : « of English origin, but who has long lived at Dover, Boulogne and Poitiers. »
Il est curieux de constater que l’Intermédiaire des Chercheurs, si prompt, ordinairement, à s’occuper des livres à clef, ne s’intéressa pas immédiatement à celui-là.
Ce n’est que le 25 juillet 1879 que M. P. Masson posa nettement la question dans l’intermédiaire. Il y eut, le 10 novembre 1879, deux réponses qui n’apprirent pas grand-chose : « Le moment n’est peut-être pas encore venu, écrivait un correspondant qui signait L…, de publier le nom de cette dame ou demoiselle, appartenant à une famille honorable, mais ruinée ( ?). Normande d’origine ( ? ?), demoiselle de compagnie ni plus ni moins que l’héroïne du Marquis de Villemer, et qui, nous assure-t-on, a été plus attristée ( ?) qu’enorgueillie du bruit qui s’est fait à son sujet, par suite de la publication des lettres, – quelques-unes retouchées ou mutilées, – que Mérimée lui avait adressées. » Le silence se fit. Le 25 octobre 1891, la question fut de nouveau posée. Le 20 janvier 1892, on y répondit nettement : « Cette inconnue s’appelait Jenny Dacquin, elle était fille d’un notaire de Boulogne-sur-Mer, etc… » Et le signataire de la note, A [ lfred ] H [ édouin ], probablement pour dépister les interviewers, annonçait gravement qu’elle était morte « à Paris, en 1887 ou 1888 ». L’Intermédiaire la ressuscita l’année suivante, par la plume d’Un Témoin qui, le 30 avril 1896, publia l’extrait de la lettre annonçant le décès de l’Inconnue, le 25 mars 1895. Le mystère était éclairci : Mlle Dacquin était bien l’Inconnue.
Un érudit de sa ville natale, M. Alphonse Lefebvre, voulut savoir d’elle plus que n’en avait dit Alfred Hédouin. Il fit des recherches, une enquête sérieuse, et le résultat de ces quelques années de travail est le volume intéressant qu’il publie aujourd’hui.
L’identité de l’Inconnue est authentiquement établie, sa famille est désormais connue, et il n’est pas jusqu’à son frère, l’officier d’artillerie, dont il est souvent question dans les lettres de Mérimée, qui n’ait maintenant son état civil.
Jeanne-Françoise Dacquin, née le 25 novembre 1811, avait publié à vingt ans dans les Annales romantiques, sous le pseudonyme de Léona, un morceau en prose (1831) et une pièce de vers (1832). M. Lefebvre les a joints à son étude si documentée. Ce ne sont pas des chefs-d’œuvre, il faut bien le reconnaître, mais c’est d’une moyenne honorable. M. Lefebvre signale cette curieuse particularité que, dans les Annales romantiques de 1832, la pièce de Jenny Dacquin se trouve placée près de Fédérigo de Mérimée. Cette constatation nous amène à penser que ce voisinage ne fut peut-être pas étranger à la lettre que la jeune fille adressa à Mérimée pour avoir un autographe de lui, et qui fut l’origine de leurs relations.
La première lettre, écrite en anglais, et signée lady Algernon Seymour, fut mise à la poste en octobre 1831 à Paris, par Alfred Hédouin, puis la correspondance devint peu à peu plus active. Le 4 décembre 1832, Mérimée partait pour l’Angleterre avec son ami Laglandière, et à son retour en France, fin janvier 1833, il voyait sa mystérieuse correspondante. C’est à une très récente et importante publication de M. Ad. Paupe, le Stendhalien par excellence, que nous devons d’avoir cette date précise. Il a pu, en effet, obtenir en communication de la famille de Sutton Sharpe, une précieuse lettre de Mérimée à son ami de Londres, qu’il a bien voulu fort aimablement nous autoriser à reproduire :
« Paris, 29 janvier 1833.
… À mon arrivée à Calais, je suis allé chez la dame qui m’avait remis le portrait de lady Seymour. D’abord, elle m’a remis une lettre évidemment écrite dans une grande agitation d’esprit, et dans laquelle mon inconnue me disait qu’elle ne pouvait me voir. La lettre lue, Mme L… (la dame de Calais), ayant pris un air excessivement sérieux, me demanda la permission de me parler avec toute franchise. Je frémissais, craignant qu’elle ne s’avouât coupable de m’avoir écrit. N.B. que c’est une dame très respectable de quarante-neuf ans au moins. Cependant, je dis, du ton le plus assuré que je pus : – « Je ne demande pas autre chose. » « Sachez donc, monsieur, que les lettres qui vous ont intrigué ne sont pas écrites par une dame anglaise, mais par une demoiselle française. Cette jeune personne a une tête fort vive, très inconsidérée, très exaltée, d’ailleurs remplie de vertus et de bons sentiments. Lorsqu’elle vous a écrit pour la première fois, elle n’avait qu’un but, celui de se procurer un autographe de vous. Peu à peu, elle a pris goût à la correspondance, puis au correspondant, enfin cela est devenu une véritable passion. En un mot, elle est folle de vous. Sa mère et moi nous étions d’abord prêtées à toutes ces folies, les croyant sans conséquences, mais maintenant nous sommes désespérées. » À quoi je répondis : « – Que voulez-vous que j’y fasse ? » – (Convenez, mon cher ami, que ma position était assez comique). Je pensai que le moment était venu de s’expliquer tout à fait. Je dis que je ne me marierais jamais et que je me lavais les mains de toute cette affaire-là : qu’on était venu me chercher, etc. J’étais il faut vous le dire, de fort mauvaise humeur du ton tragique de cette Mme L…
Elle répondit qu’il ne s’agissait pas de mariage – qu’on n’y pensait pas – mais que j’avais dérangé la tête de cette pauvre enfant, et qu’on me suppliait de la remettre. Jolie commission ! Mme L… me montra alors trois ou quatre lettres de cette demoiselle, que j’appellerai J…, lettres qui vous auraient attendri, tout féroce que vous êtes. Figurez-vous toute la folie et toute l’exaltation d’une tête bien romanesque, qui vit en province, qui se figure que je suis un héros, bien au moins comme le soleil, et le reste à l’avenant. Au milieu de toutes ces extravagances, il y avait un fond de sensibilité si réelle et si bien exprimée que je ricanais tantôt et tantôt je me sentais fondu comme une cire. Aux lettres de la fille succédèrent celles que la mère écrivit à Mme L… et ce n’étaient pas les moins curieuses. Il me parut que J… gouvernait absolument sa mère, et qu’elle l’avait rendue presque aussi éprise de moi qu’elle l’était elle-même. La bonne femme voulait savoir si je viendrais à Boulogne, où elle demeure, et si je consentirais à voir sa fille quand j’aurais appris qu’elle m’avait trompé sur son véritable nom. Elle disait que J… ne faisait rien qu’à sa tête, et qu’il n’y avait que moi au monde qui pût la faire obéir. Toutes ces lettres lues, je pris un air très grave et je dis que si cette jeune personne était si éprise de moi, je ne croyais pas devoir la voir, puisque ce serait encourager une passion qui ne pourrait avoir de résultats. Cependant, je sus si bien me faire prier que je consentis à la voir. J’étais bien aise de paraître forcé à faire une chose dont j’avais grande envie.
À Boulogne, j’envoie un commissionnaire avec une lettre à l’adresse qu’on m’avait indiquée, annonçant ma visite, et demandant un tête-à-tête. La réponse était à peu près illisible, mais m’accordait tout. Je passai une heure à mettre ma plus belle cravate, et je partis assez intrigué. J’oubliais de vous dire que Lagl m’ayant suggéré l’idée d’un guet-apens, j’avais pris une canne à lui, laquelle est munie d’un stylet. J’entre dans une maison d’assez bonne apparence, et une femme de chambre me conduit dans une petite chambre où il n’y avait qu’une bougie fort loin de la cheminée, et, devant, une femme assise dont je ne pouvais pas voir les traits. Quand j’entrai, elle se leva comme poussée par un ressort et retomba tout de suite en mettant son mouchoir devant sa figure. Je lui tendis la main, elle me donna la sienne et je m’assis. Notez que, par la disposition particulière de la bougie, elle m’éclairait entièrement et je ne pouvais voir que l’outline de J…, qui lui tournait le dos.
Nous causâmes ; elle avait une voix très agréable. Nous parlâmes de cent mille choses. Elle me parut un peu timide, mais spirituelle. Au bout d’un quart d’heure de conversation, je lui demandai de mettre la bougie entre nous deux. Elle refusa en me disant qu’elle n’oserait plus me parler ; mais un autre quart d’heure passé, elle consentit enfin.
Je vis alors une fort belle personne de vingt ans à peu près, brune, avec de beaux yeux noirs à la French ( ?), des sourcils admirables, cheveux noirs, etc. Ajoutez à cela un pied comme le doigt dans un brodequin de satin noir d’une forme ravissante. Je devins tout de suite plus aimable de moitié. Nous étions penchés tous les deux vers le feu, et elle avançait ce pied avec un bout de jambe parfaitement assorti. – « Il y a si longtemps, lui dis-je, que je n’ai vu de jolis pieds, que je ne puis me lasser de regarder le vôtre. » – « Le trouvez-vous bien, en vérité ? » me dit-elle, et elle avança ce pied vers moi avec une coquetterie enfantine. Je pris ce pied dans ma main, et tout en causant haute morale, nous en étions là, je ne sais quel diable me tenta, je levai le pied à ma bouche et je le baisai très tendrement.
Jamais Hollandais recevant au milieu de la bedaine un obus à la Paixhans n’a paru plus subitement anéanti que la pauvre J… Elle retira son pied, sa tête tomba sur sa poitrine, et elle devint cramoisie. Il aurait fallu être tigre pour continuer. Je ne suis point tigre. Nous parlâmes d’autre chose, et je me retirai, après deux heures de conversation chaste, quoique assez tendre. Elle doit venir à Paris dans quelques mois, ma vertu aura bien des efforts à faire pour résister alors. Maintenant les lettres de J… se succèdent rapidement, et je commence à en devenir moi-même un peu épris. Je lui donne d’ailleurs des conseils, comme bien vous pensez…
P.M. »
Dès lors, les relations continuèrent.
Mlle Dacquin avait fait des essais littéraires qui semblent être restés inédits et avoir disparu. Voici, en effet, une lettre de Charles Malo adressée à Pierre Hédouin qui le prouve :
Paris, 9 octobre 1831.
Cher ami et collègue,
J’ai reçu, par l’entremise du jeune M. Daquin, le paquet dont vous l’aviez chargé pour moi. Je regrette qu’il n’ait point été accompagné, dans sa petite visite, de votre fils que j’eusse été bien enchanté de connaître. J’ai à peu près l’air de faire peur aux personnes que vous chargez de vos commissions ; l’an dernier, un monsieur et une dame avaient eu la complaisance de m’apporter une lettre de vous ; je ne pus les engager même à prendre un siège dans la pièce où ils se trouvaient. Il en a été de même à peu près pour l’intéressant collégien de Louis le Grand.
Il paraît que nous autres habitants de la grande ville n’avons pas la réputation d’être fort affables, on compte là-dessus et l’on prend ainsi d’avance ses précautions ; et l’on a tort, car tout occupé qu’on soit, on pourrait à la rigueur consacrer même plusieurs heures à tel étranger qu’un ami nous adresse.
Depuis ma précédente, l’état de la librairie a engagé mon libraire à renoncer, pour cette année, à trois petites publications que je vous ai annoncées comme devant avoir lieu, ce sont l’Almanach des Demoiselles, le Chansonnier des Dames, l’Album de la Jeunesse. Les divers morceaux que vous m’envoyez pour ces recueils se trouvent donc comme non avenus.
L’Album Littéraire lui-même ne paraîtra pas, du moins sous ce titre ; je créerai en son lieu et place un nouveau Keepsake Français dans lequel figurera Marguerite, morceau, comme vous le dites, fort soigné, mais d’une dimension qui m’effraye un peu, puisque j’évalue qu’il donnera de 18 à 19 pages : notez que je ne dispose que de 300 pages, qu’il me faut une table de trente à quarante noms d’auteurs. Comment arriverai-je ?
Votre Fantôme du Tasse est déjà classé dans l’Hommage aux Dames. Je tâcherai d’y glisser le billet à Ida.
Votre Épître sur la Peinture que vous destinez aux Annales ne leur convient guère, notamment à raison des dix premiers vers, introduction jadis obligée, mais de nos jours tout à fait passée de mode. Et puis, vous vous occupez beaucoup trop de votre ami, et trop peu du public. Cette épître contient d’excellents vers, de la haute poésie, mais cela sent l’ancienne école en diable. Bref l’exorde et la conclusion, l’alpha et l’oméga de ce morceau seraient mal appréciés à Paris où la gloire, le génie, l’immortalité de votre ami pourraient bien se trouver contestés. Ceci de vous à moi : mais nos romantiques, nos Jeunes France règnent en souverains dans tous les journaux, et votre apologie tout amicale pourrait être mal traitée. Voyez ce que vous devez faire ; et surtout ne soyez pas blessé de ma sincérité ; nous avons peut-être l’un et l’autre un tort tout opposé ; vous ne voyez que Boulogne et moi je vois Paris, la France, la Suisse, la Russie, l’Angleterre, l’Amérique, enfin tous les endroits où chemine mon recueil et je ne m’attache pas spécialement à votre localité, je vois tout à l’exclusion d’elle.
Vous êtes en fonds pour me remplacer ce morceau, qu’alors je recommanderais à l’éditeur de l’Almanach des Muses pour 1832. Une pièce dans le genre de votre Salvator Rosa me conviendrait à merveille aux dédicaces près, pour lesquelles j’ai une aversion invincible. Cela est si vrai que je me suis brouillé dans un temps avec Sainte-Beuve, à propos d’une dédicace.
Qu’on accuse le silence d’une personne à laquelle on ne donne pas son adresse, on a tort et très grand tort ; mais puisque vous avez de moi deux adresses pour une, moi j’avais, en sens inverse, grandement raison de vous taxer d’insouciance, parce que vous m’avez tant privé de vos nouvelles jusqu’à l’arrivée imprévue de M. Daquin. Il ne s’en est donc fallu que de douze heures que je vous écrivisse pour stimuler votre mémoire oublieuse. Je me plais à reconnaître aujourd’hui que je jugeais mal votre silence, que vous pensiez à moi, que vous vous occupiez de moi, de moi dis-je qui jouis de vos succès, de votre gloire littéraire bien qu’elle ne soit à vos yeux qu’un hochet frivole, fugitif, imaginaire.
Vous me direz si vous consentez à ce que je fasse quelques petites coupures à Marguerite, mais ne tardez pas, car les Annales et le nouveau Keepsake sont en ce moment sous presse.
Puisque vous vous êtes chargé, avec tant de bienveillance, des productions d’une dame de votre pays qui paraît être indifféremment, pour vous, appelée Henry ou Léona, je dois, en voyant ce dernier nom figurer pour la première fois dans vos lettres, convenir, d’accord avec les faits, que j’ai reçu, l’an dernier, sous cette signature, plusieurs morceaux charmants ; un sentiment de justice m’a fait accueillir ces premiers essais d’une Muse qui m’est tout à fait inconnue ; une velléité très passagère de soulever ce voile de l’anonyme, assez piquant pour moi sans doute, m’avait engagé à vous en dire un mot ; et j’avais totalement perdu de vue, dès ce moment même, et ma question et son objet, quand votre dernière est venue me replacer soudain, sous les yeux, un souvenir d’un jour, tout à fait effacé de ma mémoire. Pour cette fois vous ramassiez le gant que je vous avais jeté depuis six mois et plus, je ne sais ce que je vous ai répondu (car je ne m’amuse pas à garder de copie de mes griffonnages), mais j’ai dû être fort insignifiant dans ma réplique ; car après tout, les anonymes et les noms de guerre, d’emprunts, etc. (j’entends pour moi personnellement qui signe mes lettres, comme mes écrits) me sont tout aussi désagréables que les dédicaces pour le moins. Au théâtre, le public ne doit pas voir l’intérieur des coulisses, cela est sage et conséquent pour plus d’un motif, mais les auteurs, le directeur, le machiniste… c’est tout différent. Tout ce qui se passe derrière la toile ne peut et ne doit être un mur pour eux.
Mais trêve de réflexions qui n’ont d’autre but que d’excuser le caprice d’un instant. J’en viens à vous accuser la réception des trois pièces qui accompagnaient les vôtres. Je n’ai pas lu encore assez attentivement ces morceaux pour vous dire l’emploi que j’en ferai soit pour l’Hommage, les Annales, soit pour le Keepsake. Je vous en parlerai d’une manière positive quand je répondrai à la lettre que j’attends de vous.
Pardonnez, mon cher Hédouin, mes causeries babillardes ; excusez ce flux de mots, de phrases vides de sens peut-être : mais ce qui n’est pas insinué chez moi, c’est l’amitié sincère que j’ai pour vous et le prix infini que j’attache à la vôtre.
Tout à vous,
CHARLES MALO.
Les relations furent-elles aussi platoniques que le suppose – et que le soutient énergiquement, – M. Lefebvre ? La question est trop délicate pour être traitée. Disons seulement qu’un passage d’une lettre de Mérimée nous semble assez affirmatif pour ne pas partager, sur ce point, l’opinion du Chercheur. D’ailleurs, comme l’a très justement fait remarquer M. Augustin Filon : « … Faire des retranchements ou des corrections dans une correspondance de cette nature, c’est donner beau jeu aux suppositions des méchants…, et la première coupable, si l’on émet des hypothèses en faveur d’une thèse diamétralement opposée, n’est autre que l’intéressée elle-même, qui, par le tripatouillage, souvent peu intelligent, qu’elle a fait des lettres autorise tous les soupçons. »
La correspondance continua donc, jusqu’à la mort de Mérimée. M. Lefebvre l’a trop bien étudiée pour que j’y revienne après lui. – Je noterai seulement une particularité dont il n’a donné qu’un exemple.
Il est curieux de constater que dans sa correspondance privée, Mlle Dacquin empruntait textuellement des phrases aux lettres que lui adressait Mérimée. M. Lefebvre a signalé notamment les passages d’une lettre de Jenny Dacquin du 26 janvier 1860, empruntés à une lettre de Mérimée du 22 janvier 1860, mais il y aurait bien d’autres comparaisons à faire. Par exemple :
Lettre de Jenny Dacquin.
DU 14 NOVEMBRE 1860
J’ai suspendu le cours d’arabe que je suivais par amour de la couleur locale, depuis que j’ai découvert qu’il y avait des lettres lunaires et des lettres solaires, et que pour l’harmonie c’est une langue qu’on pourrait parler avec un bâillon. Il ne faut jamais résister au sens commun.
DU 2 OCTOBRE 1862
À propos de littérature, as-tu lu le speech de Victor Hugo au banquet de Bruxelles ? Quel dommage qu’un homme qui a de si belles images à sa disposition, n’ait pas plus de bon sens, ni la pudeur de se retenir de dire des platitudes indignes de lui. Il y a dans sa comparaison du chemin de fer et du tunnel plus de poésie que je n’en ai trouvé dans aucun livre que j’ai lu depuis cinq ou six ans. Je lui pardonne de se griser de sa parole tant elle est belle.
Lettre de Mérimée.
DU 1er NOVEMBRE
… Je me rappelle qu’il y a des lettres lunaires et solaires,… en outre, c’est une langue sourde qu’on peut parler avec un bâillon…
DU 27 SEPTEMBRE 1862
À propos de littérature, avez-vous lu le speech de Victor Hugo à un dîner de libraires belges et autres escrocs à Bruxelles ? Quel dommage que ce garçon, qui a de si belles images à sa disposition, n’ait pas l’ombre de bon sens, ni la pudeur de se retenir de dire des platitudes indignes d’un honnête homme ! Il y a dans sa comparaison du tunnel et du chemin de fer, plus de poésie que je n’en ai trouvé, dans aucun livre que j’aie lu depuis cinq ou six ans, mais au fond ce ne sont que des images. C’est un homme qui se grise de ses paroles…
Mérimée mourait à Cannes le 23 septembre 1870. Deux heures avant sa mort, il écrivait une lettre – la dernière – à son amie de quarante ans. Quelques jours après, Jenny Dacquin écrivait à son parent :
« … J’ai eu en effet un grand chagrin de cette mort d’un ami si cher, qui a rempli ma vie ; mais ce chagrin eût été bien plus grand encore sans les circonstances terribles dans lesquelles nous vivons depuis deux mois. J’y ai vu pour lui la fin de souffrances intolérables et de tourments que supportait son courage, mais qui lui faisaient envier le sort de tous ceux disparus avant lui. Il y avait eu, cet été, une notable amélioration dans son état ; il était venu à Paris et avait assisté à la dernière séance du Luxembourg et à l’effondrement général d’affections si anciennes et si chères. Sa haute philosophie n’avait pas desséché son cœur ; il était impossible d’être meilleur et plus compatissant aux peines des autres. Il est retourné à Cannes la veille de l’investissement de Paris. – J’avais eu une lettre de lui le 26 septembre, quatre lignes m’annonçant une rechute de cette bronchite dont il souffrait depuis des années. – C’était un adieu. – Mais, je te le répète, je ne puis le plaindre : sa force morale l’a soutenu jusqu’à la fin ; il a été admirablement entouré et soigné, et s’est éteint avec toutes ses grandes facultés et sans douleurs. Je garde de lui le souvenir le plus délicieux ; le temps n’a jamais atteint cette intimité sans pareille… »
Elle aimait sans doute à relire cette correspondance. Un jour, elle pensa qu’elle n’avait pas le droit de garder pour elle seule ces joyaux littéraires. Après de longues réflexions et des hésitations, elle se décida à confier les fameuses lettres à un de ses anciens voisins de la rue Jacob, le peintre Blanchard, qu’elle chargea d’aller voir l’éditeur Michel Lévy. Celui-ci accepta, et trouva même un titre alléchant pour la nouvelle publication : Lettres à une Inconnue.
Dès le 8 février 1873, le National, sous la signature : baron Schop publiait l’entrefilet suivant :
« On parle de la prochaine apparition d’un livre destiné à faire quelque bruit. Pendant une vingtaine d’années, Mérimée avait pris l’habitude d’adresser quotidiennement une lettre à une dame de ses amies. Cette lettre était comme un journal intime des évènements…
Si l’éditeur ne se croit pas forcé de pratiquer trop d’amputations, la lecture du livre sera un vrai régal… »
Dans quelles conditions fut faite cette publication ? Nous n’avons pas, malheureusement, d’autres documents que ceux publiés au moment de la sensationnelle apparition de ces lettres, et dont M. Alphonse Lefebvre parle en détail dans ses préliminaires.
Qui est responsable des altérations, des suppressions – maladroites – qui fourmillent dans cette correspondance ? Est-ce la destinataire ou l’éditeur ?
Si c’est l’éditeur, il faudrait pour cela qu’il ait eu entre mains les originaux des lettres. Or, est-il vraisemblable que Mlle Dacquin, qui voulait « dépister les curieux » ait confié, même à M. Blanchard, ces précieux papiers ? Elle a pu, elle a dû lui remettre quelques-uns des originaux, pour démontrer à Michel Lévy l’authenticité des lettres, mais il est permis de penser que le reste était en copie.
C’est donc elle qu’il faut rendre responsable du truquage de cette correspondance. M. Augustin Filon lui reproche fort justement « … de s’être enveloppée de mystère en brouillant les dates et les noms, en battant ses lettres comme un jeu de cartes et en les rangeant dans un ordre fantastique… »
Le travail de vérification n’a jamais été fait : j’ai pensé qu’il serait intéressant de le tenter.
Je n’espère pas être arrivé à un résultat complet. Sur les cent soixante-dix lettres que comporte le premier volume, je ne suis arrivé à pouvoir rectifier que trente-trois lettres, soit un cinquième. Mais ce nombre, déjà respectable, ne peut qu’inspirer quelque méfiance à l’égard des autres lettres dont le contexte ne permet pas la critique avec quelque certitude.
Les douze premières lettres ne sont pas datées, la treizième porte la date de février 1842. Sachant que les relations épistolaires ont commencé en octobre 1831, on constate d’abord l’absence presque absolue de la correspondance de 1831 à 1841 inclus.
Bien entendu, la première, « la pièce introductive » manque, et il semble que, de la correspondance antérieure à la fin de 1832, il n’ait été gardé que la lettre 3, sans date, où on lit : « … Je suis très préoccupé en ce moment d’une affaire qui m’intéresse et qui, je l’avoue à ma honte, réside opiniâtrement dans une moitié de mon cerveau. » Ce fragment paraît se rapporter aux négociations nécessitées par les passages successifs de Mérimée – à la suite du comte d’Argout – dans différents ministères.
La lettre 6, non datée, doit être de septembre ou octobre 1832. Elle contient, en effet, le passage suivant : « Je retarderai mon voyage en Angleterre jusqu’au milieu de novembre. Si vous ne voulez pas me voir à Londres, il faut y renoncer, mais je veux voir les élections… » De même, la lettre 9, où il est fait mention d’une promesse de Jenny Dacquin d’envoyer son portrait à Mérimée, est de novembre : « Je pars pour Londres au commencement du mois prochain… » Or, Mérimée partit le 4 décembre.
La lettre 11 doit être du 6 au 9 décembre 1832 : Mérimée est à Londres, et elle est antérieure à la lettre 12, datée du 10 décembre.
La lettre 13 porte la date de février 1842 : or, elle est postérieure à la lettre 14 datée de mars. Dans la première, on lit :
« Je vous donnerais bien des babouches, mais pour que vous les mettiez pour d’autres, merci. Si vous voulez de la confiture de rose et de jasmin, il m’en reste encore un peu, mais dépêchez-vous… » Or, dans celle datée de février, il parle de l’envoi des confitures.
« Plus de babouches, je ne les trouve plus… »
La lettre 17 de juin 1842, sur une bourse dont Mlle Dacquin lui a fait présent, est antérieure à la lettre 15, datée de mars.
Dans la lettre 18, du 30 juin 1842, le passage : « J’ai passé presque tout mon hiver à étudier la mythologie dans de vieux bouquins… » semble interpolé.
La lettre 26, du mardi soir, est antérieure à la lettre 25 qui est de novembre, de même que la lettre 35 à la lettre 34.
La lettre 47, datée du 11 février 1843, doit être de 1844, attendu que la lettre 48 porte la même date, – correctement semble-t-il.
La lettre 52, février 1843, est postérieure à la lettre 54, du 9 février, parce que dans la dernière, Mérimée parle vaguement d’un ami anglais, très malade à Londres, dont il donne le nom (Sutton Sharpe) dans la lettre 52.
La fin, au moins, de la lettre 56, du 1er mars 1843, est mal datée. Elle est relative à l’Académie, et est, par conséquent, de 1844.
La lettre 58, du 11 mars, aurait dû être placée avant la lettre 57, qui est du 13.
La lettre 79, Avignon 29 septembre, est de 1834, soit antérieure de dix ans. Elle a été écrite pendant le fameux Voyage dans le Midi de la France. C’est, d’ailleurs, la réunion en une seule de deux lettres, dont l’une du 10 septembre, a été placée après celle du 29.
La lettre 80, datée de Toulon 2 octobre 1844, est aussi de 1834.
La lettre 91 est un des plus curieux spécimens de cette falsification de textes. Elle est datée du 26 mars 1844, et il est question du discours de Mérimée à l’Académie française, qui a été prononcé le 7 février 1845. Il semble que ce qui est relatif à ce discours (première partie de la lettre et quatre dernières lignes) a été emprunté à la lettre 103, datée du 7 février 1845 (p. 249). Rien ne s’oppose, du reste, à ce que l’autre fragment, depuis : « Vous pourrez me persuader… j’ai été bien content de vous voir… » n’appartienne à une lettre vraiment datée du 26 mars 1844.
La lettre 95, du 19 août 1844, relative au voyage qu’il prépare pour l’Algérie, est postérieure de trois ans. Elle est de 1847, comme le prouve une lettre écrite le même jour (19 août 1847) par Mérimée à de Witte et une autre à Mme de Montijo.
La lettre 97, du 6 septembre 1844, est relative à ses démarches pour l’Académie des inscriptions à laquelle il avait été élu l’année précédente ! Cette lettre serait donc à replacer entre les lettres 78 et 79.
La lettre 98, datée de Paris, 14 septembre 1844, encore relative au voyage d’Algérie est de 1847. Même sans cet élément de vérification chronologique, elle n’aurait pu être, en aucun cas, de 1844, car le 15 septembre de cette année, Mérimée était à Poitiers, et il écrivait à Jenny Dacquin pour s’excuser de lui répondre « tardivement ».
La lettre 101, de Perpignan 14 novembre (1844), est de 1834. Elle semble d’ailleurs être la réunion de deux, ou même trois lettres, car le passage sur Perpignan est encadré de réflexions sur les arènes de Nîmes et par une description de la fontaine de Vaucluse, qui doivent appartenir à une ou deux autres lettres.
La lettre 107, du 10 novembre 1845, relative aux recherches dans les archives de Barcelone, est, en réalité, de 1847.
La lettre 119, relative à don Pèdre, datée du 22 septembre 1847, est la réunion de deux lettres de dates peut-être différentes.
La lettre 137, de Bâle, 10 octobre 1850, est mal datée, car le 6 octobre, Mérimée était à Nîmes, d’où il écrivait une longue lettre à Lenormant et d’où il revenait directement à Paris.
La lettre 139, de Londres, 22 juillet 1851, est de 1854.
Dans le billet 144, du 1er mai 1852 sur la mort de sa mère, la dernière ligne, qui n’est pas dans le ton, doit provenir d’une autre lettre.
Les lettres 152, 153, 154, 155, 156, relatives au séjour qu’il fit en Espagne en octobre et novembre 1853, ont été mutilées du début et de la fin, probablement pour supprimer quelques passages dont on peut avoir une idée par certaines correspondances inédites.
Il manque la correspondance de décembre 1854 à juillet 1856, août 1856 à janvier 1858 (sauf une lettre).
Les lettres 170-332, de 1858 à 1870, qui forment le tome II, paraissent ne pas avoir été truquées.
Ces modifications, ces suppressions, ces fusions de lettres passèrent inaperçues, on ne songea qu’à goûter le plaisir de les lire : le succès fut grand. Le 8 décembre 1873, Jenny Dacquin écrivait à son cousin : « J’ai passé une semaine de grandes émotions concentrées dans mon bonnet de nuit ; aussi, je suis un peu dans la disposition morale du roi Midas et j’éprouve le besoin de parler aux roseaux. – Jusqu’à présent je n’ai aucune raison de regretter mon audace… plutôt utile que nuisible, en ce sens qu’elle fait connaître et aimer une grande mémoire. Ce qui me satisfait et me fortifie contre mes impressions nerveuses, est que la femme est respectée et que sa dignité n’est pas en jeu… »
Le succès des Lettres à une Inconnue a suscité des traductions, des critiques littéraires et des imitations. De ces dernières, je ne dirai rien, M. Lefebvre les ayant étudiées et réfutées dans ce volume.
Traductions.
Je ne connais que trois traductions, toutes trois anglaises :
1874. P. Mérimée’s Letters to an Incognita [ Translated Stoddard, Bric à Brac Series ], vol. III, 1874, in-8°.
1903. Letters to an Unknown, transl. by Henri Pène du Bois. London, Gibbings, 1903, in-8°. Cf. Morning Post du 7 mars 1903.
1905. The Love-Letters of a Genius. Transl. of Lettres àune Inconnue, by E.A.S. Watt, with an introduction by P.E.B. Duff. London, Narrison, 1905, in-8° cf. Tribune [ de Londres ] du 24 janvier 1906.
Articles.
1873. Lettres à une Inconnue, dans Revue des Deux-Mondes du 1er décembre, p. 481-524.
« … Les Lettres à une Inconnue renferment à la fois un roman et un journal biographique. Le roman est souvent très hardi, et…, l’aventure offre trop de détails téméraires pour que les convenances permissent à l’héroïne de la faire connaître sans ombres et sans voiles. D’un autre côté, fallait-il dérober à la postérité une collection de lettres où le caractère d’un écrivain tel que Mérimée se montre si complètement, si ingénument ?… Évidemment non. Si les convenances personnelles voulaient que l’amie demeurât une inconnue, d’autres convenances exigeaient que ce recueil fût publié… »
Cet article (p. 481-408) est suivi d’un choix des Lettres. « On a tâché, en composant cet extrait, de conserver la physionomie de l’ouvrage tout entier. De 1841 à 1870, on a emprunté des pages à chacune des périodes de la vie de Mérimée, en s’attachant surtout à ce qui intéresse notre histoire littéraire. L’auteur est là dans son vrai centre ; il travaille lui-même à son image en traçant au courant de la plume cette curieuse esquisse de son temps. »
Constitutionnel du 8 décembre. Article signé : Bachaumont. [ Demande la publication des Lettres de l’Inconnue. ]
Le Salut public de Lyon, du 10 décembre. [ Article signé : Gallus. ]
Philibert Audebrand, dans l’Illustration du 13 décembre.
Monde illustré du 13. [ C-R. peu favorable. ]
Jules Troubat, quelques notes sur Mérimée, dans la Renaissance littéraire et artistique du 14. [ A reparu plus tard dans Plume et Pinceau du même auteur, Paris, Liseux, 1887. ]
Xavier Aubryet, dans le Moniteur universel du 17 décembre.
« Les Lettres à une Inconnue n’apprendront rien de nouveau sur Mérimée, mais on lira avec plaisir ces pages pleines de contrastes, où l’on trouve tant de choses : à côté d’une concession à l’argot courant, une pointe d’érudition, – comme un membre de l’Institut qui ferait un pied de nez, – des variations sur les rhumatismes et des admirations géographiques, des petits scandales et des grandes amitiés, une bonne envie d’être amoureux avec beaucoup de dispositions à la solitude, des notes pour servir à l’histoire de France et pour ne pas servir à la biographie de l’auteur, des doléances oiseuses et des traits de naturel exquis ; le tout enveloppé dans cette morosité enjouée qui complète l’originalité de style de ce classique plus hardi qu’un romantique ; Mérimée fait penser en effet à ces ciels gris à demi éclairés qu’on préfère parfois aux ciels les plus étincelants de lumière et les plus riches d’azur. »
Fanfulla de Rome, 19 décembre.
L’Univers illustré, du 20, p. 802-805. Article signé Gérôme. [ Ludovic Halévy ?]
« Tout ce que l’on peut induire de divers passages de cette correspondance, c’est que la dame à qui elle futadressée, n’était pas mariée, qu’elle appartenait au high life anglais… »
Paul Bellet, dans la Patrie du 22.
Arsène Houssaye, dans le Gaulois du 23. [ Anecdoctes qui figureront plus tard dans ses Confessions. ]
Guy de Charnacé, dans le feuilleton du Bien public du 30.
The Hour, du 31 décembre : Merimee’s posthumous Letters.
Lettres à une Inconnue, dans la Revue britannique de décembre 1873, p. 544-5.
1874. Pall Mall Gazette du 1er janvier 1874.
Standard du 2 janvier.
Saturday Review du 3.
La Presse du 3. [ Nomme Jenny Dacquin. ]
De Lescure, feuilleton de la Presse, du 4 : Lettres à une Inconnue… reconnue.
« Mlle Jenny Dacquin doit être une femme d’un caractère viril, d’un esprit hardi et net, qui a l’habitude des voyages et de leurs dangers ; elle a dû mesurer d’avance toutes les conséquences possibles de son excursion hors de cet invariable at home dont elle a le culte et la coquetterie. Elle a dû tout prévoir, même l’imprévu ; elle ne s’étonnera donc pas et ne s’affligera point trop, peut-être, de la curiosité respectueuse mais un peu vive qui s’est faite autour d’elle, et des involontaires froissements que pourra produire pour sa toilette ou sa tranquillité l’empressement parfois maladroit des admirateurs… »
Daily Telegraph du 7.
Edmond Texier, dans le Siècle du 9. [ À propos de la réception à l’Académie française de M. de Loménie. ]
Jules Claretie, dans l’lndépendance belge du 9.
Le Bien public du 16. [ Article signé : Valère. ]
Paul Courty, dans l’Opinion nationale du 13.
Adrien Desprez, dans le Progrès de Lyon du 17.
Saturday Review du 17. [ p. 72-74 ]
Richard de Lavallée, dans le Soleil du 13. [ Reproduit dans le Journal de Paris du même jour. ]
Office de publicité du 18.
J. Barbey d’Aurevilly, dans le Constitutionnel du 2 février. [ Article très sévère. ]
Victor Fournel, dans la Gazette de France du 3 février : Œuvres posthumes de P. Mérimée, III.Lettres à une Inconnue.
The Daily Graphic de New-York, du 4.
Le Nord du 10. Article signé : H.[Barthélemy Hauréau ?] « Le nom de l’Inconnue n’est actuellement un secret pour personne. »
Cuvillier-Fleury. Le revers de la médaille, dans Journal des Débats des 14 et 15 février. [ Reproduit dans Posthumes et Revenants, article très sévère contre Mérimée, Paris, Lévy, 1879, p. 219-241. ]
Louis Ulbach. L’Académie jugée par les académiciens, dans le Bien public du 15.
Léon Dammartin, dans Paris-Journal du 17 et du 18.
National du 24 février. [ Article signé : baron Schop, sur les Lettres de l’Inconnue. ]
Bibliographie contemporaine du 15 mai. [ Au point de vue littéraire, les Lettres à une Inconnue n’ont aucune valeur ». ]
Bien public, 5 juin. [ Chronique. ]
1874. Appletons Journal de New-York, XI, 462.
Blackwood Magazine, CXV, 457, reproduit par Eclectic Magazine, LXXXII, 737.
1877. Ludwig Spach, Zur Geschichte der moderner franzœsischen Literatur. Essays-Strasburg, Trübner, 1867, in-12. [ p. 317-31. Prosper Mérimée’s Briefe an eine Unbekannte, 332-74. Einige Biefe P. Mérimée’s an ein Unbekannte. ]
1892. Karl Hillebrand, Zeiten, Wœlker und Menschen II. Wælsches und Deutsches. 2te aufl. Strasburg, Trübner, 1892. [ p. 142-157, Prosper Mérimée und die Unbekannte. ]
Macmillans Magazine de Londres, LXXIII, 211 ssq. – Prosper Mérimée et MlleDacquin.
1897. René Doumic, Les Lettres de Mérimée, dans la Revue des Deux Mondes du 15 octobre 1897 [ notamment p. 918-920. ]
1904. Émile Faguet, Mérimée amoureux, dans la Revue latine du mois de juillet. – Cet article a été reproduit, depuis, dans Amours d’Hommes de lettres, Paris, 1907, in-18, p. 294-341 : ce sera le sujet de l’étude suivante.
Les lettres adressées par l’Inconnue à Mérimée furent, probablement, brûlées dans l’incendie de la maison que Mérimée habitait rue de Lille, en 1871. M. Alph. Lefebvre a montré dans son volume que deux personnes furent tentées du désir de « restauration ». La dernière, surtout, une Anglaise, prit son rôle à cœur. Elle s’imprégna des Lettres à l’Inconnue, et composa les réponses qui parurent sous le titre An Autor’s Love, puis furent traduites en français.
Beaucoup de personnes s’y laissèrent prendre, d’autres se méfièrent.
Quoi qu’il en soit, sans se douter que la Passion d’un Auteur n’était qu’une traduction, M. Émile Faguet considéra ces lettres comme authentiques, à tel point que pour les passages douteux, il mit des gloses, corrigea, élucida, fit une étude critique. Il admire le style : « C’est généralement en très bon style… », et il est ému de la passion qui se trouve dans cette correspondance. Il publie, notamment, une lettre d’amour de l’Inconnue à Mérimée, qu’il admire profondément. Hélas ! elle n’est pas plus authentique que les autres. Elle serait d’ailleurs bien surprenante sous la plume de cette « tzigane prude ».
Voici comment M. Faguet résume la vie de l’Inconnue :
Née en 1820, en Angleterre, de parents français, elle aurait rencontré Mérimée à Paris vers 1840, et la correspondance aurait commencé en 1840, ou, au plus tôt, en 1839. À Londres (vers 1841) elle se fiança sans enthousiasme, se maria, et devint veuve avant 1842. Elle aurait donc été peu de temps mariée. Mérimée est « quinteux, défiant, jaloux, soupçonneux ». La pauvre femme, qui l’aime, « en est véritablement excédée. Vingt fois, cent fois, elle lui écrit… » Elle finit par crier son amour. M. Faguet écrit même que le roman eut une conclusion naturelle et qu’elle se montre dans la correspondance : « L’abandon et la reconnaissance amoureuse, écrit-il, le sentiment le plus profond et le plus voluptueux qu’éprouvent les femmes, sont complets et sont exquis… »
Malheureusement, cette correspondance, comme nous l’avons dit, est apocryphe.
À l’apparition de l’article de la Revue latine, quelques mériméistes furent surpris que M. Faguet se fût laissé prendre à un piège aussi visible. Lors de la réimpression de l’article en volume, M. Faguet a ajouté le post-scriptum suivant, que nous ne nous expliquons guère :
« Et maintenant, il faut bien savoir qu’il n’y a rien de moins authentique que le livre intitulé la Passion d’un auteur. J’ai raconté toute cette histoire en tenant les lettres de l’Inconnue pour aussi réelles que le sont celles de Mérimée, dans le dessein de donner plus de vie à toute cette histoire et de la « restaurer… » mais encore est-il nécessaire que le lecteur soit averti… »
Pourquoi ne pas l’avoir fait dès le début ?
Quel a été le sort des originaux des lettres de Mérimée ? Mlle Dacquin les a-t-elle détruits avant sa mort ? C’est peu probable. Elle a dû les conserver pour les relire, mais, en même temps, elle devait être décidée à n’en laisser prendre connaissance à personne.
Sa nièce, fille du capitaine Dacquin, qui fut son héritière, « n’a jamais eu en sa possession, avant comme après la mort de Mlle D…, les originaux des lettres de Mérimée… »
Nous avons pu obtenir quelques renseignements inédits intéressants :
« Une disposition écrite de sa tante la chargeait de brûler un certain nombre de papiers réunis en plusieurs paquets cachetés. Sa volonté a été scrupuleusement exécutée. Ces paquets contenaient-ils les lettres que vous auriez voulu voir ? Je l’ignore, et personne n’en saura rien, car, dans le très petit nombre de papiers laissés par Mlle Dacquin, il n’y en pas un seul qui fasse la plus petite allusion à sa correspondance avec Mérimée… »
Comme notre correspondant, nous sommes persuadés que ces paquets cachetés contenaient les originaux des lettres de Mérimée. Mlle Dacquin ne devait pas tenir, en effet, à ce que l’on pût comparer le texte tronqué – et truqué – par elle avec le texte même de Mérimée, puis, elle tenait sans doute à garder pour elle seule certains passages de ces lettres.
La tradition de la famille est que « la correspondance n’a eu pour mobile que le désir d’une femme très littéraire et très distinguée, d’entrer en relations épistolaires avec l’un des esprits les plus fins et les plus humoristiques du siècle dernier. Il en est résulté une amitié très réelle entre eux, qui s’est toujours maintenue dans les sphères élevées de la littérature et aussi du bel esprit. Il n’y faut rien voir autre chose. Cela ressort surabondamment des lettres PUBLIÉES, et s’il y avait eu autre chose, la correspondance eût duré infiniment moins longtemps… » C’est possible, mais on avouera qu’en tronquant les lettres et en rendant impossible toute vérification ultérieure, Mlle Jenny Dacquin a permis toutes les suppositions.
L’Inconnue méritait donc une étude. Celle que lui consacre M. Alphonse Lefebvre, consciencieuse et puisée aux sources, nous la fait désormais connaître, et modifiera peut-être l’appréciation que l’on portait jusqu’à présent sur elle, sur la seule foi des lettres publiées si mal.
Mâcon, le 20 avril 1908.
FÉLIX CHAMBON.
Lorsqu’à la fin de 1873 parurent les Lettres à une Inconnue, de Prosper Mérimée, le bruit courait à Boulogne, dans les salons, que l’héroïne si bien cachée de ces lettres était une Boulonnaise. Si le fait était exact, c’est dans la ville natale de l’Inconnue qu’on était le plus à même de percer le mystère. Les biographes du pays notèrent ce renseignement au passage ; mais quand ils voulurent approfondir le sujet, le bruit s’était envolé, comme tant de cancans, d’idées sans suite qui s’échangent dans les réunions mondaines. Qui le premier avait émis l’idée ? Nul ne put s’en rappeler. Les personnes qui s’étaient avancées, craignant peut-être de se compromettre ou ayant reçu le mot d’ordre, se turent, et l’oubli se fit pour le moment.
En 1886, l’un des nôtres, Ern. Deseille, relisant attentivement, disait-il, les lettres de Mérimée, – ou profitant d’une demi-confidence, ou mieux encore saisissant un écho lointain du journalisme parisien – déduisit que l’Inconnue devait s’appeler Jeanne et, d’après son âge présumé, il trouve en 1811 une naissance au nom de Jeanne Dacquin. « En consultant, ajoutait-il, ceux qui se souviennent, on obtient bientôt la preuve que tout ce que Mérimée dit de son Inconnue se rapporte à Mlle Dacquin. » – C’était là un premier jalon planté un peu au hasard. Il n’alla pas plus loin.
Déjà aussi un curieux avait lancé dans l’Intermédiaire des chercheurs, le 25 octobre 1875, cette question : « Lettres de P. Mérimée à une Inconnue. Quelle est cette Inconnue ? » La demande n’eut pas d’écho tout d’abord, mais on y revint plus tard le 25 juillet 1879, et le 10 novembre suivant, sous l’initiale L, parut cette réponse :
« Le moment n’est peut-être pas encore venu de publier le nom de cette dame ou demoiselle appartenant à une famille honorable, mais ruinée, Normande d’origine (sic), demoiselle de compagnie, ni plus ni moins que l’héroïne du Marquis de Villemer et qui, nous assure-t-on, a été plus attristée qu’enorgueillie du bruit qui s’est fait à son sujet, par suite de la publication des lettres, – quelques-unes retouchées ou mutilées, – que Mérimée lui avait adressées. »
C’était sans doute quelqu’un de son entourage qui prenait les précautions nécessaires pour empêcher la divulgation du nom de l’Inconnue et détourner les recherches.
Ce ne fut que le 20 janvier 1892 que la vérité fut en partie dévoilée, dans l’Intermédiaire, par un correspondant, qui donna des détails tellement précis, mais sans preuves à l’appui, qu’on les mit en doute, avec d’autant plus de logique qu’à la fin on annonçait que Jenny Dacquin « étant décédée à Paris en 1887 ou 1888 », ce qui était faux, – encore pour donner le change. Le correspondant signait A.H.(lisez Alfred Hédouin) ; il avait été lié en effet, au début, avec la famille, et se trouvait encore en relations avec elle.
Le 20 mai 1893, un autre correspondant, signant « un témoin », disait :
« En révélant le nom de l’inconnue aux lecteurs de l’Intermédiaire, le confrère A.H. ajoutait "elle est morte à Paris en 1887 ou 1888. " Cette assertion d’un "ami de la famille Dacquin" a été reproduite par la Revue encyclopédique de 1892, col 555, et voici que dans la Revue des Deux-Mondes, livraison du 1er





























