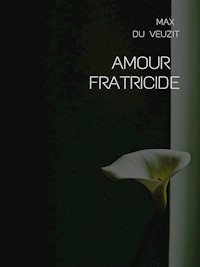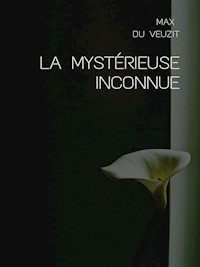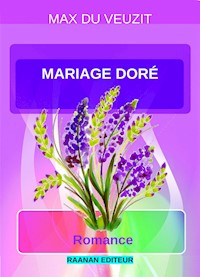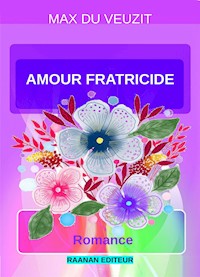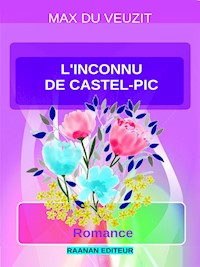2,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Après la mort du comte de Borel, sa femme et sa fille Solange ont dû quitter -voici quinze ans- le magnifique domaine de la Châtaigneraie. Un grave désaccord avait séparé, à l'époque, les parents de la petite fille. Sa mère en reste meurtrie... James Spinder, un acquéreur assez mystérieux, est à présent le maître du château. Solange réussit un jour à s'introduire à la Châtaignerie, y glane des souvenirs... M. Spinder accueille avec bienveillance la jeune fille. Il va jusqu'à lui remettre un carnet intime de son père. Une sorte de confession... Solange y découvre qu'un hôte de M. Spinder, le séduisant Maurice de Rouvalois, est le dernier qui ait vu, vivant, le comte de Borel. Pourquoi Maurice cachait-il cette rencontre à Solange, très éprise de lui ? Aurait-il fait une promesse au comte de Borel ? Désorientée, amoureuse, malheureuse mais résolue, Solange doute de la mort de son père et se jure de savoir toute la vérité...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 322
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
La Chataigneraie
Pages de titreIIIIIIIVVVIVIIVIIIPage de copyrightLa Chataigneraie
Par Max du Veuzit
Max du Veuzit est le nom de plume de Alphonsine Zéphirine Vavasseur, née au Petit-Quevilly le 29 octobre 1876 et morte à Bois-Colombes le 15 avril 1952. Elle est un écrivain de langue française, auteur de nombreux romans sentimentaux à grand succès.
I
4 avril.
Je quitte pour toujours le couvent, ce matin.
Joie, bonheur !
Les religieuses m’ont fait leurs adieux, les yeux remplis de larmes...
Yvonne du Boussu m’a dit : « Chic ! tu en as de la veine ! J’ai encore quinze mois à rester ici, moi ! »
Marthe Charmin m’a soufflé à l’oreille : « Bonne chance ! Tâche de dénicher vivement un mari et invite-moi à tes noces... »
Lucy Kabd a déclaré en m’embrassant : « Ce qu’on va s’ennuyer, ici, sans toi ! Quelle malchance, quand il en part une ! »
Enfin, Suzanne de Vouzon, ma préférée entre toutes, m’a fait ses adieux en sanglotant : « Tu m’écriras souvent, dis ?... »
J’ai promis...
Et, malgré ma joie de m’évader, cela me faisait quelque chose de les quitter, ces quatre-là !
6 avril.
Enfin libre !
Je suis aux Tourelles, depuis hier, auprès de ma chère maman et de notre vieille bonne Félicie.
Un grand silence règne dans la maison... toujours ce même silence douloureux qui m’impressionnait tant, lorsque j’étais petite.
Nos murs cachent des larmes, des soupirs, des regrets.
Ma mère, éternellement vêtue de noir, garde, non seulement dans son cœur, mais aussi sur son visage, dans sa voix, dans ses gestes, dans ses vêtements, le deuil du mari bien-aimé qui a péri en mer, après quatre années de bonheur sans nuages, alors que, toute jeune maman, ayant à peine atteint l’âge de vingt-trois ans, tout, dans la vie, semblait répondre à ses sourires, à ses désirs...
Il y a quinze ans de cela !
Les jours, les mois, les années ont passé ; dans la grande demeure silencieuse, la gaieté n’est pas revenue...
7 avril.
J’ai pris ce matin trois grandes résolutions : secouer l’ombre du passé, réveiller la maison endormie, et, tâche plus difficile peut-être, mais certainement plus douce, faire sourire ma mère !
8 avril.
Mon nom ? Solange de Borel.
Mon âge ? Dix-huit ans.
Mon portrait ? Grande, mince et blonde. Des cheveux fous, un teint clair, des yeux bizarres... comme des noisettes.
Parfaitement, j’ai les yeux couleur de noisettes bien mûres ou de vieil or bruni. On en parlait assez, à la pension !
9 avril.
Les Tourelles, c’est le nom du petit domaine où ma mère est née.
Un parc, une maison carrée, flanquée de quatre hauts clochetons aux toits d’ardoise, un potager et un herbage, voilà les Tourelles.
Dans le parc, il y a une charmille d’où l’on découvre toute la vallée environnante. C’est mon lieu de prédilection.
Dans la maison, il y a une délicieuse petite chambre pompadour. C’est la mienne.
Et dans l’herbage prennent leurs ébats un grand cheval fougueux et une jolie jument baie qu’on attelle habituellement, mais que je vais apprendre à monter.
Voilà, pour le moment, mes trois royaumes.
11 avril.
Pris, aujourd’hui, ma première leçon d’équitation.
C’est le fils de notre ancien régisseur – car nous avons été très riches, autrefois – qui me donne des leçons.
Il se nomme Bernard Sauvage et est âgé de quarante-cinq ans environ. C’est un ancien sergent rengagé et il émaille sa conversation de consonnes ronflantes comme des roulements de tambours.
– At... t... tention ! Vous allez t... t... tomber !
Ma mère a en lui une confiance illimitée. Comme elle ne veut pas que je sorte seule, ni que je reste sans cesse enfermée aux Tourelles, et que, d’un autre côté, elle ne peut ni ne veut me suivre, elle a demandé à Sauvage de bien vouloir m’accompagner.
Il vit seul, de quelques modestes rentes, dans une petite maison située de l’autre côté du vallon, au milieu des bois.
À l’appel de ma mère, il est accouru, tout fier, tout rayonnant de la mission de confiance qu’elle lui donnait.
Oh ! le bon regard de chien dévoué dont il m’a enveloppée quand je lui ai dit, en renouant connaissance, par une bonne poignée de main :
– Sauvage, je suis contente de vous avoir pour compagnon de promenade : ce qu’on va en faire des excursions, tous les deux !
– Oh ! mademoiselle, c’est moi qui suis heureux... si heureux ! Mme de Borel ne se doute pas de tout le bonheur que ça me cause !
Le brave homme était si troublé que j’ai vu ses yeux s’emplir de larmes...
J’ai été infiniment remuée par cette silencieuse émotion.
Mon vieux Sauvage, vous ne soupçonnez pas quelle spontanée sympathie elle a éprouvée pour vous, la « petite demoiselle » à qui vous servez de moniteur...
13 avril.
Reçu ce matin une lettre très affectueuse de Suzanne qui m’annonce pompeusement que les religieuses, se conformant au progrès qui met du sport dans tout, ont attaché un professeur de gymnastique à la pension,
Ces demoiselles font « du torse ». Bravo !
Moi, je fais « du cheval ». Rebravo !
14 avril.
Ça va bien. Je commence à très bien me tenir sur Mascotte.
18 avril.
Mon professeur est émerveillé ! Il dit que je suis une écuyère accomplie et que nous ferons demain une première chevauchée hors du parc.
Comme je suis contente !
19 avril.
Ce matin, toute rouge de plaisir, j’ai quitté les Tourelles à cheval.
Ma mère, le front soucieux, m’a regardé partir. Elle craint tant que mon inexpérience ne sache retenir Mascotte au passage de quelque voiture ou de quelque bruyante auto !
– Ça va, Bernard ?
– Très bien, mademoiselle. On dirait que vous avez passé toute votre enfance à cheval.
Je suis très fière ! Pourtant, au fond, j’avoue que je ne suis qu’à moitié rassurée quand Mascotte dresse les oreilles et que je la sens frémir sous moi, prise d’un impatient besoin d’exécuter un temps de galop. La présence à ses côtés de Mylord, le cheval que monte Bernard, semble l’électriser.
– Pas trop vite, mademoiselle ! Habituez-vous d’abord à la route et aux allées et venues des voitures.
Ce n’est pas à moi que Sauvage devrait dire cela, mais à Mascotte !
25 avril.
Maintenant, nous faisons de longues randonnées à cheval. Tantôt, nous sommes allés jusqu’à Thierville, le chef-lieu de canton, soit seize kilomètres aller et retour.
Il faisait un temps délicieux ; le ciel était bleu, les oiseaux chantaient en faisant leurs nids, les arbres pleins de fleurs, tels de gros bouquets blancs et roses, tranchaient sur la verdure délicate des feuilles d’avril. Tout était gai dans la nature que pare le renouveau... Il y eut pourtant de la mélancolie dans mon âme !
J’étais partie gaie, insouciante, comme tous les jours. À mes côtés, Sauvage manifestait la même sérénité. Mais un passé douloureux allait nous effleurer de son ombre.
Il a suffi d’un simple mot pour l’attirer et le faire revivre, car les mots s’échappent, se multiplient, deviennent des phrases, éveillent des pensées... des souvenirs qui font souffrir...
Nous avions descendu le vallon et remonté, à l’est, par une large route ombragée, à travers bois.
– C’est délicieux, par ici ! m’écriai-je. Comment nommez-vous ce coin-là, Bernard ?
Il m’a regardée, un peu surpris.
– Nous traversons la Châtaigneraie, en ce moment, mademoiselle, m’a-t-il dit simplement.
La Châtaigneraie !
Ce nom, brusquement, éveillait en moi de confus souvenirs.
– C’était la propriété de mon père, n’est-ce pas ?... ai-je demandé, un peu embarrassée de n’avoir pas reconnu ou deviné ce que, pourtant, j’aurais dû si bien connaître.
– Dame ! fit-il pour toute réponse, d’un ton un peu bourru.
Il évitait de me regarder et, comme si ce sujet lui avait déplu, il se mit à siffloter.
Je restai songeuse. Une foule de souvenirs m’assaillaient soudain, auxquels, pourtant, je n’avais guère pensé jusque-là.
– La Châtaigneraie... mon père !
Comme ces deux noms revenaient de loin à mon entendement ! Autour de moi, on ne les prononçait pour ainsi dire jamais.
Mon père ! La Châtaigneraie !
Je savais que le grand château avait appartenu à ma famille et que nous avions cessé de l’habiter depuis la mort de mon père.
Le sujet était triste, mais déjà fort lointain. Le temps avait passé, amenant de nouvelles images à mon cerveau d’enfant... bref, une sorte d’oubli volontaire noyait d’ombre le souvenir de mon père et celui du domaine qui nous avait appartenu.
Mais la fatalité nous mène. La main du hasard se posa lourdement sur mon épaule et me fit tressaillir à ce nom presque oublié et plutôt sans saveur pour moi : La Châtaigneraie.
Du fond de mon enfance, toute une foule de réminiscences remontèrent soudain à la surface, faisant naître un impulsif et inattendu besoin de parler d’elles.
Ce fut plus fort que moi de me tourner vers mon compagnon et de l’interroger, sans me douter que mes questions inusitées allaient déchaîner une tempête dans mon existence jusqu’ici si calme de jeune fille douillettement élevée par une mère très bonne.
– Vous avez connu mon père, vous, Bernard ?
– Oui, fit-il laconiquement.
Comme il me regardait, presque hostile, j’ajoutai, vaguement gênée :
– Vous comprenez, à la maison, on n’en parle pas. Cela rendrait plus triste encore ma pauvre maman toujours endeuillée.
– On ne vous parle pas de votre père ? s’exclama-t-il sourdement en donnant un coup de cravache brutal à son cheval.
– Jamais, affirmai-je, toute saisie de sa violence. C’est un sujet qu’il n’est pas nécessaire d’évoquer... un sujet qui me semble presque interdit devant ma mère si mélancolique.
– Mais, Félicie ?
– Félicie ne répond pas quand on l’interroge.
– La vieille chipie ! fit-il entre ses dents.
– Oh ! vous n’aimez pas Félicie ? m’écriai-je avec surprise. C’est une brave fille, cependant !
– Oui... c’est une honnête femme... mais elle est trop dévouée à sa maîtresse : ça la rend injuste et méchante pour les autres !
– On n’est jamais trop dévoué à ceux que l’on aime, répliquai-je doucement.
– Si, quelquefois... Quand le dévouement flatte, on épouse les haines et les rancunes de ceux pour qui on l’exerce.
J’ouvris de grands yeux étonnés.
– Je ne comprends pas pourquoi vous dites cela à propos de Félicie.
Il donna un nouveau coup de cravache à son cheval.
– Je suis une vieille bête qui mérite bien le nom de Sauvage que m’a légué mon père ! Votre Félicie est une sainte ! Oubliez ce que je vous ai dit à son sujet, mademoiselle. J’aurais dû garder ma langue pour une moins mauvaise cause.
Son visage était dur et violent, comme jamais, encore, il ne m’était apparu. Quelque chose en moi, pourtant, s’émouvait. Il me semblait que cette violence ne me concernait pas, au contraire !
Je fis ranger mon cheval contre le sien et, poussée par je ne sais quel subconscient dominateur :
– Bernard, mon brave Bernard, murmurai-je, ne vous fâchez pas. Si vous saviez combien cela me semble bon de causer avec vous... surtout du passé... et sérieusement, encore ! À la maison, je suis l’enfant... toujours l’enfant ! Les fleurs, les oiseaux, mes pinceaux, mes livres et mes toilettes, voilà les seules choses dont on m’entretienne... Aussi, si mes paroles éveillent en vous, quelquefois, de mauvais souvenirs, ne m’en veuillez pas, Bernard, je les prononce sans l’intention de vous faire de la peine.
Le visage de mon compagnon s’empourpra.
– Vous êtes trop bonne, mademoiselle, de vous émouvoir pour un vieil ours comme moi. Ils ont raison ceux qui vous parlent de fleurs et de papillons... Souriez, vos lèvres et vos yeux sont faits pour connaître la joie.
– Pourquoi donc alors me dites-vous ça si lugubrement ? Ne détournez pas la tête... Bernard, regardez-moi...
Il leva vers le mien un bon regard ému qui me fit du bien après sa violence de tout à l’heure.
– Ah ! si vous saviez combien je vous suis dévoué, à vous... vous, la fille de M. Frédéric !
Je me penchai vers lui et lui pressai la main avec force.
– Vous aimiez beaucoup mon père ? demandai-je avec un serrement de cœur, car je sentais que, malgré les années, cet homme en avait gardé le souvenir très précis, alors qu’aux Tourelles on ne semblait jamais vouloir penser au cher disparu.
– Je l’aimais comme un dieu, répondit Sauvage sourdement. J’avais joué avec lui tout petit. Au régiment, puis au front, je ne l’ai pas quitté. Plus tard, j’étais encore au château, à ses côtés... Il avait confiance en moi, c’est tout dire !
Il se moucha bruyamment pour cacher l’émotion qui crispait son visage ; puis, après un silence, il reprit d’un même ton voilé qui semblait remuer des souvenirs sacrés :
– C’était un homme si charmant, si aimable... trop charmant et trop aimable même... Ce sont des qualités qui font faire des bêtises, quelquefois, aux meilleurs, et ça se paie cher !
– Oui, j’ai cru comprendre que papa s’était ruiné.
– Ruiné ! s’exclama-t-il.
– Mais oui, ruiné ! répondis-je simplement, sans émotion, car cela était si loin que je n’en souffrais pas.
N’ayant pas connu la vraie richesse, je ne pouvais m’émouvoir d’une ruine qui ne me touchait qu’après coup.
Je repris :
– Papa avait perdu la majeure partie de sa fortune quand il est parti, au loin, pour essayer de la regagner... Hélas ! il n’y a trouvé que la mort. Pauvre père !
– La mort ! Vous avez dit la mort ? Tonnerre ! Est-ce sa fille qui parle de mort ?
Je sursautai, ne m’attendant pas à une telle exclamation alors que j’évoquais tout simplement la fin prématurée de mon père.
Il avait bondi sur sa selle et, maintenant, pris d’une rage subite, Bernard Sauvage faisait tournoyer sa cravache dans l’espace, vers les branches des arbres qui formaient voûte sur nos têtes. Et les feuilles tombaient, déchiquetées, après le cinglement sec qui les avait décapitées.
Étonnée de cette crise de fureur qui le bouleversait, j’avais arrêté mon cheval et je le regardais, sans comprendre, essayant d’expliquer son attitude. Pourquoi protestait-il si violemment quand je parlais de la mort de mon père ?
– Bernard, calmez-vous ! calmez-vous ! Mon Dieu ! qu’avez-vous ? Que vous ai-je dit ?
Il fut long à m’entendre.
Quand il se tourna vers moi, je perçus son pauvre visage tout contracté.
Mais, se ressaisissant à ma vue, il chercha à s’excuser et il le fit si maladroitement qu’il me parut vouloir donner le change sur les mots qui lui étaient échappés.
– Pardonnez-moi, mademoiselle Solange. Je suis un vieux sot que les mots font bondir... C’est fini, n’y pensez plus ! En Afrique, on a la tête chaude et les cerveaux s’exaltent facilement... Je suis allé là-bas et, malheureusement, j’en ai rapporté l’habitude de me mettre facilement en colère.
Je hochai la tête pensivement.
– Mais non celle de vous y mettre pour rien, observai-je, pas du tout convaincue par ses explications. Ce sont mes paroles qui vous ont fait bondir. Je vous en prie, expliquez-moi pourquoi vous avez protesté quand je vous ai parlé de la mort de mon père ?
Sa figure, à nouveau, se durcit subitement.
– Ça fait toujours du mal d’entendre des choses qu’on n’attend pas... des choses que...
Il s’arrêta.
– Votre père était un si bon maître, acheva-t-il, un peu bourru.
Il fuyait encore mon regard avec embarras.
– Non ! non ! m’écriai-je. Pas de vains prétextes ! Parlez-moi de mon père, de sa mort...
– Mais je ne sais rien, mademoiselle.
– Si, vous savez quelque chose... Votre colère n’était pas naturelle... Rien ne l’expliquait... et vous avez laissé échapper des paroles... Sauvage, par pitié, dites-moi ce que vous savez.
– Ce n’est pas à moi, mademoiselle, de vous entretenir de tout cela. Interrogez votre mère...
– Ma mère ne me dit rien. Un jour, – j’étais petite, – j’ai voulu qu’elle me parlât de mon père...
– Alors ?
– Elle s’est dressée, l’air douloureux, mais ferme, en me défendant de jamais aborder un tel sujet... Que vous dirai-je ? Sa détresse m’a frappée... je n’ai pas recommencé.
– Et Félicie ?
– Je l’ai interrogée bien des fois. Je voulais qu’elle évoque mon père... qu’elle me cite quelques scènes de son existence... qu’elle me dise comment il avait trouvé la mort.
– Et que vous répondait-elle ?
– « Monsieur est mort en mer... Ne parlez jamais de cela à Madame : le docteur a dit que ça pourrait la tuer. »
– Vous avez dû insister, cependant ?
– Oui, souvent ; mais sans résultat. Félicie ne sait rien ou refuse de me dire quelque chose. Quand j’insistais trop, elle devenait presque impolie... À la fin, j’ai fini par ne plus faire allusion au passé... À quoi bon, puisque cela ne m’avançait à rien ?
– Une façon comme une autre d’enterrer une nouvelle fois ce pauvre Monsieur, grogna l’homme, qui retomba dans son mutisme.
De nouveau, j’avais sursauté.
En éclair, l’idée que la mort de mon père cachait quelque chose de mystérieux me traversa la tête. Alors j’insistai, car je voulais savoir ; maintenant, j’étais sûre que mon compagnon était au courant de faits que j’ignorais.
– Bernard, vous ne m’avez pas répondu quand je vous ai supplié de me dire ce que vous saviez concernant la fin tragique de mon malheureux père. Je vous en prie, parlez : dites-moi la vérité, car le doute est le pire des supplices.
Il resta silencieux et sombre, quelques instants encore, comme s’il ne m’avait pas entendue. Puis, relevant la tête, il me regarda bien en face.
– Vous a-t-on conduite, quelquefois, prier sur la tombe de M. de Borel ?
– Non, puisqu’il est mort au loin... en mer... Son yacht a sombré.
Un sourire ironique crispa sa lèvre.
– M. Frédéric était ruiné, mais il possédait encore un yacht... et il usait de ce coûteux moyen de transport pour aller chercher fortune au loin ?... La fable ne tient même pas debout !
Ses remarques me foudroyèrent. Dans un réflexe d’hallucination, je passai la main sur mon front où mes idées se heurtaient fiévreusement.
La remarque de cet homme était juste. Comment ne j’avais-je pas faite moi-même ?
Et mes yeux s’agrandirent avec épouvante sous l’afflux des déductions offertes si impérativement à ma compréhension.
Mon père !... mon père que je croyais mort... dont la fin tragique n’était pas douteuse... mon père, peut-être, vivait encore ?
Il y avait du vertige dans mon cerveau.
Cependant, déjà, j’entrevoyais des possibilités inattendues.
Mon père vivant !
Malgré l’invraisemblance de cette perspective merveilleuse et n’y eût-il qu’une chance sur cent mille qu’elle se réalisât, il me fallait examiner cet atome de probabilité et essayer de tirer au clair les raisons qui pouvaient l’appuyer.
– Bernard, parlez-moi encore ! Vous m’en avez trop dit pour ne pas vous expliquer davantage. Pourquoi élevez-vous un doute sur la réalité de la mort de mon père ?
– Écoutez, mademoiselle Solange, reprit l’homme avec une certaine gravité. Chez nous, les paysans ont une croyance : un homme n’est pas mort tant qu’il n’a pas été enterré.
– Mais si son corps a disparu ?
– Pourquoi sa vie aurait-elle disparu en même temps ?
– Alors, m’écriai-je, le visage transfiguré d’espoir, vous supposez que mon père n’est pas mort ? Qu’il n’est seulement que disparu et qu’il vit quelque part, au loin ?
– Pourquoi pas ?... Ce n’est pas impossible !
Mais mon exaltation tomba.
– Il y a quinze ans qu’il est parti, fis-je en secouant la tête. S’il vivait encore... ma mère le saurait... Il serait revenu... ou nous aurait donné de ses nouvelles...
Sauvage haussa les épaules :
– Ça, c’est autre chose ! On peut vivre sans écrire, sans revenir...
– Voyons, Bernard, réfléchissez... Un homme ne laisse pas sa femme et son enfant dans l’ignorance de son existence. Et celles-ci iraient bien vite le rejoindre s’il y avait le moindre espoir qu’il vive encore... Non, mon père est bien mort, malheureusement... sans quoi nous ne serions pas séparées de lui.
Mais Sauvage continuait de secouer les épaules...
– Il n’y a pas que la mort qui puisse séparer les gens, murmura-t-il entre ses dents.
– Vous dites ?
– Rien !... J’en ai déjà trop dit !
– Je vous en prie !
– Non !... Déjà, Mme de Borel ne me pardonnerait pas si elle savait que j’ai osé élever des doutes sur la véracité des explications qu’elle vous a données.
– Mais mon père vous bénirait s’il vivait et pouvait vous entendre.
Une humidité brilla dans les yeux de mon compagnon.
– Ah ! mademoiselle Solange ! s’écria-t-il, tout ému, si vous aviez connu, comme moi, M. Frédéric, sûrement que vous voudriez le revoir et que vous le chercheriez.
– Oh ! Bernard, vous ne doutez pas que je veuille rechercher mon père !... Je ne l’ai pas connu, ou, plutôt, je ne me le rappelle pas ; son souvenir s’est estompé dans les brumes de ma mémoire de bébé ; mais vous ne pouvez savoir combien sa présence m’a manqué. Auprès de mes compagnes heureuses, qui possédaient leurs parents, je me faisais l’effet d’une déshéritée. Bien souvent, j’ai détourné la tête pour dérober mes larmes d’envie ou de regret, quand l’une d’elles, au parloir, se jetait dans les bras de son père pour l’embrasser et être pressée affectueusement contre sa poitrine accueillante et sûre.
Je m’arrêtai... mes yeux brouillés de larmes contemplaient, dans le vide, mon enfance d’orpheline. Puis, plus doucement encore, je repris :
– Un père, c’est un sourire qui suit vos pas, c’est une atmosphère chaude et joyeuse autour de soi... une ambiance sans cesse renouvelée et vivifiée, car chaque fois qu’un homme rentre au logis il semble apporter avec lui tout l’air du dehors... J’ai eu une mère affectueuse et bonne, mais j’ai ignoré la maison bruyante et remuante, les rires sonores, les escapades hardies, les voyages lointains, les surprises inattendues qu’un père se plaît à organiser... Toute mon enfance est teintée de grisailles et de silences. Ma mère me cachait ses larmes ; son sourire était doux, sa voix caressante : elle ne voulait pas me livrer son chagrin de veuve inconsolable, mais notre demeure semblait emplie de mélancolie... Instinctivement, mes pas se faisaient légers et ma voix s’assourdissait pour ne pas troubler le calme impressionnant des grandes pièces désertes.
De nouveau, je cessai de parler.
Songeuse, ployée en avant, me tassant sur ma selle, j’oubliais le paysage magnifique qui s’allongeait à mes pieds, avec, dans le fond, les hautes futaies de la Châtaigneraie dressées vers le ciel.
À un moment, ma main flatta machinalement l’encolure de Mascotte, et la bête, stimulée par cette caresse, s’ébroua et fit un temps de trot.
Réveillée par son allure, je repris contact avec l’heure présente.
– Oh ! Bernard, dis-je, revoir mon père serait le plus cher de mes vœux, mais n’est-ce pas folie que de permettre à un tel espoir d’entrer en moi ?
– L’âme est faite pour espérer, fit-il sentencieusement.
– Mais est-il raisonnable d’espérer une chose impossible ?
– Avant de dire qu’une chose ne peut se faire, il faut d’abord essayer de voir si elle est vraiment irréalisable. Qu’est-ce qui vous empêche de rechercher M. Frédéric ?
– Chercher mon père ? Oh ! c’est entendu, je ne négligerai rien pour arriver jusqu’à lui, mort ou vivant... Mais trouverai-je ?
L’homme sourit sans répondre et ses yeux, qui plongeaient dans les miens, semblaient me crier éperdument l’affirmative. Une chaude rougeur d’espérance monta de mon cœur à mes joues, sans que, pourtant, rien de tangible eût soutenu l’espoir insensé que mon compagnon venait de faire naître en moi.
En parlant, nous avions achevé notre promenade et nous étions revenus aux Tourelles.
Devant le perron, Sauvage sauta à bas de son cheval et vint me donner la main pour descendre.
– Le mot d’ordre est silence, n’est-ce pas ? fit-il à mi-voix, avec une prière dans les yeux.
Je tressaillis.
– Oui, mais aussi alliance ! répliquai-je sur le même ton après une seconde d’hésitation. Nous sommes alliés, c’est bien ainsi qu’il faut entendre, insistai-je, mes yeux rivés aux siens.
– Merci, répondit-il, tout heureux. Je n’osais pas vous le proposer ; aussi, deux fois merci !
Je le quittai et grimpai à ma chambre changer de costume.
Un étonnement était en moi. Je ne comprenais pas très bien comment j’avais pu adopter si facilement les suggestions de l’ancien soldat. Je n’étais pas moins surprise d’avoir accepté ce silence qu’il m’imposait et plus encore d’y avoir répondu spontanément par cette alliance inusitée.
Quel besoin de conspiration m’avait donc instinctivement possédée ? Et contre qui, ce silence et cette alliance ?
Contre ma mère ?
Ah ! Dieu ! non ! J’adorais ma mère et la pensée de faire quelque chose qui lui déplût n’entrait pas en moi.
Contre la crainte de troubler sa quiétude et sa tranquillité ? Oui ? C’était plutôt cette raison qui, si impérieusement, m’avait fait accepter la défense de parler de Bernard et réclamer son aide.
Et cette certitude que j’allais travailler au bonheur de ma mère, en recherchant les traces de ce mari qu’elle pleurait toujours, fit envoler toutes mes hésitations.
D’ailleurs, je me sentais légère, transfigurée. Il me semblait qu’une résurrection s’était opérée en moi.
Mon père ! mon père vivant, peut-être ! Le fol espoir ! La merveilleuse perspective ! Cela tenait du prodige !
Un miracle venait bien, en effet, de s’accomplir. Et quel miracle !
Il avait suffi d’un mot magique d’espoir pour réveiller en moi le souvenir sacré de mon père qui y était enseveli depuis quinze ans !
II
27 avril
La pluie tombe sans discontinuer depuis deux jours et je n’ai revu Bernard que de loin, quand il vient visiter Mylord et Mascotte, qu’il a pris l’habitude, à présent, de venir voir chaque matin.
Dans ma tête s’agitent impétueusement des questions : tintements joyeux d’espoirs irraisonnés, glas funèbres de désespérantes réalités.
Comment ma mère aurait-elle pu me parler de la mort de mon père, si elle n’en avait pas acquis l’absolue certitude ?
Oh ! l’affreuse voix des désillusions inéluctables !
29 avril.
Toujours la pluie !...
Toujours le doute... Quelquefois, pourtant, l’espoir luit.
Grelots assourdissants qui, nuit et jour, résonnez en moi, quand cesserez-vous votre sarabande éperdue ?
Comme j’ai hâte d’agir...
30 avril.
Je me suis tenue longtemps, ce matin, dans la chambre de ma mère.
Pour la première fois, son attitude douloureuse m’est apparue dans toute sa désolation.
Elle a trente-huit ans à peine, ma chère maman, et, pourtant, ses cheveux sont déjà grisonnants. Le visage est tout jeune encore. Mais l’expression en est si lasse, si désabusée ! Et ce sourire si triste, si morne ; cette voix monotone que rien ne paraît plus devoir animer ; ces yeux pensifs, errants, qui regardent sans voir et semblent conserver, entre leurs cils baissés, des larmes mal essuyées...
Comme elle a dû souffrir pour en arriver ainsi à ne plus personnifier que la mélancolie sans espoir.
Vingt fois, j’ai été pour lui parler de mon père, pour lui demander des explications, des détails ; mais, à temps, je me rappelais la recommandation de Félicie :
« Le docteur a dit que ça pourrait la tuer. »
Et pour ne pas succomber à la tentation de l’interroger, je me suis sauvée dans ma chambre.
1er juin.
Je suis allée, tantôt, trouver notre vieille bonne, dans sa cuisine, où elle préparait le repas du midi.
Oh ! avec celle-là, je n’ai pas de ménagements à prendre.
Et, bien que m’attendant à l’entendre grogner, je lui dis bravement :
– Félicie, j’ai cherché par toute la maison le portrait de mon père pour le mettre dans ma chambre. Peut-être l’ai-je vu sans le deviner ; ne pourriez-vous pas me l’indiquer ?
La vieille femme ne s’attendait pas à mes questions.
Tremblante et effarée, elle me regardait subitement, comme si j’avais évoqué Satan et sa cour infernale.
– Oh ! mademoiselle ! je vous en prie, ne parlez pas de ça ! Comment pouvez-vous demander une pareille chose ?
– N’est-ce pas tout naturel qu’une fille ait le désir de posséder l’image de son père ?
– Mais, Madame ! Madame !... Vous ne songez donc pas à votre mère ?
Mon air décidé semblait la souffleter et je fus émue, malgré moi, de la voir si bouleversée.
– Ma mère ne peut pas trouver mal que je veuille avoir, chez moi, le portrait de mon père à côté du sien. Si vous refusez de me le donner ou de me l’indiquer, Félicie, je m’adresserai à elle-même et je suis sûre qu’elle ne me le refusera pas.
Mes paroles la mirent hors d’elle. Oubliant ses fonctions et les égards qu’elle me devait, elle marcha vers moi, menaçante.
– Oui, c’est ça ! allez la tuer en réveillant en elle de terribles souvenirs ! Croyez-vous que ce soit pour mon plaisir que j’évite d’évoquer le passé et les choses si douces d’autrefois ? Mais j’ai vu votre mère mourante, entre mes bras, et se tordant de fièvre pendant que sa bouche inconsciente répétait le nom de votre père... de son mari ! Vous ne comprenez donc pas que si je l’ai arrachée à la mort, si je vous l’ai conservée c’est au prix d’une surveillance continuelle, en faisant disparaître tout ce qui pouvait lui rappeler la catastrophe où son bonheur avait sombré ?... Allez lui en parler, à présent qu’elle se laisse vivre à peu près tranquillement. Allez briser son fragile repos ! C’est bien là une œuvre de piété filiale à remplir... D’ailleurs, ajouta-t-elle, je dois vous prévenir que tout ce que vous pourrez dire et faire n’avancera à rien. Il n’y a plus dans la maison aucun portrait, aucun souvenir de votre père ; tout a été déchiré et brûlé par mes soins. Cherchez, mais vous ne trouverez rien ! rien !
Brisée par cette folle colère, la vieille Félicie était tombée sur une chaise en sanglotant.
Je la regardai, anéantie, mais relativement peu émue.
La violence même et l’exagération de ses reproches m’avaient fait, subitement, retrouver mon calme, et je la considérais, pour le moment, d’un œil plutôt froid.
En même temps, les paroles de Bernard me revenaient à la mémoire :
« Il y a des dévouements qui font du mal à ceux qui en sont l’objet. »
Félicie venait d’avouer que c’était elle-même qui avait fait autour de ma mère ce dur silence d’oubli au sujet de mon père.
Et soudain, malgré ses longues années de service, malgré son attachement, sa fidélité de caniche, elle me parut l’ennemie, celle qui peut-être était cause de l’état douloureux de ma mère ; celle qui était responsable de l’éloignement de mon père, si vraiment, comme Sauvage me l’avait laissé entendre, il n’était pas mort.
Malgré moi, mes poings se serrèrent sous une violence intime, inconnue jusque-là.
Je reculai vers la porte, loin de la femme, pour fuir la tentation folle qui me prenait de me jeter sur elle et de la forcer à m’avouer quel rôle malfaisant elle avait joué autrefois dans la vie de mes parents.
Sans mot dire, me sentant très pâle, je sortis de la cuisine et montai à ma chambre.
Je me croyais très calme, très résolue, mais, la portière retombée derrière moi, il y eut comme une détente de tous mes nerfs. Rage, déception, amertume, désespoir, tout chavirait mon être et tendait mes nerfs.
Je me sentis très faible, ma gorge se contracta ; autour de moi, je vis tournoyer les objets et, tout à coup, vaincue, prise de vertige, je tombai lourdement tout de mon long sur le tapis.
Quand je revins à moi, une minute après, j’étais allongée sur mon lit, avec ma mère et Félicie s’empressant à mon chevet.
– Ma fille ! ma Solange ! Qu’est-ce que tu as eu ?
Dans les chers yeux maternels, je lisais une angoisse sans bornes.
Et malgré ma faiblesse, me sentant forte à côté d’elle, je souris pour la rassurer.
– Ce n’est rien, mère... Cette pluie, n’est-ce pas ?... Mais c’est passé, c’est fini.
Pourtant, comme contrecoup, une lourde envie de pleurer me prenait.
Timidement, avec des airs de chien battu, Félicie me présenta un verre d’eau sucrée que je repoussai.
– Merci, je ne veux rien.
Et j’éclatai en sanglots convulsifs.
Consternée, Félicie resta debout devant mon lit, pendant que ma mère m’attirait dans ses bras et me berçait avec des mots très doux.
Ma crise de larmes dura fort peu de temps, heureusement, et bientôt je fus en état de me lever et de réparer le désordre de ma toilette.
Me voyant mieux, ma mère avait quitté la chambre. Félicie, au contraire, sous le prétexte de refaire mon lit, resta auprès de moi.
– le vous demande pardon, mademoiselle Solange, si ce sont mes paroles qui vous ont fait de la peine. J’aime beaucoup madame votre mère et la pensée que vous pouviez, sans le savoir, lui faire du mal m’a fait vous dire des choses très dures, que je regrette à présent.
Je me tournai vers la pauvre vieille qui se tenait debout dans une attitude si humble et si repentante qu’un élan de pitié me fit lui tendre la main.
– Oublions cela, Félicie. Je n’aime pas moins ma mère que vous pouvez l’aimer et, si je vous menaçais de l’interroger, sans avoir l’idée de le faire, c’est que je sentais que vous ne vouliez pas me répondre.
– À quoi bon vous tracasser avec toutes ces choses qui sont mortes ?
– J’aurais voulu posséder ce... que vous savez... Vraiment, je croyais que c’était de votre part mauvaise volonté.
– Non, je vous affirme que tout a été détruit, et qu’il ne reste rien de... de ce monsieur.
Je redressai brusquement la tête.
– De mon père, vous voulez dire !
Une dureté, de nouveau, passait dans mes yeux froids.
– Vous vous trompez, repris-je. Il y a quelque chose de lui que nul ne pourra jamais détruire.
– Quoi donc ? fit-elle, étonnée.
– Mon cœur ! le cœur de sa fille ! répliquai-je avec une sorte d’orgueil rageur en la poussant vers la porte.
Elle me contempla longuement avec effarement. Puis, elle quitta la chambre en hochant la tête comme si ma déclaration trop nette lui paraissait être le délire d’une insensée d’où allaient résulter bien des malheurs.
5 juin.
Enfin, le soleil brillait, ce matin ! Quand Sauvage vint visiter Mylord et Mascotte, je lui criai de ma fenêtre que s’il pouvait me consacrer sa matinée j’étais prête à faire une longue chevauchée dans la campagne.
– Je suis à vos ordres, mademoiselle, répondit-il. Je vais seller les chevaux immédiatement.
Dix minutes après, nous quittions les Tourelles.
– De quel côté allons-nous ? demanda Bernard.
– Vers la Châtaigneraie, voulez-vous ? Vous devez la connaître ; moi, je l’ignore. Conduisez-moi vers ce domaine où mon père est né.
Sans dire mot, l’ancien soldat nous fit tourner à droite, et, quand nous arrivâmes au bout du village, il me montra les dernières maisons.
– À partir de là commencent les terres de la Châtaigneraie ; depuis le bois, là-bas, jusqu’à la rivière.
– Qui est-ce qui les tient ?
– Les Raimbond.
– Ce nom m’est inconnu.
– Ce sont de nouveaux fermiers... Les Vincent, qui les affermaient depuis si longtemps, sont morts il y a quelques années.
– Mais les terres sont toujours attachées au domaine ?
– Toujours... Il n’y a rien de changé, sauf du côté de Neuville, où une vingtaine d’hectares ont été cédés au baron Jacob, par votre père... avant son départ.
– Un juif, n’est-ce pas, ce baron Jacob ?
– Oui.
– Qu’est-ce qu’il fait ?
– Il a monté une usine... une fabrique de cotonnades.
– J’en ai entendu parler... Mais, dites-moi, le nouveau propriétaire de la Châtaigneraie, c’est Me Piémont, l’ancien notaire de mon père ?
– C’est ce que tout le monde raconte.
– Ne serait-ce pas vrai ?
– C’est à voir... Ce qu’il y a de certain, c’est que c’est lui qui touche les revenus.
– Il n’habite pas la Châtaigneraie ?
– Il y vient chasser l’hiver et y passer plusieurs semaines l’été.
– Donc, c’est bien lui l’heureux propriétaire, à présent !
– Il en prend les airs... Pourtant, on pourrait remarquer bien des choses.
– Lesquelles ?
– Il n’habite généralement qu’une aile du château et tout le reste de la vaste demeure est tenu sévèrement fermé.
– Même quand il est ici ?
– Toujours.
– Tiens, pourquoi ?
– Il dit que les pièces ne sont pas habitables et qu’il faudrait beaucoup d’argent pour réparer tout ça.
– Peut-être a-t-il raison... Mon pauvre père, dans les derniers temps, n’aura pas pu entretenir tout en état.
– Je puis vous affirmer qu’au contraire M. Frédéric a toujours tenu la main à ce que tout soit mis en ordre et réparé. J’ai parcouru souvent l’intérieur du château et c’était joliment soigné : un vrai musée !
Je le remerciai du regard de ce que je pris pour un pieux mensonge.
– Enfin, ce notaire a ses raisons... chacun est libre chez soi.
– Évidemment ! Bien qu’on ne possède pas une pareille propriété – surtout quand on est un homme d’affaires... c’est-à-dire d’argent ! – pour l’habiter six semaines par an et la laisser dans l’état d’abandon où elle se trouve.
– Ah ! fis-je tristement, tout est abandonné ?
– Je vous crois ! Tenez, nous y arrivons. Je vous ai fait prendre par les derrières... Il y a une brèche dans le mur... Je connais très bien l’endroit... nos montures y passeront aisément.
– Mais vous ne comptez pas y pénétrer ?
– Pourquoi pas ? Je l’ai fait souvent, allez !
– Si quelqu’un nous y voyait ?
– Et que voulez-vous que cela fasse ? C’est Mathieu Savalle, le garde-chasse, qui a les clefs. Il surveille le château et les bois pour qu’on ne dévaste rien ; mais je puis vous affirmer qu’il ne dira rien s’il nous y rencontre. Au contraire !
– Il a servi mon père, aussi, celui-là ?
– Non, mademoiselle. C’était son défunt frère qui était garde chez vous, autrefois. Mais c’est la même chose : de père en fils, ce sont d’anciens serviteurs qui ont vécu à l’ombre du château. Mais voici la brèche... Je vais passer le premier pour vous montrer le chemin... Hop ! ça y est !... À votre tour. Tenez ferme et enlevez Mascotte ! Bravo ! Voici un beau saut !... Et maintenant, suivez-moi... Attention ! cette branche déchirerait votre écharpe... Enfin, voici l’avenue.
Nous venions, en effet, de pénétrer dans une large avenue que l’herbe et la mousse avaient complètement envahie. Elle ne gardait aucune trace de pas ; nul pied humain ne devait l’avoir parcourue depuis longtemps.
Un sentiment inexprimable de crainte et de joie me remplissait alors, et je crois que si j’avais été seule je me serais mise à pleurer d’émotion.
– Bernard, fis-je à mi-voix, – car une sorte de pudeur religieuse m’empêchait de parler haut dans ces lieux peuplés d’ancestraux souvenirs, – mon père, autrefois, a souvent dû parcourir cette allée ?
– Oui, mademoiselle. Même que je me rappelle... quand il était petit... ici, tenez... il avait échappé à la surveillance de son précepteur, un brave abbé qui savait fermer les yeux quand il le fallait. Nous étions une bande de gamins et nous jouions à la guerre. C’était M. Frédéric notre général... Comme il était crâne et fougueux ! Il nous entraînait et nous l’aurions suivi au bout du monde. Oh ! si vous aviez pu le voir...
Il porta la main à ses yeux humides et les essuya du bout des doigts.
– Faut m’excuser. Voyez-vous, mademoiselle, j’en étais !... Ça ne s’oublie pas, ces choses-là. C’est du passé qui est cher au cœur.
Je ne pus répondre, car une émotion poignante me serrait la gorge.
Il me semblait que je marchais dans un cimetière... Les tombes, c’étaient ces arbres silencieux et abandonnés...
Les fantômes, c’étaient les souvenirs de mon père que cet homme évoquait avec des larmes dans la voix... Les morts, c’était le passé, tous les êtres qui étaient de mon sang et dont je connaissais à peine le nom et encore moins l’histoire...
Après vingt minutes de marche au pas, nous débouchâmes dans le parc proprement dit.
L’herbe était haute et la pelouse remplie d’orties et de chardons. Les fleurs fanées s’entassaient, étouffant les pousses vertes ; les buissons disparaissaient sous les ronces ; les bosquets étaient impénétrables. Tout me révélait un abandon total qui me fit vraiment mal.
– Il y a quinze ans qu’aucun jardinier n’a touché à ce parc, expliqua Bernard.
– Mais, pourquoi, pourquoi l’avoir laissé dans un état de désolation ?
Mon compagnon hocha la tête pensivement.
– Les choses reflètent souvent les pensées des hommes, murmura-t-il, comme se parlant à lui-même. Il y a quinze ans, tout était beau, brillant... les allées entretenues, les serres soignées et les massifs tondus !... Le château et le parc resplendissaient de mille feux, le soir venu, car les fêtes s’y succédaient à l’envi... L’amour et la jeunesse qui unissaient vos parents, l’enfance et l’avenir que vous personnifiez, tout rayonnait ici... Puis, l’orage est venu. Il a brisé et tordu les cœurs... Finis les sourires quand les larmes arrivent. Finies les fleurs quand naissent les ronces. Maintenant, c’est l’abandon et le deuil... c’est l’image de votre maman désolée... celle de l’absence douloureuse et énigmatique de M. Frédéric... c’est la vôtre, pauvre fleur de serre qu’on n’arrive pas à déraciner et qui, malgré vous, cherchez l’ambiance où vous êtes née...
– Mais ce notaire n’aurait pas dû agir ainsi ! Il n’avait pas à se préoccuper des malheurs qui ont fondu sur nous et qui ne l’atteignaient pas. En achetant cette maison, il ne prenait pas à son compte les soucis de ses précédents propriétaires et il n’avait pas à stigmatiser à jamais les douleurs que mes pauvres parents ont ressenties alors.
– C’est donc qu’il n’est pas maître de ce château... maître de l’entretenir à son goût.
Je portai ma main fiévreuse à mon front brûlant où les pensées s’entrechoquaient en trombe.
– Si c’était vrai ? Qui me dira ?...