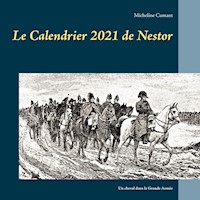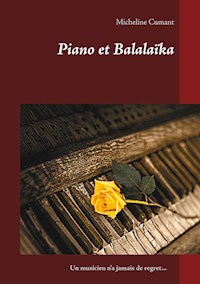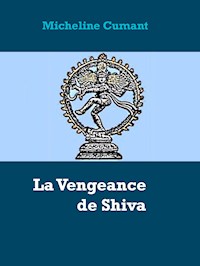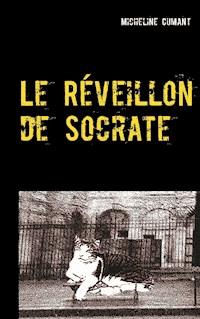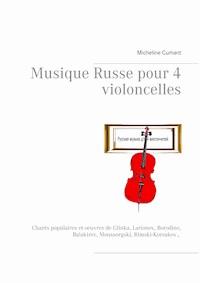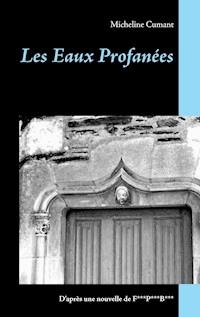Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Französisch
Le superintendent Quint-William Rockwell espérait bien passer quelques semaines de vacances dans sa maison du Wiltshire, tout près des alignements d’Avebury. Mais on découvre un cadavre… puis un meurtre est commis… Dans les deux cas, la scène évoque celle d'un rituel macabre… Et tout tourne autour d’une jeune cavalière dont il semble qu’elle n’ait laissé personne indifférent. La police locale, désarmée, finit par solliciter l’aide de l’homme de Scotland Yard qui, prenant conseil de son vieil ami, l’ancien magistrat Seamus Casey-Wynford, s’emploie à reconstituer les faits, mais aussi les ressorts psychologiques qui ont pu amener quelqu’un à devenir une sorte d’ange exterminateur. Fin musicien, le superintendent Rockwell démonte, examine les actes et les caractères comme s’il analysait une fugue de Bach, mais tout en conservant la sensibilité d’une œuvre de Chopin…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 277
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
À la mémoire de F.P.B.
Carte de la région du Wiltshire
TABLE DES MATIÈRES
PROLOGUE : Adagio Maestoso
I.
II.
III.
LIVRE PREMIER : Andantino espressivo
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
LIVRE SECOND : Allegro Agitato
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
LIVRE TROISIÈME : Presto a Tutta Forza
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
FINALE : Cadenza con espressione
I.
II.
III.
PROLOGUE : Adagio Maestoso
I.
C’était le reflet d’un nouveau-né.
Il avait seulement quelques heures de vie. Le cordon ombilical portait encore une ligature, mais du pus commençait à se former. À l’exception du sac poubelle maculé de sang et de glaires, c’était son image inversée, reproduite par-delà le temps et l’espace qu’il retrouvait dans ce fichu môme qui remuait encore. Pas de chance, ç’aurait pu être un dur à cuire, celui-là! Comme ça, sans rien, nu dans un sac poubelle, il avait encore un souffle de vie. L’autre avait eu des langes, sûrement en dentelles. Et après? Cela ne l’avait pas empêché de souffrir.
Il fallait que ce reflet disparaisse, personne ne devait savoir. Non, personne n’avait à connaître ses tourments, il ne fallait pas que ce tas de chair tout près de se décomposer — un petit souffle en moins — que cet enfant lui rappelle, rappelle aux autres ce qui s’était passé.
La masse sombre, tremblant peut-être de quelque appréhension, se rapprocha de l’enfant. Un instant, il faillit le laisser, s’en éloigner, ne rien chercher à savoir. Mais il était le prédateur qui devait accomplir son œuvre. Les mains serrèrent la tête aux os encore mous, effaçant plutôt que détruisant cette présence qui était une quantité négligeable, un tas de chair sans passé ni présent, qui ne ressentait plus les cahots de la voiture ni l’obscurité du coffre où on l’avait jeté comme un détritus. Il ne sentit pas le couteau le percer, le prédateur agissait mécaniquement, méthodiquement, comme si ces gestes macabres faisaient partie d’une routine. Cet être n’avait pas le droit d’exister, il n’avait jamais existé.
II.
Une pluie chaude et molle de fin d’août baignait les environs d’Avebury, ne parvenant pas à masquer la nonchalance des grands mégalithes qui paraissaient laper l’eau, la détacher du ciel pour y puiser une force inconnue concentrée au centre du cromlech1. En contrebas des pierres et des dolmens, une carrière désaffectée s’enfonçait dans le sol, nappée de mousse fuligineuse. Des racines affleuraient sur les entailles de l’ancienne exploitation, dont les broussailles en surplomb d’une nappe d’eau évoquant vaguement un étang s’entouraient d’un morne chatoiement de gouttelettes.
Le cadavre du nouveau-né avait été posé entre trois racines qui formaient comme un triangle. Une tige de bois traversait sa poitrine, le clouant au sol, ses intestins étaient disposés géométriquement autour de lui. En levant les yeux, on pouvait voir un menhir qui marquait le lieu de son ombre.
— Tout pour faire croire à une sorte de crime rituel, lâcha l’inspecteur Waynes, venu constater le drame.
Un des agents s’était éloigné, ne pouvant retenir une nausée, enviant le sang-froid de son supérieur. Le docteur Flynn opina avec une moue de dégoût.
— L’autopsie ne nous apprendra pas grand-chose, dit-il. Je ferai faire un test d’ADN, mais enfin…
Il se sentait découragé d’avance.
— Faites ce qu’il y a à faire, dit Waynes sentencieusement. Il le faut bien…
Lui aussi retenait son dégoût, gardant un masque flegmatique. Mais, au fond de lui-même, il se sentait outré, comme personnellement agressé. Jamais il n’avait vu une telle abomination. « Si je tenais le salaud qui… » Murmura-t-il. Puis il s’adressa au légiste, la routine reprenant le pas sur les impressions personnelles :
— Pouvez-vous déjà situer l’heure de la mort?
— Vers minuit, je pense. Pour plus de précisions, attendez mon rapport.
Le médecin avait envie d’être désagréable avec ce policier lourdaud, toujours impassible et inflexible sur « le règlement ». Il quitta les lieux sans ajouter un mot. Waynes regarda le 4x4 s’éloigner en faisant gicler de la terre humide, ornières vite parcourues de petits bras d’eau boueuse. Une ambulance de la morgue arrivait. L’inspecteur se tourna vers son second, Amy Brandon :
— Laissez faire les infirmiers. Nous ne sommes plus utiles à rien, ici. Pas le moindre indice. Dans ce marécage, d’ailleurs, le contraire eût été surprenant…
— Mais enfin, chef, intervint la jeune policière qui était parvenue à réfréner son envie de vomir, qui pouvait avoir intérêt à massacrer ce gosse de cette manière? C’est incompréhensible.
— À première vue, personne. Si ce n’est le père ou la mère. Mais alors, toute cette morbide mise en scène n’a guère de raison d’être, sauf pour nous égarer.
— À moins que l’assassin ne soit un fou.
— Ou que la personnalité de sa victime lui soit indifférente. Et, dans ce cas, Brandon, le meurtrier tue pour faire peur, dans le but de créer la panique, de démoraliser les gens, ou de les dresser les uns contre les autres. Le meurtre de cet enfant, dans ce lieu chargé de symboles, ne va pas laisser la population du Wiltshire indifférente. Je crains que l’atmosphère ne devienne vite irrespirable.
— C’est diabolique!
— Qui vous dit que nous n’avons pas affaire à un démon? »
Les deux policiers avaient rejoint leur voiture de fonction. Tant d’idées se bousculaient dans leurs têtes qu’ils ne pouvaient ni l’un ni l’autre en suivre une, et autant l’inspecteur chevronné que la jeune policière fraîche émoulue de l’école se sentaient semblables à des navires venant d’affronter un orage et ne sachant plus manœuvrer dans les eaux calmes d’un havre. Face à un acte de folie, ils se trouvaient ridiculement fragiles.
1 Un cromlech est un alignement de mégalithes, blocs de pierre rangés en formant un cercle ou des cercles imbriqués. Les plus célèbres sont ceux de Stonehenge et celui d’Avebury, dans le Wiltshire. Ils ont été érigés à partir de 2800 avant Jésus-Christ, donc à l’époque néolithique.
III.
Le légiste roula à vive allure durant quelques miles sur la route de Wroughton, puis arrêta sa voiture sur un terreplein. Il venait d’avoir une rapide et légère nausée. Ce devait être l’image de l’enfant torturé… Mais enfin, il en avait vu d’autres! Ce n’était pas le premier cadavre qui se présentait à lui dans un état propre à donner un malaise aux gens qui ne sont pas du métier. Pourquoi celui-là? Peut-être s’agissait-il d’une brève réminiscence incompréhensible, le souvenir d’un visage, d’un tout petit visage… mais un visage encore vivant, alors…
Il se morigéna. Peut-être avait-il vu trop de saloperies au cours de sa carrière, ce devait être ça, peut-être arrive-t-il un moment où l’on sature, où l’on ne peut plus traiter avec une froideur professionnelle ces visions d’accidents ou de massacres. Fébrilement, il ouvrit la boîte à gants et en sortit une petite boîte métallique. Il y préleva un cachet blanc qu’il avala d’un coup, puis ouvrit une petite bouteille d’eau et en avala une gorgée. Il soupira et prit une autre boîte dont il considéra l’étiquette. Est-ce qu’une gélule de « Prozac » — la « pilule du bonheur », ainsi que le disent certains imbéciles — l’aiderait à surmonter cette fichue épreuve? Ce ne serait jamais que la seconde de la journée, mais il s’y accoutumait. La gélule rejoignit le cachet dans son estomac. Une gorgée d’eau, et attendons que l’effet bénéfique se fasse. Le médecin se sentait dans un drôle d’état. Il renversa la tête en arrière.
Le docteur Flynn sortit de sa voiture dont il considéra le bleu sombre, apaisant, il passa le doigt sur ce qui lui semblait une éraflure et qui n’était qu’une tache de boue, il se dit qu’il faudrait quand même la faire laver, elle était vraiment marron par endroits. Il s’éloigna quelques instants puis, quand il revint à la réalité, il sentit que son visage reprenait son aspect habituel, revêtait ce mélange d’impassibilité et de gaieté qui en était la marque alternée. Son esprit lui parut merveilleusement clair, objectif. Il remit la clé sur le contact et démarra en faisant crisser le gravier sous les pneus. Direction Swindon. Le sale boulot allait bientôt commencer.
LIVRE PREMIER : Andantino espressivo
I.
Deux fois par semaine, le mardi et le vendredi, Carolyn Mac Stroud se rendait dans le centre de Swindon. Par tous les temps, on voyait sa silhouette élancée arpenter les rues commerçantes de la ville, procéder à divers achats. Il s’agissait d’une habitude prise après le suicide de son mari lorsque, les premiers moments de désarroi passés, elle avait pris conscience qu’il lui fallait impérativement se montrer, surmonter sa souffrance et le dégoût engendré par l’attitude de nombre de ses concitoyens. Bien que le suicide ait été établi de manière formelle, il y avait eu des scènes qu’elle tentait d’enterrer au plus profond d’elle—même sans jamais y parvenir totalement : des rendez-vous remis de jour en jour, des invitations annulées sous de vagues prétextes, des personnes, amies de jadis, qui n’avaient plus le temps ni l’opportunité de franchir le portail de sa trop grande maison… Et surtout, ces regards qui fuyaient, veules, ces lèvres qui frémissaient, comme désireuses de laisser échapper des sous-entendus, des allusions à la bonne santé d’Edward, à sa fortune, à son épicurisme. Ajoutées au drame, ces rumeurs acrimonieuses auraient pu éteindre la flamme qui éclairait encore par à-coups le décor noir où elle se mouvait alors.
Il n’en avait rien été. Au contraire, elle s’était décidée à faire front le jour où on lui avait rapporté que son époux s’était tué parce qu’elle ne pouvait avoir d’enfant. Comme si cela avait eu de l’importance! Bien sûr, ils auraient aimé choyer, élever des gamins, leur transmettre leur savoir et leur patrimoine. Bien sûr, ils avaient eu une période de dépression quand le verdict était tombé. Ils avaient un moment pensé à l’adoption, malgré les avis de membres de la famille, « on ne sait pas d’où ils sortent »... Mais leur bonheur s’était vite accoutumé à cette absence, en avait même été renforcé, en une sorte de complicité qui permettait de faire front devant les on-dit, exprimés ou non.
Ils s’étaient alors suffi à eux-mêmes, claquemurés dans le bel égoïsme d’une tour d’ivoire que rien ne paraissait pouvoir atteindre. Pourtant, sans raison apparente, Edward, un matin de juillet, s’était tiré une balle dans le crâne. Sur son bureau chippendale, il avait disposé trois lettres : une pour Carolyn, une pour son notaire, une pour sa sœur. Il avait si méticuleusement préparé sa mort que Carolyn songeait parfois qu’il s’était suicidé parce que sa vie ressemblait à une belle route dégagée, toute droite et monotone, sur laquelle il se sentait vieillir — il était nettement plus âgé qu’elle —, comme une vieille voiture qui ralentissait de plus en plus, voyant se dérouler un film qui montrait en boucle les mêmes images jour après jour. Peut-être s’était-elle voulue trop parfaite épouse, gommant toutes les aspérités de leur existence commune.
Et c’était bien là le seul tort qu’elle se reprochât vraiment, étant consciente que le destin avait voulu qu’ils partageassent les mêmes goûts, les mêmes élans. Elle seule savait combien une telle osmose pouvait devenir pesante, et, huit ans après ce deuil brutal, Carolyn fuyait d’instinct tous les gens dont elle pressentait qu’ils eussent pu avoir plusieurs points communs avec elle, ne tolérant dans ses relations, à une ou deux exceptions près, que ceux qu’un fossé infranchissable séparait de sa personnalité. Bien sûr, il y avait Miranda Osquith, mais, hormis leur commune passion des chevaux, que pouvait-elle avoir en commun avec cette petite, plus jeune qu’elle de plus de vingt ans? Beaucoup de choses les différenciaient : le milieu social, la culture, le sens même qu’elles donnaient à l’existence. Mais il n’en était pas moins vrai qu’elles étaient liées par ce qui pouvait ressembler à une amitié paisible.
Elles s’étaient rencontrées deux ans auparavant, sur l’hippodrome de New Abbey où Carolyn était venue voir courir deux de ses chevaux. Ce jour-là, Miranda avait victorieusement monté l’un d’eux, alors qu’elle n’était qu’apprentie. Le premier contact entre les deux femmes, aussi réservées, indépendantes l’une que l’autre, avait été emprunt d’une extrême timidité, voire de gêne. Par la force des choses — la jeune fille travaillait chez Ted Lawkin, l’entraîneur de l’écurie de Carolyn — elles avaient été amenées à se revoir, Carolyn allant souvent aux environs de Marlborough surveiller le travail de ses animaux. Un après-midi, elle avait osé convier Miranda à venir dîner chez elle le surlendemain. La jeune fille s’y était rendue, après quoi la maison de Croft Road lui était devenue familière.
Cependant, elle n’avait jamais vraiment parlé d’Edward à la jeune fille, bien qu’il lui semblât par moments qu’il se tenait auprès d’elles, écoutant leurs conversations. Carolyn se demandait parfois ce qu’il aurait pensé de cette affection. Elle n’était pas de leur monde, n’avait pas leur niveau de culture, mais partageait la même passion des chevaux et se montrait aussi discrète, aussi indépendante qu’elle.
Elle redescendit sur terre en voyant un groupe d’enfants qui sortaient du « Centre des Arts », nom pompeux donné à un complexe de béton regroupant une salle de concert, une galerie, un théâtre, et divers centres d’activités plus ou moins liées à la culture. Elle avait ce bâtiment en horreur, tout en lui reconnaissant une certaine utilité, et un agencement intérieur correct. Elle boutonna son imperméable et redressa la tête. À quarante-quatre ans, elle était encore une jolie femme, de corps sportif et de visage distingué, qui aurait pu se remarier sans difficulté aucune. En songeant à cela, un sourire mourut sur ses lèvres : plus aucun homme ne l’intéressait autrement que pour de superficielles mondanités, et tant d’entre eux avaient été si ridicules avec leurs maladroites avances! Comme pour penser à autre chose, elle entra dans un magasin, une parfumerie. Dix minutes plus tard, elle ressortait au moment même où Quint-William Rockwell garait sa voiture devant un bureau de tabac. Il reconnut sans peine la silhouette féminine habillée avec une discrétion recherchée.
Huit années auparavant, la mort d’Edward Mac Stroud — peut-être le plus important industriel du Wiltshire — n’avait pas laissé Scotland Yard indifférent. Une enquête discrète avait été menée. Enfant de la région, Rockwell y avait pris part, et s’était fait remarquer par son tact et sa célérité. Mais surtout, ces investigations de routine l’avaient amené à renouer avec ses racines, et encore maintenant il s’étonnait d’avoir pu passer tant d’années entre Londres et le continent sans ressentir le besoin impérieux d’aller puiser dans cette terre vive une eau lustrale qui le décantait, comme si l’impression de se sentir chez soi effaçait les scories ramassées au cours d’enquêtes plus ou moins épuisantes ou déprimantes. N’ayant écouté que son emballement, un peu à la manière d’un gosse sentant s’approcher l’heure de la récompense, il avait acheté à Allington, tout près d’Avebury, une maison à l’architecture peu banale, qui ouvrait sur un panorama de petits étangs. Il y passait une partie de ses vacances, toujours en septembre, et les trop rares fins de semaine qu’il pouvait voler à ses activités londoniennes. Mieux encore, il avait su persuader un de ses amis les plus chers à venir passer sa retraite dans le Wiltshire.
Sortant de sa voiture, il traversa la rue pour venir à la rencontre de Carolyn Mac Stroud. Depuis l’enquête, il y avait entre eux des rapports assez équivoques faits à la fois d’attirance intellectuelle et de méfiance. Carolyn savait que la finesse de celui qui était maintenant superintendent au Yard l’avait amené à deviner en elle des sentiments si profonds, si soigneusement étouffés, qu’elle craignait d’une peur presque irréelle de les voir percés même superficiellement. En présence du policier, sa réserve n’était pas feinte, elle restait presque sur la défensive, bien qu’elle appréciât chez lui l’aisance de l’esprit, chose exceptionnelle en ces temps de conformisme des intelligences. Sa poignée de main, lorsqu’il l’avait abordée, avait été distante, sans un sourire, avec seulement un bref éclat de ses yeux verts qu’elle avait su vite éteindre. De son côté, Rockwell ne semblait pas mécontent de cette rencontre impromptue. Ils échangèrent quelques banalités avant de se séparer, Carolyn ayant refusé de l’accompagner dans un salon de thé.
En repartant, elle eut conscience de la relative impolitesse de son attitude, mais elle avait ressenti d’un coup un absolu besoin de solitude, comme si la rencontre de ce policier pourtant courtois avait confiné à l’indiscrétion. Lorsque ce genre de crise survenait, les mots franchissaient difficilement ses lèvres et son corps devenait la proie d’un froid intense, nauséeux, comme celui d’une cave laissée en sommeil durant des siècles. Fréquentes juste après la mort d’Edward, ces crises s’étaient espacées de plus en plus, jusqu’à devenir rarissimes.
Un malaise s’ajoutant à l’autre, elle vit dans cette résurgence qui la faisait frissonner toute entière, un mauvais signe, indéchiffrable. Elle n’était pourtant guère superstitieuse, trop chrétienne pour cela, mais elle sentait une ombre se glisser contre elle, comme un brouillard impalpable qui glace le corps. Se dominant, elle accéléra sa marche, songeant à la paix de sa maison, à sa familiarité rassurante, comme à un port aux hautes digues qui la protégeaient des tempêtes environnantes.
II.
Rockwell laissa s’éloigner Carolyn Mac Stroud avant de regagner sa voiture. Il lui semblait que cette femme avait constamment quelque chose à cacher. Il attendit encore qu’elle eut disparu à l’angle d’une rue pour démarrer sa grosse Jaguar. Il passa au poste de police, un peu pour signaler sa présence, mais aussi pour rencontrer un inspecteur qu’il connaissait assez bien. Les bureaux avaient été repeints, mais, malgré cela, il y flottait toujours une vague odeur d’urine. Ayant demandé à voir l’inspecteur principal Hyatt, il s’entendit répondre qu’il était sorti. « L’enquête sur ce bébé assassiné, vous devez en avoir entendu parler, Monsieur », avait dit un des policiers de service. Oui, il en avait vaguement entendu parler, mais n’avait aucune envie de se préoccuper de cette histoire qui relevait de la compétence de la police locale. Il était déjà assez ennuyeux de devoir officiellement faire connaître sa présence! Il refusa un café lyophilisé et sortit, soulagé, il n’avait pas envie de stationner dans ces bureaux qui lui donnaient l’impression de faire des heures supplémentaires. Une fois dehors, il se sentit l’esprit libre, il était vraiment en vacances.
Une fois dégagé de la banlieue grisâtre de Swindon, il put rouler à aussi vive allure que le permettait la route d’Avebury. Après avoir traversé la petite ville, il prit la direction de Devizes et tourna à gauche vers Allington. La route était étroite, mal commode, bordée de fossés remplis d’eau. Juste avant le village, il emprunta sur une centaine de mètres un sentier empierré que coupait une vieille barrière. Il arrivait enfin chez lui, devinant dans le nuage que formait l’humidité ambiante sur les branches des arbres en se mêlant aux vapeurs des étangs la silhouette longiligne recouverte d’ardoises de Watermead. Il sortit de sa voiture pour ouvrir la barrière, rentra et ressortit pour fermer ce qui était plutôt une porte symbolique isolant la propriété du monde réel. Il gara le véhicule et avança jusqu’à la maison étroite qu’il considéra un instant. Une cour pavée, moussue par endroits, la séparait d’une pièce d’eau rectangulaire bordée sur l’autre rive de pâles saules pleureurs. C’était une construction à un étage percée de fenêtres régulièrement alignées. Au rez-de-chaussée, à chaque extrémité de la maison, deux portes aux vantaux de bois sombre, précédées de petits perrons de granit, donnaient accès à l’intérieur. Le plus surprenant était que la bâtisse n’avait d’ouvertures qu’à l’est, du côté des étangs disséminés entre les prairies et les bouquets d’arbres. Toute la partie ouest n’offrait au regard qu’un long mur maçonné que léchaient des tilleuls et des platanes plantés en rangs serrés. De hautes cheminées de briques montaient de ce mur uniforme. L’aspect emblématique de cette maison n’avait pas échappé à Rockwell. Peut-être, d’ailleurs, l’avait-elle séduit à cause de ce contraste entre le regard et l’aveuglement.
Il n’avait apporté qu’une modification à la propriété : la transformation d’une grange en garage. Après y avoir rentré la Jaguar, il ouvrit la maison puis rangea les affaires ramenées de Londres, des livres, quelques bibelots, des vêtements et un petit meuble de style qu’il plaça en divers endroits avant de trouver la vraie place de l’objet. Il se recula pour juger de l’effet, le déplaça de quelques centimètres, recula de nouveau, appréciant l’effet produit.
Alors qu’il finissait ses agencements, son téléphone fit entendre le début d’une étude pour piano de Chopin, la « Révolutionnaire ». Il songea qu’il devait le recharger, avec une arrière-pensée : il cherchait à éviter ce genre d’intrusion et prenait soin de ne pas donner à tout le monde son numéro de portable personnel. Mais non, il devait quand même être joignable. Tiens, il devrait personnaliser la sonnerie, pour les personnes dont il savait qu’elles ne l’appelaient pas pour lui vendre des assurances ou l’interviewer pour un quelconque magazine « people ». Il se promit de le faire en prenant le portable et fut rassuré : c’était son vieil ami Seamus Casey-Wynford qui l’invitait à venir prendre un verre le lendemain en fin d’après-midi. Ils bavardèrent quelques instants, Rockwell marchant de long en large dans la maison, passant dans le salon, le bureau — ou tout au moins la pièce dont il avait décidé qu’elle serait « le bureau » —, examinait la cuisine, vérifiait les robinets, déplaçait un objet. Depuis que les téléphones portables existaient, il ne savait pas discuter en restant assis, habitué qu’il était maintenant à prendre un appel alors qu’il était en chemin vers le lieu de quelque enquête.
La conversation terminée, il remit le téléphone sur son bureau, se souvint qu’il devait le recharger, brancha l’objet et revint dans le salon où il se servit un doigt de xérès. Il aimait, non sans une légère pointe de vanité, le décor qu’il s’était créé dans cet endroit, un mélange douillet d’ancien et de moderne organisé autour d’un demi-queue Pleyel surchargé de bronzes datant du milieu du dix-neuvième siècle. Aux murs, il avait accroché des portraits de famille, plus pour leurs riches cadres anciens que pour la valeur intrinsèque des toiles où les corps et les visages, fixes, comme dédaignant leur sort, paraissaient souffrir soit d’une luminosité trop vive qui les amoindrissait, soit être parcourus, à la faveur d’un ultime regret de crépuscule, d’une expression de mélancolie lointaine. Certains avaient une valeur sentimentale, lorsque leur propriétaire avait connu ou entendu parler des personnages ainsi portraiturés par un artiste local, mais d’autres représentaient de parfaits inconnus dont on savait juste qu’ils étaient « des ancêtres ». Une galerie des ancêtres, dans un château, l’idée l’amusait. En contraste, sur le carrelage, un tapis aux couleurs vives, aux dessins abstraits inspirés de Miró, semblait projeter dans le salon une vie presque sauvage, comme une note d’exotisme.
Rockwell ferma un moment les yeux, comme pour savourer ses retrouvailles avec ce cadre qu’il affectionnait. De nouveau, les arpèges de piano de l’étude de Chopin se déchaînèrent depuis le bureau. Le téléphone, il faudrait qu’il change cette sonnerie qui lui vrillait les oreilles, cet enregistrement synthétique n’était qu’une caricature de ce fabuleux morceau de virtuosité. Il arriva à temps pour décrocher, se demandant qui … Il fut surpris, car, là, cet appel était vraiment inattendu.
III.
À quelques miles de là, Alan Page surveillait d’un œil distrait sa fille Emily sur son double poney. À douze ans, elle ne se débrouillait pas trop mal. Très certainement, elle tenait de lui, au moins sur ce point. Il se dit qu’il aurait dû aller lui donner quelques conseils, mais son esprit était ailleurs. En fait, il ne savait plus très bien où il en était. Il lui semblait que le cours de son existence s’était emballé sans qu’il pût arrêter cette machine devenue folle. Il embrassa d’un coup d’œil la propriété, puis rentra dans la maison neuve qui dominait légèrement les prés et les bâtiments de l’exploitation agricole. Emily se débrouillerait bien toute seule.
Il s’en voulait bien un peu de la laisser tomber alors qu’elle ne venait aux Granges que rarement depuis que la procédure de divorce avait été entamée. En ce début de septembre, elle passait la fin des vacances chez son père. Il ne se réjouissait pas véritablement de l’avoir : elle lui rappelait un passé pas si lointain où il ne devait pas faire face à tant d’ennuis. De plus, l’attitude de la fillette, sans être inamicale, était dénuée de tout élan affectif, qu’il vienne du cœur ou soit tout simplement de circonstance. Or, il ne s’était jamais senti aussi isolé, pataugeant sans illusion dans un immense marais putride. Dans son ressentiment envers l’existence, il voulait oublier que tout était en grande partie de sa faute, qu’à lui seul incombait la responsabilité d’assumer une séparation qui lui pesait. Parfois, il essayait de se convaincre que Fay avait bien plus de torts que lui, mais il n’y arrivait jamais. Et toujours la même expression lui venait en tête : il avait fait pénétrer le loup dans la bergerie. Avec plus d’intelligence et de lucidité, il aurait pu renvoyer de chez lui cette jeune employée qui était à l’origine du déchirement qu’il vivait. Il n’en avait pas eu le courage. La jalousie de Fay avait fait le reste.
Mais enfin, il ne s’était rien passé… Oui, il y avait eu cette fête chez l’entraîneur de Salisbury, la sœur du jockey… enfin, c’était un coup d’euphorie, après une brillante victoire… mais Fay l’avait su… Et aussi… il y avait eu un peu trop de « juste une fois », de petits coups de soûlographie, de pseudo-pannes de voiture, de fins de soirées un peu arrosées… Et finalement, celle qu’il avait seulement serrée dans ses bras, mais Fay était arrivée. Oh, elle n’avait pas fait de scandale, elle était partie discrètement, et avait emmené Emily chez la grand-mère. Trop, c’était trop, lui avait-elle dit seulement.
Dès lors, il s’était senti happé par une spirale d’événements, une foutue spirale, juridique, matérielle, affective... Un faible, voilà ce qu’il était. Un brave type, mais lâche au point de ne même pas pouvoir fuir et se fuir en se tuant tellement il était hanté par la crainte de mourir seul comme un soldat blessé que les brancardiers ont oublié sur le champ de bataille.
Il jeta un coup d’œil sur les factures qui s’amoncelaient sur le secrétaire. Cela aussi, c’était un sacré problème. À une certaine époque, il avait eu de l’argent, comme en témoignait l’ameublement de sa maison, mais maintenant, celui-ci lui filait entre les doigts. Puis son regard alla sur le canapé où dormait Emily, Fay ayant fait enlever pour le prendre chez elle tout le mobilier de sa chambre d’enfant. La pièce à présent nue lui faisait horreur, et il la fermait à clé. Mais, au moins, lorsqu’Emily avait sa chambre, elle n’étalait pas ainsi dans le living son désordre. Il y avait même sous une fenêtre un hamster dans une cage. Fort heureusement, il ne puait pas trop, elle en prenait soin.
Revenue de l’écurie, Emily annonça : « Je l’ai bouchonné et je lui ai donné du foin ».
Alan, qui regroupait sur une chaise les vêtements épars de sa fille, ne se donna même pas la peine de relever la tête.
— Tu as bien refermé la porte, au moins?
— Évidemment, Papa. »
Elle avait répondu avec un peu de commisération dans la voix. Elle était déjà très vive d’esprit pour son âge, et la séparation de ses parents l’avait en quelques mois beaucoup mûrie. On eût dit qu’elle se donnait pour tâche de suppléer sa mère absente lorsqu’elle se trouvait avec son père. Cela ne l’empêchait pas d’être encore une enfant de douze ans comme les autres, chahuteuse ou chagrine, mais d’instinct elle sentait combien Alan Page recherchait en sa fille une protection, voire une autorité, sans laquelle il se sentait plus ou moins dériver au gré des vents.
Après s’être désaltérée dans la cuisine à l’eau du robinet, elle s’approcha de son père.
— Papa, as-tu songé à faire les enveloppes?
— Pas eu le temps. Mais les adresses sont sur le bureau, tu pourrais peut-être les faire…
— Avec mon écriture?
— Pourquoi pas?
— Parce que les gens risquent d’être un peu surpris, tu ne crois pas? Je crois que je ferai mieux de les taper sur l’ordinateur, si l’imprimante marche encore. Il y a encore des cartouches?
— Oui, Miranda s’en est servie avant-hier. Tu sais comment faire pour la mise en page?
— Bien sûr, c’est dans le logiciel de traitement de textes et même dans celui de l’imprimante. Tu ne le fais jamais?
— Pas pensé. Tu m’expliqueras, ça m’évitera de recopier toutes les adresses à chaque fois. Bon, je vais aller faire mon boulot ».
Le travail de la fin d’après-midi, c’était la traite, rentrer les bêtes, faire les boxes des chevaux, donner à manger à tout ce monde, surveiller les poulinières et leurs produits. Tandis qu’il s’activait ainsi, Emily avait allumé l’ordinateur, ouvert le traitement de textes et copié les adresses. Cela ne lui prit qu’une dizaine de minutes, il y avait assez d’enveloppes dans le tiroir, une seule était un peu cornée et l’imprimante ne se permit qu’un bourrage. Elle colla les timbres et déposa la pile dans le tiroir du bureau. Ensuite, elle alla allumer le poste de télévision qui occupait un angle de la pièce, près d’un beau vaisselier ancien, au bois patiné par les ans. Un vague chanteur se matérialisa sur l’écran, braillard et convulsif, mais assez mignon pour attirer l’attention d’Emily, qui reconnut le petit chouchou d’une de ses copines. Mais, un instant après, elle coupa le son, croyant entendre une voiture remonter le chemin qui menait aux Granges. En effet, elle vit par une fenêtre se matérialiser la Daimler de Benedict Minklesham. Celui-là, ce n’était pas comme les autres amis ou relations de son père, elle l’aimait vraiment bien. Il avait toujours été gentil avec elle alors que rien ne l’y forçait, étant avant tout en affaires avec son père, même si la fillette savait qu’une certaine forme d’amitié avait pu se nouer entre les deux hommes en dépit de leur différence de condition. Minklesham était âgé d’une quarantaine d’années, riche et plutôt beau garçon, et surtout il était producteur de séries télévisées. Cela passait aux yeux d’Emily pour un symbole de la réussite professionnelle, surtout lorsqu’elle avait trouvé son nom dans la rubrique « carnet mondain » d’un magazine, sous une photo de son mariage avec une ravissante actrice française. Cependant, elle avait flairé en lui un fond de mélancolie et de noirceur. Comme à son habitude, il frappa sèchement avant d’entrer et embrassa Emily avant de demander où se trouvait Page.
— Il travaille en bas, répondit-elle. Il eut un léger sourire d’excuse :
— À cette heure, j’aurais dû m’en douter. Bien, je ne vais pas le déranger. Dis-lui simplement que je suis passé, et donne-lui ce certificat, c’est celui du dernier poulain. J’ai le double.
— Vous n’allez pas partir comme ça. Vous avez soif?
— Je ne veux pas te déranger…
— Pas de problème. Vous voulez un soda, ou une bière?
— Bon, d’accord, je prendrai volontiers un verre de bière. Tu veux que j’aille me servir?
Mais la petite avait déjà disparu dans la cuisine. En revenant avec un verre mousseux et une canette de coca pour elle, elle demanda :
— Vous avez vu comment ils grandissent, vos poulains? Surtout le gris.
— Tu l’aimes bien, celui-là, hein? C’est vrai qu’il est beau. »
Deux ans plus tôt, Benedict avait investi dans trois poulinières de bonne origine et les avait confiées à Alan pour deux raisons : la proximité, il pouvait venir les voir quand bon lui semblait, et la réputation de sérieux professionnel du père d’Emily.
— Il est beau, et il est gentil. Vous savez, il me laisse le caresser sur la tête. »
Ils continuèrent à converser sur le même sujet, les chevaux étant une passion qui abolissait les frontières d’âge et de condition. La pièce s’assombrissait de grandes ombres douces. Minklesham se sentait bien et parler avec la petite fille le détendait, mais il ne pouvait décemment s’éterniser, et Alan ne revenait pas, sans doute trop occupé aux écuries. Il jeta un coup d’œil à sa montre, s’excusa, se leva. Emily le raccompagna jusqu’à la porte. Une petite voiture noire venait vers les Granges. Il regarda l’enfant avec comme un reproche au fond des yeux, mais tourna de suite la tête. Ce n’était pas de sa faute. Emily eut un geste las, désabusé, qui pouvait signifier un regret ou une excuse. Elle souhaita de toutes ses forces que la voiture s’engage directement sur le chemin menant aux bâtiments d’exploitation, mais la conductrice vint s’arrêter devant la maison, semblant hésiter en voyant la Daimler que les arbres et le demi-jour avaient dissimulée.