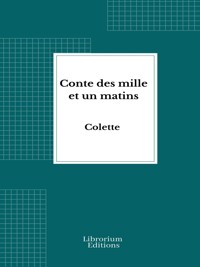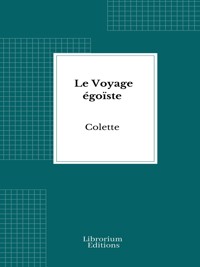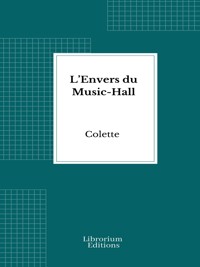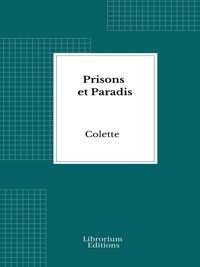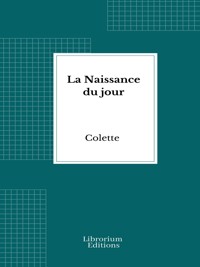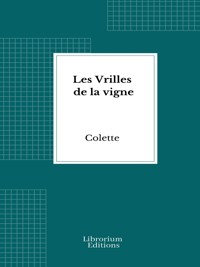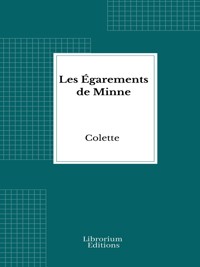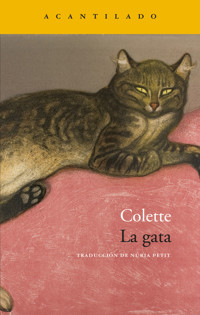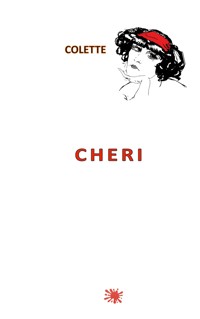1,50 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Raanan Editeur
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Claudine habite maintenant chez Annie à Casamène, tandis que Renaud, malade, est en sanatorium. Ce roman fait une sorte de bilan des aventures sentimentales de la série : Annie, qui s'est libérée de son mariage, mène une vie d'aventures sentimentales sans lendemain comme on s'adonnerait à une drogue ; Marthe, Léon et Maugis forment une sorte de ménage à trois plus ou moins apaisé ; Marcel connaît les prémices d'un vieillissement qui va s'avérer difficile ; Claudine apprend à vivre sans Renaud, dans l'amour de la nature, des animaux, et de la solitude. Extrait chapitre 3 « Il y a un mois environ que je suis à Casamène, - un mois que Renaud gèle, là-haut, tout en haut de l'Engadine. Ce n'est pas du chagrin que j'endure, c'est une espèce de manque, d'amputation, un malaise physique si peu définissable que je le confonds avec la faim, la soif, la migraine ou la fatigue. Cela se traduit par des crises courtes, des bâillements d'inanition, un écœurement malveillant. Mon pauvre beau ! Il ne voulait rien me dire, d'abord : il cachait sa neurasthénie de Parisien surmené. Il s'était mis à croire aux vins de coca, aux pepto-fers, à toutes les pepsines, et un jour il s'est évanoui sur mon cœur... Il était trop tard pour parler de campagne, de régime doux, de petit voyage : tout de suite, j'ai deviné, sur des lèvres réticentes du médecin, le mot de sanatorium... »
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Table of Contents
1 |PROLOGUE|
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Notes
Série :Claudine
|6| LA RETRAITE SENTIMENTALE
Ce roman fait suite à : |5| L’Ingénue libertine
et clôt la série des Claudine
COLETTE
LA RETRAITE
SENTIMENTALE
1907
Raanan Éditeur
Livre 1212 | édition 1
raananediteur.com
1 |PROLOGUE|
– Renaud, vous savez ce que c’est que ça ?
Il se détourne à demi, son journal sur les genoux ; sa main gauche écartée tient une cigarette, le petit doigt en l’air, comme une mondaine tiendrait un sandwich…
– Oh ! Renaud, gardez la pose une minute ! C’est celle du « littérateur mondain » tel que le représente sa plus récente photographie dans Femina… Mais devinez ce que j’ai là ?
Il regarde de loin, les sourcils froncés, le petit chiffon que j’agite en l’air, un petit chiffon jauni, large de deux doigts.
– Ça ? c’est une vieille « poupée » qui a emmailloté un index endommagé, je pense… Jette donc ça, ma petite fille, ça a l’air sale !
Cessant de rire, je m’approche de mon mari :
– Ce n’est pas sale, Renaud, c’est seulement vieux. Regardez de plus près… C’est l’épaulette de la chemise de Rézi…
– Ah !
Il n’a pas bougé, mais je le connais si bien ! Sa moustache presque toute blanche a remué imperceptiblement et ses jeunes yeux d’un bleu-noir d’étang ont noirci encore… Comme son émotion m’est douce et quel orgueil, chaque fois, de savoir qu’un seul de mes gestes remue jusqu’au fond l’eau sombre de ce regard !… J’insiste :
– Oui, l’épaulette de la chemise de Rézi… Vous vous souvenez, Renaud ?
La cendre de sa cigarette tombe sur le tapis.
– Pourquoi l’as-tu gardée ? demanda-t-il sans répondre.
– Je ne sais pas… Est-ce que cela vous déplaît ?
– Beaucoup. Tu sais bien.
Il baisse les paupières, comme il a coutume chaque fois qu’il va dire la vérité.
– Tu sais bien que ce souvenir-là, debout entre nous deux, j’ai mis tout mon cœur à l’abolir, à…
– Pas moi, Renaud, pas moi !
Il est sur le point de souffrir… Je m’élance, de la voix et du geste :
– Comprenez-moi, chéri, je n’ai pas une pensée à vous cacher ; sachez pourquoi j’ai gardé ce chiffon ; voyez où je le conservais et en quelle compagnie !
Je m’assieds, mon tiroir sur les genoux.
– Voilà un vieux cahier de l’École, voila une enveloppe où j’ai recueilli, en quittant Montigny, les pétales d’une rose cuisse-de-nymphe-émue… Voici la petite bourse en soie jaune et bleue, laide et touchante, que tricota Luce pour moi… Voilà un télégramme de vous… des photographies du théâtre de Bayreuth, un petit lézard sec que j’ai trouvé par terre, un fer de ma jument noire, celle qu’on a dû abattre… Tenez, ça c’est toutes les lettres d’Annie Samzun à côté des photographies de Marcel dans son costume de fille-fleur… Il y a des petits cailloux roses qui viennent du chemin des Vrimes, et une mèche de mes cheveux longs d’autrefois, roulée en bague… Il y a vous-même, voyez : cet instantané qu’on vous prit à Monte-Carlo, où vous êtes si parfaitement ridicule et si correctement élégant ! Pourquoi n’aurais-je pas gardé aussi ce chiffon de linon que vous qualifiez de linge à pansement ? Il est là pour me rappeler une minute de notre vie d’égoïstes à deux qui commirent cette sottise de croire – pas longtemps ! – qu’on le peut être à trois… Laissez-le-moi, Renaud, qu’il demeure dans ce fouillis sans dates qu’est notre passé ! Court et délicieux, et vide passé, vie remuante d’oisifs affairés ! C’est là-dedans qu’indifférente à l’avenir je plonge et je me mire, car je n’y trouve rien que nous-mêmes !… Non, non, vous vous trompez ! Rézi, c’est nous aussi. C’est un vagabondage un peu plus périlleux, un chemin où j’ai failli vous perdre, où vous aviez quitté ma main, cher… Oh ! si vous saviez combien j’y songe ! Appelez-moi sans amertume votre « vagabonde assise » ! J’évoque passionnément ma douleur de ce temps-là, comme on imagine, du fond d’un lit tiède le froid du dehors, la pluie sur la nuque, une route de banlieue galeuse, jalonnée d’arbres gémissants… Ne m’enlevez pas une miette de notre passé ! Plutôt, ajoutez des anneaux à cette parure de sauvagesse où je suspends des fleurs, des coquillages irisés, des morceaux de miroir, des diamants et des amulettes…
2
« Il n’y avait point de place pour toi, mon enfant chérie, dans cet hôpital sonore et verni où toute surface miroite, gelée de refléter le ciel, rien que le ciel ! Tes yeux, ô ma bête charmante, n’y auraient-ils pas perdu leur moire mouvante et dorée, où semble toujours se balancer l’ombre d’une branche ?…Et, d’ailleurs, c’était défendu ! Laisse, va, lis ceci sans que l’angoisse tire les coins de ta chère bouche et fasse remonter ta courte lèvre d’en haut… Il y a dans ma chambre, pendu au mur gelé, un « Règlement » où toutes les accolades ont la forme de ta lèvre supérieure : c’est le seul objet d’art qui pare la nudité de la pièce… Laisse, je te dis, laisse, mon enfant, ton vieux mari entre les quatre murs de ce frigorifique ; on traite de même le poisson qui manque de fraîcheur…
« Je n’ai pas encore retrouvé le sommeil, Claudine. Ils ne savent pas pourquoi. Un médecin très doux, si doux que j’ai l’impression d’être devenu un fou qu’on craint de contrarier, m’assure que c’est très normal ces insomnies. Très normal, assurément. Mon abeille endormie, toi qui dors silencieuse et le front dans tes bras, tu les entends ? C’est très normal – surtout au commencement. Attendons la fin.
« À part ce détail négligeable, tout va bien. Les mots de « phénomènes de la nutrition », de « voies digestives », de « gros côlon », de « paresse du cœur » (paresse du cœur, Claudine !) rebondissent contre les lisses parois de ma chambre comme de beaux lépidoptères…
« Écris-moi. Vois-tu comme mon écriture est claire et redressée ? C’est que je m’applique. Mille choses à Annie. Et rien pour toi que mes pauvres bras fatigués, puisque tu m’es défendue…
« Renaud.
« Je n’ai pas de nouvelles de Marcel. Occupe-toi un peu de lui. Il avait des besoins d’argent inquiétants le mois passé. »
Assise, le dos las, les mains ouvertes, je reste là comme une bonne : une promise poyaudine, qui vient de lire la lettre de son « pays » parti sous les drapeaux n’a pas les yeux plus déserts, la pensée plus gourde que moi… Renaud est là-bas, et moi, je suis ici. Je suis ici, et Renaud est là-bas… Cette idée-là fait entre là-bas et ici, entre la Suisse et Casamène, un va-et-vient fatigant, un cliquetis de navette qui travaille à vide…
Une petite voix timide dit derrière moi :
– Ce sont de bonnes nouvelles ?
Je me détourne avec un soupir :
– De bonnes nouvelles, oui, Annie, merci.
Elle incline la tête sur son cercle à broder, une espèce de tambour de basque tendu de soie fleurie. Ses cheveux lisses sont d’un noir absolu, d’un noir sans roux ni bleu, d’un noir qui étonne et satisfait le regard. Quand on voit au grand jour les cheveux d’Annie, on n’est tenté par nulle comparaison, ni le bleuté de l’hirondelle, ni le luisant de l’anthracite fraîchement concassé, ni le noir fauve de la loutre… Ils sont noirs… comme eux-mêmes, et voilà tout. Ils la coiffent d’un bonnet lisse et serré, qu’une raie de côté incline un peu sur l’oreille. Sur sa nuque bat une queue d’étalon, lourde, tordue sans art.
Il n’y a pas de créature plus douce, plus têtue, plus modeste qu’Annie. De sa fugue qui dura trois ans, de son divorce clabaudé, elle n’a gardé ni vanité, ni rancune, ni rancœur. Elle vit à Casamène toute l’année – toute l’année ? qui le sait ? pas même moi, sa seule amie… Sa peau kabyle ne vieillit pas, et j’ai peine à découvrir, dans le bleu frais de ses yeux, la secrète assurance de se connaître mieux, de s’appartenir complètement. Par le maintien, elle reste la pensionnaire aux épaules battues. Au centre de ce jardin roux, elle semble prisonnière. Elle brode volontiers, inutile et muette, assise contre la fenêtre. Eugénie Grandet ou Philomène de Watteville ?…
Moi qui me plais, vagabonde paresseuse, à écouter voyager les autres, je n’ai rien pu tirer de ma brodeuse aux longs cils. Quelquefois elle s’éveille, commence : « Un jour, à Buda-Pesth, le même soir où je me suis fait insulter par ce cocher… – Quel cocher, Annie ? – Un cocher… comme ça… comme tous les cochers… Je ne vous l’avais pas raconté ? – Non. Vous disiez donc qu’un jour, près de Buda-Pesth ?… – Un jour… oh ! je voulais dire seulement que les hôtels sont si mauvais dans ce pays-là !… Et on est mal couché, si vous saviez ! » Là-dessus, elle abaisse ses cils, comme si elle avait dit une inconvenance.
Elle a pourtant vu des pays, des ciels, des maisons qu’un granit étranger fait plus mauves ou plus bleues que les nôtres, elle a vu des terres pelées, râpées de soleil, des prairies qu’une eau cachée rend élastiques et drues, des villes où je dirais les yeux fermés, rien qu’à l’odeur, qu’elles sont de l’autre côté de la terre… Est-ce que toutes ces images fugitives n’ont pas encore atteint le fond de ses yeux ?
En ce moment, je vis chez Annie, et je supporte sa présence sans efforts, parce que je l’aime d’une espèce d’amitié animale et chaste, et parce que je suis libre à côté d’elle, libre de penser, de me taire, de fuir, de revenir à mon heure. C’est moi qui dis : « J’ai faim », qui sonne pour le thé, qui apprivoise ou taquine la chatte grise, et Toby-Chien me suit, fanatique. En vérité, je suis l’hôtesse : je m’épanouis dans les rockings et je tisonne l’âtre, tandis qu’Annie, assise à moitié sur une chaise cannée, brode, d’un air de parente pauvre. Parfois, j’en ressens une honte agacée : vraiment, elle exagère son absence, son effacement… » Annie, il y a trois jours que le mur écroulé barre l’allée, vous savez. – Oui, je sais. – Il vaudrait peut-être mieux dire qu’on le relève ? – Oui, peut-être… – Vous le direz ? – Si vous voulez. » Je me fâche :
– Enfin, ma chère, ce que j’en dis, c’est pour vous !
Elle lève ses yeux charmants, l’aiguille en l’air :
– Moi ? ça m’est égal.
– Ben, vrai ! Moi, ça me gène.
– Dites-le au jardinier.
– Je n’ai pas d’ordres à donner ici, voyons !
– Oh ! si, Claudine. Donnez-les tous, relevez les murs, coupez les bois, rentrez le foin, je serai si contente ! Donnez-moi l’illusion que rien n’est à moi, que je puis me lever de cette chaise et partir, ne laissant de moi que cette broderie commencée…
Elle se tait soudain et secoue la tête, tandis que sa queue d’étalon lui bat les épaules. Et je fais relever le mur, fagoter le bois mort, élaguer les arbres, rentrer le regain, – ça me connaît !
3
Il y a un mois environ que je suis à Casamène. – un mois que Renaud gèle, là-haut, tout en haut de l’Engadine. Ce n’est pas du chagrin que j’endure, c’est une espèce de manque, d’amputation, un malaise physique si peu définissable que je le confonds avec la faim, la soif, la migraine ou la fatigue. Cela se traduit par des crises courtes, des bâillements d’inanition, un écœurement malveillant.
Mon pauvre beau ! Il ne voulait rien me dire, d’abord : il cachait sa neurasthénie de Parisien surmené. Il s’était mis à croire aux vins de coca, aux pepto-fers, à toutes les pepsines, et un jour il s’est évanoui sur mon cœur… Il était trop tard pour parler de campagne, de régime doux, de petit voyage : tout de suite, j’ai deviné, sur des lèvres réticentes du médecin, le mot de sanatorium…
Renaud ne voulait pas : « Soigne-moi, Claudine ! tu me guériras mieux qu’eux ! » Et je lisais, dans le bleu-noir terni de ses prunelles, l’enragement jaloux de me laisser seule à Paris, une telle frousse de propriétaire que j’en éclatai de rire et de larmes – et que je rejoignis Annie à Casamène, pour faire plaisir à Renaud.
Je me mets debout. Il faut que j’écrive à un carrossier, au secrétaire de la Revue diplomatique, au fourreur qui garde mes peaux, que j’envoie l’argent du terme à Paris, quoi encore ?… J’en suis lasse d’avance. Renaud s’occupait de presque tout. Ah ! que je suis lâche et peu dévouée ! J’écrirai d’abord à Renaud, pour me donner du courage.
– Je vais écrire, Annie. Vous ne sortez pas ?
– Non, Claudine, vous me retrouverez ici.
Ses yeux soumis guettent mon approbation ; en passant, je baise ses cheveux brillants et plats qui n’ont jamais été frisés, ni ondulés, ses cheveux tout simples qui ne sentent que la bête propre. Cette épaule qui plie sous ma main… mauviette… ce n’est pas elle que je voudrais serrer ! Quand me sera rendue l’épaule, plus haute que moi, où je me hisse à la manière des chats, de mes dix doigts qui se cramponnent ? Je n’aime plus que les baisers qui tombent de haut et pour lesquels je renverse la tête, comme à la rencontre d’une savoureuse pluie d’été…
Ma petite amie a senti passer quelque chose dans mon baiser :
– Claudine… Renaud va bien, vraiment ?
Je me mords la langue un bon coup ; je ne sais pas de meilleur remède contre les larmes.
– Vraiment, mon petit… L’écriture est ferme, il mange, il se repose… Il me demande même de m’occuper de Marcel. Marcel a passé l’âge des bonnes, je pense. Je veux bien lui envoyer de l’argent – et encore !…
– Il est très jeune, n’est-ce pas ?
Je me récrie :
– Très jeune ! pas tant que ça ! Nous sommes du même âge, Marcel et moi.
– C’est ce que je voulais dire, insinue Annie, qui est bien élevée.
Je lui souris dans la glace au-dessus de la cheminée. Très jeune… non, je ne suis plus très jeune. J’ai gardé ma taille, ma liberté de mouvements ; j’ai toujours mon vêtement de chair étroite qui m’habille sans un pli… J’ai changé tout de même. Je me connais si bien ! Mes cheveux couleur de châtaigne étoffent toujours, nombreux, pressés en boucles rondes, l’angle un peu trop aigu d’un menton qu’on s’accorde à trouver spirituel. La bouche a perdu de sa gaîté et, au-dessous de l’orbite plus voluptueuse mais aussi plus creusée, la joue s’effile, longue, moins veloutée, moins remplie : le jour frisant y indique déjà le sillon – fossette encore, ou ride déjà ? – qu’y modèle patiemment le sourire… Les autres ne savent pas tout cela, je suis seule à noter la désorganisation initiale. Je n’en prends point d’amertume. Un jour, une femme qui m’aura vue dira : « Claudine est fatiguée, aujourd’hui. » Quelques mois après, un des amis de Renaud m’aura rencontrée : « J’ai vu Claudine, aujourd’hui ; elle a reçu un sacré coup de vieux, cet été ! » Et puis… et puis…
Qu’est-ce que ça fait, si Renaud ne veut pas savoir que je vieillis ? L’essentiel, à présent, ce sera de ne plus le quitter, de ne pas le laisser m’oublier vingt-quatre heures pour qu’il n’ait pas le temps de penser à moi, à moi qu’il ressuscite à toute minute sous les traits d’une fraîche enfant dont les yeux horizontaux, la lèvre « en accolade » et les cheveux couleur de bronze refirent de lui un jeune amoureux.
Quand il reviendra, je serai sous les armes : un peu de kohl bleu entre les cils, aux joues le nuage de poudre écrue couleur de ma peau, un coup de dents pour aviver la bouche… Mon Dieu ! à quoi vais-je penser là ? Ne faudra-t-il pas, oubliant mon entrée en scène, que je coure, que je le soutienne fatigué de son voyage, que je l’emporte et que je l’imprègne de moi, que je peuple l’air où il respire ?…
Je me détourne de la glace où les yeux d’Annie rencontrent mes pensées…
4
L’automne éblouit ici. Annie vit parmi cet embrasement, froide et reposée, presque indifférente, et je m’en indigne. Casamène est perché sur l’épaule ronde d’une petite montagne crépue de chênes bas, qu’octobre n’a pas encore mordu de sa flamme. Alentour, ce pays, que j’aime déjà, réunit l’âpreté d’un midi de mistral, les pins bleus de l’est, et du haut de la terrasse de gravier, on voit luire, très loin, une froide rivière, argentée et rapide, couleur d’ablette.
Le mur de clôture s’écroule sur la route, la vigne vierge anémie sournoisement les glycines, et les rosiers qu’on ne renouvelle pas dédoublent leurs fleurs, redeviennent églantiers. Du labyrinthe, puérilement dessiné par le grand-père d’Annie, il reste un fouillis d’érables, d’alisiers, des taillis de ce qu’on nomme à Montigny « pulains », des bosquets de végelias démodés. Les sapins ont cent ans et ne verront pas un autre siècle, parce que le lierre gaine leurs troncs et les étouffe… Quelle main sacrilège tourna sur son socle la dalle d’ardoise du cadran solaire, qui marque midi à deux heures moins le quart ?
Les pommiers âgés donnent des fruits nains à mettre sur les chapeaux, mais une treille de muscat noir, mystérieusement nourrie, s’est élancée, vigoureuse, a couvert et effondré un poulailler, puis, ressaisissant le bras d’un cerisier, l’a noyé de pampres, de vrilles, de raisins d’un bleu de prune qui s’égrènent déjà. Une abondance inquiétante voisine ici avec l’indigence pelée des rocs mauves qui crèvent le sol, où la ronce même ne trouve pas de quoi suspendre ses feuilles de fer hérissé.
La maison d’Annie est une basse vieille maison à un étage, chaude l’hiver et fraîche l’été, un logis sans atours, non sans grâce. Le petit fronton de marbre sculpté – trouvaille d’un grand père nourri de bonnes lettres – s’écaille et moisit, tout jaune, et sous les cinq marches descellées du perron, un crapaud chante le soir, d’un gosier amoureux et plein de perles. Au crépuscule, il chasse les derniers moucherons, les petites larves qui gîtent aux fentes des pierres. Déférent, mais rassuré, il me regarde de temps en temps, puis s’appuie d’une main humaine contre le mur, et se soulève debout pour happer… j’entends le « mop » de sa bouche large… Quand il se repose, il a un tel mouvement de paupières, pensif et hautain, que je n’ai pas encore osé lui adresser la parole… Annie le craint trop pour lui faire du mal.
Un peu plus tard, vient un hérisson, un être brouillon, inconséquent, hardi, froussard, qui trotte en myope, se trompe de trou, mange en goinfre, a peur de la chatte, et mène un bruit de jeune porc lâché. La chatte grise le hait, mais ne l’approche guère, et le vert de ses yeux s’empoisonne quand elle le regarde.
Un peu plus tard encore, une délicate chauve-souris, très petite, me frôle les cheveux. C’est l’instant où Annie frissonne, rentre et allume la lampe. Je reste encore un peu pour suivre les cercles brisés de la « rate-volage » qui crisse en volant, comme un ongle sur une vitre… Et puis je rentre dans le salon rose de lumière, où Annie brode sous l’abat-jour…
– Annie, que j’aime Casamène !
– Oui ? quel bonheur !
Elle est sincère et tendre, toute brune dans la rose lumière.
– Je l’aime, figurez-vous, comme une chose à moi !
Le bleu de ses yeux se fonce légèrement : c’est sa manière à elle de rougir…
– … Vous, Annie, vous ne trouvez pas que Casamène est une des passionnantes et mélancoliques extrémités du monde, un gîte aussi fini, aussi loin du présent que ce daguerréotype de votre grand-père ?
Elle hésite :
– Oui, autrefois je l’ai aimé, quand j’étais petite. Je croyais au labyrinthe, à l’infini de l’allée qui revient sur elle-même… On m’a dégoûtée de Casamène. Je m’y repose… je m’y pose… là ou ailleurs !…
– Incroyable ! dis-je en secouant la tête. C’est un endroit que je ne voudrais céder à personne ; si j’avais Casamène…
– Vous l’avez, dit-elle doucement.
– Oui, je l’ai… et vous avec… mais…
– Casamène est à vous, insiste Annie avec sa douceur têtue. Je vous le donne.
– Petite toquée, va !
– Non, non, pas si toquée ! Vous verrez, je vous donnerai Casamène, quand je repartirai…
Je sursaute et la regarde en face. Elle vient de couper une aiguillée de soie et pose ses ciseaux auprès d’elle. Repartir ! Elle a l’air assise là pour l’éternité !
– C’est sérieux, Annie ?
– Que je vous donne Casamène ? Assurément, c’est sérieux.
– Non, voyons… que vous pensez à repartir ?
Elle me laisse attendre une minute, regarde à la dérobée la vitre brillante derrière laquelle se presse une nuit massive, et lève un doigt :
– Chut ! dit-elle. Pas ce soir, dans tous les cas…
Sa mine ambiguë me passionne tout de suite. C’est un tel bonheur de voir quelqu’un jaillir de soi-même, se montrer – par orgueil, par inconscience ou par simple malice qui veut surprendre – se montrer dans la lumière et dire : « Je ne suis pas ce que vous pensiez ! » … Il y a du plaisir à s’attacher à ceux qui nous trompent, qui portent le message comme une robe très parée et ne l’écartent que par un désir voluptueux de nudité. Je n’ai pas aimé moins Renaud dans le temps qu’il me trompait, et qui sait si l’image de Rézi ne m’est pas demeurée plus chère pour ce qu’elle me cachait que pour ce qu’elle m’a livré ?…
Cette Annie passive, dont nous haussions les épaules avec une pitié gentille, qui l’aurait cru ? Elle a secoué son mari et son mariage simplement, sans fracas, comme ces chiens souples qu’on attache et qui sortent de leur collier fermé en se râpant un peu les oreilles…
– Vous voulez repartir, Annie ? Encore repartir !
Elle suce son doigt piqué et remue enfantinement la tête :
– Je n’ai rien dit de pareil… Admettons… Je fais un petit voyage…
Qu’elle m’amuse avec son air posé de parfait notaire, aux lèvres scellées par le secret professionnel !
– Bon sang ! Annie, vous n’avez pas besoin de tant de chichis avec moi ! Vous voulez partir ? Partez ! Et que ma présence ne vous retienne pas, au moins !
– Ne vous fâchez pas, Claudine ! Il ne s’agit pas de partir… pas encore… C’est seulement…