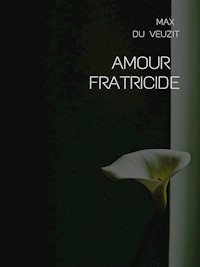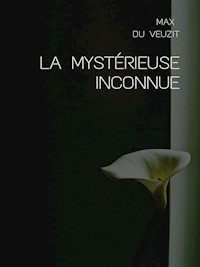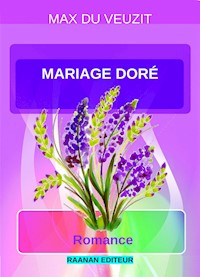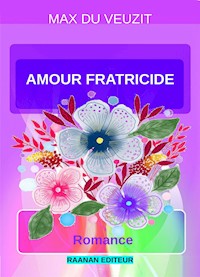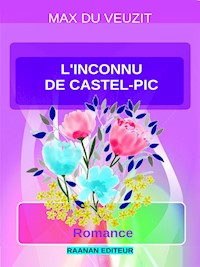1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Raanan Editeur
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
"Vous oseriez ? Vous me résisteriez ?..." Dans un luxueux hôtel particulier, Monique Somesnil et Jack Saint-Angel sont dressés face à face. La jeune institutrice l’affronte : non ! Elle ne s’emploiera pas à vaincre l’aversion instinctive de sa petite élève, Maë, la sœur...|Librairie Tallandier|
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
SOMMAIRE
Le cœur d’ivoire
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
,
MAX DU VEUZIT
LE CŒUR D’IVOIRE
Paris, Tallandier, 1936
Raanan Éditeur
Livre 1042 | édition 1
Le cœur d’ivoire
I
L’hiver avait été rude ; quoiqu’on fût déjà dans le milieu de mars au moment où commence cette histoire, le vent soufflait, âpre et froid, sur la nature à peine réveillée de son sommeil hivernal.
Le ciel était sombre cet après-midi-là ; de gros nuages gris se détachaient à l’ouest et annonçaient une pluie prochaine.
Sur l’unique route qui traverse Vassonville, petit village de Normandie, un groupe de femmes en deuil revenaient du cimetière et, pendant que le vent faisait flotter leurs châles noirs, elles avançaient, pressant le pas, dans la crainte de l’orage qui menaçait de se déchaîner sur la campagne.
C’étaient de simples femmes des champs, de celles qui ne quittent l’ouvrage que pour se rendre à l’église, le dimanche, et il avait fallu l’inhumation de M. Michel Somesnil pour leur faire cesser leurs travaux.
Par une touchante coutume des campagnes, où le respect des morts est plus profond que dans les villes, chacune avait sorti, pour la circonstance, les vêtements noirs et les capotes de crêpe remisés sur les planches des armoires et gardés précieusement depuis la perte plus ou moins éloignée d’un parent.
Elles allaient en silence, malgré leur nombre, et sur leurs visages paternes une lueur humide traduisait mal le sentiment de compassion que leur inspirait une jeune fille, à la douce et triste figure, qui marchait d’un pas automatique et comme inconsciente au milieu d’elles.
Celle-là, qui paraissait environ dix-huit ans, avait une allure distinguée sous les lourds voiles noirs et, en la regardant, on devinait la supériorité d’éducation qu’elle avait sur ses compagnes. Ses yeux étaient rouges de larmes répandues et des sanglots étouffés s’échappaient encore de ses lèvres pâlies.
À un coude du chemin, le groupe s’arrêta.
– Vous voici chez vous, mam’zelle Monique ! dit une des femmes, en s’adressant à la jeune fille. Allons, du courage ! Faut se faire une idée. Ce ne sont pas des pleurs qui le feront revenir, ce pauvre cher homme !
– À votre âge, ça se comprend ! fit une autre. C’est dur d’être seule !... Mais allez, faut que tout le monde en ait sa part de chagrins !
Celle qu’on venait de nommer Monique balbutia un remerciement et pressa mollement les mains qui se tendaient vers elle ; puis, brusquement, elle ouvrit la grande barrière de bois donnant entrée au jardin qui précède la maison.
Et pendant que les femmes, un moment arrêtées, reprenaient hâtivement le chemin de leurs demeures, la jeune fille franchit presque en courant l’espace qui la séparait de l’habitation.
Sa main, dans un mouvement machinal, ouvrit puis referma l’huis ; ses pas chancelants la conduisirent au premier étage, dans la chambre mortuaire où la malheureuse enfant vint s’effondrer à genoux, au pied du lit, où, deux jours auparavant, son père bien-aimé était encore en vie.
Cette maison, si triste en ce jour de deuil, avait cependant, vue de l’extérieur, un aspect agréable et accueillant, avec sa façade blanche, toute fleurie de rosiers grimpants et de glycines, son auvent rustique et pittoresque et les touffes d’hortensias s’épanouissant librement sous les fenêtres. L’étranger passant sur la route tournait instinctivement son regard vers cette aimable demeure, ayant peut-être au fond du cœur le désir d’en franchir le seuil.
L’intérieur répondait à cette apparence de bien-être, sans luxe ni clinquant. La lumière entrait à flots par les larges fenêtres ; les murs, aux couleurs claires, les meubles disposés avec goût, l’ordre parfait, tout faisait éprouver, malgré la modestie de l’ensemble, un sentiment de confort et de paisible repos. Chaque chose était simple, mais chaque chose était à sa place et l’œil s’en satisfaisait.
La chambre où était entrée Monique Somesnil était celle de son père ; quoiqu’elle différât peu des autres pièces, elle avait cependant son cachet particulier et l’observateur pouvait y deviner le refuge d’un soldat.
En effet, Michel Somesnil, ancien capitaine de dragons, arrêté au milieu de sa carrière par une blessure de guerre et par les gaz, qui lui avaient atteint profondément le poumon, avait conservé dans sa retraite forcée ses habitudes d’ordre et d’activité. Aimant la propreté jusqu’à la minutie, il avait en horreur les tentures et les doubles rideaux qui arrêtent l’air et gardent la poussière dans leurs plis.
En revanche, autour de lui, combien de souvenirs plus ou moins précieux étaient accumulés !... Partout, le long des murs, des photographies lui rappelaient les chers camarades, vivants ou disparus, qui traversèrent sa vie, et mille objets divers, renfermés dans deux hautes vitrines, avaient longtemps évoqué pour lui, en leur langage muet, tout un monde de souvenirs.
Que de fois, en voyant ces reliques du passé, les yeux du capitaine durent-ils être humides !...
Au-dessus du lit se dressait une panoplie bien garnie, au milieu de laquelle se détachaient, dans un médaillon de velours rouge, quatre croix et médailles gagnées par le soldat sur les champs de bataille. Et c’est là qu’il était mort, encore jeune, au milieu de tout ce qui avait été sa vie : c’est là que sa malheureuse enfant était venue crier son désespoir...
Depuis le moment fatal où son père était mort, Monique Somesnil avait marché comme dans un cauchemar, s’attendant à chaque moment à voir cesser cette affreuse vision qu’est la perte d’un être chéri. Le réveil n’en avait été que plus rude et, maintenant que tout était fini, la malheureuse enfant se rendait compte du fait accompli, de l’irréparable qui avait passé sur sa vie et fait d’elle une orpheline.
Et pendant qu’au-dehors la pluie fouettait avec rage les vitres de la maison, Monique comparait le présent à son passé enfui.
Elle évoquait son enfance, un peu triste, auprès d’une mère toujours malade ; les longs silences du père, après la mort de la femme adorée, trop vite enlevée à l’affection des siens ; puis, la pension aux jardins étroits, entourés de hauts murs, où elle avait grandi pendant que Michel Somesnil changeait de pays au hasard des garnisons.
Elle se souvenait que, quatre ou cinq fois par an, les jours de congé, il venait la prendre et la faire sortir. Comme elle était craintive, en le voyant si grave !... Mais combien vite elle se familiarisait, en se sentant si tendrement aimée de lui !... Et un long frisson la secouait à la pensée des baisers paternels. Enfin, plus tard, lorsqu’il avait pris sa retraite, il l’avait gardée toujours auprès de lui et, depuis, ils vivaient là, dans ce petit pavillon où sa mère était née.
Les trois bonnes années que le père et la fille avaient passées à Vassonville !... Les douces causeries à deux !... Les longues promenades, par tous les temps et par tous les chemins, faites ensemble, la main dans la main !... Quand le soir venait, il lisait le journal, pendant qu’elle chantait en s’accompagnant au piano et, lorsque dix heures sonnaient, quel bon baiser ils échangeaient, avant de se quitter pour gagner chacun sa chambre !... Leurs lits n’étaient séparés que par l’épaisseur du mur et, souvent, avant de partir pour le pays des songes, elle tapait, mutine, contre la cloison et, à mi-voix, s’informait si son cher papa dormait...
Ô jours heureux, que vous êtes déjà loin ! Jamais, jamais vous ne reviendrez plus !...
Comme elle avait pris vite, cette maladie !... Une grippe, au début. Mais le mal avait empiré. Pendant deux mois, Monique avait veillé son père nuit et jour avec un dévouement de tous les instants, cherchant à l’arracher à la proie qui le guettait dans l’ombre.
Malgré tout, il était mort...
L’orage redoublait au-dehors. Le silence de la chambre n’était troublé que par les sanglots de l’orpheline.
Elle appelait : « Papa ! » comme si celui-ci eût pu l’entendre et lui répondre. Elle lui disait :
– Viens, ne me quitte pas !... Pourquoi m’as-tu laissée ?... Père, viens me chercher !
Ses mains se tendaient vers le ciel, suppliantes, dans un geste d’appel, de désir d’y partir et, lasse d’implorer, elle enfouissait sa tête dans les draps du lit et pleurait en silence.
Le jour baissait, la pluie avait cessé. Dans la campagne, on entendait les bœufs mugir, réclamant la pitance du soir.
Monique s’était calmée, sa douleur était moins bruyante.
Elle ne pleurait plus, mais, quand ses yeux rencontraient, malgré l’obscurité naissante, un objet ayant appartenu au cher défunt, une larme perlait au bord de ses longs cils et, d’un geste machinal, elle l’effaçait.
À un moment, un corps velu la frôla.
Elle tressaillit d’abord, mais soudain :
– C’est toi, mon bon Fox !... dit-elle, d’une voix mouillée. Ton maître, mon bon chien, ton maître n’est plus là...
Et comme si le brave animal avait compris son langage, il aboya plaintivement, en lui léchant le visage et les mains.
Dans un besoin de tendresse, la jeune fille prit la tête de l’épagneul dans ses bras ; auprès de cet humble ami, elle se sentait moins seule.
Bientôt, elle se leva, fit craquer une allumette et sa main hésitante l’approcha d’une bougie qu’elle savait être là.
À peine la lumière se répandit-elle dans la chambre que les yeux de Monique tombèrent sur le christ d’argent placé sur une table, entre deux flambeaux, près de l’assiette dans laquelle une branche de buis trempait dans l’eau bénite. À cette vue, elle recula, les yeux agrandis devant l’appareil funéraire répandu dans la chambre.
Tirée de l’espèce de torpeur annihilante où le chagrin l’avait plongée, la jeune fille s’était mise à trembler.
Sa jeunesse ne pouvait s’être accoutumée à l’idée de la mort et une épouvante la hanta quand elle songea que tout à l’heure sa tête était posée sur le drap noir lamé de blanc de la couche mortuaire.
Affreuse impression...
Vivement, elle marcha à reculons vers la porte, suivie de Fox.
La tête lourde, les mains en feu, infiniment lasse, elle descendit verrouiller les issues de la maison, afin de se coucher et, comme elle n’était pas habituée à cette solitude – surtout pendant la nuit – et qu’elle s’en effrayait, elle prit son chien avec elle dans sa chambre.
――
Les jours qui suivirent l’inhumation de Michel Somesnil furent employés par Monique et une femme de ménage, Rosalide, qui avait soigné le défunt, à mettre tout en ordre dans la maison.
La chambre de son père fut principalement l’objet des soins de la jeune fille et c’est par là qu’elle commença.
Elle fit disparaître les nombreuses petites fioles à étiquettes rouges qui avaient contenu les inutiles remèdes absorbés par le malade ; puis, elle passa aux mille objets divers posés, par-ci par-là, dans le désarroi du premier moment.
Sa main, en les touchant, tremblait bien un peu.
N’était-ce pas quelque chose du disparu qu’elle remuait ainsi ?... C’était son passé, auquel il tenait tant ! Et, parfois, quand ce quelque chose lui avait été personnel, ses lèvres l’effleuraient, tandis qu’une larme glissait le long de sa joue pâle.
Rosalide, la femme de ménage, avait compris que le temps seul atténuerait la grande douleur de l’orpheline. Aussi évitait-elle, soigneusement, toute allusion à la peine de celle-ci.
Cependant, comme elle était curieuse, elle ne put s’empêcher de lui demander, un jour qu’elle rangeait avec elle son linge dans une armoire :
– Qu’allez-vous faire, à présent, mam’zelle Monique ?
– Faire quoi ? dit l’orpheline, en s’arrêtant dans sa besogne. À quel sujet me demandez-vous ça ?...
– Dame ! ils disent comme ça, dans le pays, que vous n’êtes pas assez riche pour vivre de vos rentes !
Monique rougit de l’indiscrétion de la bonne femme, mais commençant à s’habituer à ses façons de langage, elle reprit, doucement :
– Ils ont raison, ceux qui disent ça. Ma fortune n’est pas brillante... Je travaillerai !
– Travailler, et où, grand Dieu !... Pas ici, toujours ?...
– En effet, mais la terre est vaste et il y a d’autres pays que Vassonville... J’irai à Paris...
– Qu’y ferez-vous, bon sang ?... Il ne faut pas croire qu’il suffit d’aller à Paris pour devenir riche... La capitale est surpeuplée et le chômage y sévit plus qu’ailleurs, puisque l’on prêche le retour à la terre. Alors ?...
La jeune fille eut un geste d’indifférence.
– Il ne me faudra pas grand-chose pour vivre. Je gagnerai toujours assez pour moi !
La question que Rosalide avait posée à Monique avait beaucoup embarrassé celle-ci. Elle s’était inquiétée de sa situation d’orpheline sans fortune et elle avait réfléchi sérieusement sur le parti à prendre pour vivre désormais.
Dès que Michel Somesnil s’était senti malade, il avait fait venir un notaire et s’était entendu avec lui pour assurer à sa fille mineure le moins de soucis possible, dans le cas où il viendrait à lui manquer. Sage précaution, comme on le voit, puisque la mort l’avait pris si vite.
Un conseil de famille, réuni à la hâte, s’était occupé de l’émancipation de Monique et, quand son père mourut, celle-ci n’eut que quelques formalités à remplir pour entrer en possession du modeste héritage qu’il lui laissait.
Bien modeste, en effet, puisque en dehors de la maison et du mobilier qui venaient de ses parents, M. Somesnil ne possédait rien. Il vivait de la pension que l’État lui versait et c’était à force d’économie qu’il avait réussi, dans les dernières années de sa vie, à mettre quelques milliers de francs de côté.
Comme la maladie et tous les frais qui en découlèrent avaient considérablement diminué la petite épargne, Monique comprit vite qu’elle en verrait rapidement la fin, si elle restait plus longtemps sans travailler.
Heureusement pour elle, l’effort ne lui faisait pas peur. Elle résolut d’utiliser au plus tôt ses talents et son instruction.
Tout d’abord, la jeune fille rejeta l’idée de quitter la maison devenue si chère pour elle, sous tant de points de vue. Elle forma mille projets, tous plus extravagants les uns que les autres ; un peu de bon sens lui démontra vite l’impossibilité d’en mettre un à exécution. Il fallait donc partir...
Que pouvait-elle faire, vraiment, en ce coin perdu de Normandie et à quoi serviraient ses diplômes, si elle y restait ?...
Et comme aucune ville ne l’attirait plutôt qu’une autre, ce fut à Paris qu’elle décida de se rendre.
Une raison, du reste, l’y poussait.
Le notaire de son père, Me Dumont, qui était venu la voir depuis peu, connaissait sa situation et il lui avait proposé de la recommander à une de ses parentes de la capitale, qui cherchait une institutrice pour sa fillette.
L’idée de s’en aller du pays ne lui étant pas encore venue, Monique avait négligé cette offre gracieuse, mais maintenant qu’elle se rendait compte qu’il lui fallait aller à la ville, elle voulut, sans plus tarder, recourir aux bons offices du notaire.
Dans cette intention, elle se rendit au bourg voisin afin de voir celui-ci. Elle eut la satisfaction de rencontrer à mi-chemin celui qu’elle cherchait.
C’était un brave homme, qui lui promit d’écrire le jour même à sa parente. Il lui donna même l’adresse de cette dame, afin que la jeune fille pût aller en personne chercher une réponse dès son arrivée à Paris.
Monique le remercia vivement.
Comme elle s’éloignait, il la rappela pour lui demander ce qu’elle comptait faire de la maison que son départ rendrait libre.
– Ce que je compte en faire ?... répondit-elle, étonnée. Mais, la garder...
– Comment, vous ne la louerez pas ?...
– Je n’y ai pas songé...
– Et pourquoi ?... Je me charge de vous trouver un locataire sérieux ; cela vaudra bien mieux que de laisser la maison inhabitée. Vous perdriez tous vos meubles et vous n’y gagneriez rien...
Une mélancolie envahit l’orpheline. Elle sentait bien la dure nécessité où elle était de tirer parti de ses moindres revenus. Cependant, elle répondit, sans hésitation :
– J’espère qu’il n’y aura pas tant de dégâts ; dans tous les cas, je prendrai les précautions nécessaires afin d’en diminuer l’importance. Mon désir est qu’aucun étranger n’entre en maître là où mon père le fut. Il m’est doux aussi que les souvenirs si chers à mon cœur ne soient profanés.
Son imagination de fillette allait vite !... Son absence serait courte ; elle tâcherait de trouver quelque chose bien rémunéré, ou encore un travail facile à faire chez soi, afin de revenir pour toujours.
« Avec du courage et de la persévérance, est-ce qu’on ne peut pas réussir ?... se disait-elle, avec foi. Je sens que je réussirai ! »
Notre héroïne était à l’âge heureux où l’enthousiasme est assez fort pour vaincre l’adversité. Mais l’expérience lui manquait complètement, et elle s’imaginait qu’il suffit de vouloir pour réussir et que, ne redoutant pas l’ouvrage, tout marcherait conformément à ses souhaits.
C’est ainsi que, n’étant jamais sortie seule et ne connaissant pas Paris, elle y partait.
Une vieille rentière du pays, Mlle Juliant, ayant eu connaissance de son départ prochain, la supplia de lui laisser l’épagneul, qu’elle avait toujours admiré.
Monique y consentit.
La vieille demoiselle fut si heureuse d’avoir obtenu l’animal qu’elle engagea vivement la jeune fille à prendre l’adresse d’une de ses amies, blanchisseuse à Paris, qui pourrait certainement lui être utile si l’occasion s’en présentait. L’orpheline accepta par politesse et pour ne pas paraître dédaigneuse des bonnes intentions de l’excellente personne. Elle fit bien, comme les événements le démontreront bientôt.
Le dernier jour avant la date fixée par Monique pour son départ fut employé par elle à faire sa malle et ses adieux à tout ce qu’elle aimait.
La première de ces choses ne fut pas longue ; son bagage était léger et, lorsqu’il fut prêt, elle s’achemina vers le cimetière. Elle y passa près de deux heures à pleurer et à parler à ses chers morts, qui dormaient ensemble, sous la même pierre, de leur dernier sommeil.
Elle les pria de la bénir, du fond de leur tombe, et de la protéger, là-bas, dans la grande ville où elle allait essayer de gagner sa vie.
De son côté, elle leur jura, la main étendue vers la croix qui surmontait le monument funèbre, de rester honnête fille quoi qu’il advienne, et d’être toujours digne du nom sans tache qu’ils lui avaient légué.
Cela fait, elle se sentit tranquille et prête à partir.
La dernière nuit qu’elle passa dans sa chambre fut la plus douce depuis la mort de son père. Elle resta longtemps éveillée à contempler ce petit sanctuaire tout blanc, vraie chambre virginale qu’elle allait quitter pour y revenir, elle ne savait quand... Mais comme elle sentait des regrets gonfler son sein et des larmes mouiller ses yeux, elle ferma vite les paupières et chercha le sommeil.
Le lendemain, elle fut debout avant le jour, et, vers sept heures du matin, une voiture vint la prendre avec ses malles, pour la conduire à la gare. Elle prit place résolument à côté du conducteur, après avoir donné une dernière poignée de main à la mère Rosalide, qui avait tenu à la saluer à son départ ; mais, lorsque au détour de la route elle perdit de vue la petite maison blanche, où elle avait vécu si tranquille, elle dut se raidir pour ne pas pleurer. Et, faisant violence à ses tristes pensées, elle essaya de répondre aux banalités que lui débitait son compagnon, le conducteur de la voiture.
――
Parmi les voyageurs qui descendaient à la gare Saint-Lazare, vers midi, du train venant de Normandie, on remarquait une jeune fille vêtue de noir et dont les grands yeux tristes erraient curieusement sur ce qui l’entourait.
La longueur des quais, l’immensité du grand hall, où plus de vingt trains étaient prêts à partir, la foule qui se pressait autour d’elle, lui causaient un étonnement qu’elle ne songeait pas à dissimuler et ses regards, errant de tous côtés, manifestaient clairement sa surprise.
Elle était si bien absorbée dans sa contemplation que l’employé préposé à la sortie dut la saisir par le bras pour se faire comprendre.
– Allons ! votre billet, madame ! Quoi ! ne m’entendez-vous pas ? Voici trois fois que je vous le réclame !
Monique tendit son billet et devint écarlate en se voyant l’objet de la curiosité des personnes qui l’entouraient.
Elle pressa le pas.
Suivant le flot des voyageurs qui sortaient de la gare, elle se trouva bientôt dans la rue d’Amsterdam. La circulation était intense à cette heure et la jeune fille, qui n’était pas habituée à tant de mouvement, se sentait fort désorientée. Sans la protection du bâton blanc des agents, elle serait restée bien longtemps sur le trottoir avant d’oser se risquer à traverser les rues.
Monique, tout à fait ahurie, se laissait porter par la cohue. Elle ne savait d’ailleurs vraiment pas où se diriger. Complètement dépaysée, assourdie par le bruit continuel des voitures et des coups de klaxon, elle ne ressentait qu’une vague sensation de malaise à laquelle contribuaient sans doute les tiraillements de son estomac, qui n’avait digéré depuis la veille qu’une tasse de lait prise en hâte le matin, au moment du départ.
Partout, autour d’elle, se dressaient des hôtels et des restaurants aux menus plus ou moins alléchants. Le désir d’un bon repas l’y eût conduite s’ils eussent été déserts ; or, à cette heure-ci, ils étaient bondés et, trop timide, elle ne put se décider à en franchir seule le seuil.
Elle avait aussi remarqué des boulangeries et des pâtisseries, dont quelques-unes avaient une sorte de comptoir ouvert directement sur la rue. Il y avait là, faute de mieux, de quoi apaiser sa faim, mais elle trouvait aussi difficile de manger en pleine rue que d’entrer seule dans un restaurant.
Cependant, elle voyait des passants, des ouvrières, de jeunes garçons acheter hâtivement un croissant ou un sandwich et le croquer à belles dents. Elle vit même un homme fort élégamment vêtu, irréprochablement rasé, s’approcher du modeste étalage, acheter deux petits pains et s’éloigner furtivement tout en les mordant avec une avidité qui prouvait bien que c’était là sa première nourriture de la journée.
Ce petit fait, qui se répète si souvent à Paris, était passé inaperçu de tous, mais l’orpheline, dont la grande sensibilité et la vive intelligence en avaient saisi les moindres détails, éprouva un serrement de cœur.
Cette misère jointe à cette élégance lui faisait voir, dès ses premiers pas dans la capitale, ce qu’il y a de mirage et de trompe-l’œil dans la foule affairée et rieuse qui se presse dans les rues, et elle sentait son admiration pour Paris considérablement ébranlée tandis qu’une instinctive méfiance s’éveillait en elle contre les habitants de la grande ville.
Après tout, puisque personne ne semblait y faire attention, pourquoi la jeune fille n’essaierait-elle pas aussi de déjeuner en marchant ? La question du repas serait ainsi résolue, et rapidement.
– Tant pis, se dit-elle, un petit pain et du chocolat composeront mon menu ; je prendrai ma revanche ce soir, au dîner.
Un fugitif sourire plissa les coins de sa bouche à la pensée de manger, elle aussi, dans la rue.
Après une nouvelle hésitation, elle s’y décida timidement ; et, en voyant cette jeune fille grignoter en marchant, plus d’un badaud se retourna et la suivit des yeux.
Elle n’était pas, du reste, de celles qui passent inaperçues.
Monique était grande ; sa taille élancée était bien prise ; son visage, sans être joli, était cependant très agréable ; elle avait surtout de grands yeux bruns que de longs cils frangés voilaient langoureusement ; enfin, la masse soyeuse de ses cheveux châtains, simplement rejetés en arrière de la tête, seyait admirablement à son teint frais et rose de petite provinciale.
Il se dégageait de toute sa personne un cachet de distinction naïve, et les nombreux regards convergeant vers elle disaient clairement qu’elle plaisait à voir.
Lorsqu’elle eut fini de manger, elle s’informa du chemin qu’elle devait suivre pour se rendre rue de Courcelles, où habitait la parente du notaire. Ce n’était pas trop loin pour y aller à pied, et elle arriva vers deux heures à l’adresse indiquée.
Mme Boutel habitait un charmant hôtel de deux étages. Une grande porte donnait accès à un large vestibule pavé de dalles blanches et noires.
Le domestique à l’air gourmé qui accourut à l’appel de Monique s’informa de ce qu’elle voulait.
– Je désire parler à Mme Boutel, répondit-elle. Prévenez-la ; je suis la personne qu’un de ses parents lui a annoncée dans une lettre... Elle doit d’ailleurs m’attendre.
Le domestique, qui croyait deviner en Monique une solliciteuse, répondit avec prétention :
– Je ne pense pas, ma petite demoiselle, que Madame puisse vous recevoir à cette heure... Elle se repose. Il vous faudrait un mot d’introduction.
Le ton de l’homme blessa l’orpheline.
– N’importe. Annoncez-moi, répliqua-t-elle, sèchement.
Le serviteur, craignant de se tromper dans le jugement qu’il se formait sur la jeune visiteuse, alla prévenir sa maîtresse après avoir, au préalable, décoché à l’arrivante une grimace qui avait la prétention d’être un sourire.
Après quelques minutes d’absence, il revint.
– Si Mademoiselle veut me suivre... pria-t-il.
Et il lui fit traverser plusieurs salons luxueusement meublés, pour la laisser seule dans un petit boudoir bleu.
« Je souhaite que la maîtresse soit plus aimable que le domestique !... Il a l’air joliment prétentieux », pensa la jeune fille, qui éprouvait une gêne croissante depuis son entrée dans la maison.
L’habitude de ployer l’échine pour obtenir une faveur – et à plus forte raison un emploi – lui manquait totalement.
Elle attendit longtemps Mme Boutel.
À mesure que les minutes s’écoulaient, une crainte la saisissait de venir trop tard.
Au bout d’un quart d’heure, croyant qu’on l’avait oubliée, elle allait se décider à rappeler le domestique lorsqu’un pas léger lui annonça l’arrivée de la maîtresse de céans.
Elle ne l’attendait plus, et son émotion fut si forte que ses jambes tremblèrent sous elle et qu’elle dut s’appuyer au coin d’une étagère japonaise qui se trouvait à sa portée. En même temps, elle s’inclinait devant celle qui venait d’entrer.
Mme Boutel était une femme d’environ trente-cinq ans, très élégante, mince, fardée et d’apparence hautaine. Elle avait un air dur que ne démentaient pas ses yeux d’acier dissimulés derrière des verres encerclés d’écaille blonde.
À son entrée, elle examina Monique qui, de son côté, la regardait, intimidée, incapable d’ouvrir la bouche.
– Vous avez désiré me parler, mademoiselle ?
La voix de l’orpheline trembla en répondant :
– Je ne viens pas chez vous, madame, en personne tout à fait inconnue ; Me Dumont, notaire, un de vos parents, a dû vous faire part de mon désir d’être, si la chose est possible, l’institutrice...
– Ah ! très bien, je me souviens, interrompit la femme du banquier. Je regrette beaucoup de vous enlever cet espoir... Il est trop tard ; voici quatre jours qu’une institutrice anglaise est auprès de ma fille.
Elle parlait brièvement et les mots lui tombaient dédaigneusement du bout des lèvres.
– Trop tard, je l’avais pressenti, bégaya Monique.
Devant l’écroulement de tous ses projets, elle restait muette, tête baissée, anéantie, avec une grande envie de pleurer.
Mme Boutel, que le silence prolongé de la jeune fille agaçait visiblement, et qui semblait sous l’empire d’une nervosité excessive, lui jeta, en manière de consolation :
– Eh bien ! mademoiselle, qu’attendez-vous maintenant ?... La place est prise, je n’y puis rien ! Du reste, je crois que cela vaut beaucoup mieux ainsi ; j’aime les personnes vives et décidées, et vous ne me paraissez pas remplir les conditions que j’aurais exigées.
Monique releva vivement la tête.
L’indifférence de cette femme devant sa détresse, ses sarcasmes mêmes, la blessaient cruellement... Elle eut honte d’avoir laissé deviner son désappointement.
– Vous avez raison, madame. La Providence fait bien les choses en cette affaire... Je n’étais pas faite pour vous satisfaire.
Elle frémissait en parlant.
Cependant, ces paroles furent à peine dites qu’elle les regretta, en songeant que peut-être le brave notaire en aurait du désagrément.
Elle en épia l’effet sur le visage de Mme Boutel ; mais celle-ci parut plus étonnée que fâchée de la verte riposte de la jeune fille et, s’avançant majestueusement vers la cheminée, elle appuya ses doigts chargés de bagues sur le bouton de sonnette électrique.
Un domestique accourut aussitôt, le même qui avait introduit Monique une demi-heure auparavant.
– Baptiste, reconduisez Mademoiselle.
Un salut courtois de la part de celle-ci fut échangé contre un imperceptible mouvement de tête de l’orgueilleuse femme et, une minute après, l’orpheline se retrouva dans la rue, devant la porte qu’elle avait franchie pleine d’espoir peu de temps auparavant.
Elle reprit machinalement le chemin qu’elle avait parcouru à l’aller.
Elle marchait vite, nerveusement, avec la hâte de s’éloigner de cette maison où elle n’avait rencontré que désillusions et sécheresse de cœur. Les idées affluaient confuses à son cerveau et sa marche rapide répondait bien à son agitation intérieure.
Tout en serrant ses vêtements contre elle pour se garantir du froid, elle songeait tristement.
Jamais encore son abandon ne lui avait paru si grand qu’à cette heure, où elle errait à travers Paris, ignorante du lieu où elle reposerait le soir.
Oui, elle était bien seule, et dans trois ou quatre heures la nuit, qui venait encore tôt en cette saison, la surprendrait dans son isolement.
Tout ce qu’on lui avait dit sur Paris, ville de débauche et de mensonge, où des pièges sont tendus sous les pas des innocentes victimes, lui revenait à la mémoire, et comme une enfant à qui on donne la peur du loup, ses craintes s’en augmentaient.
Elle comprenait, un peu tard, combien elle avait négligé les plus élémentaires précautions en se confiant ainsi au hasard. Si elle avait osé, elle serait retournée immédiatement chez elle.
L’amour-propre, et aussi un peu du caractère énergique qu’elle tenait de son père, malgré son apparente faiblesse, lui représentèrent son retour comme une lâcheté.
– Comment, se disait-elle, dès les premières difficultés, je me déroberais ? Allons donc ! Il me faut lutter et persévérer, si je veux réussir ! Que je trouve d’abord un endroit pour y passer la nuit et, ensuite je me tirerai d’affaire.
Tout en réfléchissant, et par une succession de rues et de carrefours tous nouveaux pour elle, la jeune fille était arrivée auprès de l’église de la Trinité.
Dans une rue, derrière ce monument, elle avait remarqué deux ou trois écriteaux annonçant aux passants des chambres meublées à louer.
Elle se dirigea vers la plus modeste de ces maisons et allait y demander des renseignements, quand elle se sentit tirée légèrement par sa robe.
– J’ai faim, lui soupirait une petite voix d’enfant. Je n’ai pas mangé depuis hier... Ma mère est malade et nous sommes sept à la maison. Du pain, s’il vous plaît, ma bonne demoiselle !
Monique s’arrêta et, sans réfléchir que cette détresse était probablement feinte, elle chercha dans son porte-monnaie une pièce d’un franc qu’elle tendit au gamin, pendant qu’un coup de vent faisait envoler de sa bourse un papier plié qu’elle avait dû déplacer pour y puiser son aumône.
L’enfant, peu habitué, sans doute, à de telles aubaines et dont les yeux flamboyaient de plaisir, courut le ramasser et le rendit à Monique.
– Merci bien, mam’zelle, que l’bon Dieu vous l’rende !...
Il s’éloigna en courant.
L’orpheline allait remettre machinalement le petit carré de papier dans son porte-monnaie, lorsque son attention s’y porta.
Rapidement, elle le déplia et un éclair de satisfaction brilla dans son regard quand elle lut :
Mme Lesueur, repasseuse, rue Lepic, n°…
C’était l’adresse que la nouvelle maîtresse de Fox lui avait donnée avant son départ et à laquelle elle ne pensait plus en ce moment.
« Je suis grandement payée, se dit-elle, en faisant allusion aux dernières paroles du petit vagabond. Et si cette dame est aussi complaisante qu’on me l’a annoncé, elle consentira à m’aider de ses conseils pour trouver une chambre convenable dans mes prix. »
Dans la joie de cette pensée, elle entra à la Trinité et adressa au Ciel une fervente prière.
Quand elle en ressortit, un agent de police qu’elle interrogea lui indiqua sa route.
Ce n’était pas très loin et, une demi-heure, Monique s’arrêtait, au fond d’une courette, devant une petite boutique un peu basse, à la devanture de laquelle s’étalaient des objets de lingerie fraîchement repassés.
– Ce doit être là, se dit-elle en poussant la porte.
Deux ouvrières affairées, qui pliaient du linge sur une longue table recouverte d’une étoffe de laine grise, levèrent les yeux sur elle à son entrée.
– C’est bien ici que demeure Mme Lesueur ? interrogea-t-elle.
– Oui, mademoiselle, c’est moi-même, lui répondit une petite femme un peu boulotte et déjà âgée qu’elle n’avait pas aperçue en entrant.
En même temps, elle avançait un siège à la visiteuse.
– Je crains de vous déranger, à cette heure-ci, dit Monique, gênée par la présence des deux ouvrières, et qui eût préféré être seule avec la repasseuse. Je puis, si vous le voulez, revenir à un autre moment... lorsque la journée de ces demoiselles sera finie...
La vieille femme devina le désir qu’avait la jeune fille de lui parler sans témoin. Elle l’examina un moment avant de répondre, et comme l’orpheline avait fort bon air, elle ouvrit une porte vitrée au fond de l’atelier et lui fit signe de la suivre.
– Entrez par ici, mademoiselle ; l’ouvrage ne presse guère en ce moment. Asseyez-vous, nous serons mieux pour causer.
Monique s’assit, réconfortée par la douce tiédeur de l’appartement qui contrastait avec le froid vif du dehors. Elle remarqua que son interlocutrice prenait soin de se placer de façon à ne pas perdre de vue les apprenties qui devisaient à voix basse sur la visite que recevait la patronne.
Et, pendant que leurs suppositions allaient bon train, Monique Somesnil se faisait connaître et expliquait à la vieille dame l’embarras de sa situation.
– Ainsi, c’est ma vieille Juliant qui vous a engagée à venir me trouver ?... questionna-t-elle, quand l’orpheline eut fini de parler.
– Oui, madame, elle-même, qui m’a fait espérer que votre obligeance habituelle consentirait à donner quelques bons conseils à une jeune fille peu au courant des habitudes de Paris.
– Et c’est du travail que vous cherchez ?
– Pas encore, quoique ce soit ma tâche de demain. Pour aujourd’hui, il me faut trouver un logis, afin d’y passer la nuit.
– Ah ! c’est un lit qu’il vous faut !... s’écria la repasseuse d’un air méfiant. Je ne vois pas en quoi je puis vous être utile !
Monique comprit qu’il lui fallait dissiper les craintes que le ton de la vieille femme révélait. Elle reprit :
– Mes ressources, bien que modestes, me permettent de descendre à l’hôtel. Je n’en ai malheureusement pas l’habitude et je n’ose m’y rendre seule.
– Vraiment. Êtes-vous donc si timide ?
Et comme la jeune fille, interloquée, ne répondait pas, elle continua :
– Ce n’est pas pour une nuit ?
– Oh ! non, madame. C’est pour plusieurs jours... pour longtemps, peut-être, cela dépendra de l’emploi que je trouverai.
– Et vous êtes à même de payer d’avance la location mensuelle d’une petite chambre ?
– Oui, si toutefois le prix n’est pas trop élevé, répondit la jeune fille, qui était devenue rouge à la question de son interlocutrice.
Celle-ci continuait, impassible, à la fixer de ses petits yeux gris, très éveillés.
Un nouveau silence suivit, puis la vieille dame reprit :
– Les affaires vont mal, surtout pour une femme seule ; les loyers augmentent sans cesse et l’on tâche de tirer parti des moindres coins et recoins. Comme ma maison est trop grande pour moi, je reloue le second étage à un ménage d’employés. J’ai aussi un cabinet meublé, au premier, qui est libre depuis quelque temps. C’est cent francs par mois, payés d’avance... ce n’est pas cher. La maison est propre et sérieuse. Jamais il n’y a de bruit. J’hésitais à le relouer parce qu’il est près de ma chambre, mais vous me paraissez bien tranquille... Si cela pouvait vous convenir... Venez le visiter.
– Volontiers. Je ne suis pas difficile et je saurai me contenter de peu, s’écria Monique, heureuse à la pensée de loger chez une femme qu’elle savait être bonne malgré ses apparences de croque-mitaine.
– Si ça ne fait pas votre affaire, nous chercherons ailleurs, déclara philosophiquement Mme Lesueur.
Tout en parlant, elle prit une clef accrochée à un clou et précéda la jeune fille dans un couloir qui, partant de la rue, aboutissait à un escalier un peu sombre.
– Ce n’est pas bien clair, mais on s’y habitue vite, dit-elle en le gravissant ! Du reste, il n’est ni raide ni étroit et c’est un avantage pour mes vieilles jambes.
– C’est très bien, essaya de répondre Monique, qui venait de se heurter le coude à un soliveau dépassant la muraille et que la douleur avait arrêtée dans son ascension.
La vieille femme n’avait rien vu, occupée qu’elle était d’ouvrir la porte d’une petite chambre, dont elle commençait déjà à énumérer les avantages :
– Ce n’est pas luxueux, vous voyez. Un lit de fer, une table, trois chaises et une petite commode. Dans ce coin, il y a un placard où l’on peut ranger ses effets. La chambre est fraîchement tapissée, la fenêtre donne sur la rue. Tenez, regardez comme c’est gai, ce mouvement continuel des gens qui passent !
Un soupir seul lui répondit.
Monique avait beau ne pas être difficile – après avoir habité une délicieuse chambrette dans une charmante maison – elle pouvait trouver affreux l’étroit cabinet dont la repasseuse vantait la disposition.
Cependant, la crainte de se retrouver à cette heure et par ce froid dans la rue, avec le risque de passer la nuit dans un hôtel quelconque, firent que la jeune fille accepta.
– C’est entendu, madame. Je vous loue cette chambre. Je m’en contenterai. Voici les cent francs qui m’en assurent la possession pendant un mois.
Mme Lesueur empocha les pièces et les billets qu’elle lui tendait, non sans les avoir d’abord vérifiés. Cela fait, elle devint soudain plus aimable.
– Allons, je suis contente que le cabinet vous convienne, vous m’êtes sympathique et j’aurais regretté de vous voir partir. Je suis sûre que vous vous plairez ici... Si vous avez besoin de quelque chose, je suis à votre service.
– Je vous remercie, madame.
– Avez-vous quelques bagages à aller chercher ? demanda la vieille, complètement amadouée par le gracieux visage de l’orpheline.