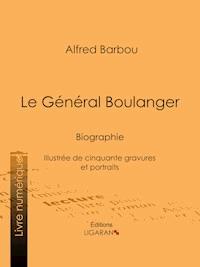
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Französisch
Extrait : "L'Europe se transforme en un camp : aux Nations avides de paix, les gouvernements réclament des armées de plus en plus nombreuses, des armements de plus en plus formidables. Pas un peuple qui ne demande de pouvoir vivre librement, à l'abri des haines et des ambitions de ses chefs, qui ne rêve de consacrer toutes ses forces au développement des merveilleuses découvertes de la science moderne, au triomphe du progrès, à l'amélioration du sort humain par l'effort commun."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 315
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
L’Europe se transforme en un camp : aux Nations avides de paix, les gouvernements réclament des armées de plus en plus nombreuses, des armements de plus en plus formidables.
Pas un peuple qui ne demande de pouvoir vivre librement, à l’abri des haines et des ambitions de ses chefs, qui ne rêve de consacrer toutes ses forces au développement des merveilleuses découvertes de la science moderne, au triomphe du progrès, à l’amélioration du sort humain par l’effort commun. Et cependant il est avant tout question à l’est et à l’ouest, au nord et au midi, d’augmenter le chiffre des régiments, de transformer les fusils et les canons, de multiplier les forteresses et les arsenaux, comme si les plus redoutables conflagrations étaient à la veille de se produire.
Dans ces circonstances l’examen de nos moyens de défense, l’étude de nos forces militaires d’où dépend l’avenir de la France, la connaissance des réformes à accomplir sont des questions s’imposant à tous ceux qui ont souci de la grandeur des destinées de la patrie.
Ces préoccupations ont inspiré le livre que nous publions et qui fait naturellement suite à nos ouvrages précédents. Après avoir étudié d’abord l’histoire de l’établissement définitif de la République dans notre pays, après avoir résumé les efforts des hommes d’État qui ont le plus puissamment contribué à la fonder, il nous a semblé utile, urgent, d’examiner les tentatives du Soldat auquel le parlement a confié le soin d’achever de rendre notre armée capable de faire face à tous les périls.
De quelle façon, depuis nos désastres, avons-nous travaillé à notre réorganisation ; quels ont été les moyens employés et quels sont les résultats obtenus ; quel but faut-il atteindre, quelles sont les améliorations tentées et celles qui restent à accomplir ? Telles sont les questions auxquelles nous nous efforcerons de répondre à l’aide de documents clairs et précis.
Désireux de faire pleine lumière sur ces faits, nous publions la biographie du ministre de la guerre, parce que ce général jeune, doué d’initiative et d’énergie, animé des intentions les meilleures est en ce moment l’ouvrier de notre défense nationale.
Dire quels sont ses états de service, les campagnes qui lui ont permis de prouver sa valeur et de mériter à trente-trois ans le grade d’officier supérieur ; quelles sont les qualités qui lui ont valu la confiance de ses subordonnés ; exposer comment il a affirmé sa supériorité d’administrateur en demeurant directeur de l’infanterie, c’est-à-dire en occupant le poste le plus important de l’administration de la guerre, sous trois ministères successifs ; résumer son œuvre personnelle, voilà notre tâche.
Qu’on ne s’attende point cependant à trouver ici des éloges seulement ; il s’agit avant tout d’une constatation.
Nous voulons tracer avec bonne foi et sincérité, après avoir recueilli des renseignements exacts, le portrait d’un homme à qui sont liées en ce moment les destinées de la France. À l’heure où la Prusse, à qui pèse sa conquête, songe sans cesse qu’on veut la lui ravir, et inquiète, aux aguets, demande des soldats, toujours des soldats, des soldats encore ; à cette heure, disons-nous, où l’inquiétude et la menace nous entourent, il nous semble que le chef de notre armée doit tenir dans nos préoccupations la première place. Chacun de nous doit chercher à se rendre compte de notre organisation nouvelle.
Ainsi que tous ceux qui rompent en visière à la routine, cessent de suivre les chemins battus et veulent innover, réformer, améliorer, le Général a été blâmé, attaqué non sans violence, mais en revanche son œuvre a été accueillie par un grand nombre avec un réel enthousiasme ; notre livre a pour but de permettre à nos lecteurs de juger impartialement.
Quelle est la pensée qui guide le ministre Boulanger ? Il l’a exprimée, résumée lui-même récemment en ces termes :
« … Ceux-là, inquiets ou aveugles, ignorent ou feignent d’ignorer que tout pays qui veut vivre doit être fort et que la première condition pour le développement des ressources intellectuelles, industrielles et commerciales d’un grand peuple, est la sécurité, basée sur la conscience de sa force. Or, en présence des mesures prises par toutes les nations pour élever au suprême degré la puissance et la mobilité de leur machine militaire, notre patrimoine national serait-il en sûreté, ce patrimoine, fruit des travaux, des luttes, des souffrances, du génie de nos pères, si nous étions moins armés et moins préparés que nos voisins ?
… Pour mon compte, plus patriote encore que soldat, je désire ardemment le maintien de la paix si nécessaire à la marche du progrès et au bonheur de mon pays. C’est pour cela que dédaignant certaines attaques et fort du sentiment du devoir, je poursuis sans relâche la préparation à la guerre, seule garantie des paix durables… »
Un tel langage a été applaudi par tous les patriotes qui songent à l’avenir et s’y préparent, le cœur vaillant, en dehors des manifestations tumultueuses ou tapageuses.
Après avoir cité ces paroles d’un homme ayant l’entrain, l’activité et aussi la bonne humeur nécessaire en France à un chef d’armée, nous allons énumérer ses actes qui indiquent un remarquable esprit de suite.
À ceux qui saluent avec joie le réveil de notre esprit militaire et veulent, à l’ombre du drapeau, conserver l’indépendance du sol, les conquêtes de notre civilisation, la liberté si chèrement achetée, nous dédions cette étude sincère, qui n’est point l’apologie d’un homme, mais simplement l’examen d’une virile et patriotique tentative.
ALFRED BARBOU.
SOMMAIRE : Les premières années du général Boulanger. – Son entrée à Saint-Cyr. – La promotion de Crimée-Sébastopol. – Nomination de sous-lieutenant au premier régiment de tirailleurs algériens. – Historique de ce corps d’élite. – Ses premiers combats en Afrique. – Son héroïsme en Crimée. – Le sous-lieutenant aux tirailleurs (octobre 1856). – Difficultés du début. – Un festin interrompu. – En campagne. – Le baptême du feu. – La guerre en Kabylie. – À l’assaut des montagnes. – Le pic du Djurjura.
En notre temps, à de rares exceptions près, la vie d’un officier date de son entrée à Saint-Cyr : aussi dirons-nous d’abord que le général Boulanger (Georges-Ernest-Jean-Marie), né à Rennes le 29 avril 1837, et fils d’un avoué établi à Paris, entra à Saint-Cyr le 15 janvier 1855.
Il avait fait ses études au lycée de Nantes et est actuellement président de l’association des anciens élèves de cet établissement qui a fourni à notre pays tant d’hommes remarquables et distingués. C’est là tout ce que nous savons de son enfance et de sa vocation.
Nous aurions pu sans doute mieux nous enquérir, mais l’existence du Soldat seule nous intéresse.
À l’école militaire le futur sous-lieutenant travailla ferme, mais fut entravé dans ses études par une maladie assez grave, qui lui a été rappelée l’an passé d’une façon curieuse, au moment où, devenu ministre, il visitait l’École militaire.
Pour cette inspection tout le personnel était présent ; seule la doyenne des infirmières, une pauvre vieille clouée sur son lit par les douleurs hésitait à quitter sa chambre ; mais comme déjà elle était infirmière en 1855, ses compagnes la hissèrent sur leurs épaules et la descendirent au rez-de-chaussée.
Lorsque passa le général elle l’interpella avec cette bonhomie sans façon affectée par les anciennes religieuses au service de l’armée :
– Ah ! fit-elle, c’est vous qui êtes le ministre ?
– Oui, madame.
– Comment donc vous appelez-vous ?
– Je me nomme Boulanger.
– Boulanger, attendez donc ; mais je me souviens de vous. Pendant votre première année vous avez été plus de huit jours en danger de mort. Eh bien, il vous en a fallu de la chance pour qu’on ait pu vous tirer d’affaire, avec l’aide de votre mère qui passait les nuits à côté de moi, au pied de votre lit.
L’anecdote est charmante ; elle a beaucoup touché le Ministre de la guerre et nous l’avons citée parce qu’elle est tout ce que nous avons d’intéressant à rappeler pour ses jeunes années.
Les détails qui suivent, détails d’une exactitude absolue, nous ont été fournis par un des camarades du général, celui qui l’a suivi dans ses premières campagnes. Nous le remercions ici de sa bienveillance.
Chaque promotion à Saint-Cyr, porte un nom, emprunté par elle à un des évènements les plus importants de l’année ; celle du Saint-Cyrien Boulanger s’appelle la promotion de Crimée-Sébastopol parce que, à cause de la guerre contre la Russie, les deux promotions en 1855, furent réunies en une ; aussi se composait-elle de 612 membres.
Que sont devenus en 1885, après trente années, ces 612 sous-lieutenants ? Il nous a semblé intéressant de le rechercher et nous avons trouvé le tableau suivant dans l’annuaire de la promotion.
Sur 612 officiers il n’en reste plus que 183 en activité de service ; ils occupent les grades suivants :
À ce chiffre nous ajoutons :
Et nous avons ainsi l’histoire résumée de deux générations de Saint-Cyriens. Le général de division est le général Boulanger, ministre de la guerre. Les six généraux de brigade sont le général Bégin, le général Bichot, le général Faverot de Kerbrech, le général Hervé, le général Rozier de Linage et le général Caillard.
La promotion de Crimée-Sébastopol a formé il y a quelques années une association dont les statuts sont intéressants. Cette association fraternelle a pour but de venir en aide à ceux de ses membres que frappe l’infortune. C’est une réunion de camarades de même âge ayant tous suivi la même carrière et qui se sont groupés pour se venir en aide ; elle est, en quelque sorte, civile et comparable aux associations maintenant nombreuses que forment entre eux les anciens élèves d’un même collège, les membres d’une corporation. Depuis quatre années son président d’honneur est le général Boulanger et son vice-président d’honneur le chef d’escadrons Clapeyron qui en a été un des plus ardents promoteurs.
La camaraderie en est la première règle. L’un des articles des statuts déclare que tout camarade de promotion qui, soit par écrit, soit de vive voix, se servira du mot vous à l’égard de ses camarades sera passible d’une amende de 5 francs, laquelle sera versée entre les mains du trésorier et affectée au fonds de roulement.
C’est ainsi que plusieurs de ces messieurs accoutumés au respect dû à leurs supérieurs et ayant écrit au chef actuel de l’armée en ces termes :
« Monsieur le Ministre,
J’ai l’honneur de vous féliciter de votre nomination, etc… »
ont reçu par courrier la réponse suivante :
« Mon cher camarade,
Je te remercie de tes félicitations, mais je te prie d’envoyer immédiatement cent sous au trésorier de la promotion…
Général BOULANGER. »
Le jeune Boulanger sorti de Saint-Cyr en 1856, fût envoyé le 1er octobre, avec le grade de sous-lieutenant, au 1er régiment de tirailleurs algériens. C’est là qu’il fit ses premières armes.
Avant de raconter la rude expédition de la Grande Kabylie à laquelle il prit une part active faisons rapidement l’historique de l’infanterie indigène.
Son organisation date de 1841. On avait compris dès les premiers jours de l’occupation algérienne l’utilité de rattacher à la cause française tous ceux des habitants du pays qui se montreraient disposés à nous servir, et, en divers temps, sous des noms qui ont souvent changé, furent formés des corps spéciaux tantôt mêlés de Français, tantôt exclusivement de Musulmans. Les indigènes résistant mieux que les Européens à l’insalubrité du climat, supportent plus aisément les privations et les fatigues des courses lointaines, et, traités avec bienveillance et justice ils n’ont cessé de se montrer dévoués, courageux, fidèles.
Partant de ce principe, le maréchal duc de Dalmatie, ministre de la guerre sous Louis-Philippe, créa sous le nom de tirailleurs, trois bataillons distincts d’infanterie indigène qui furent organisés en 1842, à l’aide d’officiers et de sous-officiers français choisis dans les régiments de France et d’Algérie. Aussitôt équipée, cette milice recrutée des éléments les plus divers prit part vaillamment à la défense de notre conquête.
Cette assimilation militaire si rapide de la race arabe a paru merveilleuse aux gens du métier ; elle démontre en effet que nous sommes des colonisateurs, quoi qu’on dise, et les exploits des tirailleurs indigènes, des turcos, prouvent que les Français conquérants en Afrique ont su utiliser glorieusement pour la mère patrie les Arabes épris de la guerre.
Ils servirent d’abord à combattre les tribus insoumises et, dès les premiers engagements, firent preuve d’un courage et d’une fidélité à toute épreuve, puis sous les ordres du général Changarnier, luttèrent avec succès contre les Kabyles.
La guerre de la Kabylie étant celle qui nous intéresse particulièrement dans cet ouvrage, nous allons l’esquisser à grands traits. La Kabylie, partie de l’Algérie, se divise en deux parties, la Petite et la Grande. La Grande Kabylie est l’un des plus beaux pays de montagnes de la Méditerranée. Elle est bien arrosée, bien cultivée, riche en jardins et en plantations d’oliviers. Ses limites sont la mer au Nord, l’Isser à l’Ouest, le Sahel à l’Est et au Sud ; elle compte environ quatre cent mille habitants.
C’est un pays fort accidenté. Les jardins fertiles, les riches vergers qui entourent les habitations n’ont pas fait perdre de vue le soin de la défense ; partout sont ménagés des ravins, des retranchements, des haies de cactus qui forment d’innombrables petites forteresses ; tous les villages sont construits sur des hauteurs. Les ports principaux sont Bougie et Dellys.
Les Kabyles braves et prudents sont groupés en tribus indépendantes les unes des autres, se gouvernant elles-mêmes comme des États distincts.
En France on ne comprit pas d’abord la nécessité de soumettre ces tribus tranquilles mais toujours menaçantes. Maîtres de Bougie depuis 1833, nous n’avions fait, en 1846, aucune tentative sérieuse vers la montagne. Le maréchal Bugeaud avait maintes fois essayé de démontrer l’utilité d’envahir la Kabylie que les Arabes se plaisaient à regarder comme un asile inviolable pour nous. Il obtint enfin l’autorisation d’agir en 1847.
Dans cette pénible campagne les tirailleurs indigènes se signalèrent d’une façon particulière ; ils supportèrent sans se plaindre des fatigues et des privations sans nombre. Le maréchal duc d’Isly en personne prit le commandement de la colonne dont ils faisaient partie, et après de rudes et brillants combats ces indigènes s’emparèrent des villages de Beni-Abbés, véritables nids d’aigles dont les Turcs n’avaient jamais pu se rendre maîtres. De Wimpffen, Daumas, Canrobert, Bosquet, prirent part à ces faits d’armes, et malgré la résistance prolongée de certaines tribus et les excitations des fanatiques, la soumission commença bientôt.
Des expéditions partielles continuèrent durant plusieurs années ; Saint-Arnaud, Mac-Mahon, Camou étendirent successivement nos conquêtes, mais sans obtenir la pacification complète du pays.
En 1854, l’expédition d’Orient étant décidée, le ministre de la guerre dut prendre à l’armée d’Afrique ses meilleures troupes et les tirailleurs algériens s’embarquèrent pour la Crimée ; leur départ s’effectua au milieu d’un immense concours de population indigène accourue pour les saluer de leurs acclamations et leur adresser un suprême adieu. Dans tous les combats leur valeur les fit distinguer : à l’Alma, à Inkermann, au Mamelon Vert, à la Tchernaïa, à Balaklava, à Malakoff, les vaillants enfants de l’Afrique se conduisirent comme des héros, arrosant de leurs sangles champs de bataille. Sur le terrain ils bondissaient et s’élançaient les premiers au-devant de l’ennemi ; on les comparaît à des lions. Les Anglais, témoins des prodiges qu’ils accomplissaient s’arrêtaient de combattre pour les acclamer, leur criant : « Bravo ! Algerianers ! »
Maintes fois eux et leurs chefs furent récompensés de leur superbe courage par des citations à l’ordre de l’armée. Le colonel Rose les commandait. L’histoire de cette guerre est pleine de leurs traits d’héroïsme. Ils s’acquirent là une réputation éclatante.
La guerre terminée à la fin de 1855, les tirailleurs reçurent l’ordre de retourner en Afrique. Hélas ! combien manquaient à l’appel, mais ainsi qu’on l’a dit justement, leur souvenir vivra à jamais dans tous les cœurs pour lesquels l’honneur, la bravoure, le dévouement ne sont pas de vains mots.
Leur corps dissous fut reformé en 1856.
Tandis qu’on se battait contre les Russes de graves évènements se passaient en Afrique.
Le départ de nos troupes avait réveillé chez quelques marabouts des espérances qu’on croyait à jamais éteintes : sur quelques points l’agitation grandissait ; la guerre sainte était prêchée, l’insurrection se propageait ; il fallut lutter de nouveau et en 1857, refaire une expédition définitive en Kabylie. Le maréchal Randon fut chargé de la commander et appela le 1er régiment de tirailleurs à en faire partie.
C’est à cette époque que le sous-lieutenant Boulanger sorti de Saint-Cyr fut nommé, comme nous l’avons dit, sous-lieutenant dans ce corps d’élite, qu’il rejoignit en janvier 1857 à Blidah en compagnie de deux de ses camarades nommés dans les mêmes conditions, les sous-lieutenants Brault, actuellement colonel commandant l’école militaire de la Flèche, et Juffé, aujourd’hui lieutenant-colonel au 46e.
L’accueil fait à ces trois jeunes gens ne fut pas d’abord très chaleureux. C’était la première fois que l’École spéciale militaire envoyait directement aux tirailleurs des sous-lieutenants pour occuper des places réservées jusqu’alors aux sous-officiers du Corps. Ces derniers, voyant l’avancement sur lequel ils comptaient compromis par cette mesure, manifestaient en toute occasion leur mécontentement et le traduisaient par des paroles d’une vivacité soldatesque.
Entre maints propos, (je ne cite que le moins imagé), ils se plaignaient que la mère Saint-Cyr eût pondu en une seule année trois oiseaux de cette espèce, et ils se demandaient où s’arrêterait cette fécondité si préjudiciable pour eux.
Il fallut donc d’abord rompre la glace et se faire bien voir non seulement des égaux mais encore des sous-officiers. La jeunesse, l’entrain, la bonne humeur confiante des nouveaux venus devaient triompher assez vite de cette première difficulté : le caractère gai, expansif, affectueux du sous-lieutenant Boulanger contribua beaucoup à amener en peu de temps une heureuse détente. Bientôt, au reste, on allait faire mieux connaissance, sur le vrai terrain et recevoir le baptême du feu qui donne à l’officier droit de cité dans le régiment.
Les anciens tout récemment revenus de Crimée, ou de l’expédition des Beni-Koufi de 1856 parlaient si souvent de leurs campagnes que nos trois jeunes gens étaient impatients de prendre part à cette vie active, accidentée, glorieuse, et de faire leurs preuves à leur tour.
On commentait chaque jour le bruit de l’expédition prochaine projetée par le maréchal Randon dont la retraite de 1854 avait laissé un pénible souvenir et réclamait une vengeance. Mais en attendant le printemps, époque fixée pour la répression nécessaire, on se mit au courant des détails du service.
Les premiers pas dans la carrière ne se font point sans quelque appréhension ; ce n’est pas sans une émotion réelle que l’on exerce pour la première fois son petit commandement ; la responsabilité si légère qu’elle soit, en dépit de la bienveillance et des encouragements, semble d’abord pesante aux plus hardis. Toutefois le sous-lieutenant Boulanger voulut fêter son premier tour de service et il invita ses compagnons à dîner avec lui, au poste, pour y pendre la crémaillère et passer gaiement sa première veillée militaire. Les invités arrivèrent si nombreux qu’il fallut se serrer beaucoup à table, et, comme le vestiaire manquait, on accrocha aux murs et aux fenêtres les armes, les képis, les cols, en un mot tout ce qui était gênant pour ces fraternelles agapes. Au moment où la petite fête battait son plein, tandis que les convives tous animés par la jeunesse et l’espérance échangeaient des propos bruyants, choquaient leurs verres avec fracas, le turco de faction fit retentir le cri « aux armes ! » Le poste court au râtelier, saisit les fusils, et, commandé par le sergent forme les rangs. L’officier sortit à son tour ; il faisait grand jour encore, et rien à l’horizon ne lui parut d’abord suspect. Déjà il s’étonnait de cette fausse alerte quand le factionnaire qui avait des yeux expérimentés lui désigna sur la grande route un point mobile, s’avançant lentement, grossissant peu à peu.
Bientôt il fut possible de distinguer un homme à cheveux blancs, vêtu d’une tunique noire, tenant à la main une canne à pomme ; c’était le commandant de place, en tournée.
Toute la bande de convives sans prendre le temps d’aller chercher dans la salle les objets qui lui appartenaient s’échappa, comme une volée d’oiseaux effarouchés, à travers un jardin d’orangers attenant au poste dont le chef resta seul vis-à-vis de l’inspecteur inattendu.
– Combien d’hommes au poste ? interrogea celui-ci d’abord, selon l’usage.
D’un coup d’œil le sous-lieutenant Boulanger mesura le rang et répondit par un à peu près acceptable.
L’inspecteur après avoir commandé demi-tour et fait rompre les rangs se dirigea vers la chambre de l’officier de garde pour y faire les vérifications accoutumées ; mais apercevant aux fenêtres des ornements insolites, il s’arrêta. Tandis que baissant la tête le jeune sous-lieutenant cherchait des explications qui eussent été invraisemblables autant qu’embarrassées, le vieux commandant jetait sur lui un regard sévère ; mais il ne voulut point se montrer impitoyable pour une peccadille de jeunesse, se contenta de ce reproche muet et reprit, sans infliger aucune punition, la route de Blidah.
Cette bienveillante sévérité, cette leçon pleine de tact et de bonté produisit plus d’effet que tout autre châtiment ; le jeune homme ne l’oublia point. Sa légère incartade lui fit comprendre dès le début les avantages d’une stricte discipline.
Au reste les doux loisirs de la garnison de Blidah ne furent pas de longue durée ; peu de temps après l’incident que nous venons de conter, le bataillon de notre lieutenant partit pour Tizi-Ouzou renforcer les avant-postes qui se trouvaient sur les limites de la Grande Kabylie. Le véritable apprentissage de la guerre allait commencer.
Au commencement de 1857 le 1er régiment de tirailleurs se réunissait à l’Arbâ des Beni-Moussa et se mettait en route pour aller concourir à la formation des quatre divisions qui se massaient au pied des massifs abrupts de la Grande Kabylie. Le régiment faisait partie de la division Renault, mais deux compagnies, dont celle du sous-lieutenant Boulanger, furent détachées à la division Yusuf.
Les difficultés de l’entreprise étaient telles que les vieux soldats de Crimée, ceux qui avaient assisté à la prise de Sébastopol, hochaient la tête et disaient à leurs officiers en regardant les contingents Kabyles étagés au-dessus de leurs têtes sur des pics inaccessibles : « Aller les chercher là-haut, c’est folie, c’est impossible ! »
On y alla cependant, mais l’assaut fut rude.
Soug-el-Arbâa était le point central du pays des Aït-Iraten, la tribu la plus hostile et la plus puissante, celle qu’il fallait soumettre d’abord. Nos troupes étaient réunies à huit cents mètres au-dessous de ces hauteurs, d’où se détachent trois contreforts aux crêtes étroites, hérissés de pitons rocheux, retranchements naturels et formidables. Partout de véritables murailles de roc, des fourrés impénétrables, des ravins profonds. Et pour escalader ces sommets fortifiés, défendus par de nombreux Kabyles courageux, agiles, bons tireurs, bien armés, pas un sentier connu, nulle indication précise.
En avant ! Tel fut le mot d’ordre.
L’attaque commença le 24 mai. À cinq heures et demie du matin les colonnes de la division Renault s’élancèrent vers le village placé à mi-côte des premières pentes. Les autres divisions opéraient simultanément sur d’autres points. À chaque pas nos soldats se trouvaient arrêtés par de hautes herbes, des broussailles à travers lesquelles il fallait se frayer un passage. Après une longue et pénible marche, nos tirailleurs arrivent près des premiers postes. On aperçoit distinctement les Kabyles qui, couchés derrière leurs retranchements, le fusil à l’épaule, attendent le moment de faire feu à coup sûr.
Mais avant que ne parle la poudre, les combattants, à portée de la voix, commencent à s’invectiver à la façon des héros d’Homère ; ils échangent des insultes et se montrent le poing.
Bientôt la bataille s’engage, quelques pièces d’artillerie hissées aux prix de fatigues inouïes sur les premières pentes ouvrent le feu ; nos fusées vont semer l’épouvante parmi les groupes ennemis, nos obus éventrent les embuscades, fouillent les bois ; les balles commencent à siffler, nos clairons sonnent la charge et nos tirailleurs, le fusil en bandoulière, dédaignant de répondre au feu des Kabyles, s’accrochant aux aspérités, se faisant la courte échelle, s’élèvent de rocher en rocher.
Les villages qu’on rencontre sont enlevés à la baïonnette ; chemin faisant on arrête des otages qui sont placés sous bonne garde. Mais les difficultés croissent à mesure que l’on monte : Les pentes sont plus raides, les vergers plus touffus, les haies plus épaisses ; l’ennemi profite habilement des obstacles qui nous arrêtent, toutefois nous avançons toujours et il se replie vers les côtes.
Les tirailleurs indigènes se distinguent par une admirable intrépidité, un irrésistible élan ; et ce furent les compagnies dont faisait partie le sous-lieutenant Boulanger qui eurent, ainsi que le constate l’Historique du régiment, l’honneur d’aborder les premières la crête des Irdjen et d’enlever avec une furia sans pareille l’importante position où les Aït-Iraten étaient les mieux fortifiés.
Après trois heures de lutte notre drapeau, arboré au sommet d’une mosquée, apprenait notre victoire aux tribus des plus hautes montagnes assistant avec stupéfaction à la défaite de la plus puissante tribu de la Kabylie, tribu réputée invincible.
Sur les autres points la lutte était également opiniâtre.
Les Kabyles embusqués dans des bois de figuiers faisaient sur nos troupes un feu violent et meurtrier et opposaient à notre élan une résistance furieuse : abordés maintes fois à la baïonnette par nos tirailleurs, repoussés, rejetés dans les ravins, ils revenaient sans cesse plus nombreux, plus opiniâtres, livrant avec l’acharnement du désespoir le combat suprême pour leur indépendance et la défense de leur sol.
À chaque instant on tombe mortellement frappé. En quelques minutes le fanion d’une de nos compagnies change cinq fois de main ; cinq fois les sous-officiers qui le relèvent le laissent retomber dans leur sang. Le combat est implacable, terrible, mais à la fin nous restons maîtres du champ de bataille. Dans cette seule journée le régiment de tirailleurs eut vingt-six hommes tués et soixante-douze blessés, dont deux officiers.
L’expédition ayant pour but la soumission définitive de la Kabylie, de nombreux engagements eurent lieu les jours suivants, et le jeune officier dont nous écrivons l’histoire fit vaillamment ses premières armes et se montra digne de commander aux braves indigènes qui gaiement, affrontant la mort, couraient au-devant des balles avec une admirable intrépidité.
Pour obliger les tribus à demander plus vite l’âmân, il fallut, avons-nous dit, arrêter des otages, dont nos gravures reproduisent le type ; ce sont des dessins faits à l’époque de cette guerre, d’après des documents authentiques. Quand la soumission tardait trop on en était réduit à détruire des villages, à saccager des jardins, à couper des figuiers, et les chefs des tribus accouraient demander qu’on mit un terme à cette dévastation, qu’on ne réduisit point à la misère leurs vaillants compagnons.
Sans retard le maréchal Randon ordonna de commencer sur les hauteurs de Soug-el-Arbâa, dont nous étions les maîtres, la construction d’un fort qui prit le nom de Fort-Napoléon. Situé sur le nœud formé par les trois crêtes des Irdjen, des Aït-Akerma et des Aït-Oumâlou, cet important établissement militaire est la clé du pays et assure notre domination. Il fallut pour l’établir entreprendre des travaux considérables, ouvrir de larges routes dans un pays extraordinairement tourmenté comme on sait. Les tirailleurs, comprenant l’utilité de cette besogne, manièrent la pioche avec ardeur, comme ils avaient tenu le fusil ; tout le corps d’armée s’en mêla et en quelques jours vingt mille soldats, transformés en terrassiers, rendirent carrossable, accessible à l’artillerie, un chemin de vingt-cinq kilomètres.
Les tirailleurs encouragés, guidés par leurs officiers, montrèrent en cette occasion une extraordinaire bonne volonté, une incroyable énergie. Tandis que s’exécutaient ces travaux gigantesques, les Kabyles eux-mêmes de la farouche tribu des Aït-Iraten se familiarisèrent avec nos soldats, apprécièrent les efforts dont ils étaient capables, vinrent approvisionner nos marchés, demandèrent même à être employés aux travaux, et grâce à la précieuse faculté d’assimilation plus puissante chez les Français que chez tout autre peuple, quoiqu’on dise, ils devinrent en peu de temps nos amis. Ces peuplades intelligentes autant que guerrières se rendirent aisément compte des avantages que procureraient à leur commerce, des facilités que donneraient à leurs communications, de vastes voies bien entretenues ; en un mot, ils comprirent que notre conquête était avant tout une œuvre de civilisation, de progrès, de bienfaisance, et l’on sut leur prouver que les vainqueurs n’en voulaient point à leur indépendance.
La pose de la première pierre du fort fut une fête magnifique, la récompense des glorieux efforts de l’armée expéditionnaire.
En moins de trois semaines une œuvre immense avait été accomplie : aussi, avec des acclamations sans nombre fut salué le défilé d’une section d’artillerie de campagne sur la route nouvelle construite dans un pays inaccessible, le mois d’avant, route bordée de poteaux télégraphiques maintenant ! Un tel résultat tient du prodige.
Cependant quelques tribus plus éloignées s’efforçaient de prolonger la résistance. La soumission des Aït-Iraten n’avait point entraîné celle de leurs voisins les Aït-Jenni, les Aït-Aïci, et les Aït-Merquellât. À la fin du mois de juin il fallut de nouveau combattre, et les quatre divisions du général Chapuis, du général Renault, du général Jusuf et du général de Mac-Mahon furent chargées d’achever la campagne.
Les difficultés étaient les mêmes, les actes d’héroïsme furent les mêmes aussi. Nous ne pouvons entrer ici dans tous les détails de cette expédition pénible à cause de la nature du terrain, mais nous en relatons le dernier épisode parce que les deux compagnies de tirailleurs de la division Jusuf dont faisait partie le sous-lieutenant Boulanger, y jouèrent un rôle important, décisif.
Les Kabyles qui restent à vaincre habitent les massifs les plus rugueux, les plus bouleversés, les plus ravinés, un fouillis inextricable semé de gorges escarpées, profondes où tombent avec fracas d’impétueux torrents et que surmontent des pics dont la pointe semblable à des aiguilles disparaît dans les nuages. Les rares sentiers qu’on rencontre dans ce dédale sont à peine accessibles aux chèvres.
C’est là qu’il fallut aller chercher les derniers rebelles. L’opération commença dans la nuit du 10 au 15 juillet 1857.
Pour amener l’ennemi à composition il était indispensable, il importait de le déloger de sa plus haute position, des crêtes inaccessibles du Djurjura, de façon à menacer la ligne de retraite que commande ce passage. L’ascension était en apparence impossible ; il fallait faire dans les ténèbres, le long de gouttières creusées par les pluies et la fonte des neiges dans des rochers presque lisses, cinq lieues, et grimper de la sorte, en pleine obscurité, et dans le plus profond silence, car le moindre bruit eût donné l’éveil aux bandes de Kabyles dispersées qui erraient dans les montagnes avec leurs troupeaux.
Ni le général Boulanger, ni aucun de ceux qui étaient là n’oublieront jamais cette effroyable escalade. À dix heures du soir le capitaine Delastie de Valdufresne auquel l’ancienneté donnait le commandement du détachement réunit ses officiers et ses hommes : ordre de garder pendant la marche le silence le plus absolu, d’amarrer les sabres et les baïonnettes, de ne point fumer : la moindre lueur, le plus léger bruit, et l’on était perdu. Aussitôt arrivés au sommet du pic on allumerait un grand feu pour donner au gros de nos troupes le signal d’une attaque générale.
Le détachement partit à onze heures, guidé par deux hommes du pays et commença de gravir sans bruit les rochers entassés les uns sur les autres.
On se hissait comme on pouvait, se poussant, se tendant la main, s’accrochant aux anfractuosités, risquant à chaque pas de rouler au fond d’un gouffre. Pas un mot, pas un murmure, pas un juron, tandis qu’on gravissait avec des fatigues inouïes cette gigantesque muraille de cinq lieues.
Parviendra-t-on jusqu’au but ? on ne le sait. Là-haut le piton d’Azrou est garni de retranchements en pierres sèches habilement construits derrière lesquels l’ennemi veille sans doute et fusillera à bout portant, les aventureux assaillants qui seront précipités dans les ravins béants. Qu’importe ! On va toujours.
Pendant ce temps le général Yusuf s’inquiète. Au point du jour il ne voit pas paraître le signal convenu. Que se passe-t-il ? Peut-être les guides ont trahi. Peut-être nos deux compagnies sont tombées au milieu d’un poste ennemi qui les a détruites. L’entreprise était trop aventureuse, trop hardie, trop périlleuse.
Soudain, au moment où l’inquiétude est à son comble le pic s’éclaire, la flamme jaillit et colore d’une rouge lueur les montagnes voisines.
Ce signal c’est le succès de l’opération redoutable, c’est le triomphe de notre cause. Il est salué par d’innombrables cris de joie. Nos tirailleurs ne surent que plus tard à quel danger ils avaient échappé. Les Aït-Melikech étaient chargés de la défense de cette position, mais ils ne l’occupaient que pendant le jour ne pouvant admettre la possibilité d’une attaque de nuit : dix minutes plus tard on les trouvait à leur poste et peut-être eût-il été impossible de les en déloger.
Mais l’escalade heureusement terminée eut tous les bons résultats qu’en attendait le commandant en chef. Les Kabyles se retirèrent démoralisés, désespérant de pouvoir échapper à un ennemi pour qui, disaient-ils, la demeure des aigles même n’était point inaccessible.
Quelques coups de fusil encore, une vigoureuse razzia et les ennemis forcés dans leurs derniers retranchements, acculés au Djurjura où toute retraite leur était fermée, comprirent qu’ils n’avaient plus d’espoir que dans la clémence du vainqueur.
« Les Français sont un grand peuple ! » s’écriaient les vieillards, en parlant de l’ascension que nous avons décrite, « ils sont montés là-haut ! » Et ils envoyèrent porter des paroles de paix et de soumission.
Ce qui toutefois plus que leurs défaites et la construction de nos forteresses firent des Kabyles de fidèles sujets de la France, ce fut la manière dont on les traita.
Ils discutèrent froidement et acceptèrent sans murmure l’impôt forcé ; mais quand le maréchal Randon ajouta qu’il ne serait touché ni à leurs femmes, ni à leurs biens, ni à leurs institutions, ce fut parmi les anciens une véritable explosion de joie qui se communiqua à toutes les tribus. Notre conquête parut dès lors complètement assurée.
Depuis cette époque notre drapeau flotte sur tout le territoire algérien depuis La Calle jusqu’à Djemâa-Ghazaouat.
Les opérations étant terminées l’armée expéditionnaire fut dissoute, mais le général Renault tint à honneur d’écrire au colonel des tirailleurs pour lui exprimer la satisfaction de toutes les vertus militaires par lesquelles ses hommes s’étaient distingués.
« La valeur, dit-il, dans cette lettre, la patience, la discipline, l’élan français ont éclaté aux yeux de tous. »
De son côté, le maréchal Randon, dans l’ordre du jour qui précéda son départ, déclara que l’Algérie reconnaissante remerciait ses défenseurs et il mentionna spécialement le 1er régiment de tirailleurs en ces termes :
« Ce régiment peut à juste titre être fier de la part qu’il a prise dans la brillante campagne de la Grande Kabylie : toujours on l’a vu au premier rang, toujours il a eu le périlleux honneur de montrer le chemin de la gloire aux troupes nationales ; c’est sur les vaillantes poitrines de ces intrépides soldats que sont venus se briser les efforts de l’ennemi ; ils ont arrosé de leur sang cette autre voie sacrée qu’ils ont ouverte dans les âpres montagnes. Ils savent mourir quand la France le leur demande ; ils pratiquent au plus haut degré les deux plus admirables vertus militaires : ils combattent sans crainte et tombent sans plainte. »
Le sous-lieutenant Boulanger qui avait eu la bonne fortune de tirer pour la première fois l’épée en semblable compagnie peut prendre sa part de ces éloges. C’est ainsi qu’il apprit dès le début ce que peuvent l’énergie, l’audace et le courage.
SOMMAIRE : Sous la tente. – Quelques mois de repos. – La question italienne. – Déclaration de guerre de l’Autriche. – Commencement des hostilités (mai 1859). – On demande des volontaires aux Tirailleurs. – Le sous-lieutenant Boulanger s’inscrit le premier. – Arrivée en Italie. – La légende des turcos anthropophages. – Marches et contremarches. – Impatience de combattre. – Le village de Robecchetto. – À la baïonnette ! – Furieuse offensive du premier bataillon de tirailleurs. – Une balle en pleine poitrine. – Victoire ! – Fin de la campagne d’Italie. – La croix de la légion d’honneur. – Retour à Blidah (janvier 1860). – Nomination de lieutenant (28 mars). – Plaisirs de garnison. – Un tambour qui boite. – Tout finit par des chansons. – Une nouvelle expédition.
À la suite des glorieux évènements que nous venons de relater, le régiment de tirailleurs regagna par détachements les petites garnisons de la province.





























