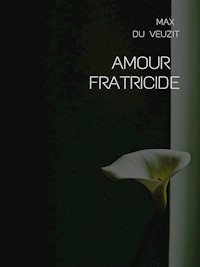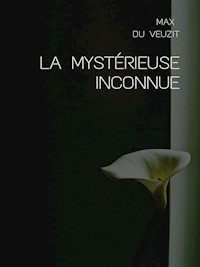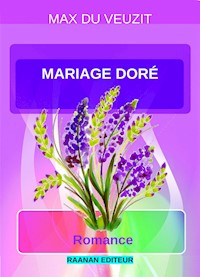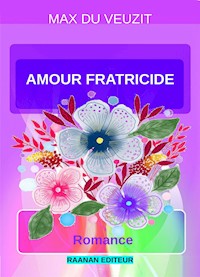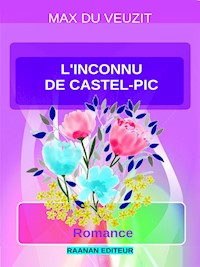1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Raanan Editeur
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Orpheline, Marguerite est recueillie par son tuteur, Sir Evérard, dans le domaine de Malbackt, en Ecosse. Le luxe de la demeure, isolée dans une nature sauvage, ne parvient pas à dissiper l'intense malaise qui saisit la jeune Française dès son arrivée. Marguerite n'éprouve aucune sympathie pour Sir Evérard, un homme cynique. Cruel, même... Son sentiment devient angoisse lorsqu'elle découvre que le neveu de son hôte, Roland, est séquestré dans le donjon. Un colosse, l'inquiétant Piercy, âme damnée du châtelain, monte une garde vigilante auprès de celui que l'on dit fou... Une étrange maladie terrasse le reclus. Chargée de le soigner, Marguerite se jure d'éclaircir le mystère. Peu à peu, d'ailleurs, elle ressent à son contact un trouble irrépressible. Son coeur s'émeut, se donne... Les deux jeunes gens s'apercevront trop tard de la force de leur amour et de l'inextricable piège dans lequel ils sont tombés...| Tout espoir leur est-il interdit, désormais ? |Librairie Jules Tallandier|
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
SOMMAIRE
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV
XXVI
XXVII
XXVIII
Notes
MAX DU VEUZIT
LE MYSTÈRE DE MALBACKT
1908
Raanan Éditeur
Livre 1027 | édition 1
À M. Auguste Godefroy,
au cher maître et ami,
qui publia mes trois premiers romans,
en souvenir ému et affectueux.
Max du Veuzit.
I
Ma mère mourut en me donnant le jour et mon père ne lui survécut que quelques années à peine.
À la mort de ce dernier, comme je n’avais pas de proches parents pour me recueillir, on demanda à un cousin éloigné de ma mère, de consentir à me servir de tuteur.
Il s’appelait Evérard Dunbuy et habitait un vieux manoir près de Dumfries en Écosse.
Les liens de parenté qui me rattachaient à cet homme étaient plutôt vagues et il fallait remonter à plusieurs générations pour les établir. Cependant, comme il avait été en relation d’affaires avec mon père, il ne fit pas trop de difficultés pour accepter la tutelle qu’on lui offrait.
Il vint même de Dumfries à Guingamp – ville que mes parents avaient toujours habitée – pour me voir et prendre les mesures relatives à mon éducation dont il entendait ne point se charger.
– Je suis veuf, expliqua-t-il au notaire qui s’occupait de mes intérêts, et je vis seul, avec quelques serviteurs, à Malbackt. – C’était le nom de son domaine. – Je ne puis me faire l’éducateur de cette enfant. Il lui faut des soins maternels à son âge, et je suis certain qu’elle les trouvera plus facilement dans son pays d’origine qu’en Angleterre dont elle ne connaît pas la langue. D’ailleurs, il me paraît naturel qu’elle reçoive exactement la même instruction que ses parents lui eussent donnée, s’ils avaient vécu.
Ce raisonnement parut très sage à M. Le Uanec, le notaire, qui le comprit d’autant mieux que sir Evérard Dunbuy passait pour être très riche, alors que moi je ne possédais presque rien.
Il fut donc convenu que j’entrerais au couvent de Saint-Brieuc et que j’y resterais jusqu’à ce que mon éducation fût complètement achevée. Mon tuteur me ferait connaître ensuite ses intentions à mon égard.
Ce ne fut que la veille de mon départ pour la pension que je vis celui de qui dépendait désormais ma destinée.
Quoiqu’il y ait longtemps de cela, je me souviens très bien de l’impression pénible qu’il me causa quand, tenant fortement la main de ma nourrice qui m’accompagnait, je pénétrai dans le cabinet de M. Yves Le Uanec.
C’était un petit homme au ventre gros et aux jambes grêles. Il portait un binocle derrière lequel ses yeux gris paraissaient durs et perçants. Deux favoris rouges pendaient de chaque côté de son visage, donnant à sa physionomie je ne sais quel aspect rêche et désagréable.
– Ah ! voici la petite Marguerite. Elle n’est pas belle ! fit-il dans un bon français ne rappelant que de loin son accent britannique.
Un peu effrayée par l’exclamation dont il avait salué mon arrivée, je me blottis plus encore contre ma nourrice.
Le notaire se leva et vint vers moi :
– Approchez, mon enfant ; venez embrasser votre tuteur, dit-il doucement en me tirant par la main.
– Oh ! non, non ! criai-je. Nounou, ne me quitte pas !
Et je résistai, me cramponnant aux robes de celle-ci qui essayait de me rassurer.
– Non, elle n’est pas belle ! répéta mon tuteur qui regardait d’un œil indifférent cette petite scène. Elle tient de son père probablement. Dans notre famille les femmes sont généralement fort jolies...
Il disait cela du bout des lèvres et d’un ton dédaigneux qui, malgré mon jeune âge, ne m’échappa point.
– Elle grandira, balbutia ma nourrice avec une forte envie de pleurer. Ses parents étaient beaux comme des amours.
– Tant mieux !... Et peu importe, du reste !
Et se tournant complètement vers le notaire, sans faire attention davantage à moi, il reprit avec lui la conversation que mon arrivée avait interrompue.
Le lendemain de cette aventure, j’entrai chez les sœurs de Saint-Brieuc. J’y restai jusqu’à ce que j’eusse atteint l’âge de dix-huit ans.
À cette date, mon tuteur me fit savoir, toujours par l’intermédiaire de M. Le Uanec, que mon éducation devant être achevée, il désirait m’avoir chez lui, à Malbackt ; et, pour couvrir mes frais de voyage, il envoyait un chèque de cinq cents francs.
Jusqu’à ce jour, je n’avais pour ainsi dire pas réfléchi à ma position d’orpheline sans fortune. J’avais vécu insouciante parmi mes compagnes que j’aimais comme des sœurs et les religieuses que je considérais comme de véritables parentes.
Jamais l’idée que je pusse les quitter un jour ne s’était posée sérieusement à mon esprit.
Evérard Dunbuy avait montré, durant les douze années que j’avais passées à la pension, tant d’indifférence à mon égard que j’étais persuadée qu’au moment venu de prendre une décision pour mon avenir, il s’en remettrait complètement au notaire de ce soin.
On conçoit donc mon émoi quand j’appris son désir de m’avoir près de lui.
La pensée qu’il me fallait, à dix-huit ans, quitter mon pays, mes bonnes maîtresses, mes compagnes aimées, pour aller vers l’inconnu, vers le tuteur étranger dont j’avais gardé un si désagréable souvenir, me fit verser d’abondantes larmes.
Cependant, ayant obtenu du notaire la promesse que ma nourrice m’accompagnerait dans mon voyage, – si, toutefois, elle y consentait – je finis par accepter avec moins d’amertume l’idée de mon exil.
Pressentie, la brave femme ne refusa pas.
Son mari et son fils étaient morts l’année précédente, rien ne la retenait plus en Bretagne, et elle se dit prête à s’attacher à mon sort et à me suivre partout.
– Pourvu que là-bas, ils veulent bien me garder, je n’en demande pas plus...
Excellente Benoise qui trouvait tout simple de s’expatrier avec moi !
Je crois, pourtant, qu’au fond, elle ne se rendait pas bien compte de la distance qui sépare Dumfries de Guingamp, et pour elle, y aller, ne devait pas lui sembler un plus grand sacrifice que de se placer à Paris, comme chaque jour elle voyait de jeunes Bretonnes le faire pour gagner leur vie. Dans les deux cas, ne fallait-il pas quitter le sol natal, et quel que fût le pays où ses pas la porteraient, ne lui paraîtrait-il pas toujours au bout du monde, du moment qu’elle ne verrait plus ses champs d’ajoncs, le clocher de son village et les coiffes blanches de ses sœurs d’Armorique ?
Ce fut un mardi matin que je quittai Saint-Brieuc, en compagnie de ma fidèle nourrice.
Deux religieuses m’accompagnèrent jusque sur le quai de la gare.
Au moment de leur dire adieu, pour toujours peut-être, je crus vraiment que je n’aurais pas le courage de partir. Heureusement, le notaire avait tenu, lui aussi, à assister à mon départ et ce fut lui qui s’occupa de nos billets et de nos bagages.
– N’oubliez pas, mon enfant, que votre tuteur est très riche, qu’il n’a pas d’héritiers directs et que si vous savez vous faire aimer de lui, vous n’aurez rien à y perdre, dit-il en m’installant dans un compartiment de première classe.
La dernière recommandation de mes maîtresses fut moins matérielle :
– Quoi qu’il arrive, petite Marguerite, mettez toujours votre conscience et votre devoir au-dessus de tout, firent-elles en me serrant tendrement dans leurs bras.
Bientôt le train fila et je ne vis plus le quai de la gare sur lequel deux mouchoirs blancs s’agitaient en guise d’adieu.
À travers les larmes qui noyaient mes yeux, je distinguai encore les landes et les coteaux de ma chère Bretagne, ses champs de sarrasin, ses ruisseaux qui couraient aux pieds des saules, ses maisons de pierre et de chaume, ses petites vaches blanches tachetées de noir ; puis ce fut différent. À mesure que le train franchissait les stations, le pays changeait d’aspect et me devenait inconnu...
– Déjà si loin, et pourtant si près encore ! balbutiai-je en le constatant. Qu’est-ce que ce sera là-bas ?...
Mais comme si ma nourrice avait compris les mots que mes lèvres n’avaient fait que murmurer, elle m’attira contre elle, maternellement, et me baisa au front.
– Nous serons deux, ma chérie. Ne pleurez plus.
Et je lui rendis ses caresses, le cœur moins gros.
II
Le lendemain soir, nous arrivâmes à Calais, d’où nous nous embarquâmes pour Douvres. Et le quatrième jour, à dix heures du matin, après avoir passé par Londres et Liverpool sans nous y arrêter plus longtemps que pour y prendre un peu de repos entre les trains, nous descendions à Dumfries.
J’avais prévenu télégraphiquement, à Liverpool, mon tuteur, de l’heure exacte de notre arrivée et celui-ci avait envoyé une voiture, à la gare, au-devant de nous.
Aussi, à peine avions-nous mis le pied hors de notre wagon qu’un homme d’une trentaine d’années, vêtu d’une sorte de houppelande grise, se précipita vers moi.
À son aspect je devinai un domestique.
– Miss Margaret Dumart ? s’informa-t-il en s’inclinant respectueusement.
– C’est moi, répondis-je un peu amusée d’entendre pour la première fois mon nom de Marguerite prononcé en anglais.
– Je suis chargé par sir Evérard Dunbuy de conduire Mademoiselle à Malbackt...
Je lui tendis mes billets.
– Si vous voulez vous occuper de mes bagages : il y a deux grandes malles et une plus petite.
Pendant qu’il les plaçait sur la plate-forme de la voiture, j’envoyai Benoise chez un boulanger, dont la boutique se dressait en face de la gare, pour y acheter un petit pain que, sans plus de façon, je me mis à dévorer à belles dents, aussitôt qu’elle l’eut apporté, car je n’avais pas déjeuné.
Tout en mangeant, je remarquai que l’homme envoyé par mon tuteur m’examinait curieusement en dessous, chaque fois qu’il passait devant moi, restée debout près de la portière de la voiture.
– Est-ce loin, Malbackt ? lui demandai-je comme il installait mon sac de voyage sur la banquette intérieure.
– Quatorze milles nous séparent des premières terres et vingt-deux de l’habitation.
– Et combien de temps faut-il pour se rendre à cette dernière ?
– Le chemin monte toujours ; dans six heures, nous pourrions y être si nous ne nous arrêtions pas en route.
– Six heures ! C’est long !... Nous allons nous arrêter, dites-vous ?
– Oui, à mi-chemin, pour laisser reposer les chevaux. Mademoiselle pourra déjeuner.
Je répétai ces paroles à Benoise qui ne les avait pas comprises, car nous avions parlé en anglais, langue que j’avais fort heureusement apprise avec un professeur d’origine britannique.
– Comme il habite loin, votre tuteur ! mâchonna ma nourrice quand je lui eus expliqué à quelle distance nous étions de Malbackt. Est-ce que nous arriverons jamais au but ?
– Nous y touchons, ma bonne amie, fis-je en m’asseyant auprès d’elle, dans la voiture.
Elle soupira.
– Ce n’est vraiment pas trop tôt.
À ce moment, l’homme qui avait pris place sur le siège de devant, fit claquer son fouet allègrement et la voiture roula avec fracas sur le pavé de Dumfries qu’elle traversa en quelques minutes.
Le chemin que nous suivîmes alors était escarpé et difficile. Parfois, s’élevant à une grande hauteur, il côtoyait le faîte d’un précipice ou serpentait dans une gorge étroite ; d’autres fois, il suivait en pente douce les vallées verdoyantes et les terres cultivées que de petits ruisseaux sillonnaient en tous sens ; ou encore, il longeait les bords d’un petit lac dans lequel les hautes collines miraient leurs arêtes de pierre.
Le spectacle était vraiment grandiose.
À chaque coude du terrain la scène changeait autour de nous, soit que les montagnes et les vallées nous apparussent sous un autre aspect par suite de notre position tantôt élevée ou tantôt basse, soit qu’un village surgît tout à coup, devant nous, au pied d’un coteau couvert de bruyères, ou que les hautes murailles d’une tour se dressassent sur un pic escarpé, au moment même où nous nous attendions le moins à les y rencontrer.
Deux heures et demie environ après notre sortie de Dumfries, notre conducteur arrêta ses chevaux à la porte d’une petite auberge.
En mettant pied à terre, je fus saluée par une vieille femme à l’air affable, dont le nez long et effilé était surmonté d’une paire de lunettes.
– Qu’y a-t-il pour votre service, belle demoiselle ? me demanda-t-elle avec ce mélange de familiarité et de respect que j’ai rencontré, depuis, chez la plupart des aubergistes écossais avancés en âge.
– Pouvez-vous nous donner à manger ? répondis-je un peu gênée, l’éducation que j’avais reçue jusqu’alors ne m’ayant pas habituée à traiter ces questions de subsistance pourtant élémentaires.
Elle devina, sans doute, mon embarras, car elle se fit plus aimable encore.
– J’ai du hotchpoch|1| et de la morue, fit-elle en ouvrant devant nous la porte d’une petite salle assez proprette. Si vous voulez entrer, dans quelques minutes j’aurai préparé votre repas.
Benoise et moi pénétrâmes dans la pièce qu’elle nous indiquait.
Des images grossières ornaient les murs blanchis à la chaux. Je m’amusai d’abord à les regarder, puis j’allai m’asseoir près de la fenêtre. De là, je vis notre conducteur dételer ses chevaux et les attacher devant une auge pleine d’avoine.
L’aubergiste, qui allait et venait de sa cheminée à la porte de sa cuisine, l’interpella comme il finissait :
– Eh bien ! Killan, vous voilà en promenade agréable, ma foi ! Ce n’est pas tous les jours que vous portez si frais minois à Malbackt ?
– Comme vous dites, Mrs. Mengs.
– Et qui est cette jolie personne ?
– La pupille du maître, à ce que m’a dit Edie, la cuisinière du château.
– Un court séjour dans notre coin ?
– Du tout ! Il paraît qu’elle va rester chez nous.
– Vous perdez la tête, Killan ! La colombe n’est pas faite pour vivre près du hibou ! Une vieille pie-grièche eût mieux fait son affaire.
– Vous avez peut-être raison, ce sera cependant comme je viens de le dire.
– Eh bien ! je la plains, la pauvrette ! Elle y perdra plus d’une plume...
De nouveau, elle quitta le seuil de sa maison pour aller tisonner son feu ; et, n’entendant plus rien, je me mis à penser aux singulières paroles qu’elle venait de prononcer.
Hélas ! Le résultat de mes réflexions ne fut pas très gai. Jusque-là, je n’aimais guère mon tuteur, sans en avoir peur pourtant, mais voilà que, soudain, je me mettais à le redouter sérieusement.
– Qu’avez-vous, Marguerite ? me demanda Benoise en voyant mon front rembruni.
– Rien, répondis-je, dominant mon abattement, car je ne tenais pas à l’inquiéter inutilement. J’ai faim, je suis lasse, et je voudrais être installée à Malbackt ; j’ai hâte de savoir pourquoi Evérard Dunbuy me fait venir près de lui.
– Vous le saurez peut-être trop tôt, dit-elle en hochant la tête. Depuis que j’ai vu ce pays sauvage et ces gens misérables que notre voiture a croisés en route, je n’augure rien de bon de l’issue de notre voyage.
Je ne lui répondis que par un gros soupir et je me mis à manger silencieusement les mets que notre hôtesse plaçait devant nous.
Celle-ci avait laissée ouverte la porte qui communiquait entre la petite salle où nous étions et sa cuisine, de façon sans doute à faire plus rapidement le service, et de ma place, je voyais le conducteur de notre voiture, assis sur un tabouret de bois, mangeant sa soupe.
L’aubergiste et lui continuaient à parler.
C’était des potins du pays qu’ils se racontaient et cela ne m’intéressait guère. Cependant, je crus distinguer, à un moment, le nom de mon tuteur, et j’écoutai avec plus d’attention, car tout ce qui touchait celui-ci m’intriguait au plus haut point.
– Et tient-il toujours sir Roland en tutelle ? disait la femme. Ce garçon est-il vraiment aussi fou qu’il le dit ?
L’homme sursauta et jeta un rapide regard vers moi, comme s’il avait eu peur que j’eusse entendu la demande.
– Allez au diable, bonne femme, avec vos questions, fit-il à moitié contrarié. Il en cuit souvent de s’occuper des affaires des grands. Servez-moi une bouteille d’ale et mettez un frein à votre langue, cela vaudra mieux.
Elle lui apporta le breuvage qu’il demandait.
– Elle n’a pas entendu, dit-elle à mi-voix, en jetant un coup d’œil sur moi qui paraissais fort occupée à découper ma côtelette de mouton.
Le quittant ensuite, elle vint vers nous comme pour s’assurer que rien ne manquait sur la table, mais je remarquai qu’elle prenait soin de refermer la porte après elle, quand elle s’en retourna.
« Qu’est-ce que cela veut dire ? me demandai-je alors. Quel est ce sir Roland dont on redoute de prononcer le nom devant moi ? »
Pendant quelques instants, je formai toutes sortes de conjectures, puis, de guerre lasse, aucune ne me paraissant digne d’être retenue, vu que je ne connaissais pas assez mon tuteur pour qu’elles pussent être vraisemblables, je finis par ne plus penser à la conversation que j’avais entendue et je répondis à ma nourrice qui me parlait de notre chère Bretagne.
Bientôt, d’ailleurs, le conducteur de la voiture vint nous prévenir que les chevaux étaient attelés et que nous pourrions repartir dès que je serais prête.
– Tout de suite, lui dis-je.
Et je me hâtai de solder le modeste repas que nous venions de prendre.
Cette dernière étape de notre voyage s’acheva tristement.
Benoise et moi étions trop préoccupées pour pouvoir parler et nos yeux erraient pensivement sur le pays que nous traversions, comme si nous avions voulu interroger les arbres et les plantes pour leur arracher le secret de notre destinée.
À un moment, le chemin tortueux que nous suivions depuis l’auberge devint si mauvais, que notre conducteur descendit de son siège et se mit à marcher auprès de ses chevaux.
Passant ma tête à une des glaces baissées, je l’appelai près de moi.
– Sommes-nous encore loin ? lui demandai-je.
– Quand nous serons sur le plateau, vous apercevrez, dans le lointain, les tours du château de Malbackt, me répondit-il.
– Donc, si j’ai bien compris ce que vous me disiez tantôt, repris-je, nous devons être en ce moment sur les terres de ce domaine ?
– Effectivement ! Ces champs et ces bois en font partie depuis le petit cours d’eau que nous avons traversé sur un pont, au bas de la côte.
– Et tous ces biens appartiennent à mon tuteur ! m’écriai-je assez étourdiment.
L’homme me regarda en dessous et ne répondit pas. Il retourna auprès de ses chevaux jusqu’à ce que nous eussions achevé de franchir la sente. Alors, se tournant vers moi, il étendit le bras vers une masse sombre qu’on apercevait à l’autre extrémité du plateau.
– Malbackt, dit-il seulement.
Mon regard suivit la direction qu’il m’indiquait.
De loin, l’aspect du château était imposant.
C’était une énorme bâtisse de pierre grise que quatre grandes tours dominaient aux angles. Ces tours étaient garnies de créneaux se projetant en dehors des murs, et de meurtrières qui semblaient en défendre l’entrée. Un large fossé et d’épaisses murailles crénelées entouraient le corps principal et en faisaient ainsi une véritable forteresse.
Cette vaste demeure, qui devait avoir plusieurs siècles d’existence, se dressait à l’extrémité d’un site s’élevant brusquement d’un glen|2| escarpé et assez large, qui le cernait presque de tous côtés.
Pour y accéder, comme me l’expliqua notre guide, il n’y avait pas d’autre chemin que celui que nous avions suivi jusque-là, les flancs du glen étant absolument inaccessibles.
À l’entour, ne se voyait aucune trace d’habitation.
L’endroit était complètement désert ; mieux que cela, il était stérile et dénudé.
Ici, c’était la surface grise d’un rocher qui attirait le regard ; ailleurs, des champs de bruyères s’étalaient à perte de vue ; plus loin, des taillis espacés couvraient la cime des collines avoisinant le glen; quelques bouquets de grands arbres, sur le plateau, à gauche, décoraient seuls le sévère paysage ; enfin, tout autour du domaine, de maigres arbrisseaux étendaient leurs branchages sur l’abîme, ou emplissaient les cavités creusées dans le roc par les éboulements et les pluies.
– Comme cette demeure est triste ! murmurai-je après l’avoir longuement examinée.
– Oui, répondit Benoise, et je m’y attendais : un sentier aussi sauvage ne pouvait que conduire à la tanière d’un ours.
Je souris à sa boutade.
– Ne riez pas, Marguerite ! reprit-elle sérieusement. Qui sait si l’intérieur de ce château ne répond pas à l’aspect effrayant du dehors... Ce n’est pas une habitation chrétienne, cela : c’est une véritable prison.
– Une prison ! répétai-je en frissonnant et en fermant les yeux pour ne plus voir les grands murs sombres vers lesquels notre voiture courait trop rapidement, maintenant, à mon gré.
Je ne les rouvris que lorsque le bruit des sabots des chevaux, frappant les pierres de la route, cessa brusquement.
Nous étions arrivés au pied des hautes murailles de Malbackt, dont une grande porte de chêne, entièrement garnie de clous et protégée par une grille extérieure en fer, fermait l’accès.
Notre conducteur sortant une espèce de trompe de sa poche, en tira deux longs sons distincts que l’écho répercuta lugubrement.
À ce signal, la lourde porte roula sur ses gonds et notre voiture, franchissant le large pont-levis de bois jeté sur le fossé, pénétra sous la voûte sombre, en forme de corridor, qui débouchait dans la cour intérieure du château.
Notre voyage était enfin terminé.
III
Aussitôt après notre arrivée, un valet nous débarrassa de nos sacs, de nos parapluies et de nos vêtements de voyage, puis il nous conduisit dans une vaste antichambre, sobrement meublée de chaises et de bancs sculptés, rangés en bataille le long des murs, en nous priant de bien vouloir attendre que son maître eût été informé de notre présence à Malbackt.
Quelques minutes après qu’il nous eut quittées, un second valet, vêtu celui-là d’une vareuse de drap brun rugueux à gros boutons d’étoffe bariolée de vert et de rouge, vint nous chercher ; et, après nous avoir fait passer par une enfilade de salons plus longs les uns que les autres, il nous introduisit dans le cabinet de sir Evérard.
C’était une large pièce, richement lambrissée, d’un bois de couleur très foncée, que deux hautes fenêtres garnies de rideaux de soie et de velours frangés d’or éclairaient.
Plusieurs bibliothèques, dont les rayons étaient pesamment chargés de livres aux agrafes ciselées, régnaient le long des murs. Entre les deux fenêtres, une table massive en chêne, couverte de papiers épars, de coffrets d’ébène et de tout l’arsenal nécessaire pour écrire, tenait lieu de bureau.
Le baron était confortablement installé dans un large fauteuil auprès d’un feu de bois, qui pétillait joyeusement, dans une très haute cheminée de marbre gris.
En me voyant entrer, il tourna ses yeux vers moi, et, à douze ans de distance, je ressentis sous son regard la même impression d’angoisse que la première fois où je l’avais aperçu dans le cabinet du notaire, à Guingamp.
Je restai debout, près de la porte, n’osant avancer, et Benoise se tint derrière moi, immobile, saisie, je crois bien, d’une crainte égale à la mienne.
Un instant, mon tuteur m’examina en silence.
– Est-ce que je vous fais peur, Marguerite, que vous oubliez de me présenter vos respects ? me dit-il enfin, assez froidement, en français.
Je me raidis et fis un effort pour parler.
– Je vous demande pardon, monsieur, répondis-je d’une voix ferme quoique basse, il y a très longtemps que je ne vous ai vu et je n’étais pas certaine d’être en présence de mon tuteur. Veuillez me permettre de m’informer...
Il m’interrompit assez brusquement :
– Je vous en dispense. Approchez et asseyez-vous ; nous serons mieux pour causer.
Je pris place en face de lui, sur un siège, qu’il m’indiquait de la main et je répondis aux questions qu’il me posa sur mes études et mes connaissances littéraires, sur les personnes que j’avais fréquentées jusqu’à ce jour, sur toute ma vie passée, enfin.
Notre conversation roula sur ces sujets, une heure durant ; après quoi, satisfait probablement de ce que je lui avais appris, il daigna s’apercevoir que je n’étais pas seule et que Benoise attendait, toujours debout, près de la porte.
– Cette femme qui vous accompagne est celle qui vous a élevée, je crois ?
– Oui, c’est ma nourrice.
– Restera-t-elle longtemps ici ?
– Autant de temps qu’il vous plaira, monsieur. Je serais fort heureuse que vous puissiez l’occuper parmi votre personnel : elle consent à ne point me quitter.
– C’est bon ! Qu’elle reste pour le moment ; on verra plus tard si je puis la garder ici...
Je le remerciai vivement de cette faveur, mais il m’interrompit à nouveau, et m’attirant près de la fenêtre, car la nuit était presque venue pendant notre entretien, il se mit à m’examiner encore plus longuement qu’il ne l’avait fait jusque-là.
– Mes compliments ! fit-il à la fin. Vous êtes beaucoup plus jolie que je ne m’y attendais. J’avais gardé de vous le souvenir d’une désagréable fillette et voilà que vous êtes ravissante à présent. J’aime autant ça...
Ce compliment débité sur le ton d’un acheteur soupesant la marchandise qu’on vient de lui adresser m’humilia plutôt qu’il ne me fit plaisir.
– Puis-je me retirer, maintenant ? lui demandai-je alors. Je suis un peu fatiguée de mon long voyage et je voudrais me rafraîchir et me reposer.
– Je vais vous faire conduire dans vos appartements. J’ai fait aménager à votre intention une des tourelles du château, vous y serez complètement chez vous. Je vous ferai servir votre souper, ce soir, dans votre chambre, si vous le désirez.
En parlant, il avait sonné un domestique.
Celui qui m’avait introduite près de lui reparut, et, sur son ordre, me conduisit à une des tours qui formaient les angles du principal corps de logis, comme je l’avais remarqué en voiture.
La tour que j’allais habiter comprenait deux étages reliés au-dehors par un étroit escalier, qui permettait d’entrer et de sortir directement de chez soi sans passer par le château. Cet escalier me parut fort commode pour mon indépendance.
Le premier étage était occupé par un salon assez grand.
Au second, il y avait une chambre et un petit cabinet.
C’est dans cette dernière pièce, prenant jour par une étroite lucarne, qu’on dressa un lit pour ma nourrice afin qu’elle ne fût pas séparée de moi.
L’agencement de ma chambre me plut beaucoup.
Elle était tendue d’étoffes à fleurettes bleues ; un épais tapis couvrait le plancher ; les rideaux du lit et des fenêtres étaient ornés d’une large dentelle blanche, un petit guéridon d’ébène supportait un vase rempli de fleurs naturelles et deux lourds chandeliers d’argent ; enfin, sur la toilette en marbre blanc, se dressait une belle glace de Venise encadrée de filigrane d’argent.
Qu’il y avait loin de ma modeste chambrette du couvent de Saint-Brieuc à l’élégant appartement qui allait être mien à présent ! Et, tout de suite, je sus un gré infini à mon tuteur de m’avoir logée si agréablement.
IV
Mon premier soin en m’éveillant, le lendemain matin, fut d’ouvrir une des étroites fenêtres qui laissaient pénétrer la lumière dans ma chambre et de mettre la tête dehors afin de me rendre compte de l’emplacement exact de la tour que j’occupais.
La vue que je découvris, alors, était admirable et terrible à la fois. Et, machinalement, mon premier mouvement fut, en poussant un cri de surprise, de battre des mains.
Ma chambre s’élevait dans le prolongement des parois du glen, de telle sorte que les arcs-boutants par lesquels les fondements de la tour étaient soutenus semblaient une partie du roc même.
En me penchant un peu, je pouvais apercevoir l’abîme au fond duquel un torrent écumant coulait avec fracas.
De l’autre côté du glen, je voyais en face de moi une longue file de collines boisées, que le soleil levant nimbait de reflets mauves dans le lointain.
Plus à droite, un large plateau couvert d’un gazon velouté s’étendait en pente douce jusqu’à mi-hauteur d’une petite montagne aux flancs revêtus de la pourpre sombre et riche des bruyères.