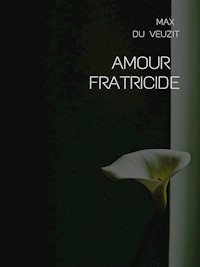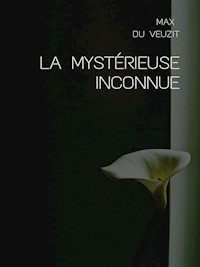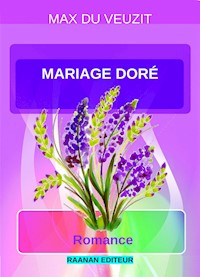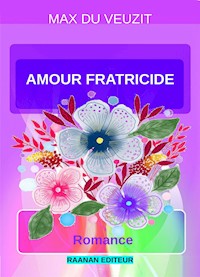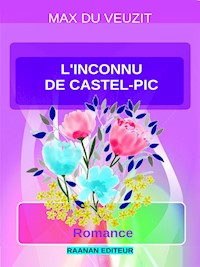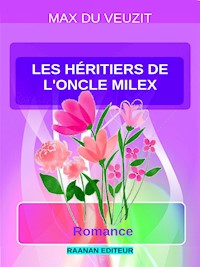
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Raanan Editeur
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Château en Touraine, haras à Maisons-Laffitte, hôtel particulier, yacht, domaine sur la côte d’Azur, tel est le mirifique héritage que l’oncle Milex laisse à sa nièce Mary Stone... si elle épouse son cousin Harrison. C’est une clause du testament. Pour juger son « futur » sans être parée de l’auréole de la « riche héritière » Mary demande à son amie Maryse de se faire passer pour elle. Facile ! L’Américaine et la Française se ressemblent beaucoup. Dès la première rencontre Mary et Maryse d’une part, Daniel et son ami Gérard d’autre part vont tricher. Au cours de la visite en commun de « l’héritage » les quatre jeunes gens se livrent à une sorte de joute amoureuse où chacun use de subterfuges... qui se retourneront contre leurs auteurs. Par son étrange testament, l’oncle Milex voulait sans doute assurer le bonheur de ses héritiers. N’a-t-il pas trop brouillé les cartes ?...|Librairie Jules Tallandier|
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
SOMMAIRE
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
Notes
MAX DU VEUZIT
LES HÉRITIERS
DE L’ONCLE MILEX
Paris, J. Tallandier, 1938
Raanan Éditeur
Livre 1038 | édition 1
Les héritiers de l’oncle Milex
I
La lettre qui est arrivée, aujourd’hui, pour Mary Stone, ma chère petite compagne américaine, menace de nous jeter, elle et moi, en pleine aventure ; et je sens le besoin, ce soir, de me recueillir, de me tâter plutôt, si je puis employer ce verbe à son sens complètement figuré.
C’est que, depuis quelques mois, je me laisse vivre, un peu au gré du hasard et sans chercher à interrompre le fil des menus événements qui me ballottent çà et là, selon le caprice de Mary.
Cette fois, la chose est d’importance !
Vais-je, oui ou non, accepter de suivre en France ma bouillante compagne ?
Irai-je jouer, à ses côtés, à Paris, le singulier rôle qu’elle me réserve ?
Ne vais-je pas risquer de compromettre mon repos moral et ma réputation de jeune femme sérieuse et sensée, dans une aventure qui peut tourner à ma confusion ?
D’un autre côté, puis-je refuser mon concours à cette chère Mary qui a l’habitude de toujours compter sur moi ? Ai-je le droit de la laisser se débrouiller seule, en ces circonstances où tout son avenir doit se jouer ?
Questions troublantes qui me harcèlent et que je dois résoudre pratiquement, intelligemment.
Donc, résumons d’abord les années passées qui ont amené pour moi ce terrible problème.
Tâtons-nous...
Je suis née en France où j’ai habité jusqu’à l’âge de dix-huit ans. J’en ai vingt-sept aujourd’hui, ce qui fait neuf ans que je suis à New York et que je n’ai pas quitté Mary.
Neuf ans ! C’est un bail d’amitié et d’accoutumance, ça ! Réellement. Mary a le droit de compter sur moi. Mais n’anticipons pas.
J’achevais, à Versailles, mes études au moment où la guerre finissait. Il y avait déjà six ans que j’étais entrée au couvent de Sainte-Clotilde et, bien que je m’y plusse réellement, je fus enchantée quand mon père, André des Roches, m’écrivit du front que c’était ma dernière année d’internat et que j’irai vivre auprès de lui, aussitôt les hostilités finies.
Il comptait reprendre ses chers travaux de chimiste dans un laboratoire parisien, dès qu’il serait libéré, et j’attendais impatiemment le moment de le rejoindre.
J’avais eu le grand bonheur, en cette atroce guerre, où tant de sang généreux avait coulé, de voir mon père bien-aimé revenir sain et sauf, n’ayant récolté, heureusement, durant ces quatre années sanglantes, que deux blessures légères.
La destinée, qui jusqu’ici m’avait paru favorable, s’appesantit soudain impitoyablement sur mes frêles épaules : mon père, que le feu avait épargné si miraculeusement, fut une des premières victimes de l’épidémie de grippe qui s’abattit soudain sur l’Europe épuisée. Il mourut solitaire, au fond d’un quelconque hôpital de province.
Ma douleur fut atroce. Elle n’eut, comme pendant, que la détresse matérielle où cette mort me laissa.
J’étais orpheline, sans fortune, et fille d’un soldat mort de maladie... La patrie, saignée à blanc par tant d’infortunes à secourir, ne pouvait rien pour moi.
En ces jours néfastes où je me demandais ce que j’allais devenir, seule au monde – ma mère étant morte lorsque j’atteignais ma douzième année – et sans expérience, le ciel permit qu’un ami de mon père, un Américain répondant au nom de Jack Stone, me tendît une main secourable.
Venu en France pour assurer le ravitaillement de l’armée kaki d’outre-Atlantique, il allait repartir, la guerre achevée, pour son pays, où sa fille Mary l’attendait.
Généreusement, en l’honneur de son ami André des Roches, – c’était le nom de mon père, – que Jack Stone avait tout particulièrement connu et estimé, il m’offrit de m’emmener avec lui. Sa fille avait treize ans, je l’aiderais à parfaire son instruction en étant à la fois, pour elle, son institutrice, sa gouvernante et sa demoiselle de compagnie.
J’acceptai avec reconnaissance.
L’Américain se hâta donc de faire régler ma situation d’enfant mineure et, comme je ne possédais pour tout bien qu’une petite propriété venant de ma mère, à Villennes, sur les bords de la Seine, louée douze cents francs par an à un locataire épris de canotage et de yachting, mes affaires furent vite en ordre.
Moins de quinze jours après, je m’embarquai avec lui pour l’Amérique.
Une vie toute nouvelle commença pour moi à New York.
Mary Stone, qui avait perdu sa mère, peu d’années après sa naissance, était une élève moyenne, ni trop studieuse ni trop turbulente.
Elle se montrait affectueuse et exubérante, deux qualités qui lui gagnèrent tout de suite mon affection.
Très gâtée par son père qui l’adorait et par une grand-mère pour qui elle était la seule raison de vivre, elle eût pu se montrer insupportable et égoïste. Il n’en fut rien. Elle se contentait d’être parfois un peu trop volontaire et le plus souvent d’une insouciance frisant l’inconscience.
Hormis ces deux défauts qui, parfois, atteignaient chez elle le caractère de deux qualités, elle fut réellement aimable et charmante à souhait. Auprès d’elle, en vérité, ma vie s’établit sans heurt et assez agréablement ; j’étais délivrée de tous soucis matériels et l’ambiance était amicale.
――
Mary venait d’atteindre sa vingtième année quand sa grand-mère mourut.
Ma jeune compagne eut un réel chagrin de cette mort et je partageai sa peine avec sincérité, car cette vieille dame s’était toujours montrée très bonne pour la pauvre orpheline que j’étais, exilée si loin du nid.
À cette époque se place pour moi un grand événement.
M. Jack Stone, le père de Mary, était alors âgé de cinquante-cinq ans. C’était un homme très actif et très occupé. Pris du matin au soir par ses affaires, il était plus souvent à son bureau qu’à la maison, avec nous.
Jusqu’ici, il m’avait toujours traitée avec une correction amicale, mais un peu distante. J’étais la gouvernante de sa fille, l’enfant d’un ami disparu ; rien ne laissait paraître qu’il eût eu jamais une autre pensée à mon sujet.
Cependant, la mort de sa belle-mère parut rapprocher l’Américain de notre groupe endeuillé.
Il devint soudain plus empressé et plus confiant avec moi. Si bien que peu de temps après le décès de la vieille dame, et alors que Mary portait encore le grand deuil, Jack Stone m’offrit de devenir sa femme et de partager sa vie.
J’eus l’involontaire hésitation des femmes très jeunes qu’un homme à cheveux blancs recherche.
J’avais vingt-cinq ans et n’avais jamais envisagé la possibilité de me marier en Amérique. D’autre part, était-il sage de m’enfermer dans les liens du mariage avec un homme qui avait le même âge qu’aurait eu mon père s’il avait vécu ?
Je me demandais aussi ce que penserait Mary d’un tel projet. N’allais-je pas m’aliéner l’affection qu’elle me portait en acceptant la proposition de son père ? Cette crainte me décourageait, car je n’étais pas certaine de posséder les qualités requises pour faire une belle-mère acceptable.
Ce fut ma petite compagne qui enleva toutes mes hésitations.
Contrairement à ce que je redoutais, Mary se réjouissait sincèrement des projets de son père, et elle ne souhaitait qu’une chose, c’est que ma réponse y fût favorable. Elle eut tant de belles raisons à me fournir à ce sujet, que je donnai mon acquiescement et que Jack Stone me passa au doigt l’anneau des fiançailles.
Nous nous connaissions de longue date, lui et moi ; point n’était besoin de faire traîner les préliminaires de cette union. Mary réclama seulement un délai de quelques semaines, afin de pouvoir quitter ses noirs atours pour assister en toilette claire à la cérémonie intime que nous prévoyions.
J’acceptai facilement ce délai dont ma pudeur s’arrangeait. M. Stone en fut moins satisfait : à son âge, les jours qui fuient ont une valeur insoupçonnée des gens plus jeunes.
Il était écrit que, de même que sept ans auparavant, je n’atteindrais pas, cette fois encore, le bonheur tranquille que tout paraissait m’attribuer : un affreux accident d’automobile, où sa voiture fut réduite en miettes, blessa si grièvement Jack Stone, qu’il mourut en moins de quarante-huit heures.
Le malheureux avait survécu assez à ses blessures pour voir sa fille et moi en larmes à son chevet.
Et, prévoyant que, lui parti, la vie pouvait nous séparer et laisser Mary sans protection, il me demanda d’accepter qu’un prêtre vînt, in extremis, bénir notre union, afin que mon avenir fût assuré et que sa fille pût trouver en moi une protectrice légale.
Pour le tranquilliser, j’acceptai son offre sans hésiter. Je m’étais d’ailleurs habituée à l’idée de devenir sa femme et sa demande parut toute naturelle, puisque je considérais mon sort comme déjà lié au sien.
J’affirme ici que, dans ma pensée, il n’y eut alors aucune question d’amour-propre, ni aucun calcul d’intérêt.
J’acceptai tout simplement, parce que la chose me parut normale puisque j’étais déjà sa fiancée, parce que je le sentais inquiet et malheureux du sort de son enfant ; enfin, parce qu’il m’était doux de le rassurer en un moment pareil. La pensée de Mary me guidait aussi. Elle pleurait, et je la voyais orpheline et seule comme je l’avais été moi-même ; pouvais-je refuser de lui donner l’appui légal que son père réclamait pour elle ?
J’ajoute également qu’en acceptant de devenir la femme du moribond, j’eus l’impression de m’acquitter envers Mary de la dette contractée, sept ans auparavant, vis-à-vis de son père.
Ce n’est que quelques jours après le décès de Jack Stone et lorsque les hommes d’affaires s’occupèrent de régler la succession, que je compris seulement tous les avantages que j’allais tirer de ce mariage. C’est ainsi que j’appris qu’avant de mourir le père de Mary avait trouvé la force, dans son amour paternel et dans son affection pour moi, de régler nos situations respectives. Toute sa fortune passait naturellement à sa fille unique ; mais Jack Stone en avait distrait une petite partie qui était devenue mon avoir personnel.
En dehors de ce legs, il s’était arrangé pour que Mary me versât régulièrement une rente annuelle, nos intérêts, à elle et à moi, devant rester communs, de telle sorte que ni elle ni moi ne pouvions nous isoler ou nous ignorer.
Elle ne pouvait se passer de mon concours et, à moins de renoncer à tous les avantages qui m’étaient acquis, il m’était impossible de lui refuser l’appui de mes conseils et de mon dévouement.
Contrairement à mon attente, cette clause singulière fit plaisir à Mary.
– Tant mieux, fit-elle, je suis assurée de ne jamais vous perdre. Et, puisque d’une part nos intérêts sont communs, et que, d’autre part, vous êtes trop jeune pour pouvoir exiger de moi le respect dû à une belle-mère, nous allons vivre toutes les deux comme deux sœurs, âgées respectivement de vingt et de vingt-cinq ans.
Et il en fut ainsi. Dans le grand vide que la mort de Jack Stone créait autour de nous, nous ne songeâmes, toutes les deux, qu’à nous rapprocher et à nous soutenir mutuellement.
Notre intimité devint même très douce et très affectueuse. Deux sœurs n’auraient pas pu être plus unies ni s’aimer davantage. Nous prîmes l’habitude de nous habiller pareillement, de jouir des mêmes distractions, et de fréquenter les mêmes amies ou les mêmes lieux de plaisir.
Les gens s’habituèrent si bien à nous voir toujours ensemble, qu’on ne nous appelait plus que les sœurs Stone.
Et c’était la grande joie de Mary quand quelque vieille dame, trompée par nos vêtements semblables et nos allures identiques, affirmait que nous nous ressemblions si fort que, sans les cheveux blonds de Mary et la toison châtaine qui couronnait ma tête, il eût été difficile de nous différencier.
La vérité, c’est que nous sommes de la même taille élancée, toutes les deux ; mais Mary est plus musclée que moi. Elle a une forte carrure, une poitrine plate et des membres épais. Moi, au contraire, je parais plus frêle, plus délicate, alors que je suis tout en chair, avec des épaules rondes, des seins bien fermes, des hanches marquées et des mollets bien pris, malgré mes extrémités plutôt petites.
Pour un œil exercé, Mary est réellement un beau spécimen de femme sportive et solide, alors que je personnifie la fausse maigre française, telle que nos dessinateurs parisiens aiment à la représenter.
――
Depuis vingt mois que Jack Stone est mort, Mary et moi avons vécu en complète intimité et dans un accord parfait qu’aucun nuage n’a troublé. Nous avons beaucoup voyagé, promenant nos inséparables silhouettes dans toutes les grandes villes de l’Amérique du Nord.
Ces randonnées ont fortifié notre mutuelle confiance l’une dans l’autre, en même temps qu’elles estompaient un peu l’amertume de notre deuil. Le temps, en passant, n’émousse-t-il pas tous les sentiments ?
Peu à peu, Mary a séché ses larmes d’orpheline et, moi, celles que me faisait verser la pensée de l’ami très cher dont la mort m’a trop vite séparée.
Et voici que, revenues à New York depuis peu, ayant repris une vie plus calme, plus ordonnée, une lettre de France est arrivée, ce matin même, pour troubler notre bonne quiétude et nous entraîner vers je ne sais quelle singulière aventure.
――
Voyons, comment cela a-t-il commencé exactement, ce matin ?
J’achevais de déjeuner dans la salle à manger, quand Mary est entrée.
– Maryse ! Maryse ! criait-elle. Devinez quelle singulière lettre je reçois à l’instant ?
Maryse, c’est moi.
Maryse des Roches est bien le nom que j’ai porté jusqu’à vingt-cinq ans. Depuis que Jack Stone, à son lit de mort, m’a donné son nom, je suis devenue Maryse Stone.
Maryse et sa belle-fille Mary forment en vérité une seule raison sociale : Maryse et Mary Stone...
Ce rapprochement de nos deux prénoms n’est pas sans donner un certain charme aux liens affectueux qui nous unissent, ma compagne et moi. Sur les registres des hôtels où nous descendons en voyage, cela fait bel effet :
« Maryse et Mary Stone ! »
Cela sonne bien aussi aux oreilles quand on nous annonce à la porte d’un salon.
Donc, ce matin, Mary est entrée dans la salle à manger quand je finissais de déjeuner.
Elle brandissait une large enveloppe blanche que des cachets rouges marquaient au verso.
– Devinez ! répéta-t-elle.
– Une lettre chargée, remarquai-je. C’est de l’argent qui vous arrive ?
– Vous y êtes presque !
– J’en ai d’autant plus de mérite que j’ignorais que vous eussiez des intérêts en France, observai-je.
Mais elle secoua la tête.
– Jusqu’ici, je n’avais pas. Maintenant, je vais avoir.
– Et comment cela ?
– Mon oncle est mort !
Sa figure transfigurée de joie à l’annonce de ce deuil détonnait un peu. Ce n’est pas dans nos habitudes, en France, d’annoncer si joyeusement un décès, et jusqu’ici, il ne m’a pas paru que ce fût de mise, non plus, en Amérique.
Malgré moi, une ombre avait passé sur mon visage, et mon sourire s’était voilé un instant. Instinctivement, ma compassion allait à l’orpheline qu’un nouveau malheur allait assombrir.
– Ma petite Mary, je suis navrée de cette mauvaise nouvelle.
– No, fit-elle tranquillement en secouant la tête. Ce n’est pas précisément une mauvaise nouvelle, puisque j’hérite !
Comme, involontairement, j’avais eu un geste de protestation, elle dit vivement :
– D’abord, je ne connaissais pas cet oncle, et si le notaire français ne donnait pas beaucoup de détails, je ne saurais pas, au juste, quels liens me rattachent à ce lointain parent, parti pour l’autre monde.
Je souris devant son sens pratique. Réellement, elle ne peut s’affecter de la mort d’une personne qu’elle n’a jamais vue. En revanche, la logique veut qu’elle soit enchantée d’un héritage inattendu.
– Je garde donc pour une autre occasion toutes les condoléances que je croyais devoir vous présenter aujourd’hui.
– Yes ! gardez, gardez... cette chose très triste, très regrettable, ne me touche que subjectivement. Maintenant, il faut que vous aidiez moi à comprendre...
– Comprendre quoi ?
– Le parent... le degré de cousinage, vous dites en France.
– Il est donc si compliqué ?
– Beaucoup plus que vous ne l’imaginez, ma chère Maryse... Ainsi, je lis... c’était le demi-frère de ma mère... Il y a aussi un autre héritier qui est mon cousin... sans être mon parent...
– Diable ! c’est confus ! Le notaire n’explique pas mieux ?
– Oh ! si ! Il met des noms... des tas de noms ! Mais ça embrouille plus encore cette affaire... Tenez, Maryse, lisez vous-même et expliquez...
Elle s’assied à table, devant moi, et pendant que je parcours la lettre qu’elle vient de recevoir, je la vois attirer la chocolatière et se verser un grand bol du bouillant liquide.
– Les émotions creusent ! fais-je remarquer en souriant.
– Yes, ce doit être ! J’ai une faim formidable ce matin... Maryse chérie, lisez vite, pour faire comprendre à moi ?
J’ai repris ma lecture et, au bout de cinq minutes, je puis lui expliquer ce qu’elle désire.
– Ce notaire précise d’abord vos noms et prénoms...
« Mary Nancy Stone, fille de Jack Stone et de Maddy Milex, son épouse... tous deux décédés... »
– Oh ! ça je sais !
– Ensuite, cette lettre rappelle que votre mère Maddy Milex était née d’un second mariage de votre grand-père, Horace Milex. On ajoute que votre aïeul, d’une première union avec une Française, nommée Henriette Manceau, avait un fils, Pierre Milex, qui est l’oncle que vous venez de perdre.
– Ah ! très bien... Vous expliquez lumineusement, Maryse. Et ceci évoque à mes souvenirs tout ce que mon cher papa disait de ce frère demi-sanguin de ma pauvre maman, morte si jeune.
– Alors, vous voici en pays de connaissance, puisque M. Stone vous a parlé quelquefois de votre oncle Pierre Milex.
– Oui, parlé !... très sommairement.
– Enfin, vous n’ignorez pas qui il était.
– Évidemment, je sais un peu !... Mais pas joli, joli ! C’était un très original garçon... méfiant beaucoup !
Mon regard interrogea Mary.
– Oui, expliqua-t-elle. Par crainte d’être épousé pour son argent, il n’a jamais voulu prendre femme. Et je crois me rappeler que mon père disait de lui qu’il était capable de faire mille folies, toutes plus absurdes les unes que les autres.
J’approuvai de la tête.
– Ce que vous me dites là est assez vraisemblable, observai-je. Si j’en juge par le singulier testament qu’il semble avoir dicté au notaire, avant de mourir, votre oncle ne manquait pas d’humour... Vous avez lu, Mary, les conditions imposées à l’héritière que vous êtes ?
– J’ai lu, mais expliquez encore, Marysette. Mon pauvre tête a superbement de mal à comprendre.
J’ai eu un léger froncement de sourcils devant ce masculin intempestif et cet adverbe audacieusement accouplés.
Depuis neuf ans que je n’ai pas quitté Mary Stone, elle devrait parler un français irréprochable, et je reste journellement confondue devant les erreurs qu’elle commet.
Elle a surpris ma grimace, car elle allonge le bras vers moi et pose sa main sur la mienne :
– Ne vous fâchez pas, Maryse. Maintenant que j’aurai terres et châteaux en France, je prendrai l’accent du terroir gaulois, pendant que vous, vieille citoyenne de New York, vous finirez par devenir une vraie Américaine... une...
Elle s’arrête subitement, comme si une image intérieure faisait chavirer son langage.
– Ah ! oh ! Très drôle, le boum de mon pensée... Très magnifiquement original...
Puis elle réfléchit quelques instants, et, tout à coup, sa physionomie s’éclaire d’une lueur malicieuse. Je la vois donner des signes évidents d’une jubilation intérieure que je ne puis comprendre.
– Expliquez encore, Maryse !... Vite, vite, qu’est-ce qu’il raconte, le monsieur d’affaires français ?
– On dit un homme d’affaires...
– Yes, un homme ! Expliquez vite, chérie ? J’ai une idée.
– Je me méfie beaucoup des idées qui vous viennent si joyeusement, fais-je observer, un peu taquine.
– Oh ! Maryse ! Cette fois vous approuverez tout à fait.
– Enfin, nous verrons !
De nouveau, je reprends la missive de France, pour poursuivre l’explication de cette fameuse lettre.
– J’ouvre les portes de mon cerveau, pour bien accueillir vos paroles.
D’un coup d’œil, j’ai parcouru la dernière partie de la communication du notaire.
– Voilà... La fortune de votre oncle consiste en valeurs immobilières dans sa plus grande partie... un hôtel à Paris, un château en Touraine et une jolie propriété à Nice. Il y a encore un yacht, amarré au Havre, et une écurie de courses à Maisons-Laffitte.
– Chic ! J’adore toutes ces chères vieilles choses françaises !
– Oui, évidemment, ça fait toujours plaisir, bien que la fortune que vous a laissée votre père soit assez coquette pour vous permettre de satisfaire tous vos caprices... même l’écurie et le bateau.
– Oh ! Yes ! Je sais ! Je suis riche !... Mais c’est si amusant d’hériter d’un château, d’un hôtel et d’une propriété avec lesquels il faut faire connaissance. C’est le plaisir de la visite des lieux qui est délicieusement high life.
– En effet, cela doit être charmant d’arriver en héritière dans une maison inconnue... Malheureusement, en cette affaire, il y a un autre héritier.
– Hélas ! gémit-elle. J’ai vu ! Un parent qui est mon cousin sans l’être... Aussi expliquez, Maryse, comment une pareille abomination peut se concevoir.
– Oh ! d’une façon très simple. Votre grand-père, Horace Milex, avait épousé en premières noces une veuve qui possédait un grand fils déjà. Ce jeune homme, qui répondait au nom de Jean Harrisson, était donc le demi-frère de Pierre Milex. Or, cet Harrisson a eu aussi un fils, Daniel... Et c’est ce Daniel Harrisson qui, comme vous, et au même titre, hérite de son oncle, Pierre Milex.
– Vous comprenez bien cela, Maryse ?
– Oh ! très bien, affirmai-je.
– Alors, tant mieux ! Je vous crois sur parole, car il est très fatigant à suivre la parenté demi-sang.