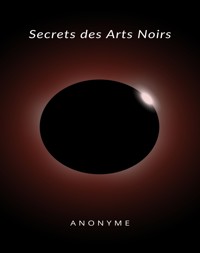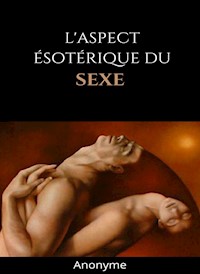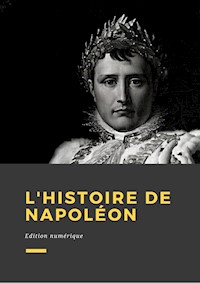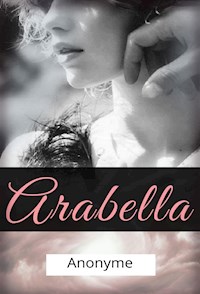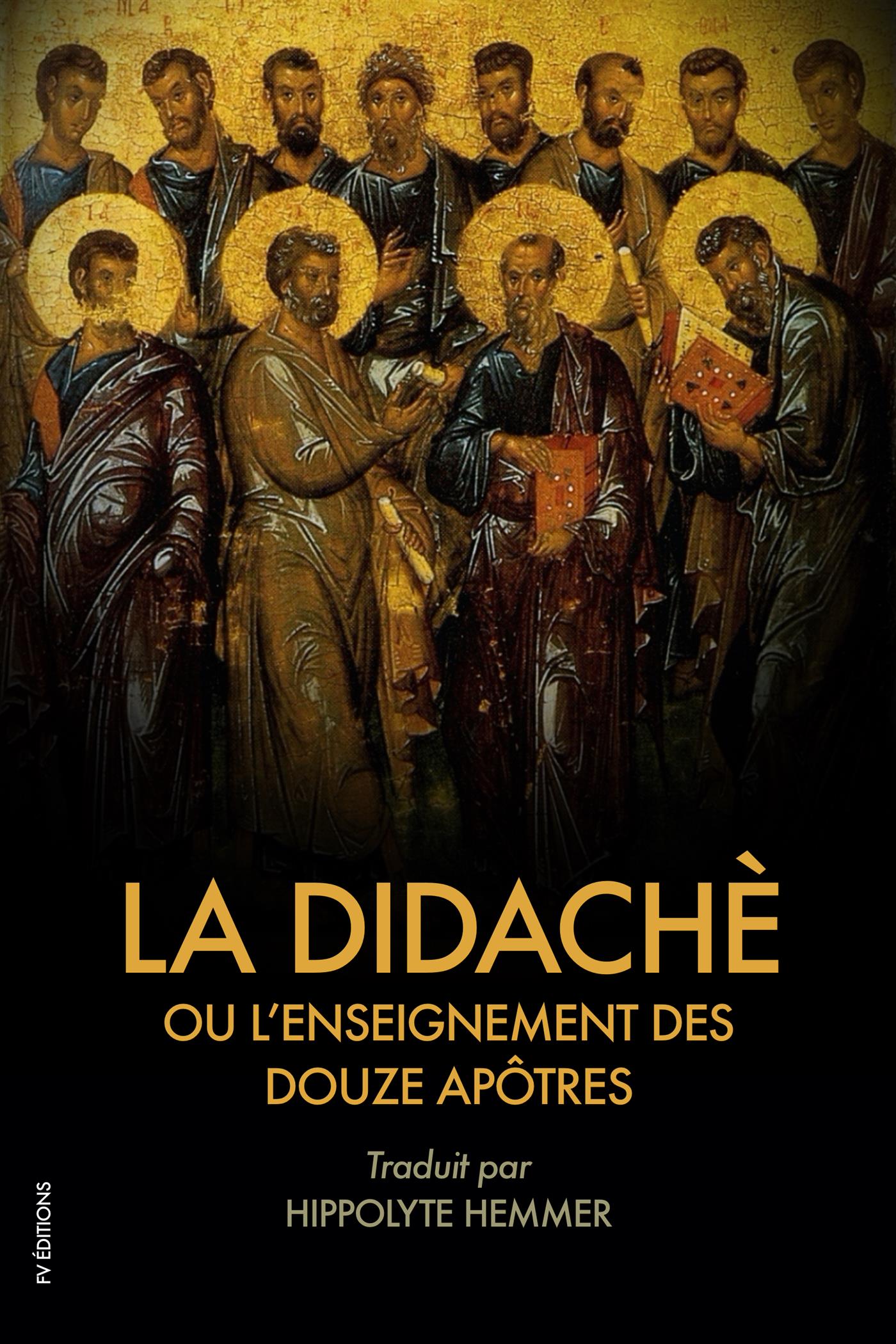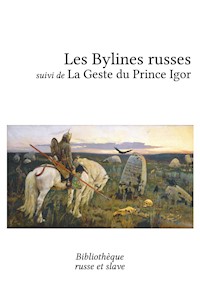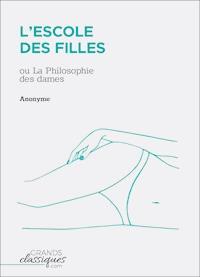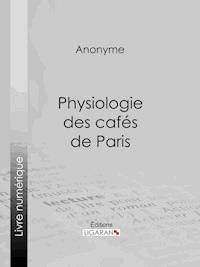Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Lettres bourguignonnes est un livre fascinant qui nous plonge au cœur de la Bourgogne du XVIIIe siècle. Écrit par un auteur anonyme, cet ouvrage nous offre une perspective unique sur la vie quotidienne, les coutumes et les intrigues de cette région emblématique de la France.À travers une série de lettres, l'auteur nous dévoile les pensées intimes et les anecdotes captivantes de différents personnages bourguignons. Des nobles aux paysans, en passant par les artisans et les commerçants, chaque lettre nous transporte dans un univers riche en diversité sociale et culturelle.L'auteur anonyme nous offre également un regard critique sur la société de l'époque, dénonçant les inégalités, les injustices et les privilèges de la noblesse. Les lettres bourguignonnes sont ainsi un témoignage précieux de l'histoire sociale et politique de la Bourgogne au XVIIIe siècle.Mais au-delà de son aspect historique, ce livre est avant tout une véritable immersion dans la vie bourguignonne. Les descriptions des paysages, des fêtes populaires et des spécialités culinaires nous transportent littéralement dans cette région empreinte de traditions et de convivialité.Lettres bourguignonnes est un ouvrage à la fois divertissant et instructif, qui nous permet de découvrir la Bourgogne sous un angle inédit. Que vous soyez passionné d'histoire, amateur de littérature épistolaire ou simplement curieux de plonger dans l'atmosphère unique de cette région, ce livre saura vous captiver et vous émerveiller.
Extrait : "Mon ami, je suis à Paris depuis quatre jours. Je me porte bien, et mon domicile est sur la place des Victoires, n° 20. Il y a ici beaucoup de monde, beaucoup de voitures et beaucoup de bruit. Je cours du matin au soir, je suis étourdi, fatigué. Adieu, je vais me coucher. Dans une autre lettre je t'en dirai davantage."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 152
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Je vous rends votre livre, monsieur, il ne vaut rien.
Et pourquoi ?
Les tableaux sont outrés, le style dur, incorrect, point d’invention, point d’intrigue.
Que voulez-vous, les lettres sont telles que je les ai reçues, il ne m’était pas permis de rien changer.
Alors il ne fallait pas les publier. Mais dois-je ajouter foi à vos discours. Ces lettres ont-elles jamais été écrites autre part que dans votre livre ?
Je m’en tiens à ce que je vous ai dit ; que vous me croyiez ou non, la chose m’est indifférente.
L’histoire du cimetière du Père-La-chaise serait intéressante, si l’on pouvait y croire.
Je puis vous assurer que rien n’est plus vrai, demandez plutôt à M. de Chauvelin, il a vu le héros de cette histoire.
CHARLES À ÉDOUARD
Paris, 15 février 1819.
Mon ami, je suis à Paris depuis quatre jours. Je me porte bien, et mon domicile est sur la place des Victoires, n° 20.
Il y a ici beaucoup de monde, beaucoup de voitures et beaucoup de bruit. Je cours du matin au soir, je suis étourdi, fatigué. Adieu, je vais me coucher. Dans une autre lettre je t’en dirai davantage.
En me répondant, n’oublie pas de me rapporter les discours qu’on tient là-bas sur mon voyage.
Ton véritable ami.
CHARLES À SA MÈRE
Paris, 15 février 1829.
Calmez votre inquiétude, ô ma bonne mère, votre fils jouit d’une excellente santé, et au milieu de huit cent mille âmes, des plaisirs et des jouissances de toute espèce, il s’occupe de vous : je vous envoie le portrait de madame de Lavalette, de cette femme que vous admirez justement. Quant à ma charmante sœur, pour obtenir mon pardon de tous les petits traits que je lui ai faits, je lui envoie un chapeau et une robe dans le dernier genre.
Les femmes, ici, ma mère, ne vous ressemblent pas ; elles ont une bien mauvaise réputation : leur grande affaire est de briller, et pour y parvenir, dit-on elles emploient des moyens que peu de nos provinciales connaissent encore, mais patience, elles en viendront là ; Paris n’est-il pas le centre de la civilisation et du bon goût ?
Ô ma mère, quand je me rappelle vos leçons et vos exemples, quand je me souviens que, jeune encore, vous avez renoncé aux charmes d’une nouvelle union, pour rester fidèle à votre époux, et pour ne pas compromettre les intérêts de vos enfants, je suis saisi d’indignation en voyant ces mœurs. Gardez-vous bien d’amener Julie à Paris ; ce lieu ne lui convient pas ; il faut pour voir de sang-froid tous ces objets de damnation, plus de force et plus de raison que n’en comporte la tête d’une jeune fille.
Adieu, vous et ma sœur, je vous embrasse mille fois.
CHARLES À ÉDOUARD
Paris, le 21 février 1829.
Mon cher Édouard,
Je t’ai promis des détails sur la capitale, je tiens ma parole, les voici :
Pour le service de leurs chambres, les Parisiens ne veulent point de femmes ; ils prétendent que ces demoiselles volent le vin et l’argent de leurs maîtres pour entretenir leurs amants ; cela peut être vrai, mais en dépit de ce danger que l’on court d’ailleurs avec les domestiques des deux sexes, je ne veux point de valets, car je ne vois rien de si méprisable que ces hommes qui n’ont d’autres occupations que de brosser, peigner, baigner et coucher leurs maîtres ; laissons ces soins aux femmes qui sont nées, comme dit l’Écriture Sainte, pour nous servir et nous récréer.
Je suis allé voir le Palais-Royal, le Louvre, les Tuileries, les Champs-Élysées : tout est beau, tout est magnifique, mais je ne suis ni architecte, ni peintre, ni même amateur. Je tourne autour, je regarde, je ne sens rien et je m’en vais.
Il n’en a pas été ainsi au pied de la colonne Vendôme ; je n’ai fait attention sans doute, ni à son élévation, ni aux difficultés qu’il a fallu vaincre pour la construire, mais j’ai senti ma poitrine oppressée délicieusement en pensant aux faits d’armes et aux victoires qu’elle nous rappelle. France, jadis la reine du monde, ces Autrichiens, que tes guerriers ont mille fois dispersés comme un vil troupeau, ces Cosaques du Don, qui fuyaient épouvantés devant, le panache de Murat, sont venus armés au pied de cette colonne, ils ont renversé la statue du héros à qui tu dois ta gloire, ils nous ont dicté de honteuses lois ! Étais-tu donc réservée pour tant d’humiliation !
Mais attendons l’heure de la vengeance pourra peut-être sonner un jour. Voilà, mon ami, les objets qui, seuls, excitent mon enthousiasme : qu’un autre aille au Louvre admirer des portiques ou la souplesse des courtisans, qu’il se précipite avec la foule pour entendre St-Megrin débiter des niaiseries, à la bonne heure, j’y consens. Quant à moi, il ne me faut que des souvenirs.
Ton ami dévoué.
CHARLES AU MÊME
Paris, 25 février 1829.
Tu m’as laissé, mon cher Édouard, autant que je puis me rappeler, au pied de la colonne Vendôme, déplorant amèrement contre le destin qui a voulu que nous subissions l’infamie d’une invasion : aujourd’hui, c’est bien un autre spectacle, tu vas me retrouver aux pieds d’un fashionable : mais qu’est-ce qu’un fashionable, me diras-tu ; attends un instant, je vais te le dire.
Hier, comme je désirais aller aux Invalides, je m’adressai, pour savoir mon chemin, à un jeune homme brillant de toilette, que je voyais étendu dans unmagnifique cabriolet ; mais lui, ne me répondit rien. Je renouvelai ma question ; même silence. Piqué alors de ce sot orgueil, je lui dis avec humeur : Eh ! monsieur l’élégant, faites donc attention, je vous parle.
– Vous m’ennuyez, me répondit-il.
– Je vous ennuie… Parbleu, vous êtes un drôle, un faquin… Il avait disparu.
Furieux d’une pareille insolence, et dans l’intention d’en tirer vengeance, je m’informai auprès d’un individu, qui avait été témoin de la scène, quel pouvait être le jeune homme.
– C’est un fashionable, me dit-il.
– Qu’est-ce qu’un fashionable ? (Tu vois, je fis ta question.)
– Un fashionable, monsieur, est un jeune parisien qui n’a aucune des qualités du cœur ni de l’esprit, qui, depuis sa sortie du collège, au lieu d’achever son éducation par des études et des méditations, n’a pensé qu’à sa toilette et à faire la cour aux femmes ; mais malheureusement comme il est sot, sans goût et dépourvu de sentiments, sa toilette a toujours été ridicule, et il ne s’est attaché qu’à des femmes qui sont l’écume des salons ; c’est-à-dire aux étourdies, aux coquettes et aux galantes.
– Quel bizarre portrait me faites-vous là !
– Il est vrai ; mais écoutez : Un fashionable a une telle admiration pour les femmes qu’il les imite et les copie en tout. Comme elles, il porte un corset ; comme elles, il cherche à se donner une fine taille. N’avez-vous pas remarqué la forme de son habit et de son gilet ? Ne voyez-vous pas qu’ils sont taillés à dessein de faire ressortir ses hanches et de donner du volume à ses fesses ? La nuit il met des papillotes, il couche avec un petit chien, il a des vapeurs, sa santé est délicate, et si vous lui parlez de Milhaut qui, à Waterloo, comme le remarque Norvins, décimait les rangs anglais, avec la main de fer de ses cuirassiers, il s’écrie : « Ah ! quelle horreur !… du sang !… John, John, mon flacon. »
Actuellement avez-vous encore envie de vous fâcher contre lui ?
– Non vraiment, je le méprise trop.
– Vous êtes étranger, à ce que je vois ? En ce cas, écoutez bien ce conseil ; quand vous voudrez obtenir quelques renseignements, adressez-vous aux marchands, aux artisans, aux ouvriers enfin : plus bas c’est de la canaille ; plus haut c’est de l’orgueil et de l’égoïsme (à part les exceptions). Les extrêmes se touchent quelquefois.
Là-dessus il m’indiqua mon chemin, me salua et disparut.
J’enfilai la rue qu’il m’avait indiquée, et tout en m’acheminant vers l’hôtel des Invalides, je répétais en moi-même, voilà ma foi un brave homme.
À une autre fois, mon ami. Je t’embrasse.
JULIE À SON FRÈRE
Beaune, le 14 mars 1829.
Mon aimable frère, oh ! comme je t’aime ! Un beau chapeau, une robe de Paris : que d’envieuses j’ai faites au bal ! mais sais-tu qu’elle me va bien ma robe ? Je l’ai mise déjà plusieurs fois, et maman m’a grondée ; elle dit que je suis une petite coquette, c’est cependant bien vilain d’être coquette : vas, mon frère, je ne suis point ingrate, quand tu seras ici, je te donnerai mon perroquet que j’aime bien, car il parle comme moi : ce méchant Édouard dit que c’est moi qui parle comme lui.
Puisque tu es si aimable, il faut que tu me fasses encore un plaisir ; écoute, tu vas voir. Maman craint que tu ne restes trop longtemps à Paris, elle s’ennuie loin de toi et moi aussi, mon frère ; elle parle de t’aller chercher sur la fin du mois : eh bien ! au lieu de l’empêcher de partir, écris-lui une lettre pour l’engager à faire ce voyage, car vois-tu, moi, j’irai avec elle : oh ! comme je t’aurai obligation ! oh ! comme je t’aimerai ! C’est qu’on dit cette ville si belle, si délicieuse ; et puis, Charles, j’aurai le plaisir de te voir et de t’embrasser. Tu feras ce que je te demande, n’est-il pas vrai ? Allons, je compte là-dessus.
Il n’y a plus de fête à Beaune. Tout le monde est en prière, excepté les jeunes gens, mais dans peu il faudra bien aussi qu’ils aillent à l’église, car mon oncle Valsain m’a dit que, dans quatre jours, nous aurions des missionnaires. Heureusement qu’ils viennent pendant le carême ; voyez donc, s’ils fussent venus pendant le carnaval !…
Émilie se marie avec M. Louis, après Pâques, je serai de la noce ; Achille, qui vient de l’école Saint-Cyr, qui a un bel habit d’uniforme, m’a demandé pour sa fille d’honneur. Ah ! mon Dieu ! pourvu que les missionnaires soient partis.
Adieu, mon aimable frère, je t’embrasse et je t’aime bien ; maman t’écrit aussi, je n’ai pas voulu lui montrer ma lettre.
ÉDOUARD À CHARLES
Beaune, le 10 mars 1829.
J’ai reçu tes lettres, mon brave ami, elles m’ont fait plaisir, et je t’en remercie. Tout le monde se porte bien ici, et tes amis seraient heureux, si tu étais parmi eux, mais comme tu me l’as dit cent fois, il faut que tu voyages.
Quant aux discours qu’on tient à Beaune sur ton compte, ils sont de plusieurs façons. Commençons d’abord par diviser les discoureurs en deux classes, tes amis et tes ennemis.
Parmi les premiers, les uns disent que tu as tort de courir ainsi le monde, que tu ferais mieux de travailler et dépenser à ton état ; qu’il faut une occupation à l’homme, quelle que soit d’ailleurs sa fortune. D’autres soutiennent au contraire que tu as bien fait de jeter ta robe d’avocat aux orties ; que cette profession n’est bonne que pour quelques privilégiés, mais que, pour le reste, c’est un métier où l’on ne gagne pas le pain qu’on mange, excepté qu’on ne soit disposé à solliciter auprès des avoués et leur faire maintes courbettes, ce qui ne convient pas à un honnête homme. D’autres, enfin, ne considérant le bonheur que dans une parfaite indépendance et dans la possibilité de faire ce qui plaît, gardent le silence, je suis de ces derniers.
Quant à tes ennemis, c’est autre chose. Tu dois bien penser qu’ayant, toute ta vie, maltraité les fripons et les sots orgueilleux, espèce de gens qui pullulent partout, tu ne dois pas être très bien dans l’esprit de ces messieurs : aussi ils t’arrangent joliment : ils affirment que tu n’as quitté ta profession que parce que tu étais trop au-dessous ; ils affirment que tu es allé à Paris pour cacher la honte que t’a imprimée la famille Berger en rejetant ton alliance ; ils te supposent des dettes, ils t’accusent d’être joueur : ils vont plus loin, ils montrent une lettre de la capitale où il est dit que tu sollicites auprès des jésuites une place de juge de paix ou de juge auditeur.
Tes amis ont repoussé ces calomnies suivant leur caractère : Auguste les a traités de menteurs, de cafards et de misérables ; Hector leur a prouvé en trois points combien leurs faits avancés étaient invraisemblables et absurdes : quant à moi, qui ai toujours préféré les actions aux discours, j’ai pris ma cravache et j’ai coupé la figure à deux des plus mutins.
Pour cette action, j’ai été traduit à la police correctionnelle, et malgré la défense d’Hector, j’ai été condamné à 60 francs d’amende et huit jours de prison.
Adieu, loyal Charles, quand il s’agit de nos amis, ne craignons pas les verrous.
CHARLES À ÉDOUARD
Paris, 15 mars 1829.
J’ai lu ta lettre avec une vive émotion, sensible et brave Édouard. Eh quoi ! en prison ! et en prison pour moi, en vérité tu m’enchantes. Je partirais sur-le-champ pour aller partager ta captivité, si au lieu de huit jours tu avais été condamné seulement à quinze ; mais en considérant la date de la condamnation et le jour de mon arrivée, je te trouverais en liberté : ainsi je reste.
Les misérables ! oser m’accuser de faire ma cour aux jésuites ! Vraiment, mon ami, tu as bien fait de les corriger, et tes coups de cravache me font un bien sensible. Cependant, à l’avenir, ne t’expose plus de la sorte, ces gens-là ne valent pas la peine qu’on coure pour eux les chances d’une heure de prison. Du mépris, un dédain bien vrai, bien amer, quelques épithètes qu’ils redoutent le plus ; par exemple, congréganistes, jésuites à robe courte, soldats de la vierge, chevaliers du christ, etc ; vois-tu leurs regards louches, leurs teints enflammés, leurs gestes comprimés, ô les hideux scélérats. Cependant quelques femmes en sont folles ; adieu, je me porte bien et suis ton ami pour la vie.
M. VALSAIN À CHARLES SON NEVEU
Beaune, le 25 mars 1829.
Je ne sais, mon neveu, ce que tu es allé faire à Paris ; mais ce voyage, sans me consulter, ne m’a point satisfait du tout. Ta mère, ma chère belle-sœur, est trop faible ; elle ne te tient pas assez en bride, et si je n’y prends garde, tu deviendras bientôt un fort mauvais sujet. Je t’avais prévenu que les missionnaires devaient arriver pour le carême, je t’avais engagé à te préparer pour recevoir dignement la faveur insigne que je devais solliciter pour toi, et tu te sauves précisément au moment de leur arrivée. Pour aller où ? À Paris, dans un lieu où l’on ne voit que crimes et iniquités, dans un lieu où, comme dit mon confesseur, on imprime le Constitutionnel, le Courrier-Français et le Journal des Débats.
Hâte-toi donc de revenir : c’est le frère de ton père, c’est ton oncle, c’est ton ami qui t’appelle. Tu sais que je suis très riche, que je n’ai que toi et ta sœur pour héritiers. Eh bien ! si tu veux m’écouter, si tu veux entrer dans la congrégation, je te donnerai à toi seul tout mon bien. Ta sœur n’aura rien ; cette petite morveuse n’a-t-elle pas refusé de chanter dans la mission ! Tu entends, Charles. Oui, tout mon bien, tout mon argent, tous mes meubles, mes domaines, mes maisons, etc. Mais, si tu ne veux pas, si tu persistes dans tes pernicieux principes, tu n’auras rien. Ma fortune n’est pas faite pour entretenir des pourceaux qui dédaignent la parole des apôtres, pour se nourrir de turpitudes et d’abominations, comme dit monseigneur l’évêque de Bordeaux ; je la donnerai à la société de Jésus : aussi bien, c’est ce que me recommande tous les jours mon confesseur.
Il faut que tu saches que tu n’auras aucune démarche à faire. Je me charge de tout : Déjà j’ai été deux fois chez le père Petit, missionnaire très respectable, comme dit M. le président, et voici ce que nous avons résolu touchant ta réception. Je veux te donner mot pour mot, et comme en dialogue, notre conversation, afin que tu saches ce que j’ai fait pour toi et combien la société s’est montrée indulgente en ta faveur : c’est moi qui commence.
Je viens pour la seconde fois, vénérable père d’une société plus vénérable encore, m’entretenir avec vous des moyens de faire recevoir mon neveu dans la congrégation.
Mais, monsieur Valsain, me répondez-vous des sentiments de votre neveu ? Est-il bien décidé, enfin.
Bien décidé, non, mais il se rendra avant peu, je vais lui écrire une lettre dans le bon style, il a peur de perdre ma succession, voyez-vous.
Vous êtes donc bien riche, monsieur.
Oui, très riche, j’ai trois cent mille francs.
Trois cent mille francs !… et vous n’avez rien donné aux jésuites, je veux dire à l’église ?
Comment, mon révérend, rien donné… mais j’ai donné aux sœurs du couvent Sainte-Marie, pour parer la sainte Vierge, m’ont-elles dit, tous les bijoux de ma pauvre femme. J’ai acheté de la toile et du drap pour habiller cinq cents frères ignorantins. J’ai donné mon plus beau lit, mon lit nuptial pour mettre dans la chambre du chef de votre mission ; j’ai acheté ce manteau que vous portez en ce moment ; j’ai…
C’est bien, c’est bien, je ne savais pas… Mais revenons à votre neveu, vous dites donc que vous le déciderez à se faire affilier dans la sainte congrégation ?
Je vous en réponds corps pour corps.
Vous rendrez là, monsieur, un grand service à la religion et à notre société. Il y a joie au ciel et chez nous quand un impie se convertit ; mais quels sont donc les motifs de son hésitation ?
Je vous avouerai qu’il n’aime pas trop la prière, et que les lieux saints n’ont point d’attraits pour lui.