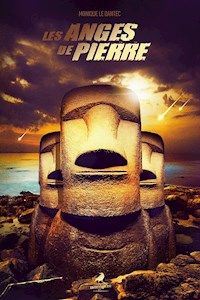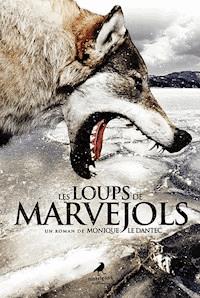Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Morrigane Éditions
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Un retour dans le passé s’impose pour Marielle qui s'était pourtant juré de ne jamais remettre les pieds à Portsall...
Une journaliste d’investigation, Marielle, doit retrouver celui qui a poussé son ancien amant du haut de la falaise. Les forces de l’ordre ont conclu à un accident, mais elle n’y croit pas. Confrontée à tous ceux qui ont côtoyé Virgile pendant ses dix ans d’absence, sa femme Janice épousée par intérêt, indépendante et insaisissable, sa mère Lucie qui perd la raison, le père Anselme, de l’Opus Dei, Félicité, sorcière du village, le jardinier Yvon, homme mutique à l’allure inoffensive, tous ces gens lui soumettront une vision différente de celui qu’elle a tant aimé. De plus, ses propres souvenirs remontent et crèvent à la surface. Certains viennent de l’eau pure, mais d’autres de la vase... Sans oublier l’âme du mort, omniprésente, qui ne trouvera la paix qu’une fois son assassin découvert.
Monique Le Dantec nous entraîne encore une fois dans un thriller époustouflant, aux limites de l’irrationnel et de la folie.
EXTRAIT
Le chemin fuyant au cœur des dunes creusées par le vent et couvertes d’un gazon rude, plus bas la mer qui déferlait doucement sur les rochers, la fraîcheur d’une lumière délicieuse, la fine salure qui me venait au visage chassèrent les papillons noirs que déclenchait le souvenir de Marielle. Je marchai un bon moment, droit devant moi sur la colline herbue et le sable blanc, l’esprit vide et serein. Ignorant que l’Ankou (la Mort) était aux aguets. Mais aucun sombre pressentiment n’effleura ma conscience, aucune intuition prémonitoire ne rompit le charme de l’instant présent.
A PROPOS DE L’AUTEUR
Monique Le Dantec, membre de l'Académie ARTS-SCIENCES-LETTRES (médaille Argent 2013), est née en 1945 à Paris, berceau de sa famille depuis plusieurs générations. C’est d’ailleurs dans la capitale que ses premiers romans prennent leur source. Mais c’est vers 1995 qu’elle s’installe réellement dans l’écriture.
Si elle privilégie les intrigues où le fantastique se mêle au quotidien, où l’imaginaire fait la part belle au futur et à l’anticipation, elle sait aussi, pour certaines œuvres, rester dans l’air du temps, et s’appuyer sur un simple fait divers pour le transformer en un thriller inquiétant.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 341
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
RESUMÉ
« Entre mer et granit, là où la croix brave le ciel et étend son ombre sur le dolmen, où au bas de la falaise, la vague assaille le roc sans relâche, où les nuits de pleine lune, les korrigans viennent danser sur la grève, j’ai été assassiné. La journée avait pourtant bien commencé ».
Une journaliste d’investigation, Marielle, doit retrouver celui qui a poussé son ancien amant du haut de la falaise. Les forces de l’ordre ont conclu à un accident, mais elle n’y croit pas. Confrontée à tous ceux qui ont côtoyé Virgile pendant ses dix ans d’absence, sa femme Janice épousée par intérêt, indépendante et insaisissable, sa mère Lucie qui perd la raison, le père Anselme, de l’Opus Dei, Félicité, sorcière du village, le jardinier Yvon, homme mutique à l’allure inoffensive, tous ces gens lui soumettront une vision différente de celui qu’elle a tant aimé. De plus, ses propres souvenirs remontent et crèvent à la surface. Certains viennent de l’eau pure, mais d’autres de la vase... Sans oublier l’âme du mort, omniprésente, qui ne trouvera la paix qu’une fois son assassin découvert.
Monique Le Dantec, membre de l’Académie ARTS-SCIENCES-LETTRES (médaille Argent 2013), nous entraîne encore une fois dans un thriller époustouflant, aux limites de l’irrationnel et de la folie.
Pour suivre l’auteur : www.monique-ledantec-ecrivain.fr
À Evan
Tu peux jeter ton cricomme on se jette des falaisestu sais très bienque tu n'amerriras jamaistu rebondirasd'écho en échosans jamais trouverla mer ni la mort
Léah
1
Entre mer et granit, là où la croix brave le ciel et étend son ombre sur le dolmen, où au bas de la falaise, la vague assaille le roc sans relâche, où les nuits de pleine lune, les korrigans dansent sur la grève, j’ai été assassiné.
La journée avait pourtant bien commencé.
Janice venait de partir chez ses parents à Morgat. Ayant décidé de rénover leur propriété qui n’en avait d’ailleurs guère besoin – ils possèdent la plus somptueuse villa de Morgat – la présence immédiate de leur fille s’était révélée brusquement indispensable. Il est vrai que les deux années qu’elle avait mollement passées à suivre des cours de décoration d’intérieur aux Beaux-Arts, études qu’elle n’avait jamais concrétisées par la suite, avaient subitement rendu ses conseils essentiels et primordiaux !
Cela dit, quelques jours de tranquillité à Liorzh Gwenn (Jardin Blanc) n’étaient pas pour me déplaire. Ma mère, à la suite d’un vœu à ma naissance qu’elle avait espérée pendant plus de quinze ans, avait baptisé ainsi la vieille bâtisse familiale. Puis ordonné de la plantation d’arbustes et de fleurs immaculées qu’Yvon le jardinier entretenait à la perfection. Ayant appris cette heureuse absence hier après-midi, j’en avais profité pour décaler mes rendez-vous au centre, au grand dam de Corinne qui ne supportait pas les modifications d’agenda. Mais, après cinq minutes de rébellion, délai maximum que je pouvais tolérer de sa part même si je l’appréciais beaucoup, elle avait fini par s’incliner devant mes arguments autant fantaisistes que mensongers, et m’avait souhaité le bon rétablissement d’une indisposition que j’avais lâchement évoquée pour la circonstance. Les clients d’Ar Ganevedenn (l’Arc-en-ciel) patienteraient, l’esthétique pouvait attendre quelques jours sans grand dommage pour leur santé !
Dès que le 4X4 de Janice avait disparu sur la route de Gwitalmeze (Ploudalmezau), j’avais emprunté l’escalier de vieilles pierres brillant d’un éclat sombre qui reliait le jardin à la plage. Si des nappes de brume flottaient encore au ras des berges du Gouer ar Milinou (Ruisseau des Moulins), qui se jetait dans la baie et qui séparait les deux communes de Kersaint et de Portsall, de l’autre côté de l’anse, la croix et le dolmen d’Ar Guiligui, émergeant du champ d’or des ajoncs, resplendissaient dans le soleil acidulé du printemps.
Venant du large, le vent apportait un parfum d’algue et d’écume et des embruns scintillants de sel. C’était basse mer, mais déjà l’heure d’accalmie entre le jusant et le flot montant lorsque le courant s’inverse.
Je laissai mon regard errer sur ce paysage si familier que je ressentais à chaque fois une étrange impression d’éternité, immobile au bord de la plage de sable blanc où le temps semblait n’avoir aucune prise, aucune importance.
Pourtant ce matin, j’eus le sentiment de le voir d’un œil nouveau. Tous les détails ressortaient comme une eau-forte du ciel. Ce fond bleu strié de nuages en fuite au-dessus de la Manche limpide mouchetée par les îlots m’emportait vers des horizons nouveaux. Autour de la crique, la côte granitique et extraordinairement découpée du pays de Léon se prolonge en mer par un vaste plateau peu profond. Celui-ci est parsemé de massifs rocheux émergés en permanence, mais aussi d’une quantité innombrable de hauts-fonds et d’écueils affleurants. Très dangereux pour la navigation – seuls les hommes de la région peuvent s’y risquer –, ce lieu est tout à fait propice à la pêche et à la récolte du goémon.
Enfant, j’ai toujours pensé que le début du monde commençait ici, dans ce paysage âpre et farouche battu par les vents marins, et non comme son nom l’indique, la fin de la terre. À l’écoute de la rumeur des flots, je savais que cette journée serait particulièrement éblouissante.
Sur la droite au fond de l’anse, au milieu des roseaux et des herbes sauvages, les eaux de la rivière tourbillonnaient et sautillaient, mêlées d’arcs-en-ciel mouvants. Son murmure invitait à la rêverie.
Juste devant Liorzh Gwenn, de l’autre côté de la crique, le toit de tuiles brunes de la maison de Marielle, à l’ombre des pins, surgissait au milieu d’azalées et de rhododendrons. Un étranger n’aurait jamais pu deviner que cette demeure était abandonnée depuis des années. Seul Yvon, suivant les ordres de ma mère, entretenait ce lieu avec une constance digne d’un saint. Car Marielle avait dit qu’elle ne reviendrait jamais à Portsall. Mais je soupçonnais fort Mammig Lucie de conserver l’espoir de son retour un jour.
Ne voulant pas m’attarder sur l’évocation morose des erreurs du passé, je décidai de longer la baie vers les ruines du château de Trémazan.
Le chemin fuyant au cœur des dunes creusées par le vent et couvertes d’un gazon rude, plus bas la mer qui déferlait doucement sur les rochers, la fraîcheur d’une lumière délicieuse, la fine salure qui me venait au visage chassèrent les papillons noirs que déclenchait le souvenir de Marielle. Je marchai un bon moment, droit devant moi sur la colline herbue et le sable blanc, l’esprit vide et serein. Ignorant que l’Ankou (la Mort) était aux aguets. Mais aucun sombre pressentiment n’effleura ma conscience, aucune intuition prémonitoire ne rompit le charme de l’instant présent.
Ce sentiment de plénitude parfaite, de bonheur incroyable, je devais le ressentir jusqu’au soir. Au moins, franchissant les portes du paradis ou de l’enfer – je ne peux encore le dire – je pourrai affirmer que je suis mort heureux !
Je continuai mon chemin jusqu’à la pointe de Landunvez, tentant au passage de remettre un terme sur tous les écueils qui apparaissaient, l’île Verte, Ar Vouric, Mén Guenn, Mén Houarn, Mén Loüet, Penn Ven, les Fillettes, Barbuan…Toutes ces appellations émergeaient de mon enfance, ces toponymes qu’on m’obligeait à apprendre par cœur, mais tellement ancrés dans les esprits et dans la culture locale que cela en devenait un jeu, tous ces vocables choisis en fonction des activités nautiques, de la pêche, du pilotage ou du bornage.
Il est évident qu’un homme coupant du goémon à marée basse sur des hauts-fonds et qu’un marin pêcheur tirant sa ligne au large avec son bateau, ne pouvaient pas avoir la même perception du monde qui les entourait, ni des repères identiques de l’espace. Par exemple, la roche sur laquelle les anciens venaient arracher le varech, le trou de sable riche en gravettes… leurs noms correspondaient à l’utilisation qu’en faisait celui qui les avait inventés.
De plus, d’autres toponymes s’y ajoutèrent, ceux des lieux que la fantaisie de la nature avait plus particulièrement signés de son sceau, les brisants aux formes caractéristiques, le serpent, la baleine... les couleurs spécifiques, noires, vertes… Sans oublier les appellations issues de l’histoire ou des légendes qui ont marqué de leur empreinte les pierres et les grèves de la mer, ainsi que dans les terres. Je cédai à mes souvenirs d’enfance, précieux et puissants, et me laissai emporter par leur flot. On m’a tellement raconté la vie d’antan que je pouvais imaginer sans mal mon père se rendre à l’usine de goémon à Portsall où il était employé comme contremaître. La cheminée ne fume plus depuis les années 1950, mais elle est toujours là pour témoigner de l’activité économique principale de la région.
Mon grand-père aussi, je le voyais à son retour de pêche, lui qui partageait son temps entre la capture des crustacés avec ses kevells, ses casiers, et des poissons à l’aide des linennou kaillaoui, les lignes traînantes, ou kordennou, les dormantes comme les palangres. Ma grand-mère enfin, qui ramassait avec tant d’autres les algues sur la grève ?
Ces images exceptionnelles qui surgirent ce matin avec une acuité toute particulière auraient pu m’alerter, être le signe qu’il arrivait quelque chose d’anormal dans mon existence. Mais plongé dans le passé, je n’y pris pas garde.
Bien évidemment, dans ma jeunesse, ces évocations, je ne les ressentais pas ainsi. Elles ne sont que la traduction « adulte » de ce qui était ma vie de petit garçon du fin fond du Finistère, Penn-ar-Bed, ce pays du bout du monde, issu d’une famille modeste.
Ce dont je me souviens réellement, à travers le prisme de l’enfance, c’est d’un gamin fluet et solitaire, aux cheveux bouclés et aux grands yeux verts. Ramassant des coquillages sur la grève et fabriquant des colliers pour sa mère. Piquant une tête dans les vagues froides et tourmentées en s’imaginant être ar rinkin (un requin). Dénichant les oiseaux, mais élevant une souris dans une boite à chaussure. Furetant dans la lande à la recherche des korrigans et restant dissimulé sous le dolmen des heures à les attendre pour les capturer. Répondant à leurs sarcasmes, mais chantant avec eux quand le vent soufflait avec violence. Construisant des cabanes dans les genêts. Dérobant les pommes du voisin. Pédalant sur son vélo en brandissant son épée plus redoutable qu’Excalibur. Adorant l’institutrice, mais tremblant devant le curé de la paroisse… Il y avait l’existence de tous les jours, celle qui paraissait si normale, si évidente qu’il n’était pas envisageable qu’elle puisse changer un jour. La pêche, le goémon, les soirées en famille autour de la cheminée en dégustant crêpes et châtaignes…
C’était surtout la vie de la mer qui prédominait, celle qui martelait ses heures à la communauté. La nature domestique et collective des récoltes conduisait à la grève une foule de gens qui devaient, pour opérer dans de bonnes conditions, se résoudre à une sectorisation rigoureuse de leur champ de travail. Pour éviter les contentieux, la frontière terrestre des communes était généralement prolongée sur l’estran par une ligne fictive souvent matérialisée par les roches à goémon noir.
Je me rappelle aussi que mon grand-père racontait les conflits dont certains devenaient violents, jusqu’à causer la mort ! Le nom d’un rocher, Merkou an Garred, en conserve d’ailleurs le souvenir, entre Ploudalmezau et Lampol.
Je suis né dans cet univers. Et si j’ai eu la chance, poussé par ma mère qui cependant n’en a jamais fait, de poursuivre des études auxquelles mon milieu familial ne me prédestinait pas, j’en garde des visions et des émotions, celles qui constituent la trame d’un être humain, dans laquelle il puise ses forces et pose les assises de sa personnalité. Je n’ai jamais envisagé d’aller vivre ailleurs que sur cette terre de vent et d’eau à la rude beauté.
Pourtant, elle a été touchée par la main du Diable ! Et le Diable en ce jour maudit du 16 mars 1978 s’appelait l’Amoco Cadiz venu s’échouer devant la dune de Pozguen. Près de deux cent trente mille tonnes de pétrole brut déversées sur les côtes bretonnes !
J’avais treize ans à l’époque. Portsall en a gardé la mémoire funeste en installant l’ancre du supertanker sur le port.
Les mois qui suivirent furent terribles, mais démontrèrent qu’une certaine solidarité s’établissait entre les hommes devant une catastrophe d’une telle ampleur. Les agriculteurs, les associations écologiques, les habitants, tous ont œuvré de leur mieux pour nettoyer le littoral le plus rapidement possible.
Je ne veux pas m’étendre sur ce sujet, il fait partie des pires souvenirs que je possède, mais les visions d’horreur de la côte polluée, de ces trois ou quatre mille cadavres d’oiseaux qui gisaient sur la grève, de ces poissons crevés, de ces algues détruites resteront à jamais dans mon esprit.
Mais que ce soit Dieu ou Lucifer qui règne ici, la Mort est venue me chercher. Ancré à cette terre de mon vivant, j’y suis rivé maintenant pour l’éternité. Le temps s’écoulera désormais muet, aveugle, insaisissable, mais je demeure prisonnier d’une interrogation qui j’espère ne sera pas sans réponse. Qui m’a poussé du haut des rochers ?
Néanmoins, dans l’ignorance de cet instant fatidique, je respirai l’air salin à pleins poumons. Seuls les sifflements de la brise troublaient le silence, un vent léger qui soufflait au ras du sol, provoquant des mouvements dans l’herbe rêche. Les vagues vert émeraude, frangées d’écume, venaient mourir en douceur sur la plage en contrebas.
Je marchai longtemps vers Lanildut sur le chemin côtier qui serpentait parmi un amoncellement granitique et stérile. La mer montante soupirait tranquillement le long du rivage. Dans la transparence de la lumière, le soleil culminant dans le ciel me rappela à l’ordre.
Il devait être largement l’heure de rentrer pour déjeuner. Je décidai de passer par les terres, contournant le vaisseau de vieilles pierres humides qu’était devenue l’ancienne collégiale du XIIIe siècle des seigneurs Tenneguy du Châtel, puis je piquai d’un bon pas vers Kersaint à travers champs. À l’entrée du village, un grand peuplier ondulait dans le vent, effleurant la toiture d’une des premières maisons de ses hautes branches. Un jardin foisonnant de glycine en grappes et aux allées bordées de buis fit revivre un instant l’institutrice que j’avais eue pendant des années et qui habitait ici à l’époque. Que de fois avons-nous joué dans son enclos, que de crêpes confectionnait-elle pour les gamins après l’école quand elle savait que les parents rentraient tard du travail ! Son image pourtant de femme austère et peu diserte, au visage large, au front bombé et aux yeux de porcelaine, est restée gravée dans mon cœur. Elle est enterrée dans le cimetière qui jouxte l’église.
Longeant Notre-Dame du Bon Secours, dont les vitraux rappellent l’histoire de saint Tanguy, fondateur du monastère de la pointe Saint-Matthieu, je rejoignis en quelques pas Liorzh Gwenn.
Il était temps. Mammig Lucie m’attendait de pied ferme pour passer à table. Dans son regard se manifestait l’agacement, mais à mon arrivée, un large sourire éclaira son visage et elle maîtrisa sa mauvaise humeur. Pour une fois que je partageais son repas, elle avait mis les petits plats dans les grands et plusieurs mets étaient disposés sur la desserte de la salle à manger.
En effet, elle refusait de les prendre avec Janice, officiellement pour ne pas nous déranger. Mais je crois bien qu’elle la détestait cordialement même si elle ne m’en avait jamais fait la confidence. Nous avions fait construire une cuisine supplémentaire attenante aux deux pièces en rez-de-chaussée qu’elle occupait afin de conserver, malgré son âge avancé, un semblant d’indépendance qu’elle semblait grandement apprécier.
Le repas terminé, après avoir jeté un coup d’œil à Merzin dans sa stalle qui attendait placidement le retour de sa maîtresse pour galoper dans la lande, mais qui me gratifia d’un hennissement enjoué, je m’installai dans un fauteuil en rotin face à la mer, m’essayant à la lecture du rapport du dernier congrès des chirurgiens à Rennes, tandis que ma mère se retirait pour sa sieste habituelle.
L’exposé rébarbatif et le peu de motivation que j’avais aujourd’hui envers la profession me plongèrent rapidement dans un endormissement profond.
Quand je m’éveillai, les feuillets épars sur les genoux, le soleil déclinait à l’arrière du toit et les ombres s’allongeaient dans le jardin. Encore arrimé aux strates du sommeil, il me sembla apercevoir, s’échappant de la cheminée de la maison de Marielle, une légère écharpe de fumée.
Le sang en ébullition, je me levai d’un bond. Même sachant que ce n’était qu’une illusion, je décidai tout de même d’en avoir le cœur net.
J’informai Mammig Lucie qui tricotait dans le salon, je suppose mon énième chandail, que j’avais envie de fruits de mer pour le soir. Le poissonnier à proximité se situait sur le port et je partis en direction de Portsall.
Contournant l’anse, j’empruntai l’impasse Saint-Usuen qui longeait la propriété de Marielle. À mon approche, une mouette, juchée sur la branche d’un chêne, cria comme un reproche et s’envola en battant des ailes furieusement.
Le portillon en bois était toujours ouvert et je pénétrai dans le jardin noyé d’ombre, faisant le tour de sa demeure. Bien évidemment, tous les volets étaient fermés, et un désert de silence entourait la vieille maison. Autour des azalées, des aiguilles de pin jonchaient le sol et formaient un tapis doux et moelleux. Tout ce qui bouillonnait en moi de souvenirs et de flamme s’était éteint à tout jamais.
Ne voulant ruminer d’amers et vains regrets, je quittai les lieux. J’avais rompu les amarres avec Marielle, il était inutile de revenir sur un passé relégué dans l’oubli, qui paraissait n’avoir jamais existé. Un ennui morne enlisa ma pensée. Je le chassai en discutant un bon moment avec le poissonnier qui, déjà, s’apprêtait à nettoyer son magasin avant la fermeture. Je commandai deux douzaines d’huîtres, des bulots, un crabe, des langoustines, des palourdes et quelques praires. Il se proposa de les ouvrir et de les apporter sur un lit de glace à Liorzh Gwenn, car il habitait près de chez nous.
Je repris donc tranquillement le chemin du retour, les mains dans les poches, remontant une sente qui donnait directement au site archéologique d’Ar Guiligui où se côtoyaient le menhir, le dolmen et la croix de granit, au bord d’un promontoire d’où l’on a un point de vue panoramique et remarquable sur toute la côte de la mer d’Iroise.
À mon arrivée, je fus envahi d’une émotion étrange.
Sans doute, le texte d’Émile Souvestre affiché sur un panneau à l’entrée du site « C’est debout, sur la pointe de Guiligui, appuyé sur un dolmen et les yeux fixés sur la mer, qu’il faut aller méditer quand la vie étroite du monde vous blesse. On devient fort à cet air de l’océan qui vous coule dans la poitrine. On se sent retrempé et vivace. » y fut sans doute pour quelque chose. Pourtant, je le connaissais par cœur.
Mais, c’est sûrement parce que je venais d’arriver au rendez-vous que le destin m’avait fixé.
Un vent du nord s’était engouffré dans la baie. Le sang d’un coucher de soleil inondait l’horizon.
Je passai devant le menhir, grimpai le sentier à travers les ajoncs, longeai le dolmen et me hissai d’un bond sur le socle de la croix qui surplombait les rochers d’une bonne vingtaine de mètres. En bas, le long du rivage déchiqueté, la mer avait repris sa guerre contre le granit. Par moments, malgré la hauteur, des embruns frappaient mon visage. C’était l’heure tranquille où, dans la baie, les bateaux ancrés tanguaient doucement, d’autres s’éloignaient vers le large ou bien allaient mouiller au port dans un ballet immuable et mystérieux. Les toitures d’ardoise de Portsall qui ponctuaient la côte jusqu’à la pointe de Porsguen luisaient dans le soir encore flamboyant.
J’ignore combien de temps je restai là, immobile en équilibre sur le socle du calvaire, épaule contre poteau de granit, dominant les flots tel Manawydan, le dieu de la mer et de la navigation, à la proue de son navire.
Soudain, je sentis deux bras m’enserrer la taille. Tous mes réflexes s’annihilèrent par la surprise. Une seconde après, une main me projetait violemment en avant. Rassemblant tout ce que je possédais de force et d’énergie, je me contorsionnai en tentant d’agripper la croix, en vain.
Je m’entendis pousser un hurlement terrible, mais les roches glissantes se précipitèrent vers moi, chacune avec plus de rapidité que la précédente. Je ne saurais dire combien de temps dura la chute. Ce fut une vision fugace, une réalité incompréhensible, une souffrance brutale. Puis un éclair rouge fulgurant inonda ma conscience. Dans une stupeur incrédule, le corps brisé, je me vis stupidement immobilisé sur le plat de la dernière grosse pierre.
J’eus le sentiment de dériver aux confins de la raison et du non-sens. Mais assorti d’une certitude absolue. Si mon esprit vivait encore, c’était bel et bien mon cadavre qui gisait là, les bras en croix, les jambes frôlant les vagues et l’horreur dans les yeux fixant le ciel…
2
Devant la fenêtre, figée de stupeur, Marielle relut pour la troisième fois la lettre qu’elle tenait entre ses doigts tremblants. De la rue, la lueur palpitante de l’enseigne du restaurant chinois au bas de chez elle se propageait à l’appartement dans une cadence exaspérante. Les faisceaux des phares des automobiles s’y ajoutaient et formaient un ballet incessant. Ils glissaient sur le mur, se déployaient d’un bout à l’autre du plafond, dévalaient le côté opposé pour se perdre dans la moquette du salon.
Plus loin, des éclats de lumières pourpres illuminaient le haut des façades des quatre tours de la Bibliothèque Nationale de France dont les vitres se teintaient de rose dans le soir couchant.
Devant la fenêtre, le profil de la femme se dessinait, très net, saisissant. La pâleur blême qui s’était installée à la première lecture sur son visage s’effaçait peu à peu, au fur et à mesure que les mots prenaient corps dans son esprit. Mais une certaine voussure des épaules trahissait son désarroi.
D’un pas de somnambule, les traits inertes, elle posa la lettre sur un guéridon, puis se rendit dans la salle de bains. Elle sortit de la douche comme une noyée des vagues de la mer. Passant une robe d’intérieur à capuchon grège qui la faisait ressembler à une none, elle saisit la missive et se laissa choir dans un fauteuil, essuyant d’un revers de main une mèche de cheveux encore ruisselante. Son visage se fixa dans l’attention.
Elle avait une décision à prendre.
Ses lèvres se serraient en une ligne dure et mince comme pour retenir un sanglot, qui cuirassait ses traits d’ordinaire si doux.
Elle avait une décision à prendre, certes, mais laquelle ? Devait-elle ignorer la demande pressante de Lucie Saint-Roch, ou bien y accéder comme la vieille femme la suppliait ? Ses doigts nerveux jouaient avec le feuillet, le tournant et retournant dans tous les sens comme si les mots échappaient à son entendement.
Soudain, Aengus sauta d’un bond élastique de l’armoire d’où il surveillait les allées et venues de sa maîtresse, et atterrit sur ses genoux en poussant un miaulement retentissant.
Une lueur fugitive éclaira le visage sombre de Marielle.
– Que faut-il faire, à ton avis ? Penses-tu qu’il soit bon que je parte là-bas ?
Le chat la fixa de ses grands yeux bleus et la heurta d’un coup de tête comme s’il donnait son assentiment. Un sourire triste apparut sur les lèvres de la femme. Dans une étreinte sans gêne, l’animal se cala contre elle et se mit à ronronner avec fureur.
Prisonnière du malstrom lumineux qui peuplait l’appartement, elle se blottit au creux du fauteuil. Pourtant, elle garda la tête droite, les mains bien posées à plat sur les accoudoirs, les pupilles braquées sur les tours roses, la lettre sur les genoux. Immobile. Comme morte. Puis elle ferma les paupières, évoquant les images d’un passé lointain.
Les premières lueurs de l’aube la trouvèrent ainsi, éveillée, grise, le regard insondable. Sa décision était prise, elle céderait à cette demande qui se trompait de chemin. Mais elle savait que désormais elle vivrait comme un double d’elle-même, à distance des évènements. Aengus s’était endormi sur ses genoux. Elle tira de dessous l’animal la lettre et la relut une dernière fois.
« Très chère Marielle,
Je viens vous annoncer une horrible nouvelle. Mon fils vient de trouver la mort au pied de la falaise sous la croix d’Ar Guiligui. La police s’oriente vers un accident. Vous qui le connaissiez intimement, il est bien difficile d’imaginer qu’il ait été assez imprudent pour s’approcher si près et prendre le risque de glisser. D’autant que le temps était beau et qu’il n’y avait pas de vent. Une autre hypothèse me vient à l’esprit, le suicide. Mais je ne peux imaginer qu’il désirait mettre fin à ses jours, même si je sais que sa vie l’avait déçu. Il reste donc une autre version, que quelqu’un l’ait poussé. Même si les conclusions de l’enquête ne sont pas définitives, je crains que ce soit la thèse de l’accident qui soit retenue et l’affaire classée. Mais quelque chose au fond de moi se révolte à cette idée. Son esprit me souffle qu’il n’est pas en paix. C’est pour cela que je vous demande, je vous supplie même, si vos occupations vous le permettent bien sûr, de venir étudier vous-même toutes les causes qui auraient pu provoquer ce drame. Au nom de l’amour que vous lui avez porté, et de l’amitié indéfectible qui nous lie.
Très chère Marielle, je vous attends.
Lucie Saint-Roch »
Elle se leva péniblement, se dirigea d’un pas incertain vers la fenêtre. L’aube avait tissé un voile de brume sur les tours de la Bibliothèque qui leur donnait un air mystérieux et fantomatique. L’enseigne du Chinois était arrêtée. Les éboueurs passaient rue Chevaleret dans un bruit lointain et assourdi. L’ombre grise de la Pitié-Salpêtrière fermait le quartier.
Le rythme perpétuellement agacé du cœur de Paris semblait s’éteindre ici, pas seulement à cause de l’heure matinale, mais de l’essence même du lieu. En effet, le secteur avait pris, depuis la construction de la grande Bibliothèque et l’aménagement des abords, outre un côté futuriste qu’elle appréciait, un aspect un peu estival et alangui qui lui plaisait. Surtout le soir, quand les tours s’étaient vidées de ses employés et des visiteurs.
Elle trouvait aussi que l’endroit était propice à l’étude et à la réflexion. Il faut dire qu’elle fréquentait assidûment la BnF, et que plus aucune salle n’avait de secret pour elle. Cette proximité l’avait aidée dans sa profession de journaliste et la qualité de ses reportages s’en était accrue, le contexte général de ses analyses étant beaucoup plus fouillé qu’auparavant.
Max, son rédacteur en chef, lui en avait très vite fait le compliment. Difficile de rétorquer qu’il s’agissait en fait, indépendamment de toutes les données offertes par Internet dont elle bénéficiait comme tous ses collègues, et des constatations obtenues sur place lors des interviews, d’une simple question de lieu de résidence ! Que la proximité immédiate d’une des plus grosses banques de documentation du monde lui permettait de travailler d’une manière beaucoup plus pointue. Marielle frissonna. Plus de peine que de froid. D’ennui surtout.
Max, justement ! Il fallait qu’elle passe au journal lui annoncer son départ pour la Bretagne. Elle ignorait le laps de temps qu’elle devrait consacrer à cette enquête. À cette pensée, un soupir s’échappa de ses lèvres.
Rouvrir la maison de Portsall n’était pas un problème. Un peu de ménage, une bonne flambée dans la cheminée, et la demeure reprendrait vie rapidement. Revenir séjourner dans des lieux qu’elle avait décidé de quitter à tout jamais, c’était cela qui l’ébranlait. Mais surtout, surtout, ce qui la bouleversait au-delà de toute raison, c’était l’idée de replonger dans la période qu’elle avait vécue avec Virgile. Ces années étaient de celles qu’on n’oublie jamais. Elle avait fait l’impasse dessus. C’était une voie définitive, sans issue.
Le front collé à la vitre, le regard ancré aux tours, ce n’est pas Paris qu’elle voyait, mais le passé. Des larmes s’étaient cristallisées au coin de ses paupières. Des images s’engouffraient dans son esprit, qu’elle chassa impitoyablement. Des années qu’elle avait mises à se cuirasser, à se prémunir de ces projections intruses qui justement la harcelaient à ses moments de faiblesse.
Elle abritait une fêlure qu’elle avait réussi à colmater, presque à oublier. Elle l’avait reléguée dans une zone d’ombre. Mais l’ombre n’est pas le paradis. Ni l’enfer. Juste le purgatoire dont il faudra qu’elle s’échappe un jour.
Pourtant, cette bataille qu’elle avait cru gagner par un acte irrémédiable, elle savait bien qu’elle devrait la reprendre. Elle avait le sentiment de marcher sur un fil, tel un funambule. Le moindre faux pas, et ce serait la chute. Alors, pourquoi acceptait-elle de répondre favorablement à la supplication de Lucie ? Revenir sur la terre ancestrale ? Affronter à nouveau tout ce qu’elle avait voulu gommer dans son existence ?
Un filet s’était tressé autour d’elle dans lequel elle savait qu’elle finirait par se prendre. Mais si elle refusait d’y accéder, les conséquences seraient sans doute pires encore. Elle vivrait en permanence sur le qui-vive, à l’affût du moindre incident qui pourrait survenir à tout moment. Elle n’avait pas le choix. Cette lettre était la justification, qu’elle n’avait certes pas anticipée, mais qui lui permettait d’affronter les démons. An Diaoul, le Diable lui-même l’attendait là-bas. Elle devait le vaincre pour toujours.
Désormais, maintenant que sa décision était prise, elle avait un rôle à tenir. Elle devrait présenter à chacun, et surtout à Lucie qui ne serait pas dupe, une façade que nul ne devait être en mesure de briser.
Forte de cette pensée, elle partit se préparer pour sortir. Le miroir de la salle de bains lui renvoya un visage défait, des traits tirés, des cernes sous les yeux. Des plis d’amertume fermaient sa bouche. Pas étonnant, après avoir passé la nuit à méditer et à fluctuer dans un raz de marée de souvenirs, dont la plupart étaient des bulles émergeant de l’eau pure, mais d’autres de la vase.
Si elle ne voulait pas faire peur à Max et obtenir ces quelques jours de congé nécessaires pour satisfaire Lucie Saint-Roch, elle avait tout intérêt à améliorer son aspect physique, à défaut du moral qui se cantonnait dans un choix aussi aléatoire qu’inutile ! Mais bon... Elle ne devait pas reculer. Elle imagina surtout le chagrin que devait ressentir la vieille femme. Perdre son fils unique, objet de toutes ses attentions et de tout son amour… Elle eut une pensée de pitié pour elle. Mais c’est une souffrance qui ne se partage pas. Il serait bien temps, lors de leur prochaine rencontre, de lui manifester son soutien.
Une douche interminable, un brushing énergique, un fond de teint léger, un maquillage du regard soigné et un rouge à lèvres lumineux parvinrent à chasser les strates de son insomnie.
Le miroir lui renvoya le reflet d’un visage accusant la quarantaine sereine, aux cheveux châtains et souples, aux yeux couleur de miel, au front large et pensif, au sourire de Joconde, à la carnation claire. Elle s’approcha de près, rectifia l’emplacement d’un cil, se dit qu’elle donnerait le change à Max, bien incapable qu’il serait de découvrir le personnage qu’elle s’apprêtait à tenir.
Plus elle se contemplait dans la psyché, plus elle se trouvait un physique d’une banalité affligeante. Ni grande ni petite, trop neutre pour attirer l’attention, pas assez originale ou piquante pour être remarquée. Parfois, elle se demandait s’il n’aurait pas mieux valu être plus laide ! Au moins, elle aurait eu une lutte à mener, faire oublier cette disgrâce par d’autres artifices. Mais là, non, rien. Aucune aspérité. Ordinaire.
Même sa physionomie était éteinte, ses paupières s’ouvraient et se fermaient sur un regard vide. Un visage inexpressif, des prunelles sans flamme, une allure de passe-muraille. Voilà ce qu’elle était !
En revanche, ce dont elle n’avait nullement conscience, c’était son élégance naturelle, cette sorte d’aura qui l’enveloppait comme une lumière. Cela découlait de son port de tête droit et altier, de sa manière d’être, franche et attentive, de sa voix claire et bien timbrée, de sa démarche souple et affirmée, de son habillement, toujours très net et de bon goût. C’était surtout ce rejet de toute turpitude, ce refus de toute compromission, cette dignité dans chaque décision qu’elle était amenée à prendre qui la faisaient sortir du lot de ceux qui avaient pour coutume de s’incliner devant l’autel des vanités.
Mais elle ignorait la façon dont ses confrères la percevaient. L’eût-elle su, une vague de timidité l’aurait sans doute affaiblie. Elle se considérait comme un esprit curieux certes, mais sans grande imagination, s’appuyant essentiellement sur des données scientifiques et techniques qu’elle ne cherchait pas à découvrir ou à accroître et encore moins à contester, mais à utiliser. Elle s’estimait comme une organisatrice de l’information plus qu’une créatrice d’évènements.
Son miroir lui renvoyait une image morose, éteinte. Comme un feu vaincu. Pourtant, quand elle parcourait les albums photo de son enfance, c’est une fillette enjouée et taquine qui apparaissait à toutes les pages, un diablotin de korrigan qui courait sur la lande et qui plongeait dans les vagues, avec des soleils de rire qui lui tiraient ses paupières et des fossettes qui marquaient ses joues.
Plus grand-chose de sa prime jeunesse ne subsistait à présent. À part peut-être cet amour qu’elle conservait envers sa région d’origine. Mais qu’elle avait su effacer en arrivant dans la capitale. Elle s’était jetée à corps perdu dans sa carrière, dans la recherche scientifique, et Paris l’avait adoptée. Elle s’y sentait bien, n’avait pas envie de résider ailleurs. C’était son lieu d’ancrage, son port à elle, et elle y tenait.
Elle trouvait toujours assez surprenants ces provinciaux qui venaient travailler ici et qui ne parlaient que de leur village. À se demander s’ils ouvraient leurs yeux et leur cœur à « la plus belle ville du monde » ! Tous les arguments qu’on lui avançait la faisaient sourire. Les embouteillages… elle se souvenait aussi de ceux de Brest ! Et quand on lui servait pollution, elle rétorquait Amoco Cadiz !
Elle esquivait ces discussions stériles. Sans renier la Bretagne et toute la culture celtique qui s’y rattachait et qu’elle adorait, elle ne regrettait pas son installation dans la capitale. Au moins, elle avait su « larguer les amarres ». C’était peut-être la seule chose vraiment positive qu’elle avait réussie depuis son départ. Outre sa profession bien sûr, mais qui s’exerçait partout ailleurs dans le monde.
Parce que, sur le plan du cœur, c’était plutôt morne plaine. Heureusement, Max avait été là pour recoller les morceaux à son arrivée à Paris. Investi d’un sixième sens, il avait immédiatement compris, lors de leurs premiers entretiens, que la jeune journaliste fraîchement émoulue dans le domaine des reportages scientifiques, pleine de feu et d’audace pour celui qu’il avait l’intention de lui confier – une étude sur la pollution dans le delta du Niger avec les grands pétroliers et les raffineries sauvages des autochtones – était brisée de l’intérieur. Que son sourire factice et son regard absent trahissaient une colère et une douleur qu’il devrait canaliser pour tirer le meilleur parti d’elle.
Pour mieux la capter – ses connaissances et sa façon d’aborder la profession l’avaient enchanté –, cette montagne de cent quarante kilos de chair et de graisse lui avait tout de suite présenté un aspect patelin et un visage dévoué. Sacré Max ! Elle n’avait pas été dupe, mais elle avait compris qu’elle avait un allié, certes intéressé, mais un allié tout de même dans ce nouveau monde qu’elle approchait avec toute la fougue pouvant lui faire oublier Virgile.
C’était peu, et c’était beaucoup à la fois. Les premiers temps au journal faisaient partie de ses bons souvenirs. À l’exception d’un collègue assez déplaisant qu’elle avait ignoré tout de suite, elle avait été bien accueillie par les autres, et n’avait jamais eu de conflit particulier avec quiconque.
Évidemment, sa blessure, personne n’en avait jamais rien su. Même Max, malgré tous ses efforts pour l’inciter à se confier, n’avait jamais pu lui soutirer le moindre épanchement. Elle avait décidé de rayer Virgile de son univers. Il n’était donc pas question de le nommer ou le faire réapparaître par des révélations aussi douloureuses que superflues. Elle considérait avoir deux vies. L’une avec Virgile, l’autre sans.
La seconde avait été riche en évènements professionnels, en voyages sur tous les continents, en reportages-découvertes qui lui avaient forgé une philosophie mitigée sur l’avenir du monde. C’est ainsi qu’elle s’était lancée dans une course effrénée autour de la planète, et avait ramené dans ses bagages de nombreux rapports relatifs à l’environnement et ses conséquences, réchauffement climatique, couche d’ozone, augmentation de certaines maladies, extinction de certaines espèces animales ou végétales, etc. Les récentes découvertes en génétique et leur application, OGM, sélection biologique des enfants, clonage des êtres humains n’avaient pas non plus échappé à ses investigations.
Elle avait eu ce regard critique que l’écologisme pose sur la société occidentale et sa culture scientifique et technologique. Elle avait su ouvrir des brèches pour y glisser les valeurs humanistes, trop perçues à son avis comme anthropocentriques, et par là, dominatrices et destructrices.
Elle avait réussi à situer le débat entre les écologistes et leurs adversaires dans le cadre du deep ecology, le courant vert profond, celui qui se compare aux grands mouvements d’émancipation qui ont ponctué le devenir démocratique de l’Occident, qui prétend établir l’égalité de toutes les créatures vivantes, contre les privilèges accordés seulement aux individus.
Pourtant, elle voyait le futur d’une manière relativement plus optimiste que la plupart de ses collègues. Sans méconnaître les menaces potentielles pour l’environnement, elle était persuadée que l’homme était capable de relever les défis majeurs actuels, en favorisant l’exploitation des ressources renouvelables et organisant la sauvegarde des sites dans leur état d’origine ainsi que les espèces en danger.
Sa philosophie en appelait à un nouveau contrat social, qui ne serait plus seulement pour l’habitant de la Terre, mais porterait aussi sur la Nature. C’était le sort des générations futures dont il s’agissait, et toute son énergie se ciblait dans cette gageure. Mais son premier combat avait été bien plus naïf. Elle s’était opposée à certains médias, ces vautours qui se nourrissaient des malheurs de la planète. Qu’un fait divers de fond de campagne puisse se transformer en un raz de marée journalistique et provoquer des évènements qui n’auraient jamais eu lieu sans le relais intempestif de la profession l’exaspérait au plus haut point.
Elle ne s’intéressait pas particulièrement à la politique ni aux religions. Mais elle se souvenait parfaitement de ce pasteur intégriste américain qui, dans son humble paroisse, avait décidé de brûler des exemplaires du Coran en réponse au 11 septembre ! Les publications d’information et la télévision s’étaient jetées sur l’affaire comme des vautours et avaient fait monter la pression dans le monde entier.
Elle considérait ces gens comme des irresponsables. Il est vrai qu’on lui rétorquait souvent que la médiasphère montrait ce que le bon peuple voulait voir, disait ce qu’il désirait entendre. Que ces actualités douteuses, il s’en repaissait jusqu’à la nausée, incapable de déceler qu’il était manipulé. Que ses confrères n’étaient que le miroitement des mentalités contemporaines. C’est pour cela qu’elle pensait que leur rôle à eux, les messagers du monde, était de faire le tri, de garder ou non le silence, mais de ne pas orienter les esprits dans un but purement mercantile. Ils n’étaient pas des dieux.
Ces réflexions, tandis qu’elle se maquillait avec soin, avaient faire rosir ses joues. Pour la première fois depuis la réception de la lettre, elle sourit franchement à son reflet dans le miroir. Trêve de toutes ces considérations, il était temps d’y aller ! Elle avait à convaincre Max de la nécessité de son absence, satisfaire la demande de Lucie Saint-Roch et surtout cohabiter désormais avec le fantôme de Virgile.
3
Après deux heures de navigation à aussi vive allure que possible dans des courants contraires, Janice, dès les manœuvres d’accostage terminées, sauta d’un bond nerveux sur le quai du port de plaisance de Morgat, enroula le cordage à la bite d’amarrage, jeta un coup d’œil au flyer pour voir si elle n’avait rien oublié dans le cockpit et se dirigea d’un pas rapide vers le centre-ville.
Il n’était pas encore l’heure du dîner. Ses parents ne seraient pas là à l’attendre, l’air pincé pour sa mère, raide comme un piquet sur son canapé, et serein pour son père, en train de savourer son whisky devant la fenêtre, le regard au loin.
Une petite brise s’était levée avec l’arrivée du soir, vaguement incertain. L’odeur iodée lui fouettait les narines, un parfum de marées et de varechs, de crustacés et de sable humide. Le bleu du jour se mourait, faisant place à un gris moucheté de nuages tandis que la lune, molle et pâle, s’élevait dans le ciel. À l’horizon, de l’autre côté de la baie de Douarnenez, les éclairs lents et rotatifs du phare de la Vieille couvraient la mer et la terre de grandes blessures blanches. Elle respira à pleins poumons, et emprunta la rue principale. Elle avait quelques emplettes à faire avant de rejoindre la demeure familiale.