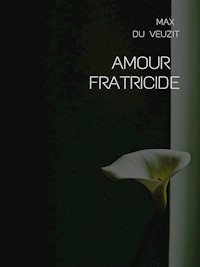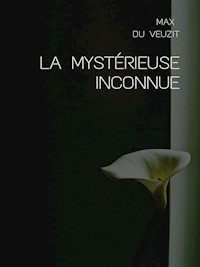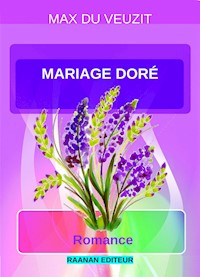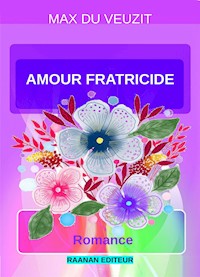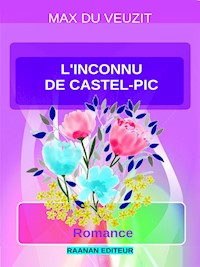2,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Le lieutenant de Fragon, jeune officier sans fortune, par surcroît accablé de dettes, se résigne à contracter un très riche mariage. Mais la hâte avec laquelle l'on presse le fiancé fait naître certains soupcons dans l'esprit du jeune homme. Mariés, une barrière invisible semble séparer le marié de sa femme Gilberte. Plus tard, il apprendra "la raison cachée" qui nécessita la conclusion hâtive de leur union. Gilberte, de bonne foi, croyait son mari averti de sa pénible aventure. Celui-ci part, désespéré. La réconciliation sera-t-elle possible?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 334
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Mariage doré
Pages de titreIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIIIXIVXVXVIXVIIXVIIIXIXXXXXIXXIIXXIIIXXIVXXVXXVIXXVIIXXVIIIXXIXXXXXXXIXXXIIXXXIIIXXXIVXXXVXXXVIPage de copyrightMariage Doré
Max du Veuzit
I
À six heures, le brosseur, un solide gaillard aux yeux de jais, pénétra dans la chambre close du lieutenant Rodolphe de Fragon.
Minutieusement, il rangea sur une chaise les effets qu’il venait de secouer ; puis il tira les rideaux, ouvrit les persiennes, qui claquèrent, et, laissant la fenêtre grande ouverte sur le jardin, il s’approcha du lit :
– Mon lieutenant, six heures sont sonnées !
Le jeune homme ne dormait pas.
La pensée engourdie, le corps prostré, l’œil entrouvert, il avait suivi les mouvements du soldat dans un demi-sommeil.
La voix bruyante de celui-ci le tira de la torpeur où il s’immobilisait paresseusement.
Il bâilla et se dressa en sursaut sur sa couche.
D’un geste rapide, déjà il rejetait loin de lui les couvertures, quand, brusquement, la pensée endormie depuis la veille surgit, rayonnante, chassant loin du cerveau les dernières brumes du sommeil.
Ce fut comme un déclic tintamarresque, comme l’entrée brusque d’un maître dans sa maison solitaire qui retentit soudain de sa venue.
Et son geste commencé resta inachevé, les couvertures demeurèrent plaquées sur ses membres subitement immobilisés.
La question affolante sur laquelle il s’était endormi, après l’avoir retournée dans tous les sens, se dressait de nouveau imposante et insoluble devant lui.
Il la répéta :
« Il faut que, pour ce soir, à minuit, j’aie trouvé vingt-cinq mille francs ! »
Pauvre diable de lieutenant, n’ayant que sa misérable solde pour vivre, cette somme de vingt-cinq mille francs représentait pour lui une véritable fortune.
Et sottement, l’avant-veille, dans un soir de folies avec des camarades, dans une minute d’ivresse causée par un souper meilleur que d’habitude, lui qui, de sa vie, n’avait jamais touché une carte, il avait joué...
Joué et perdu !
Perdu sur parole cette somme fantastique à ses yeux, cette somme dont il ne possédait pas le premier liard !
« Vingt-cinq mille francs pour ce soir ! »
Où les trouver ?
À qui les emprunter ?
D’ailleurs, les emprunter, était-ce honnête ?
Jamais, même en ayant beaucoup de temps devant lui, même en se privant du nécessaire, jamais il ne réussirait à amasser tant d’argent.
Il faut avoir vécu la vie des garnisons pour bien comprendre l’impossibilité matérielle où il était d’envisager sainement un remboursement futur.
Tout au plus, un emprunt, s’il avait pu le faire, ne lui aurait servi qu’à gagner du temps. Il eût reculé l’échéance trop proche ; mais le jeune homme n’en aurait – selon l’expression populaire – que mieux sauté ensuite.
Quant à trouver, d’autre manière, l’argent dont il avait besoin, c’était plus impossible encore. Chacun sait bien que les billets de mille francs ne se rencontrent pas au coin des bornes, tels les vulgaires journaux.
Il était orphelin, sans parents proches, sans famille riche ; qui donc aurait pu s’intéresser assez à sa détresse pour mettre pareille somme à sa disposition ?
Personne !
Son honneur, sa vie même, pouvaient être en jeu ; nul n’en était atteint, nul n’avait cure de sauver l’un ou l’autre.
Les camarades ?
C’étaient tous de bien gentils garçons ; mais ils avaient, eux aussi, leurs embêtements et leurs charges.
« Et puis ! il se le répétait, lorsqu’on a indélicatement joué et perdu une chose que l’on ne possède pas, une chose qu’on sait ne pouvoir se procurer, l’honnêteté empêche de faire appel aux camarades ! »
Rodolphe était, avant tout, un orgueilleux, il envisageait sévèrement son cas, mais ne voulait pas que d’autres pussent faire les mêmes critiques :
« Il y a des vérités que l’on n’avoue pas et des actes irréfléchis dont on a honte de laisser percer la légèreté. »
Alors, quoi ?
De quelque façon qu’il se retournât, les mêmes impossibilités se dressaient :
« Il n’y a qu’une sortie à cette impasse : la mort ! »
Il frissonna.
À vingt-huit ans, on n’envisage pas avec calme le suicide.
Et, cependant, c’était la seule solution qui, depuis deux jours, se fût présentée à son cerveau surexcité.
Avec une sorte de volupté sauvage, où la désespérance se joignait à l’orgueil, déjà par la pensée il en avait réglé la tragique mise en scène : l’heure ? minuit ; le costume ? sa tenue de fantaisie ; le décor ? sa chambre qui lui servait aussi de studio ; l’arme ? le revolver ; l’endroit ? le cœur...
Il voulait mourir, le sourire sur les lèvres, le front calme, l’air hautain devant l’adversité, comme il lui semblait que le fils de son père devait mourir.
– Mon lieutenant, une lettre !
De nouveau, la voix méridionale du soldat le faisait sursauter.
– Donnez.
Sa correspondance était plutôt rare, et les lettres qui arrivaient à son nom peu nombreuses.
Il prit l’enveloppe et l’examina comme une chose curieuse.
L’écriture lui était inconnue ; le timbre de la poste peu appuyé ne révélait rien...
Soudain, il tressaillit, et de la stupeur passa dans ses yeux.
Un cachet de cire rouge, à ses armes, scellait la mystérieuse missive.
– Ah !
Un instant, il resta interdit, les prunelles fixées sur le petit disque rouge.
Ce cachet le bouleversait !
C’était comme un visage familier qui lui souriait... un visage qui n’aurait pas été le sien et dans lequel, pourtant, il se serait reconnu.
Qui donc lui écrivait ?
Un parent ?
Un parent portant le même nom, puisque les mêmes armoiries que lui ?
En dépit de sa certitude de l’instant d’avant, il y avait donc, quelque part, un membre de sa famille connaissant son existence et s’intéressant à lui ?
À cette pensée, il sentit son cœur se dilater.
Il lui sembla que cette lettre était le salut, que ce parent, quel qu’il fût, allait être son libérateur.
S’enorgueillissant du même blason, pouvait-il l’abandonner dans une aussi tragique circonstance ?
Des larmes de soulagement, inconsciemment, lui montèrent aux yeux.
Comme il était doux, cet espoir surgi brusquement !
Il ouvrit l’enveloppe avec soin pour ne pas briser le cachet béni.
Et il lut, avec stupeur d’abord, avec joie ensuite, cette curieuse missive :
« À Monsieur Rodolphe de Fragon,
« Lieutenant d’aviation,
à Versailles. »
« Mon cher enfant,
« Depuis quand les jeunes hommes bien élevés délaissent-ils leurs vieilles parentes ? Vous trouvez-vous trop riche d’amis ou d’affections que vous dédaigniez la seule alliée qui vous reste ?
« Votre père, respectueux des liens de famille, vous conduisait parfois vers moi. Mais votre mise au collège, en supprimant ces visites, la mort de vos parents, puis la vie militaire, vous ont rendu oublieux et indifférent. La route tracée par les pas paternels ne fut plus jamais suivie par vous.
« Moi, malgré votre négligence, je pense toujours au blond garçonnet que vous étiez, à ce bel enfant qui m’appelait tante Sophie, bien que je ne sois pour vous qu’une cousine éloignée.
« Venez me voir, Rodolphe, je sais que la situation de vos parents n’était pas des plus brillantes. Vous devez être plus riche d’orgueil que d’écus. J’ai pensé à vous dans une circonstance heureuse qui se présente. Autant vaut qu’un mien parent en profite plutôt qu’un étranger.
« Venez sans trop tarder, nous causerons.
« Votre vieille cousine,
Sophie de Fragon
« Rue Saint-Dominique, 28bis. »
Deux fois de suite, il relut cette bienfaisante lettre, n’en remarquant pas les termes emphatiques et vieillots.
Ah ! qu’il était heureux !
Quelle merveilleuse résurrection après la lente agonie des dernières quarante-huit heures !
La brave, l’excellente tante Sophie !
Son intervention lui sauvait l’honneur et la vie.
« Certes ! J’irai la voir ! Et aujourd’hui, encore ! »
Il essaya de se la rappeler. À de longues années de distance ne se souviendrait-il pas d’elle ?
Tante Sophie !
Ce nom ne lui disait plus rien.
Cependant, en cherchant loin dans ses souvenirs, il crut se rappeler une longue et maigre femme au regard froid, à la voix pointue, chez qui son père l’avait conduit quelquefois.
Mais c’était vague, et l’image indécise lui laissait comme un relent de gêne et d’embarras...
Il secoua cette impression désagréable en essayant de se persuader que, sûrement, tante Sophie ne devait pas être l’anguleuse personne dont son infidèle mémoire s’efforçait en vain de préciser les contours.
Au surplus, il allait bientôt être renseigné. Le temps d’obtenir la liberté de la journée, et il ne ferait qu’un saut jusqu’à la rue Saint-Dominique, à Paris.
Gaiement, cette fois, l’âme de beaucoup rassérénée, il sauta de son lit et s’habilla minutieusement.
Deux heures après il prenait à la gare de Versailles le train pour Paris.
II
Tante Sophie habitait le quatrième étage – troisième au-dessus de l’entresol, disait la concierge – d’une grande et triste maison de rapport, dont la façade terne et nue donnait la froide impression d’un couvent désaffecté.
Les jappements aigus d’un roquet signalèrent aux hôtes de cette demeure l’arrêt du lieutenant sur le palier du quatrième.
À son coup de sonnette discret, la maîtresse du logis, elle-même, vint ouvrir.
Tout d’abord, dans le noir du petit vestibule, le jeune homme ne distingua qu’une silhouette féminine très longue, très mince et un peu voûtée ; mais ensuite, dans le minuscule salon où elle l’introduisit, après qu’il lui eut décliné ses noms et qualités, il vit mieux la vieille femme.
Et tout de suite, un peu désappointé, il reconnut Sophie de Fragon !
C’était bien elle, l’anguleux fantôme de sa mémoire rebelle.
Elle, dont l’air méfiant, les lèvres minces et cruelles sur des dents rares, le regard fugitif des petits yeux gris, les mains maigres, aux ongles longs comme des griffes, paralysaient soudain l’élan affectueux que le jeune officier se proposait vis-à-vis de son unique parente.
Car, chose bizarre, bien que le visage de la vieille femme n’évoquât pour lui aucun souvenir précis, il avait la sensation que sa gêne présente était surtout faite d’une gêne ancienne, ressuscitée tout à coup.
Dès la première minute, l’impression que lui causait sa vieille cousine était nettement antipathique. Cette impression ne devait, malheureusement, que s’accentuer et se justifier par la suite.
À travers les aboiements de l’horrible cabot, Rodolphe de Fragon essaya de se faire entendre. Et, poliment, faisant effort pour être aimable :
– Pardonnez-moi mon long silence, madame ; j’avais oublié, sinon votre personne, du moins votre demeure. Je suis heureux, et je vous en remercie vivement, que vous ayez bien voulu me rappeler l’une et l’autre.
Elle ne répondit pas.
Restée debout et sans souci de son embarras, elle l’examinait bizarrement, le détaillant des pieds à la tête, avec une insistance particulière.
Il perdit un peu contenance, et il lui sembla qu’il rougissait sous les petits yeux gris inquisiteurs.
Autour de lui, le roquet tournait, grognon et défiant, ne contribuant pas peu à augmenter le malaise du jeune homme.
Volontiers, celui-ci lui aurait donné un coup de pied, pour éloigner de lui son encombrante petite personne.
Pourtant, voulant secouer l’impression de plus en plus pénible qu’il ressentait, il interrogea :
– Je vous dérange à cette heure, madame ?
La femme eut un petit rire moqueur et, sans répondre à ses paroles, elle dit, poursuivant tout haut son idée :
– Abélard !... Ma parole, je crois voir Abélard !
Ahuri, ne sachant si c’était, ou non, un compliment, il la regarda.
– Abélard était votre grand-oncle, expliqua-t-elle, et vous lui ressemblez physiquement d’une façon frappante... C’était un fort bel homme, je vous assure ! Malheureusement pour vous, vous n’avez ni son aplomb, ni son air vainqueur.
De nouveau, elle fit retentir son rire agaçant.
Il remercia d’un salut étonné l’aménité des paroles et du rire, songeant à part lui combien dans sa situation actuelle il avait peu de raison de se glorifier.
Et, malgré lui, la hantise revint.
Mentalement, pour la centième fois peut-être depuis deux jours, il se répéta :
« Il me faut trouver vingt-cinq mille francs avant minuit ou me tuer... »
Non, évidemment, cette pensée ne devait pas lui donner un air vainqueur ! En revanche, elle lui valut une patience angélique vis-à-vis de son interlocutrice durant cette première entrevue.
Cependant, la vieille femme, après avoir fait taire le bruyant Kiki, – c’était le nom du petit chien – avait fait asseoir l’officier et l’interrogeait.
Elle posait ses questions brusquement, sans détours et sans discrétion aucune :
– Vous avez quel âge, maintenant, mon cousin ?
Sa voix était sèche... comme ses lèvres, comme son air, comme toute sa personne !
Il répondit :
– Vingt-huit ans.
– Vous les portez bien... Et pas marié, je pense ?
Il sourit :
– Non, heureusement !
Elle arqua ses sourcils, curieuse :
– Pourquoi, heureusement ?
– Parce que je plaindrais la malheureuse femme qui unirait son sort au mien, ma position actuelle étant des plus modestes.
– Elle peut devenir brillante.
– Peut-être... Bien que, sorti des rangs, je ne doive guère espérer un avancement rapide sans circonstances particulières.
– Aussi, pourquoi avoir choisi l’état militaire ?
– Il me séduisait. J’étais jeune, orgueilleux, sans expérience... Le prestige de l’uniforme ! Peut-être aussi ai-je eu peur de déchoir dans une lutte pour la vie. L’armée était la seule porte qui fût ouverte largement à un homme de mon caractère, sans connaissances spéciales... sans ressources, surtout !
– Comment cela ?
– Un proverbe espagnol dit qu’un gentilhomme pauvre n’a que trois routes devant lui : l’Église, l’armée ou la mer. J’ai choisi l’armée !
– Mais pourquoi y être entré par la voie la plus difficile ?
– J’avais dix-huit ans lorsque mon père mourut. Avec lui s’éteignait la pension qui, jusque-là, lui avait permis de subvenir à nos mutuels besoins... De la fortune de ma pauvre mère, il ne restait rien ; j’ai donc dû laisser mes études au moment même où, reçu à Polytechnique, je me disposais à les achever brillamment.
– Et alors ?
– Je me suis engagé... pour ne pas mourir de faim... Aujourd’hui, je me rends compte que, dans l’industrie privée ou dans le commerce, j’aurais pu arriver à me créer une situation mieux rétribuée...
Un court silence suivit ces explications données le plus brièvement possible par l’officier.
La vieille femme roulait entre ses doigts le bout d’une écharpe de laine jetée sur ses maigres épaules, et, du coin de l’œil, elle fixait sournoisement son parent.
Tout à coup son rire pointu, presque rageur, sonna de nouveau dans la pièce :
– Ainsi, de votre propre aveu, mon cousin, votre avenir est loin d’être brillant ?
Une rougeur subite empourpra le visage du lieutenant.
Elle avait vraiment une trop maladroite façon de poser ses questions !
Pourtant, il maîtrisa encore sa mauvaise humeur.
– Je suis un modeste et un travailleur ! fit-il, avec une sorte d’orgueil farouche. Jusqu’ici, j’ai vécu insouciant de l’avenir. J’avais foi en moi ! Il y a là, – et, disant cela, il se frappait le front, – il y a là de graves problèmes à résoudre, bientôt résolus, même ! qui m’assureront, je l’espère, une situation honorable et enviée.
Les yeux perçants de son interlocutrice s’allumèrent soudain.
Elle tendit le cou vers lui :
– Un travail ?... une invention ? questionna-t-elle, avidement.
– Oui, une invention... plusieurs même ! Et sensationnelles, encore !
Il faisait allusion à la navigation aérienne, qu’il devait perfectionner dans un sens qui, depuis, a donné de si brillants résultats.
Un éclair d’orgueil avait passé dans les prunelles décolorées de Sophie de Fragon. Par-dessus tout, cette femme avait le culte de la race et tout vibrait en elle à la pensée qu’un descendant mâle des illustres aïeux dont elle s’enorgueillissait pouvait redonner de l’éclat au nom patronymique, – jadis connu et célèbre, – aujourd’hui oublié, submergé par le flot envahissant des noms roturiers en vedette qui volent de bouche en bouche, sans qu’on sache bien au juste quel mérite particulier les a mis en relief.
Un instant, le regard ému de la vieille femme enveloppa le jeune homme.
Était-il possible que ce dernier fût capable d’inventer quelque chose ? Avait-il vraiment l’âme d’un créateur pouvant atteindre la célébrité et peut-être gagner des monceaux d’or ? En ce temps d’après-guerre, l’argent seul semble consacrer la gloire, et Sophie de Fragon avait un éblouissement devant le vertige d’une telle supposition.
Ses lèvres tremblèrent, semblant balbutier une prière... une action de grâces, peut-être, devant l’avenir entrevu !
Rodolphe de Fragon, cependant, avait repris son air accablé. Devant la misère mal déguisée de l’appartement où il se trouvait, il n’osait plus voir en sa vieille cousine la libératrice qu’il avait espérée pour le tirer d’affaire.
En foule, tous ses soucis revenaient, et, maintenant, il aurait voulu être seul, hors de cette maison décourageante, loin de cette femme hostile qui riait d’une façon si désagréable.
Mais tante Sophie, sortant de sa rêverie, daignait s’intéresser de nouveau à lui.
– Pour inventer quelque chose, reprit-elle tout à coup, pour lancer une invention, surtout, il faut de l’argent... beaucoup d’argent ! Et, si j’ai bien compris, vous êtes plus riche d’illusions que d’écus.
La figure de l’officier s’obscurcit encore :
– Hélas !
– Sans doute avez-vous entrevu un moyen de vous en procurer ?
De la tête, il fit signe que non.
La question mettait son âme à vif !
Et alors, ne s’arrêtant pas à l’éclair bizarre des yeux qui le fixaient, obéissant à une force étrange qui le poussait à crier sa détresse à un être humain, sans examiner le piètre résultat qui découlerait, bien certainement, de ses confidences, il dit tout à la vieille femme : sa minute d’égarement, l’enjeu insensé, sa situation désespérée, l’impasse où il se trouvait acculé.
Elle l’écoutait attentivement, l’haleine en suspens, le front barré d’un pli de dureté ; pourtant, sur les lèvres minces, un fugitif sourire semblait se dessiner. On eût dit que la vieille dame était ennuyée de la modeste situation de Rodolphe, en même temps que joyeuse de ses embarras financiers.
Quel projet ténébreux poursuivait-elle donc au sujet du jeune homme ?
La tête basse, l’âme étreinte, celui-ci n’en continuait pas moins son récit : c’était son unique chance qu’il essayait et le dernier effort dont il se sentit encore capable !
D’avance ne s’était-il pas condamné à mort ? Une désillusion de plus ne comptait guère...
Cependant, comme il parlait de suicide, la vieille sursauta, le visage empourpré sous la menace subite qui la transperçait : sa race éteinte, par la faute de ce jeune fou !
Ah ! Il ferait beau voir qu’elle lui laissât accomplir cette suprême sottise !
– Vous tuer ? Et de quel droit, malheureux enfant ? s’écria-t-elle, frémissante.
Il releva la tête et simplement expliqua :
– Je n’ai que ma vie à offrir à mon créancier ! La honte...
Mais elle l’interrompit brutalement :
– La honte, monsieur, serait de laisser derrière vous cette dette impayée, de telle façon qu’un homme pût se vanter d’être à jamais le créancier d’un Fragon.
Il se leva un peu pâle, avec, machinalement, un mouvement agressif comme s’il avait eu un homme devant lui :
– Ah ! je défends bien...
Le rire de la vieille coupa de nouveau sa phrase. Il vit le ridicule de son attitude combative, eut un geste d’excuse, et se rassit, accablé, pendant qu’elle ricanait brusquement :
– Vous défendez ? Vraiment ! Mais quand vous serez mort, qui donc fera respecter votre défense et empêchera les gens de salir votre nom et de suspecter jusqu’aux bonnes intentions de votre dernier acte, auquel on attribuera peut-être tous les motifs... les plus inavouables surtout ? De telle sorte que votre suicide ne sera plus ce que vous souhaitez qu’il soit : une réparation d’honneur ; mais deviendra, en passant par toutes les bouches, un acte de désespéré au seuil de l’infamie.
Il la regarda, effaré.
Avec quel raffinement elle l’assommait, cette femme à qui il était venu, plein de confiance, crier sa misérable détresse ! Elle n’avait même pas eu, pour adoucir sa peine, un mot de pitié et de réconfort !
Il se sentit soudain pour elle des sentiments de haine ; et des mots méchants montèrent à ses lèvres, qui, heureusement pour sa dignité d’homme, restèrent farouchement closes.
Sophie de Fragon, cependant, continuait, en dépit de cette hostilité sourde qu’elle lisait subitement dans les yeux de l’officier :
– Mourir ? Non, mon cousin, vous n’en avez pas le droit. Plus la situation est désespérée, plus vous devez serrer les dents et essayer d’y faire face. À votre âge, on lutte contre l’adversité et on se fait une gloire de vaincre la malchance. Enfin, on ne se contente pas d’une position de tout repos : on doit avoir l’ambition de poursuivre un but qui vaille le mal qu’on se donne pour l’atteindre. Vous êtes pauvre, eh bien, vos efforts doivent tendre à être riche... l’argent, voyez-vous, donne toutes les puissances et toutes les joies. Soyez de votre temps, Rodolphe, et, comme les autres, faites-vous un dieu du veau d’or... Ah ! oui ! soyez riche et transmettez à vos fils, avec le patrimoine d’honneur que représente votre famille la possibilité de tenir le rang auquel ils auront droit. Mais ne parlez pas de mourir. Vous êtes le dernier de votre race et votre vie ne vous appartient pas. Comment avez-vous pu l’oublier et laisser à une faible femme le soin de vous le rappeler ?
Exaltée par ses propres paroles, elle s’était dressée, les yeux brillants, la voix ardente, mettant toute son âme dans sa protestation.
Malgré l’aversion que lui inspirait sa cousine, Rodolphe ressentit pour elle, en cet instant, une sorte d’admiration. Son fanatisme avait quelque chose de respectable qui l’impressionnait au plus profond de lui-même.
Ce fut donc tristement, plutôt qu’avec mauvaise humeur, qu’il répondit :
– Je me suis déjà dit tout ce que vous m’exposez, et je vous affirme que c’est ma plus grande torture de faillir à la tâche que la vie impose à chaque homme. Malheureusement, la situation que je vous ai exposée est sans issue ; je ne suis plus maître des événements qu’à mon vif regret j’ai déchaînés autour de moi si maladroitement.
– La situation est sans issue, dites-vous ?
– Hélas !
– Pourtant, si je vous montrais une sortie à cette, impasse ?...
– Vous ?
– Oui, moi.
– Mais comment ?
– Je puis vous fournir le moyen de payer votre dette à l’heure dite.
– Oh ! si vous faisiez cela...
Il n’acheva pas, l’émotion lui coupant la parole.
En une bouffée, l’espoir revenait de nouveau...
Et, comme il était très droit, très franc, très spontané aussi, ses sentiments firent volte-face à l’égard de sa cousine et il s’en voulut des méchantes pensées qu’il avait eues pour elle tout à l’heure.
Anticipant, il allait lui parler de gratitude, de reconnaissance, de toutes ces choses dont son cœur était maintenant plein ; elle ne lui en laissa pas le temps :
– Ne me remerciez pas, Rodolphe ; c’est moins pour vous que pour nos ascendants que je vais agir. Au fond de leur tombe, ils ne doivent pas avoir à rougir de notre décadence... Vos confidences ne sont pour rien dans le but que je poursuis. En vous mandant près de moi, j’ignorais votre véritable situation et, cependant, déjà, j’avais un plan en vue de votre avenir et de l’éclat que je veux lui donner. La meilleure preuve de reconnaissance que vous puissiez me marquer sera de ne point soulever d’insupportables objections contre mes projets !
Le ton âpre de son interlocutrice ne rembrunit pas le jeune officier. L’astre d’espoir que lui laissaient entrevoir les paroles resplendissait trop en lui pour qu’il distinguât la sécheresse de la voix qui les prononçait.
– Je vous écoute, dit-il seulement.
– Tout d’abord, reprit-elle, avez-vous songé sérieusement à vous marier, Rodolphe ?
Il eut un léger sursaut de surprise.
– Non, jamais ! Je crois vous avoir dit que mes ressources ne me permettaient pas ce luxe.
– Néanmoins, la pensée du mariage ne vous répugne pas, et si vous n’aviez pas ce souci matériel de l’existence, vous vous arrêteriez sans déplaisir à l’idée de fonder une famille ?
– Évidemment, un foyer à soi, des enfants qui vous perpétuent... tout homme a rêvé ça !
– Eh bien, il ne tient qu’à vous de réaliser ce rêve.
Comme il allait protester, elle l’arrêta d’un geste de la main.
– Non, ne m’objectez pas votre manque de fortune. La jeune fille que je veux vous proposer est riche... très riche !
Il sourit :
– Alors, elle ne peut accepter pour mari un modeste officier comme moi !
– Vous vous trompez. D’abord, sa fortune lui permet d’épouser l’homme qui lui plaira, et je suis sûre que vous serez cet homme-là... j’en suis certaine ! Ensuite...
Elle hésita ; puis, cherchant ses mots, ajouta :
– En principe, elle accepte ce mariage.
– Mais elle me connaît donc, cette jeune fille ! s’écria-t-il, surpris.
– Je lui ai parlé de vous... beaucoup.
– Et cela a suffi ? fit-il, abasourdi.
– Oui... tout ce qu’on lui a dit de vous... de votre honorabilité, de votre jeunesse... puis, son caractère romanesque... aimant ! Enfin, son tuteur – elle est orpheline – a pris des renseignements sur vous... nous en avons causé... vous plaisez ! Bref, il ne tient qu’à vous d’être l’heureux élu.
Il passa la main sur son front brûlant où les idées se heurtaient en chaos.
– Je suis tout ahuri par votre proposition, fit-il après un silence. Mais, en supposant que je plaise vraiment à cette jeune fille, rien ne prouve qu’il y ait réciprocité, et qu’elle soit la femme que je souhaiterais voir toujours à mes côtés. Répond-elle seulement à l’idéal que je me suis fait de celle qui partagerait ma vie ?
Sophie de Fragon eut un ricanement amusé.
– L’âme sœur, quoi !
– Oui, fit-il gravement, celle que l’on aime, que l’on respecte et en qui on met toute sa confiance !
Elle haussa les épaules avec une sorte de pitié.
– Enfant !... Vous oubliez que ma protégée est riche... fabuleusement riche.
– Un mariage d’argent ! protesta-t-il, pendant qu’une moue de mépris tendait ses lèvres.
Mais, patiemment, elle rectifia :
– Un mariage de raison, d’inclination même, puisqu’il vous permet de réaliser toutes vos ambitions et tous vos rêves. Songez que ce mariage, en vous tirant de votre fâcheuse situation, vous permettra en même temps de réédifier votre maison, de vivre selon votre rang, selon vos goûts ; enfin, de poursuivre vos recherches, de mettre au point votre invention... en un mot, de devenir quelqu’un.
En parlant, elle scrutait la physionomie du jeune officier pour tâcher de deviner ses sentiments. À l’expression tendue et sérieuse de son visage, elle comprit que ses arguments avaient porté, et que seuls, l’orgueil, la dignité, l’amour-propre, lui fermaient la bouche pour un acquiescement.
Pourtant, les mauvais côtés de ce mariage d’argent apparaissaient malgré tout à Rodolphe.
– Je vois très bien les avantages que je retirerais de cette union, dit-il, pensif, après quelques instants de réflexion, mais je distingue moins facilement ceux que cette jeune fille y trouverait.
– Vous oubliez qu’elle deviendrait Mme Rodolphe de Fragon.
Il se mordit les lèvres et une rougeur subite fonça son pâle visage.
– Oui, c’est vrai ! Il s’agit de vendre mon nom.
La vieille eut un mouvement d’impatience.
– De le partager, seulement, avec une femme riche qui lui donnera l’éclat auquel il a droit. Vous êtes ridicule d’employer de pareils mots. Aujourd’hui, un mariage d’argent est admis partout.
Le lieutenant s’était levé, et, à grands pas, arpentait l’étroit espace réservé entre les meubles tassés le long des murs.
– C’est la fille de quelque mercanti enrichi ? fit-il en s’arrêtant brusquement devant tante Sophie.
– Non.
– Alors ! L’enfant de quelque femme... ?
Mais elle ne le laissa pas achever :
– Arrêtez ! C’est une jeune fille de notre monde. Son nom figure en bonne place dans l’armorial.
Il fut interdit.
– Je comprends de moins en moins ! Elle est donc bien laide ?
– Vous en jugerez.
– Infirme, peut-être ?
Elle éclata de rire, et, ironiquement :
– Oui, elle a une tête de bois !
Puis, redevenant sérieuse, elle reprit, persuasive :
– Allons, mon pauvre enfant, ne vous torturez pas ainsi le cerveau pour trouver des tares qui n’existent pas. Vous ne sentez donc pas combien j’ai le culte du passé et l’orgueil du nom que j’entretiens farouchement en moi-même ? Comment pouvez-vous supposer, vous, le chef actuel de notre maison, que je conseillerais un mariage qui pût vous rendre ridicule ?
Il fut convaincu.
Plus que tout ce qu’elle avait dit jusqu’ici, sa véhémente protestation anéantissait ses velléités de résistance.
Elle comprit son triomphe, et, battant le fer pendant qu’il était chaud, demanda :
– Eh bien, je puis dire un mot de vos intentions à la famille ?
Il se cabra, ne capitulant pas encore.
– Oh ! non, non ! Je vous en prie, pas si vite !
– Vous oubliez ce qu’il vous faut trouver avant la nuit, répliqua-t-elle froidement.
– Vous me mettez le couteau sur la gorge !
– Vos tergiversations sont extraordinaires. Oui ou non, consentez-vous ? Vous mériteriez que je vous abandonne à votre triste sort.
– Ne vous fâchez pas ! s’écria-t-il avec détresse. Je suis en complet désarroi... Il s’agit du bonheur de ma vie entière, que diantre !
– Il s’agit même de votre vie, puisque, si ce mariage ne se fait pas, il ne vous restera que le suicide comme suprême argument.
– Et comment un mariage m’assurera-t-il, ce soir, la somme qui me manque ?
– Ne vous inquiétez pas de cela. La question est pour vous trop délicate à dénouer... Je m’en charge. Pourvu que vous soyez le futur mari de cette jeune fille, tout ira bien.
– Mais je ne puis être ainsi, subitement, son fiancé...
– Vous pouvez le devenir avant la nuit.
Son assurance impressionna l’officier et il n’osa rien répliquer.
– Allons, vous êtes décidé, cette fois ?
Une lueur d’affolement traversa les prunelles du jeune homme.
– Oh ! cette impasse ! s’écria-t-il. Ne pas payer cette dette et être déshonoré ! Épouser cette femme et me mépriser ; me tuer et laisser sciemment mon nom sali, ma race disparaître !
– Justement, des trois maux vous choisirez le moindre. Au surplus, rien ne prouve que vous ne deviendrez pas amoureux fou de votre femme, et que ce mariage, commencé en affaire, ne se terminera pas en idylle.
– Dieu le veuille !
C’était un cri de vaincu. Il se rendait enfin définitivement aux arguments de sa parente.
Elle leva les bras au ciel comme pour le prendre à témoin de la patience qu’elle avait dû déployer vis-à-vis de Rodolphe.
– Enfin, vous voici raisonnable ! J’étais bien sûre que vous finiriez par être de mon avis. À moins d’être insensé, on ne refuse pas bénévolement une fortune de neuf millions.
– Neuf millions !
Il y avait de quoi rendre fou de joie le plus calme des hommes et, cependant, ce chiffre, formidable pour lui qui ne possédait rien, lui faisait plutôt peur, et il avait l’impression d’un lourd, très lourd fardeau à porter.
Comme il restait pétrifié à sa place, si absorbé dans ses pensées qu’il en oubliait la présence de sa vieille cousine, celle-ci le rappela au sentiment de la réalité.
– Il est midi, Rodolphe. Allez déjeuner ! Je ne vous offre pas de partager mon repas... il est trop maigre et je suis seule pour le servir. D’ailleurs, ajouta-t-elle, il me faut m’occuper de vous et voir M. de la Saponaire au plus vite.
– M. de la Saponaire ? interrogea-t-il, machinalement.
– Oui, c’est le tuteur de votre fiancée.
Elle disait déjà « sa fiancée », et il ne protestait pas. Tante Sophie menait les événements avec une telle rapidité qu’il ne songeait plus à lui résister.
– Revenez à cinq heures, j’aurai du nouveau.
Et, sans plus attendre son adhésion, sans vouloir écouter ses faibles protestations, elle le poussa vers la sortie et referma la porte derrière lui, tout cela si vite qu’il se trouva dans l’escalier sans s’en rendre compte.
– À tantôt.
À travers l’huis refermé, et pendant qu’il rajustait sa tenue que cette sortie un peu brusque avait dérangée, il lui sembla entendre le rire aigu de la vieille femme retentir brusquement.
Et, inquiet, la pensée affolée, ne sachant à quoi se résoudre, il partit dans la rue tout droit devant lui, au hasard.
III
– Pardon, monsieur !... C’est-y chez Mlle de Fragon que vous montez ?
À la voix polie de la concierge, Rodolphe se retourna :
– Oui.
– Alors, c’est pas la peine ! Elle n’est pas là.
– Elle n’est pas là ? interrogea le jeune homme, surpris. Mais elle va rentrer, sans doute ; elle sait que je dois venir.
– Dame !... elle aura été obligée de sortir, probablement. Seulement, elle m’a laissé une lettre pour remettre à monsieur l’officier.
– Ah ! bon !
– Il est probable que Monsieur en saura plus long... quand il aura lu.
La femme rentra dans sa loge pendant que de Fragon, la gorge serrée sous le désappointement involontaire, redescendait les quelques marches qu’il avait déjà gravies.
– Tenez, monsieur, voici !
Et la concierge, revenue sur le pas de sa porte, lui tendait une enveloppe fermée.
– Merci...
– Au revoir, monsieur.
Rodolphe salua et sortit.
Dans la rue seulement, il prit connaissance du petit mot de « tante Sophie », et, tout de suite, il respira mieux :
« Revenez me prendre à huit heures, lui disait sa parente. Nous irons chez votre fiancée. Soignez votre toilette, car on vous présentera officiellement à la jeune fille.
« Ne vous inquiétez pas ; tout va bien.
« Sophie de Fragon. »
– Tout va bien !
Longtemps il répéta ces trois mots qui lui faisaient du bien sans le rassurer complètement. Il leur prêtait toutes les interprétations possibles, mais ses suppositions ne satisfaisaient point sa curiosité, et il regretta que sa parente ne lui eût point donné plus de détails.
Qu’avait-elle fait depuis midi ? Quelles avaient été ses démarches, ses explications au tuteur, puisque tuteur il y avait ?
Maintenant qu’après des révoltes intérieures sa pensée commençait à s’habituer au projet de mariage sauveur, il avait hâte de se renseigner sur cette femme inconnue qu’on lui souhaitait pour partager son mystérieux avenir.
Une angoisse le pinçait à l’idée qu’elle lui serait peut-être antipathique, mais, fermement, quel que fût le désespéré de sa situation, il était résolu, dans ce cas, à tout accepter plutôt que de contracter des liens qui lui répugneraient. Ce léger pacte qu’il faisait avec les événements le réhabilitait un peu à ses yeux.
« Si elle me plaît, ce ne sera plus un mariage d’argent... »
Cependant, il sentait bien que son moi intime avait subi une défaite morale. Sans connaître une femme, il s’habituait à l’idée de l’épouser, seulement parce qu’elle possédait des millions, et il se disait qu’il eût été très beau de penser différemment.
À huit heures, il revint chez sa vieille cousine. Entre-temps, usant d’un taxi qui l’avait transporté chez lui, à Versailles, il avait procédé à une toilette soignée et échangé son costume militaire contre un impeccable habit noir.
Quand Sophie de Fragon le vit entrer chez elle, elle ne dissimula pas sa joie.
– À la bonne heure, Rodolphe, vous êtes exact !
Il eut un piteux sourire.
– L’exactitude forcée de ceux qui ne sont plus maîtres de leur destinée.
– Allons, allons, ne vous posez pas en victime, mon ami. Vous avez, au contraire, toutes les chances. La Providence est véritablement pour vous en cette affaire.
– Tant mieux, dit-il, la moindre difficulté m’eût encore paru un trop grand obstacle dans l’état d’esprit où je suis.
– Le principal est que vous vous soyez enfin décidé à ce mariage, fit la pratique cousine. J’ai vu tantôt M. de la Saponaire ; les choses sont arrangées avec lui et vous pouvez vous considérer comme agréé.
– Très flatté !
Elle haussa les épaules devant la mine navrée qu’il montrait.
– Quittez cet air lugubre, fit-elle en riant, ce n’est pas à un enterrement que nous allons.
– Si, répliqua-t-il, gravement, nous allons enterrer, ce soir, toute la bonne opinion que j’avais de moi.
– Bah ! le convoi sera de première classe, et il y aura tant de fleurs et de richesses répandues, que vous auriez mauvaise grâce à ne pas vous réjouir.
Il ne répondit pas. Sa parente ne semblait pas pouvoir comprendre la révolte intime qui le soulevait.
Ils prirent une auto qui, dans la nuit lumineuse des rues parisiennes, les emporta vers l’avenue d’Iéna, où habitaient les Saponaire.
Depuis un bon moment, une question harcelait Rodolphe, qui hésitait à la poser.
Il s’y décida, une rougeur fugitive aux tempes :
– Avez-vous fait connaître au tuteur de votre amie mes embarras d’argent ?
– Non ! fit-elle. C’était inutile ; je veux, d’ailleurs, que vous entriez le front haut dans cette famille.
– J’aime autant cela ; mais...
Il se tut, horriblement gêné pour poursuivre.
La vieille avait compris.
– Ne vous inquiétez pas de votre dette, Rodolphe. Les vingt-cinq mille francs que vous devez vous seront versés à temps.
– Et comment ? insista-t-il.
– Une de mes amies met cette somme à ma disposition. Elle exige seulement deux choses.
– Lesquelles ?
– Que vous soyez fiancé, ce soir, à Gilberte de la Saponaire. L’autre condition vise le remboursement futur.
– Et alors ?
– Elle vous donne six semaines pour payer.
– Six semaines. C’est dérisoire !
– Non, d’ici là, vous pouvez être marié.
– Allons donc !
– Avec de l’adresse et une fiancée qui ne demande qu’à vous adorer, il faudrait être sot, mon cher, pour subir de longues fiançailles. Votre empressement ne pourra qu’être flatteur, du reste.
Il se tut ; toute cette question pécuniaire lui donnait des nausées. Oh ! s’être mis dans la nécessité de débattre une si malpropre affaire ! Quelle dégringolade dans sa propre estime !...
Un silence était tombé entre eux. Tout à coup, Sophie de Fragon demanda :
– Avez-vous pensé à la bague ?
– Quelle bague ?
– L’anneau de fiançailles des Fragon. Vous devez l’avoir parmi les bijoux de votre mère.
– En effet ; mais je n’ai point songé qu’il pourrait être utile aujourd’hui.
– Étourneau !
– Bah ! si ce mariage doit se faire, il sera toujours temps de sortir cette bague du coffret.
Insouciant de ce détail auquel il accordait peu d’importance, il ne se tracassait guère ; mais la vieille femme tenait à ce que rien ne fît manquer le succès de l’entreprise si ardemment préparée.
– Du tout ! s’exclama-t-elle. Il ne faut rien remettre à plus tard. Puisque ce soir on vous présente officiellement à Gilberte, il faut que vous affirmiez vos liens de fiancé... l’anneau donné et accepté correspond, de part et d’autre, à un engagement d’honneur.
– Mais, puisque c’est impossible ! Je ne l’ai pas.
– Heureusement, j’avais prévu votre oubli... Tenez, fit-elle, en lui passant un minuscule écrin, voici la bague de ma mère ; elle doit ressembler sensiblement à celle que vous possédez, votre bisaïeul et mon grand-père étant les deux frères.
Il voulait refuser le don précieux entre tous.
– Je ne puis accepter que vous vous en dessaisissiez, ma cousine.
– Si. Je n’ai point d’enfant à qui la léguer, je serais heureuse de la voir au doigt de celle qui va perpétuer notre lignée. Prenez-la, Rodolphe, vous me ferez plaisir.
– Merci, dit-il simplement.
Il fit jouer le ressort de l’écrin et un cercle d’or, sur lequel un chiffre en émail bleu et une couronne de minuscules diamants se détachaient, apparut, merveilleux de finesse, sur le fond de satin blanc.
Rodolphe examina l’anneau avec émotion.
– Oui, c’est bien le pareil, murmura-t-il. Mon père en retira un semblable du doigt de ma mère qui venait de mourir.
« Pour celle qui sera ma fille plus tard, dit-il en me regardant, les yeux pleins de larmes. Puisse-t-elle avoir les mêmes vertus que l’admirable compagne de ma vie qui vient de partir ! »
Le jeune homme ferma l’écrin brusquement, et le glissa dans la poche intérieure de son habit.
La vue de cet anneau, en faisant revivre une scène inoubliable de son enfance, le bouleversait dans ses fibres les plus intimes.
Par une association d’idées toute naturelle en la circonstance, il songea à ce qu’avaient dû être les fiançailles de ses parents, si épris l’un de l’autre, à ce qu’auraient dû être normalement les siennes, à ce qu’elles allaient être en réalité...
Et une souffrance aiguë tordit son cœur et crispa son visage.
Pourtant, une amère satisfaction lui venait de se dire que, par un heureux hasard, l’anneau sacré de sa mère ne figurerait pas dans cette inique parodie du mariage d’amour.
Il s’était rejeté brusquement dans le coin sombre de la voiture, si absorbé en ses pénibles réflexions, que Sophie de Fragon dut lui toucher le bras pour le tirer de sa torpeur.
– Nous sommes arrivés, Rodolphe.
Silencieusement, il sauta sur le trottoir bitumé et tendit la main à la vieille femme empêtrée dans les dentelles de son antique manteau.
– Nous voici enfin au seuil de la fortune, lui murmura-t-elle à l’oreille, en guise de merci.
Il ne répondit pas.
Les sourcils froncés, il regardait la maison où sa destinée allait se jouer.
IV
D’un rapide coup d’œil, de Fragon avait examiné la grande bâtisse de pierre qu’une cour pavée et une haute grille dorée séparaient de la rue.
Le large perron de marbre blanc, la lourde marquise ajourée, les lanternes forgées, le luxe sévère déployé dès l’entrée, semblaient accueillir de hautaine façon les modestes visiteurs. Le lieutenant eut de nouveau l’impression écrasante d’une trop grosse richesse à subir. Ses humbles quartiers de noblesse s’épouvantaient des millions qu’on leur proposait.