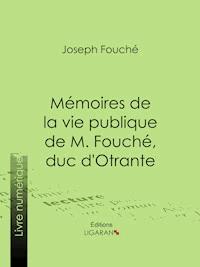
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Französisch
"""Mémoires de la vie publique de M. Fouché, duc d'Otrante"" est un ouvrage captivant qui nous plonge au cœur des intrigues politiques et des coulisses du pouvoir au début du XIXe siècle. Écrit par Joseph Fouché lui-même, cet homme énigmatique et controversé, ce livre constitue une véritable mine d'informations sur une période charnière de l'histoire de France.
Fouché, duc d'Otrante, fut l'un des acteurs majeurs de la Révolution française et de l'Empire napoléonien. Tour à tour révolutionnaire, policier redoutable et ministre de la Police, il a su naviguer habilement entre les différents régimes politiques pour préserver sa position et ses intérêts.
Dans ses mémoires, Fouché nous dévoile les secrets de sa carrière politique, depuis ses débuts modestes en tant que conventionnel jusqu'à son ascension au poste de ministre de la Police sous Napoléon Bonaparte. Il nous livre des récits fascinants sur les complots, les trahisons et les jeux de pouvoir qui ont marqué cette époque tumultueuse.
Mais au-delà des intrigues politiques, Fouché nous offre également un aperçu de sa personnalité complexe. Homme d'une grande intelligence et d'une ambition dévorante, il était prêt à tout pour atteindre ses objectifs. Ses mémoires nous permettent de mieux comprendre les motivations qui ont guidé ses actions et les dilemmes auxquels il a été confronté.
Ce livre constitue une source précieuse pour les historiens et les passionnés d'histoire. Il nous offre un regard unique sur les coulisses du pouvoir et nous permet de mieux appréhender les enjeux politiques de l'époque. Les mémoires de Fouché sont un témoignage inestimable qui nous plonge au cœur d'une période charnière de l'histoire de France.
Extrait : ""Joseph Fouché, duc d'Otrante, grand-croix de plusieurs ordres français et étrangers, est né le 29 mai 1769, à Nantes, département de la Loire-Inférieure. Son éducation fut confiée aux pères de l'Oratoire ; il fut placé par ses parents, à l'âge de 9 ans, au pensionnat du collège de Nantes."""
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 109
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
JOSEPH FOUCHÉ, duc d’Otrante, grand-croix de plusieurs ordres français et étrangers, est né le 29 mai 1763, à Nantes, département de la Loire-Inférieure. Son éducation fut confiée aux pères de l’Oratoire ; il fut placé par ses parents, à l’âge de 9 ans, au pensionnat du collège de Nantes. Ses premiers maîtres le jugèrent mal ; ils prirent la gaîté de son caractère pour de la légèreté, et comme il montrait de la répugnance à étudier le rudiment et les règles de la grammaire, ils crurent qu’il manquait d’entendement. Plus tard, on essaya en vain de lui apprendre la versification latine et française, son genre d’esprit ne pouvait s’assujettir à aucune contrainte. On en concluait qu’il n’était susceptible que de peu d’application. M. Durif, préfet des études, homme de beaucoup d’esprit, qui l’avait pris en affection et qui l’observait avec attention, avait remarqué que son élève choisissait de préférence à la bibliothèque, pour sa lecture, les livres les plus sérieux, et que tandis que ses camarades lisaient des romans, il s’occupait à méditer les pensées de Pascal. Il voulut savoir un jour ce qu’il en comprenait ; il s’approche de lui et lui adresse plusieurs questions ; il fut très étonné de l’étendue et de la variété de ses idées. Loin d’éviter de répondre, il engagea la conversation sur les matières les plus abstraites.
M. Fouché, destiné à suivre la carrière de son père, qui était capitaine de vaisseau, étudiait les mathématiques et y faisait des progrès. Il était sur le point de quitter le collège, lorsque M. Durif représenta à ses parents que la mer ne convenait point à son tempérament ; il leur conseilla de le faire entrer dans l’Oratoire pour y professer un cours. Le père y consentit et fit conduire son fils à l’institution à Paris.
On mit entre les mains du jeune oratorien les commentaires de Jansénius et le catéchisme du Concile de Trente. Il ne put surmonter le dégoût que lui inspirait une pareille étude ; il alla trouver le supérieur de la maison, M. Mérault de Bissy, auquel il avait été recommandé d’une manière spéciale, il ne lui dissimula rien. M. Mérault, qui avait autant de bonté que de lumières, le conduisit dans sa bibliothèque et lui permit de choisir les ouvrages qui lui conviendraient le mieux. Il s’arrêta sur le petit carême de Massillon et sur les œuvres de Nicole ; et comme il ne voulait rien avoir désormais de caché pour un homme qui allait être à la fois son ami et son confesseur, il lui avoua qu’il avait dans sa chambre Tacite, Horace, et Euclide. Quoique l’usage des livres profanes fût interdit dans cette maison, il obtint facilement la permission de les garder.
M. Fouché, après avoir professé avec distinction, la morale, la logique, la métaphysique, la physique et les mathématiques à l’académie royale de Juilly, à Arras, à l’école militaire de Vendôme, quitta l’Oratoire pour se marier et pour s’établir à Nantes dans le dessein d’y exercer la profession d’avocat. Tous ceux qui l’ont connu dans l’Oratoire, lui ont conservé une grande estime et un tendre attachement.
M. Malouet qui, comme lui, avait professé dans l’Oratoire, lui portait une extrême affection. On l’a vu, depuis que M. Fouché est parvenu à la tête des affaires, braver toutes les menaces de l’autorité pour aller lui rendre visite dans ses proscriptions sous Bonaparte. M. Malouet a payé lui-même d’un exil à Tours sa généreuse amitié. Ce qui honore davantage cet illustre ami, c’est qu’il n’avait point de fortune et qu’il sacrifiait les émoluments de sa place au besoin de son cœur. Si M. Fouché a éprouvé de grandes ingratitudes, il a reçu de grandes consolations. La reconnaissance de M. Malouet, de M. Cazales et de quelques autres hommes célèbres, suffit pour lui faire oublier le grand nombre d’ingrats obscurs qu’il a faits dans ses divers ministères.
Nourri de bonne heure d’idées justes, d’études solides, la révolution qui commençait ne le surprit pas dans le dénuement et dans le vague ; appelé à la convention nationale, il ne rechercha point l’éclat, il s’ensevelit dans le comité d’instruction publique, où il se lia avec Condorcet.
Nous garderons le silence sur son opinion dans le procès de Louis XVI, puisque Louis XVIII a cru devoir la couvrir d’un voile en le nommant son ministre de la police.
À l’époque où M. Fouché professait la philosophie à Arras, il avait connu Maximilien Robespierre, et lui avait prêté des fonds pour se rendre et s’établir à Paris, lorsqu’il fut nommé à l’assemblée constituante. Robespierre le vit d’abord souvent, mais bientôt la diversité de leurs opinions les divisa. À l’issue d’un dîner qui avait eu lieu chez M. Fouché, Robespierre déclamait avec violence contre les Girondins, et apostrophait Vergniaud qui était présent ; M. Fouché, qui aimait Vergniaud, s’approcha de lui et s’adressant à Robespierre : « Avec une pareille violence, lui dit-il, vous gagnerez sûrement les passions, mais vous n’aurez jamais ni estime ni confiance. » Celui-ci piqué se retira.
M. Fouché, forcé d’aller en mission dans les départements, fut bien obligé de se rapprocher du langage du temps, et de payer son tribut à la fatalité des circonstances ; mais, dans une proclamation même de la loi contre les suspects, qui ordonnait l’emprisonnement en masse des prêtres et des nobles, on lit un alinéa qu’il était courageux d’écrire et d’imprimer le 25 août 1793.
« La loi veut que les hommes suspects soient éloignés du commerce social ; cette loi est commandée par l’intérêt de l’état, mais prendre pour base de son opinion des dénonciations vagues, provoquées par des passions viles, ce serait favoriser un arbitraire qui répugne autant à mon cœur qu’à l’équité. Il ne faut pas que le glaive se promène au hasard. La loi commande de sévères punitions, et non des proscriptions aussi immorales que barbares. »
Envoyé à Lyon, il a attaqué le despotisme du brigandage et enchaîné l’anarchie ; il rétablissait le calme et la sécurité dans les âmes, lorsque Robespierre l’accusa aux Jacobins d’opprimer les patriotes et de transiger avec l’aristocratie. Rappelé à Paris, son âme ose se lever devant la tyrannie de Robespierre, il le somme, du haut de la tribune de la convention nationale, de motiver son accusation.
La chute de Robespierre mit fin à ces débats. On crut que les passions allaient être enfermées dans sa tombe, mais il semble que notre destinée soit de tourner dans un cercle de calamités et d’erreurs. Ceux qui s’étaient les plus avilis devant Robespierre ne trouvaient plus, après sa mort, d’expressions assez violentes pour peindre leur haine.
L’exagération fut portée au point qu’on lui prêtait des desseins de dictature. « Vous lui faites bien de l’honneur, repartit vivement M. Fouché, de lui prêter des plans et des vues ; loin de disposer de l’avenir, il n’y pensait même pas ; il était entraîné, il obéissait à une impulsion qu’il ne pouvait ni suspendre, ni diriger. » Cette réplique parut une intention de bienveillance. M. Fouché fut considéré, dès ce moment, par ses ennemis comme un Robespierriste, et bientôt accusé d’entrer dans un complot pour rétablir la terreur.
Il fut éloigné de la convention nationale ; ce n’est qu’après la dissolution de cette assemblée, que M. Fouché reparaît sur la Scène et est envoyé par le directoire exécutif successivement en ambassade à Milan et à la Haye. Il défend avec fermeté l’indépendance de ces deux États contre la faiblesse de son gouvernement, qui après avoir promis de la respecter, la sacrifiait à des insinuations étrangères.
Les yeux du directoire s’ouvrirent, mais il n’était plus temps, les armées ennemies s’avançaient en Italie ; les mécontents prenaient de l’audace dans l’intérieur, le désordre s’accroissait. M. Fouché fut appelé au ministère de la police générale, où il s’est acquis une grande illustration par le bien qu’il y a fait, par les maux qu’il a empêchés, et par la résistance qu’il a opposée aux passions, dans toutes les crises.
Son premier acte en entrant au ministère sous le directoire exécutif, fut un rapport remarquable contre les anarchistes : » N’espérez point, dit-il, qu’ils se corrigent ; ce qu’ils entreprennent pour l’indépendance de leurs passions est pour eux vertu et liberté ; les moyens par lesquels ils menacent et épouvantent les états, leur semblent des moyens propres à en préparer la force et les prospérités. Il ajoute en parlant des monstres qui ont assassiné dans les prisons : « Leurs remords ne peuvent effacer le souvenir des homicides qu’ils ont commis. » La nation voit toujours leurs assassinats qui l’effrayent, et ne peut lire dans leurs âmes le remords qui pourrait la rassurer ».
Ceux qui voient le duc d’Otrante au milieu de sa famille, sont tentés de croire que ses idées et ses sentiments ne s’étendent pas au-delà du cercle des affections domestiques. Ses mœurs sont simples et réglées. Il était inutile qu’il fût riche pour lui ; il dédaigne l’artifice et les subtilités, il souffre qu’on lui parle avec liberté. Il traite légèrement les choses frivoles, donne une attention forte à tout ce qui est sérieux. Toutes les idées relatives à l’état d’homme, à son bonheur, à ses devoirs, lui sont familières. Tout ce qui contribue à former les sociétés civiles, à les perfectionner, à les défendre, à les corrompre et à les détruire, est l’objet continuel de ses méditations. Il a protégé, dans son long et difficile ministère, toutes les existences sans exception, il y avait sécurité complète pour tout individu qui ne recherchait que la tranquillité. Il s’est toujours opposé aux lois de circonstances. « Elles ne font, disait-il souvent, que constater le mal sans y remédier, parce que leur exécution nécessairement arbitraire est toujours confiée aux passions ».
Comme le Duc a servi divers gouvernements, ses ennemis ont cherché à persuader que son caractère se pliait à tout ; mais s’il eût été le complaisant de tous les gouvernements, il nous semble qu’il n’aurait point passé une partie de sa vie dans l’exil et dans la proscription.
La correspondance du duc d’Otrante, ses instructions aux préfets portent le cachet de la prévoyance et de l’art profond de manier le cœur humain. Son style est souvent incorrect ; mais tout ce qu’il écrit est conçu à une grande hauteur.
On a dit que le duc d’Otrante, dans son ministère sous la République, tendait par ses instructions aux préfets à substituer la morale à la religion, et la police à la justice. Nous nous sommes procuré les deux circulaires qui ont servi de base à cette étrange accusation. Leur date est du mois de brumaire où Bonaparte fut nommé chef du gouvernement de la République. Quand on réfléchit sur cette époque, on est frappé du courage de celui qui les a écrites ; il fallait une grande supériorité de langage pour faire passer alors les sentiments et la doctrine qui y sont exprimés.
Circulaire aux Évêques.
Paris, le 25 Brumaire.
(16 Nov 1799)
Au premier du Consulat.
AUCUN peuple civilisé n’a été sans culte ou sans plusieurs cultes. Mais aucun peuple connu n’a été assez éclairé pour donner à la religion la place qu’elle doit avoir.
Les uns ont fait des lois religieuses, comme des lois civiles et criminelles, une partie du code social, et leur pontificat était une magistrature. Le gouvernement en était d’abord plus fort ; mais quand les opinions religieuses perdaient leur force, il perdait la sienne.
Chez d’autres peuples, le gouvernement et la religion ont été deux puissances à côté l’une de l’autre qui se touchaient sans cesse, pour s’appuyer, pour se combattre ; là, les ministres du culte ont été tour à tour oppresseurs, opprimés. C’est l’histoire de l’Europe moderne.
D’autres temps sont arrivés ; la raison les a préparés ; la religion doit les bénir. Vous ne serez plus exposés ni à exercer la persécution ni à la souffrir. Tous les cultes seront libres ; et s’il en est qui reçoive une protection particulière, ce sera celui qui servira le mieux la république. Le gouvernement ne veut pas accorder de privilège, mais il veut reconnaître les services.
Après tant de querelles dont nous avons tous payé les torts ou les erreurs de notre sang, ne jetez plus des regards trop douloureux sur votre puissance et votre fortune passée ; un gouvernement qui vient de se former au milieu du peuple et des malheurs, connaît trop la nature pour vous faire un crime de vos regrets : peut-être même pense-t-il qu’il eût été plus juste comme plus généreux et plus prudent de vous épargner tant de sacrifices et de graduer ceux que vous deviez faire. Mais dans vos malheurs personnels, si vous avez la foi que vous prêchez, vous avez une grande consolation : ils ont ramené votre culte à ce qui a toujours relevé les puissances qui déclinent, aux principes de son institution.
Voyez déjà comme vos infortunes ont fléchi les haines de ceux même qui vous accusent de leurs maux : un assentiment universel a applaudi au décret qui n’exige plus de vous aucun serment, qui ne vous demande que votre promesse de lui être fidèles. Rien ne vous gêne plus dans vos scrupules même les plus timides.
Celui qui apparut aux hommes pour leur apporter les maximes de cette morale céleste que vous leur prêchez, n’en demandait pas autant aux puissances de la terre ; ils n’avaient pas plus de moyens de faire de leur foi la foi de l’univers, eux qui, trois siècles après la naissance du christianisme, le placèrent sur le trône de l’empire romain avec Constantin qui leur devait aussi ce trône. Mais songez-y : ces magnifiques perspectives, qui se rouvrent pour se prolonger au-delà des temps et des mondes visibles, se refermeront devant vous, si vous ne tenez pas tout ce que vous promettez au gouvernement.





























