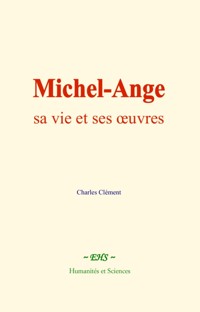
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: EHS
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Französisch
S’il est un homme qui représente la renaissance avec plus d’éclat qu’aucun autre de ses contemporains, c’est Michel-Ange. Le caractère est chez lui à l’égal du génie. Sa vie, presque séculaire et prodigieusement active, est sans tache. Quant à l’artiste, on n’ose croire qu’il puisse être surpassé. Il réunit dans sa prodigieuse personnalité les deux facultés maîtresses qui sont en quelque sorte les pôles de la nature humaine, et dont la réunion chez les mêmes individus fit la grandeur souveraine de l’école toscane : l’invention et la raison, une vaste et fougueuse imagination dirigée par une méthode précise, ferme et sûre. De pareils géants, dont l’antiquité eût fait des dieux, sont ainsi jetés de loin en loin dans l’histoire comme des exemples vivants qui montrent à quelle grandeur notre race peut atteindre et jusqu’où l’ambition de l’homme peut prétendre. Pour la critique préoccupée d’expliquer les œuvres de l’artiste par la vie de l’homme, il y a là un sujet d’études qui garderait aujourd’hui encore son à-propos, si même de récentes publications en Angleterre et en Italie n’étaient venues rappeler sur le peintre de la Sixtine et le sculpteur du Moïse l’attention des amis de l’art.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Charles Clément (1889-1972), né à Rolle et mort à Lausanne, est un peintre, illustrateur, caricaturiste et graveur vaudois. Formé à Düsseldorf et Paris, il publie "dessins humoristiques" et cofonde L'Arbalète à Lausanne. Peintre verrier dès 1928, il réalise vitraux et peintures murales, notamment à la cathédrale de Lausanne. Il crée aussi des scènes de rue, nus et paysages vaudois. Ses œuvres figurent dans de nombreux musées.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 128
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Couverture
Michel-Ange : sa vie et ses œuvres
Page de titre
Michel-Ange : sa vie et ses œuvres
Charles Clément
EHS
Michel-Ange
Que ton visage est triste et ton front amaigri,Sublime Michel-Ange, ô vieux tailleur de pierre !Nulle larme jamais n’a baigné ta paupière :Comme Dante, on dirait que tu n’as jamais ri. Hélas ! D’un lait trop fort la muse t’a nourri,L’art fut ton seul amour et prit ta vie entière ;Soixante ans tu courus une triple carrièreSans reposer ton cœur sur un cœur attendri.
Pauvre Buonarotti ! Ton seul bonheur au mondeFut d’imprimer au marbre une grandeur profonde,Et puissant comme Dieu, d’effrayer comme lui : Aussi, quand tu parvins à ta saison dernière,Vieux lion fatigué, sous ta blanche crinièreTu mourus longuement plein de gloire et d’ennui.
Auguste Barbier
La grande ère de l’art moderne, l’époque merveilleuse de la renaissance, que nous pouvons embrasser aujourd’hui dans son ensemble, ne fut pas l’œuvre d’un jour : elle se distingue cependant des civilisations antiques en ce que son développement fut rapide, local, sans arrêt, et qu’elle succéda presque sans transition à la sinistre obscurité du moyen âge. Après dix siècles d’efforts inouïs et à peu près stériles, dans un ciel sillonné d’éclairs qui ne montrent guère que des ruines, elle éclate presque sans aurore, brillante comme un jour d’été. Telle est même l’abondance et la spontanéité de la vie nouvelle, qu’on a pu dire que, de morte qu’elle était, l’humanité venait de renaître, et saluer ce temps du nom glorieux qu’il a gardé. Un autre caractère plus important de cette époque, et qui la sépare également de l’antiquité, c’est que les œuvres sont plus que jamais individuelles et marquées du sceau de l’auteur. Je suis loin sans doute de contester l’existence personnelle d’Homère, de Zoroastre, ou du sculpteur anonyme des marbres d’Égine. J’ignore si le chantre de la guerre de Troie était aveugle; je ne sais ni dans quelle langue, ni dans quel lieu furent prononcées les sentences du plus ancien des sages ; le nom de l’architecte du temple de Jupiter panhellénien sera vraisemblablement toujours un mystère : ces obscurités ne me font point douter que ces œuvres n’appartiennent à des personnes distinctes, à des hommes qui ont vécu. Et pourtant je ne puis m’en dissimuler le caractère collectif et général. Les écoles dans l’antiquité représentaient les directions diverses de l’esprit, et dans leur succession les modifications naturelles de l’opinion. Un enseignement sévère, une tradition suivie, tout en gênant l’essor de la pensée individuelle, amenait l’art, par des progrès incessants, jusqu’à ses dernières limites. Les Phidias, les Scopas, les Praxitèle, étaient bien moins les chefs des écoles qui portent leurs noms que les représentants les plus illustres des idées qui les caractérisent. De là découle la forme abstraite de l’art grec et sa perfection.
Sous le souffle puissant de la liberté reconquise, l’homme retrouva tous les attributs de la vie personnelle. Les superstitions, les chimères, les terreurs du moyen âge s’évanouirent comme les souvenirs des rêveries stériles d’un sommeil agité. Une lumière éclatante rayonna sur des hommes jeunes, libres et fiers. Chacun s’avança où son goût le portait; les aptitudes les plus diverses se firent jour. Le caractère de l’artiste s’accusa nettement dans son œuvre, qui, devenue plus vivante, acquit en même temps une individualité plus précise, et refléta nettement ses idées propres, ses penchants, ses passions. Ghirlandajo, Léonard de Vinci, Michel-Ange, ont vécu dans la même ville et dans le même temps; mais qui pourrait confondre les plus insignifiants de leurs ouvrages? Tout est grand dans cette époque mémorable, les cœurs sont à la hauteur du génie, et dans les circonstances les plus difficiles, au milieu des bouleversements politiques, on vit rarement ces honnêtes grands hommes céder aux sollicitations de l’intérêt personnel, négliger la dignité de la vie, oublier que le talent n’exempte pas des plus humbles vertus. Tout certes ne fut point parfait dans ce temps, loin de là : si la renaissance eut des héros et des saints, elle eut aussi des Borgia; les plus hautes facultés se rencontrèrent parfois unies à l’infamie et à la lâcheté. Ces alliances monstrueuses qui étonnent et déconcertent la raison, qui scandalisent la conscience, se verront toujours partout où il se trouvera des hommes; mais elles sont alors comparativement rares, et les exemples contraires sont nombreux et éclatants.
S’il est un homme qui représente la renaissance avec plus d’éclat qu’aucun autre de ses contemporains, c’est Michel-Ange. Le caractère est chez lui à l’égal du génie. Sa vie, presque séculaire et prodigieusement active, est sans tache. Quant à l’artiste, on n’ose croire qu’il puisse être surpassé. Il réunit dans sa prodigieuse personnalité les deux facultés maîtresses qui sont en quelque sorte les pôles de la nature humaine, et dont la réunion chez les mêmes individus fit la grandeur souveraine de l’école toscane : l’invention et la raison, une vaste et fougueuse imagination dirigée par une méthode précise, ferme et sûre. De pareils géants, dont l’antiquité eût fait des dieux, sont ainsi jetés de loin en loin dans l’histoire comme des exemples vivants qui montrent à quelle grandeur notre race peut atteindre et jusqu’où l’ambition de l’homme peut prétendre. Pour la critique préoccupée d’expliquer les œuvres de l’artiste par la vie de l’homme, il y a là un sujet d’études qui garderait aujourd’hui encore son à-propos, si même de récentes publications en Angleterre et en Italie n’étaient venues rappeler sur le peintre de la Sixtine et le sculpteur du Moïse l’attention des amis de l’art.
I.
Michel-Ange naquit le 6 mars 1475, près d’Arezzo, dans le Valentino. Son père, Leonardo Buonarotti Simoni, était alors podestat de Castello di Chiusi e Caprese. Condivi affirme et Vasari paraît croire que les Buonarotti descendaient des comtes de Canossa, famille très ancienne et de sang presque royal. Gori, dans son commentaire sur Condivi, reproduit même un arbre généalogique des Buonarotti, dont il dit avoir vu les pièces authentiques, et qui remonte jusqu’à l’année 1260 ; mais cette antique origine, généralement acceptée au temps de Michel-Ange, paraît plus que douteuse aujourd’hui. Ce qui est certain, c’est que les Buonarotti étaient établis à Florence depuis longtemps, qu’ils avaient à plusieurs époques servi le gouvernement de la république dans des charges assez importantes, et le nom de Michel-Ange ne réclame ni une autre ni une plus haute origine.
L’année de la charge de Leonardo Buonarotti étant expirée, il revint à Florence, et mit l’enfant en nourrice à Settignano, où il avait une petite propriété, chez la femme d’un tailleur de pierres. Bien des années plus tard, Michel-Ange rappelait cette circonstance à Vasari, et lui disait : « Mon cher George, si j’ai quelque chose de bon dans l’esprit, je le dois à la légèreté de l’air de votre pays d’Arezzo, de même que je dois au lait que j’ai sucé les maillets et les ciseaux dont je me sers pour sculpter mes figures. »
Leonardo Buonarotti n’était pas riche. Le revenu de sa propriété de Settignano, qu’il faisait valoir lui-même, suffisait à grand’peine à entretenir une famille nombreuse. Il plaça plusieurs de ses enfants dans le commerce des soieries et des laines; mais, discernant bientôt chez le jeune Michel-Ange des dispositions remarquables, il lui fit commencer des études littéraires, et l’envoya chez Francesco Urbino, qui tenait une école de grammaire à Florence. Michel-Ange ne fit dans cette école aucun progrès. Il ne montrait de goût que pour le dessin, et employait à barbouiller les murs de la maison paternelle tout le temps qu’il pouvait dérober à ses études. Leonardo ne voulait pas entendre parler d’un art qu’il trouvait indigne de sa famille; ses fils se joignirent à lui pour contrarier les goûts de l’enfant, et Michel-Ange fut bien souvent, dit Condivi, « grondé et même terriblement battu. » Il se lia à cette époque avec un enfant de son âge, Francesco Granacci, élève du Ghirlandajo, et qui lui procurait des dessins de ce maître. L’obstination de Michel-Ange finit par vaincre les répugnances de son père, qui conclut avec l’auteur des fresques de Sainte-Marie-Nouvelle un contrat par lequel l’enfant devait être reçu pendant trois ans dans son atelier moyennant une rétribution de 24 florins d’or, que le maître, contre tous les usages, devait payer à l’élève. Ce contrat est daté du 1er avril 1489. Michel-Ange n’avait par conséquent que quatorze ans.
C’est dans cette charmante église de Santa-Maria-Novella, qu’il nommait plus tard « sa fiancée, » que Michel-Ange put se livrer pour la première fois sans réserve, sous la direction d’un des artistes les plus célèbres de l’époque, à son goût pour la peinture. Ses progrès furent si rapides, que, peu de temps après son entrée dans l’atelier, Ghirlandajo disait de lui : « Ce jeune homme en sait plus que moi. » Et, s’il faut en croire Condivi, ce n’était pas sans jalousie qu’il le voyait corriger d’une main sûre ses propres dessins et ceux de ses meilleurs élèves.
Faut-il attribuer cependant à un enfant de quinze ans, ainsi que le font M. Harford et l’auteur d’un excellent article du Quarterly Review, l’admirable peinture a tempera qui faisait naguère le plus bel ornement de l’exposition de Manchester? La précocité bien établie du génie de Michel-Ange suffit-elle pour expliquer tant de science et de maturité? J’avoue que je ne puis l’accorder. Cette peinture n’est certainement pas de Domenico Ghirlandajo, comme on l’a cru jusqu’ici. Je ne mets pas en question l’authenticité, qui est évidente. Sans parler de la largeur de la composition et du dessin, du caractère de la tête de la Vierge, de l’incomparable beauté des anges qui se trouvent à droite, de certaines habitudes que Michel-Ange ne perdit jamais, comme de faire les pieds trop petits par un raffinement d’élégance et de donner à ses enfants ces nez retroussés et un peu faunesques qu’on retrouve dans la Sixtine, il suffirait pour l’attester de remarquer l’évidente parenté qui existe entre cet ouvrage et la Vierge de la chapelle des Médicis. Ce qui me paraît probable, c’est que ce tableau ne fut exécuté que lorsque Michel-Ange fut sorti de l’atelier, qu’il eut fortifié son goût et son talent par l’étude des fresques de Masaccio et des antiques des jardins de Saint-Marc, entre 1492 et 1495, pendant ces années de première jeunesse qui durent être fécondes, et sur lesquelles les biographes nous ont laissé si peu de renseignements.
Michel-Ange n’acheva pas son apprentissage chez Ghirlandajo. Depuis la mort de Ghiberti et de Donatello, la sculpture n’avait plus aucun représentant distingué à Florence. Laurent de Médicis désirait la relever; il avait réuni dans ses jardins de la place Saint-Marc un grand nombre de statues et de fragments antiques, et il y avait formé une école de dessin sous la direction de Bertoldo, disciple de Donatello. Il avait demandé des élèves aux peintres les plus célèbres de Florence. Ghirlandajo lui envoya Michel-Ange et Granacci. C’est là que Michel-Ange sculpta cette tête de faune dont l’histoire est connue, et qui lui valut la protection de Laurent. Florence brillait alors d’un éclat suprême. Aux Dante, aux Giotto, aux Orgagna, avaient succédé les Pétrarque, les Brunelleschi, les Donatello, les Ghiberti, les Masaccio. Cette seconde génération venait à peine de s’éteindre, laissant Florence pleine de chefs-d’œuvre. Laurent de Médicis possédait toutes les qualités d’un protecteur éclairé des arts et celles aussi qui pouvaient rendre sa domination légère à ses concitoyens. Riche, généreux, d’un esprit sagace et conciliant, amateur passionné de toutes les œuvres de l’esprit, connaissant l’antiquité et protégeant la littérature nouvelle, entouré d’artistes, de poètes, de philosophes, d’érudits, savant, philosophe et poète lui-même, il régnait sur un peuple épris de toute beauté plus par la séduction que par la tyrannie. Les Florentins l’aimaient, et à la veille de perdre leur liberté, l’ayant déjà perdue, ils ne sentaient pas les chaînes dont ils se laissaient lier. Laurent avait pressenti le génie de l’élève de Ghirlandajo; il voulut l’avoir dans sa maison, il l’admit à sa table, et le donna pour compagnon à ses fils, lui allouant cinq ducats par mois, que Michel-Ange employait à secourir son père.
Michel-Ange ne quitta plus Laurent jusqu’à sa mort. Ce fut pendant ces trois années de tranquillité passées dans l’intimité des hommes les plus lettrés de ce siècle, entre Politien, Pic de La Mirandole et le platonicien Marsilio Ficino, que son esprit se développa, se mûrit, acquit tant d’ampleur et de sûreté. Politien en particulier l’avait pris en grande amitié. C’est par son conseil qu’il sculpta le bas-relief des Centaures et la gracieuse Vierge, dans laquelle il chercha, selon Vasari, à imiter le style de Donatello. Il passa plusieurs mois à copier les fresques de Masaccio dans l’église del Carmine. Il étudiait vers le même temps l’anatomie dans l’hôpital de Santo-Spirito, et faisait un Christ de bois pour le prieur, qui lui en avait facilité l’entrée. Il continuait ses études d’après l’antique dans les jardins de Saint-Marc, dont Laurent lui avait donné une clé. Ses progrès étaient tels qu’ils excitèrent bien souvent la jalousie de ses camarades et lui valurent en particulier ce coup de poing de Torrignano, qui lui fracassa le nez, et contribua à donner à son visage, déjà très accentué, l’expression rude et presque sauvage qu’on lui connaît.
Laurent mourut en 1492. Michel-Ange perdait en lui plus qu’un protecteur. Condivi dit que « il éprouva un si grand chagrin de cette mort qu’il resta plusieurs jours sans pouvoir rien faire. » Sa longue carrière montrera plus d’une fois quel souvenir attendri et pieux il garda pour ce nom de Médicis, et dans quelles alternatives difficiles le mirent sa reconnaissance et ses convictions républicaines. Dans de pareilles circonstances, il est sans doute utile et commode de s’attacher sans réserve ou de suivre ses propres opinions sans tenir aucun compte des sentiments du cœur. La juste mesure entre l’ingratitude et la servilité n’est pas facile à garder. A cet égard, dans les circonstances les plus périlleuses, Michel-Ange ne faillit jamais : il ne fut ni ingrat ni servile, et ce grand trait de son caractère mérite d’être aussi soigneusement remarqué que son génie.
Étant retourné chez son père, il fit un Hercule de marbre de quatre brasses de hauteur, qui fut plus tard acheté, avec d’autres ouvrages d’art, par Giovan Battista della Palla pour le compte de François Ier, et envoyé en France. On ignore ce qu’il est devenu. Pierre de Médicis, l’indigne fils de Laurent, engagea Michel-Ange à reprendre son appartement dans son palais; il le consultait souvent pour l’achat de pierres gravées, de parures et d’objets d’antiquité. Pierre comprenait sans doute à sa manière le mérite de son hôte, car il l’occupait à faire des statues de neige, et il se vantait d’avoir chez lui deux hommes rares, Michel-Ange et un valet espagnol qui, à une merveilleuse beauté de corps, joignait une telle agilité qu’un cheval lancé à fond de train ne pouvait le devancer.





























